
Pour une géographie de combat. Entretien avec Renaud Duterme
Auteur du Petit manuel pour une géographie de combat (La Découverte, 2020), Renaud Duterme revient sur la place de la géographie pour comprendre le capitalisme contemporain. Loin d’une géographie académique, Duterme met en lumière les logiques capitalistes sous-tendant les dynamiques spatiales.
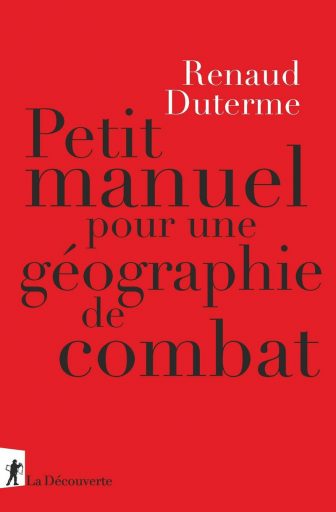
En 1923, La revue marxiste publiait un texte de l’économiste soviétique Isaak Dachkowski qui pose la question des effets de l’élargissement du marché capitaliste sur la production de l’espace. Aujourd’hui les travaux d’un géographe comme David Harvey sont assez populaires, lus et étudiés bien au-delà des cercles marxistes. Dans votre Petit manuel pour une géographie de combat (La Découverte, 2020), vous écrivez qu’il est essentiel de se « réapproprier cette discipline qu’est la géographie » : pourquoi avoir opté pour la forme d’un « petit manuel » ? Quel est, selon vous, l’état des lieux de la géographie « de combat » aujourd’hui dans le champ francophone ?
L’idée d’un manuel est de le destiner avant tout au public le plus large possible, au-delà des sphères académiques. Comme pour le concept d’histoire populaire d’Howard Zinn, le but est de montrer qu’il existe une autre géographie que celle très en vogue et très « technicienne » des programmes scolaires et celle très « spectacle » des grands médias. Ici, au contraire, une géographie de combat met en avant les rapports d’exploitation et de domination au cœur de son analyse, dans le but évident de fournir des armes pour les luttes en cours et à venir.
Cette forme de géographie est encore relativement marginale dans le monde francophone. Celui-ci était pourtant bien parti à la fin du XIXe siècle avec les travaux des anarchistes Elisée Reclus et Pierre Kropotkine, mais, par la suite, excepté sans doute les travaux d’Henri Lefebvre, la géographie radicale est relativement absente en tant que telle. Ce qui est regrettable, car la dimension spatiale est pourtant fondamentale pour comprendre la dynamique capitaliste. Elle est d’ailleurs en filigrane dans de nombreuses analyses d’auteurs marxistes tels que Rosa Luxembourg, Ernest Mandel ou plus récemment Éric Toussaint.
Il faudra attendre la fin du siècle dernier et la traduction française d’auteurs anglophones, tels que David Harvey ou Mike Davis, pour qu’elle ré-émerge en tant que telle et qu’elle influence de nombreux géographes francophones. Depuis lors, il semble bien qu’on assiste à un renouveau de cette géographie radicale avec l’engouement chez de jeunes géographes pour des analyses beaucoup plus engagées. D’où l’écriture de ce livre, qui se veut avant tout synthétique et une porte d’entrée vers des travaux plus conséquents au sein de ce courant de pensée.
Dans votre partie sur les origines spatiales du capitalisme, vous écrivez que « [l]a grande majorité des chercheurs s’accordent sur le fait que ces conditions [permettant l’émergence du capitalisme] furent surtout réunies en Angleterre au cours du XVIIIe siècle. » Il est vrai que de nombreuses écoles historiques placent les débuts du capitalisme dans l’Angleterre du XVIIIe. Cependant, d’autres chercheurs.euses ont discuté et remis en cause cette assertion. Ne pensez-vous pas qu’en faisant de l’Angleterre le centre des débuts du capitalisme, on risque de tomber dans une appréhension eurocentriste des développements du capitalisme ?
C’est une question qui me préoccupe depuis un certain nombre d’années et il est clair qu’étant donné l’objectif du livre, je n’ai pas voulu m’engager en profondeur dans des débats qui auraient nécessité un développement considérable.
En fait, la réponse à cette question dépend de la définition qu’on donne du capitalisme. Bien entendu, la majorité s’accorde pour le considérer comme un système basé sur la propriété privée des moyens de production et visant l’accumulation sans limites. Mais je rajouterais que ce qui singularise véritablement le capitalisme est l’autonomie et surtout la domination de la sphère économique sur le reste de la société. Ce qui s’inscrit évidemment dans les travaux de Karl Polanyi qui parle de « désencastrement de l’économie », ce qui désigne en définitive une marchandisation de tout ce qui peut l’être.
Or, en admettant ce trait majeur du capitalisme, il me semble que les faits confirment que c’est bel et bien l’Angleterre qui fut la première à expérimenter cette dynamique.
Pour ma part, je ne vois pas d’eurocentrisme dans cette hypothèse, qui plus est souvent confirmée par de nombreux auteurs non-occidentaux. Il n’y aurait en outre rien de glorieux pour l’Angleterre à revendiquer la paternité du système capitaliste, tant ce dernier n’a pu émerger qu’au sein d’un contexte d’exploitation globale.
Vous vous attardez assez longuement sur le « contrôle de l’espace comme source de profit » : pour faire écho à la question précédente, vous décrivez le capitalisme comme s’étant installé en Europe avant d’aller piller le reste du monde, notamment grâce au contrôle – par les puissances capitalistes – d’espaces stratégiques. Or, l’Europe était déjà en contact avec d’autres parties du monde auparavant et certains auteurs affirment que cela a aussi participé de la montée du capitalisme en Europe : que faire de cela ?
Des auteurs comme Nisancioglu et Anievas (cf. : How the West Came to Rule) ont, par exemple, appuyé l’importance de l’Empire Mongole du 13e siècle pour le développement technique en Europe, ou encore le rôle joué par la rivalité entre les Empires habsbourgeois et ottoman dans la montée de « nouvelles forces contre-hégémonique » (comme les Français et Néerlandais).
Peut-être ne suis-je pas clair, mais je ne pense pas écrire exactement cela. Je dis plutôt, en me basant évidemment sur de nombreux travaux (notamment le premier tome de la somme qu’Alain Bihr a proposé récemment), que ce sont bien des relations commerciales de longue distance qui ont amorcé la dynamique capitaliste, notamment en autonomisant une sphère marchande qui va peu à peu s’affranchir des contraintes de la société et par là pouvoir se constituer en véritablement puissance de plus en plus indépendante par rapport au pouvoir du Prince.
Par conséquent, il est bien entendu que les relations commerciales séculaires de part et d’autre de l’Eurasie ont fourni un élément déterminant pour expliquer le développement du capitalisme. Il est d’ailleurs vrai jusqu’à aujourd’hui qu’un facteur de pouvoir est bel et bien la maîtrise de l’espace, notamment via la circulation de biens et de capitaux.
De plus, les relations commerciales vont contribuer à cette montée en puissance des marchands de bien d’autres façons, notamment via la maîtrise d’outils financiers de plus en plus complexes (lettre de change, systèmes d’assurance, de crédit, etc.) qui vont encore une fois permettre le développement d’un embryon de ce qu’on aurait tendance à appeler de nos jours « la finance », à savoir une instance de plus en plus déconnectée de l’économie « réelle ».
Je pense donc que l’erreur serait de tenter de définir l’émergence du capitalisme par une date ou un évènement déterminés. Au contraire, ce système s’est développé petit à petit sur plusieurs siècles et par le biais de nombreuses dynamiques qui se poursuivent d’ailleurs jusqu’aujourd’hui. On peut citer, parmi d’autres, la montée en puissance des bourgeoisies marchandes européennes à partir du Moyen-Âge (effectivement encouragées par le morcellement du continent en différentes puissances rivales), l’exploitation du continent américain, le commerce triangulaire ou encore la privatisation des terres communales. Tous ces éléments ont bel et bien joué un rôle fondamental dans la montée en puissance des logiques capitalistes et l’erreur serait à mon sens de les prendre isolément.
En quel sens la géographie vous semble-t-elle jouer un rôle essentiel pour surmonter les crises du capitalisme aujourd’hui ?
Ce livre part d’une des contradictions fondamentales du capitalisme, à savoir la nécessité de trouver sans cesse de nouveaux débouchés pour pallier la surproduction (trouvant son origine dans la réduction des « coûts » salariaux). Or, à cet égard, l’expansion géographique, et donc la conquête de nouveaux marchés, fournit une réponse parfaite à cette surproduction, car elle permet à des marchandises d’être vendue indépendamment des politiques de diminution salariale pratiquée sur le marché d’origine de l’entreprise. De ce fait, on constate depuis les débuts du capitalisme une propension intrinsèque à l’expansion spatiale.
Cette expansion s’est d’abord effectuée via le processus colonial. On sait que les territoires conquis fournirent à la fois des ressources considérables, mais également des débouchés pour l’industrie naissante. Elle s’est poursuivie après les indépendances, notamment via l’endettement et les politiques promues par les institutions financières internationales, Banque mondiale et FMI en tête. Ces politiques ont en effet systématiquement eu comme objectif d’intégrer davantage des économies entières aux logiques de marché, pour le plus grand profit des classes possédantes locales et des entreprises et pays du Centre capitaliste.
Et de nos jours, les politiques de libre-échange, de privatisation et de libéralisation du commerce et des mouvements de capitaux ont encore pour principales conséquences l’ouverture de nouveaux marchés pour de grands groupes financiers et industriels. Évoquons juste le fonds d’investissement BlackRock qui serait un des grands gagnants de la politique des retraites chère à Emmanuel Macron.
Vous écrivez que la ville a été le lieu d’où « émergea véritablement le capitalisme » — et que celle-ci a donc aussi été façonnée par le capitalisme. Que pensez-vous de la validité du concept de « capitalisme agraire » ? En quoi, aujourd’hui, l’urbanisation joue-t-elle un rôle dans la lutte des classes ?
Encore une fois, tout dépend de ce qu’on met derrière la définition de capitalisme. Si vous pensez à la thèse de Meiksins Wood, je pense qu’elle ne contredit pas le fait que l’autonomie de la sphère économique que j’évoquais tout à l’heure s’est véritablement développée au sein du monde marchand. Mais évidemment, cela n’exclut pas le fait que des rapports sociaux capitalistes se mettaient en place simultanément dans les campagnes. De nouveau, la pénétration du capitalisme dans la société est avant tout un processus graduel plutôt qu’un évènement précis que l’on pourrait dater et délimiter précisément dans le temps et dans l’espace.
Quant à l’urbanisation, elle a joué (et joue encore aujourd’hui) un grand rôle dans la stabilisation du capitalisme à plusieurs égards. En premier lieu, à l’instar de la conquête géographique, elle va également lui fournir des débouchés considérables : construction et rénovation du bâti, d’infrastructures diverses (routes, ponts, tunnels, gares, habitations, etc.), production de ciment, de véhicules liés à cet aménagement du territoire, etc. C’est ainsi que la vague de périurbanisation qui a touché les pays occidentaux a fortement contribué à la croissance économique de l’époque, que ça soit aux États-Unis dans les années 1930 ou en Europe durant les Trente Glorieuses.
Ensuite, cette construction/rénovation urbaine permanente a besoin d’une quantité d’emplois considérable qui permet de fournir un salaire à des millions de travailleurs et de calmer d’éventuelles velléités populaires et donc de garantir une certaine paix sociale.
Enfin, la forme d’urbanisation très en vogue dans les pays les plus riches, à savoir une périurbanisation à l’américaine enjoint des millions de personnes à devenir propriétaire de leur logement (souvent un pavillon) et leur donne un niveau de vie relativement confortable qui décourage une remise en profondeur du système économique, car elle pourrait remettre en cause leur statut de propriétaire.
Vous écrivez que la planète est devenue « un terrain de compétition permanente » pour les grandes entreprises multinationales et les institutions bancaires. Qu’entendez-vous par là ? Selon vous, ce processus efface-t-il les frontières ou les réorganise-t-il ?
Suite aux progrès dans les transports et les télécommunications, les grands groupes financiers et industriels ont eu la capacité de mettre en concurrence les acteurs immobiles et interchangeables, à savoir essentiellement les travailleurs et les territoires. Il s’en est suivi un chantage à la délocalisation qui subordonne l’ensemble de ces acteurs au bon vouloir de ces groupes. Ces derniers ont de ce fait la possibilité de faire de la planète entière leur terrain de jeu et de soumettre leurs desiderata aux États et aux populations. Ces progrès technologiques furent sans doute décisifs pour comprendre le succès des politiques antisociales menées par les classes dirigeantes depuis la fin des années 1970.
Dans La frontière comme méthode, Sandro Mezzadra et Brett Neilson écrivent que « les processus de mondialisation des vingt dernières années n’ont pas abouti à une diminution des frontières, mais à leur prolifération. » Qu’en pensez-vous ?
Le capitalisme mondialisé a une relation ambiguë avec les frontières. D’un côté, il a besoin d’un affaiblissement de ces dernières pour accroître la mobilité des marchandises, des capitaux et dans une moindre mesure des personnes (du moins celles qui en ont les moyens ou qui lui sont nécessaires). Mais d’un autre côté, cette liberté du capital va provoquer une insécurité économique dans de nombreuses régions du monde, insécurité qui va fournir un énorme alibi pour les replis identitaires de tout bord. On remarque ainsi que, dans les très nombreux pays où ces replis bénéficient d’un certain succès, la peur du déclassement constitue un puissant facteur de ce succès. Or, ce déclassement trouve principalement son origine dans les politiques de délocalisation et de mise en concurrence de la main-d’œuvre intrinsèque à cette mondialisation capitaliste.
D’un point de vue méthodologique, qu’apporte la géographie pour saisir la crise écologique actuelle ?
Elle apporte un autre regard, fondamental et nécessaire pour y apporter des réponses cohérentes et radicales. Ce qu’il faut d’ores et déjà souligner, c’est que le recours massif aux énergies fossiles a émergé main dans la main avec le capitalisme, notamment parce qu’elles lui permettent de rompre ses chaînes spatiales, pour reprendre les mots du géographe Andreas Malm. Ce dernier a démontré de façon convaincante qu’au XIXe siècle, le choix de la vapeur par rapport à l’énergie hydraulique obéissait avant tout à la volonté de rapprocher les usines plus près des bassins de main-d’œuvre, celles-ci n’étant plus dépendantes des cours d’eau. Les patrons d’industrie pouvaient par conséquent jouer davantage sur les rivalités entre travailleurs, en particulier en cas de grève.
Le pétrole va jouer un rôle similaire, mais à un niveau mondial comme nous l’avons vu. Cette énergie va également encourager le just-in-time, c’est-à-dire des chaînes de production à flux tendu et la suppression des stocks, dont on voit les conséquences actuellement suite à l’arrêt de la plupart des économies industrielles.
En bref, les énergies fossiles vont permettre au capitalisme d’accroître les profits de manière faramineuse et, en retour, ce système va bien évidemment encourager des fortunes probablement parmi les plus élevées de l’histoire dans le secteur énergétique.
En outre, le capitalisme ne peut perdurer et trouver une légitimité qu’en externalisant les impacts écologiques inhérents à son processus de production. Dès ses origines, il les externalise soit dans le temps (pensons aux émissions de gaz à effet de serre), soit dans l’espace (déforestation importée, délocalisation des usines polluantes, exportation de déchets, surexploitation des écosystèmes étrangers pour l’agriculture ou l’activité minière et pétrolière, etc.). Il est ainsi clair que si l’ensemble des nuisances qu’il créées devaient être supportées dans les principaux lieux de consommation qui le font vivre, sa légitimité n’aurait jamais pu perdurer plusieurs siècles.
Or, la phase de mondialisation extrême dans laquelle se trouve dorénavant le capitalisme limite de plus en plus cette externalisation, puisqu’elle a tellement été poussée loin qu’il devient de plus en plus difficile de se débarrasser des nuisances sans que ces dernières n’affectent l’ensemble de la planète.
Cette situation dépasse l’analyse théorique, car il remet en question nombre de « solutions » mises en avant par les gouvernements et les entreprises telles que le développement massif d’énergies renouvelables ou la promotion de la voiture électrique. En effet, ces technologies ne peuvent se généraliser qu’en exploitant davantage des écosystèmes (notamment à travers l’industrie minière), ce qui tempère fortement leur caractère « propre ».
En bref, la géographie nous conduit à envisager des solutions globales tenant compte de la totalité des cycles de production, et une fois ce raisonnement admis, on ne peut qu’en tirer une conclusion : la seule porte de sortie consisterait à produire moins et à transporter moins. Or, l’on sait que cela implique nécessairement de rompre en profondeur avec la logique capitaliste.
Dans Géographie de la domination, le géographe David Harvey rappelle que pour Marx, « le capitalisme se caractérise par un perpétuel effort pour s’affranchir de tous les obstacles spatiaux » et que se fait alors jour une contradiction selon laquelle « l’organisation spatiale est nécessaire au dépassement de l’espace. » C’est aussi cela que vous soulignez dans votre livre. Quelles stratégies offre alors la pensée « de l’espace » ?
Étant donné que l’espace est nécessaire au capital, une bonne manière de combattre ce dernier pourrait être de se le réapproprier. Car, aujourd’hui, l’espace est de plus en plus organisé pour coller aux besoins du marché et attirer les acteurs les plus mobiles que j’ai déjà évoqués : entreprises, grandes fortunes, touristes, étudiants, etc.
Sur le terrain, cela se traduit par une vision managériale de l’aménagement du territoire avec une priorité accordée à des projets qui placeraient ce territoire en bonne position dans la grande hiérarchie mondiale : nouveaux aéroports ou gares TGV, développement de la smart city, centres commerciaux, développement d’infrastructures touristiques, organisation de grandes compétitions sportives, accueil d’évènements internationaux, etc.
Or, les retombées socio-économiques de ces projets sur les populations sont relativement faibles, voire franchement nuisibles. Par contre, elles sont clairement source de profit pour de nombreux acteurs économiques, en particulier les grandes entreprises de la construction, les grandes marques franchisées et évidemment le secteur de la banque et de l’assurance.
En quel sens la géographie peut-elle nous aider à saisir une crise comme celle du Covid19 par exemple ?
De plusieurs façons, dont une qui a trait à la nature même de la géographie : à savoir de mettre au centre de son analyse les liens entre les sociétés et leur environnement. Cette crise constitue ensuite un cas d’école pour comprendre de nombreux objets d’étude propres à la géographie, à commencer bien sûr par le phénomène de mondialisation. Enfin, la géographie nous permet également de comprendre les impacts désastreux des politiques qui nous ont conduits dans cette situation.
Plusieurs exemples illustrent cela :
– notre dépendance à la Chine bien évidemment, résultat des politiques de libre-échange et de la possibilité offertes aux grandes entreprises de sous-traiter de nombreuses activités dans des régions à bas salaire ou à faibles normes environnementales ;
– les coupes dans les services publics en raison de la soumission des États aux règles budgétaires européennes et à la volatilité des capitaux, planant comme une épée de Damoclès sur tout gouvernement se risquant à des politiques un tant soit peu progressistes ;
– l’externalisation d’une part significative de notre production alimentaire également, et ce afin de promouvoir une économie de services totalement hors-sol. On voit à quel point cette question peut se révéler cruciale en cas de perturbation de chaînes d’approvisionnement toujours plus longues.
Plus généralement, on voit ici les limites de politiques visant à intégrer toujours davantage les territoires aux grands flux de la mondialisation tels que les mouvements de capitaux, de touristes, de marchandises, etc. Cette crise illustre à la perfection l’incapacité d’un tel modèle à faire face à des chocs exogènes, ici une épidémie, mais on pourrait dire la même chose d’un conflit, d’une pénurie énergétique ou de désastres écologiques et climatiques qui ne vont qu’aller en s’aggravant.
Face à cela, il n’y a guère qu’un retour à une certaine autonomie territoriale qui peut apporter une véritable résilience de nos sociétés à ces chocs. Et, n’en déplaise à certains, cette autonomie ne pourra que passer par la sortie de nombreux aspects de nos vies quotidiennes de la logique de marché.
Et ici encore, la géographie a un rôle à jouer, car elle nous permet d’articuler des solutions de rupture à des niveaux locaux avec des revendications et des combats plus globaux (pensons notamment à quelques préalables que sont l’annulation des dettes illégitimes, le refinancement de véritables services publics ou encore le contrôle des mouvements de capitaux). C’est sans doute la force de cette discipline que d’articuler les différentes échelles. Rien que pour cette raison, les luttes et mobilisations à venir ont beaucoup à apprendre de la géographie.
Entretien réalisé par Selim Nadi.









