
Aux origines de l’ordre racial. Entretien avec Aurélia Michel
Dans cet entretien autour de son livre Un monde en nègre et blanc (Seuil, 2020), Aurélia Michel propose une réflexion historique sur les liens entre esclavage et construction sociale de la race. En rappelant comment le capitalisme s’en est nourri avec les filières de la traite, elle montre que le recours à une racialisation a été nécessaire aux blancs – catégorie sociopolitique et non biologique – pour reconduire des dispositifs de hiérarchisation et des modalités renouvelées de domination, après les abolitions de l’esclavage.
Elle évoque également les déclinaisons du racisme – racisme ordinaire, structurel, institutionnel… – et s’interroge sur l’existence d’un racisme d’État. Aurélia Michel pense ce sujet d’un point de vue historique et fondamentalement politique, avec ce constat qui ouvre surtout des perspectives : un monde sans race est possible mais, pour cela, il faut combattre le racisme non comme un préjugé archaïque mais comme un rapport social de domination historiquement construit, s’exprimant sur un plan aussi bien matériel qu’idéologique, dans les pratiques ordinaires comme dans des dispositifs d’État.
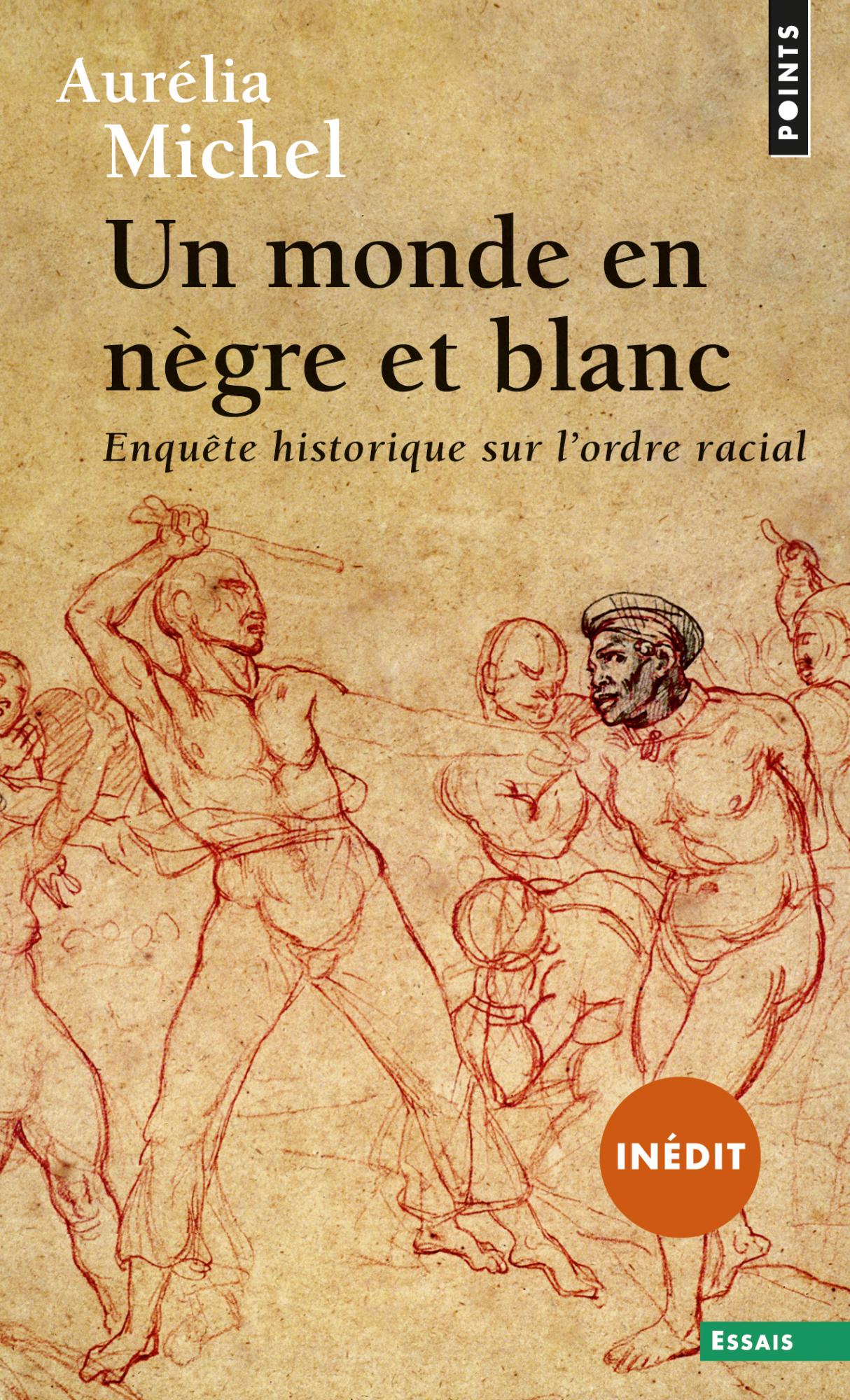
Contretemps : Le sous-titre de votre livre est « Enquête historique sur l’ordre racial ». Pourquoi avoir choisi de faire de la notion de « race » le sujet de cette œuvre ? Pourquoi ce parti pris depuis une perspective d’historienne ?
Aurélia Michel : C’est un sujet qui me touche, qui nous touche tous et toutes. L’un des objectifs de ce livre, c’est de mettre en évidence le fait que nous sommes tous et toutes traversé-es par cette histoire. Il se trouve que j’ai découvert, en préparant un cours à l’université sur les Amériques noires, que même en tant qu’historienne de l’Amérique latine, j’étais finalement très peu consciente de ce qu’étaient la traite atlantique et l’économie esclavagiste dans l’histoire de l’Europe moderne, et du lien très fort entre esclavage et colonisation.
Mon ignorance était d’autant plus suspecte que l’on n’est pas, avec ce sujet, face à une insuffisance de sources. Il y a au contraire une quantité innombrable de travaux historiques qui attestent, argumentent, précisent. Et pour moi il ne s’agissait pas de faire une nouvelle recherche, mais simplement de construire un récit qui soit audible, en tout cas qui rende audible, plus que jusqu’à présent, l’ensemble des faits, des réalités qui constituent cette histoire et surtout leur centralité dans nos sociétés.
Ensuite, le propre d’une approche historique de la race – la seule que je pourrais avoir de toute façon – c’est de situer d’emblée la race comme une construction, que l’on peut reconstituer historiquement : on peut faire une enquête sur son apparition, sa trajectoire, son développement et probablement, comme pour tout processus humain, sa fin.
C’est donc que la race n’est pas un concept, ni même une idée, une mauvaise idée dont il faudrait se débarrasser. C’est un fait historique avec une trajectoire. Mon approche est donc tout sauf essentialiste. La race n’est ni évidemment une réalité biologique, ni non plus une opinion, ou encore un travers universel de l’humanité. Je l’envisage comme un rapport social, un dispositif utilisé ou subi par les acteurs et actrices dans une dynamique historique, économique, qui relève d’une histoire des sociétés.
Contretemps : Est-ce qu’on pourrait parler chez vous d’une approche fonctionnaliste de la race ? Vous vous intéressez notamment à la fonction de la race dans l’organisation du travail, dans l’économie des sociétés des Amériques et cela dès le XVe siècle. Comment croisez-vous cet aspect avec la dimension proprement politique de la race ?
Aurélia Michel : J’ai choisi une approche très pragmatique : quand le terme de race, dans son sens de domination, apparaît-il ? La première chose que j’ai comprise, c’est que la race vient de l’esclavage. Quand on envisage la suppression de l’esclavage dans l’économie européenne et plus largement occidentale, la notion de race se diffuse et prend en partie sa fonction. Il faut donc d’abord réfléchir à l’esclavage pour comprendre ce qu’est la race. Je ne sais pas si c’est une approche fonctionnaliste, mais concrètement l’expansion européenne à partir du XVe siècle, qui est elle-même le développement d’un empire colonial, est fortement articulée au recours à l’esclavage, à la possibilité d’utiliser massivement le travail esclave et les filières de traite.
L’esclavage ouvre des possibilités au développement du capitalisme et vice versa, le développement du capitalisme suscite la consolidation des filières de traite, des marchés, ce qui explique les proportions incroyables qu’a atteintes la traite atlantique à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle.
C’est effectivement une lecture économique qui amène à un deuxième type de réflexion : pourquoi l’esclavage est si nécessaire ou si utile au capitalisme ? Et quel est le rapport entre les deux ?
J’ai utilisé pour y réfléchir la définition de l’esclavage dans l’œuvre de Claude Meillassoux.
Contretemps : Pourquoi mobiliser les travaux d’un anthropologue comme soubassement à votre démarche d’historienne ?
Aurélia Michel : L’objet « race » et l’objet « esclavage » pour l’historien-ne sont très compliqués : ils conduisent à des discussions sans fin pour savoir si tel type d’esclavage dans telle société ressemble à tel autre, s’il faut s’appuyer sur le statut des esclaves, ou sur le statut du travail, ou le type de relations entre les maîtres et les esclaves. C’est un objet insaisissable.
En même temps, il est présent partout, on sait très bien le reconnaître dans chaque société, et d’ailleurs, bien qu’il se décline différemment, il est toujours possible de traduire le terme « esclave » d’une langue à l’autre.
Ce n’est pas une définition historique qui m’a fait avancer mais celle de l’anthropologue Claude Meillassoux. Elle est d’ailleurs reprise par de nombreux-ses auteur-e-s pour mesurer ce qu’implique une telle institution dans une société, mais aussi pour comprendre aussi ce qui fait la spécificité de la société européenne dans son rapport à l’esclavage. Selon Meillassoux, le procédé permis par l’esclavage consiste à extraire ou dégager un individu de toute inscription sociale, c’est-à-dire de toute parenté. Sans identité sociale, sans lien qui l’engage à d’autres membres de la société, l’esclave est disponible à l’aliénation : de son corps, de son travail ou de tout autre de ses attributs humains.
Contretemps : À ce sujet, justement, pouvez-vous développer sur la question de « l’esclave comme anti-parent » que vous abordez dans votre livre ?
Ce que « découvre » Meillassoux dans les sociétés ouest-africaines et dans leur histoire, c’est que l’esclave n’entre pas dans le système de parenté de la société qui l’emploie. Cette caractéristique, on la retrouve partout, et elle permet de définir l’esclave comme un « anti-parent ». Si par exemple un-e esclave a des enfants biologiques, ils seront soit esclaves comme lui/elle- et donc à condition égale avec lui/elle – soit reconnus comme libres ou membres du groupe, c’est-à-dire affiliés à des parents qui ne sont pas esclaves. L’esclave ne pourra donc pas s’inscrire dans une lignée, avoir une identité sociale et la transmettre à son tour, être parent d’un enfant libre, être membre du groupe. Cette rupture-là, cette exclusion fondamentale, est également la manière dont le groupe s’approprie l’esclave, le rend familier, le domestique. L’objectif n’est pas d’en faire un étranger, de l’expulser mais au contraire le faire entrer dans la maison, dans la famille, dans la domesticité, dans le domaine.
Il y a une conséquence importante selon Meillassoux : le travail esclave ne se reproduit pas de lui-même, il n’appartient pas à un système social qui organise le renouvellement des générations. L’esclave est extrait d’une autre société, l’esclavage implique donc la traite. Pour la société qui emploie des esclaves, il n’y a pas de nécessité de faire société avec ses esclaves, de se soucier de l’union des esclaves, de leur reproduction, leurs « familles » : on s’approvisionne sur le marché. C’est fondamental dans la conception même du travail moderne par le capitalisme.
L’esclavage, c’est l’invention du travail « libre », au sens de libéré de toute autre réciprocité ou obligation sociale, de tout lien social. Ce travail est disponible, il est aliénable. Il est possible de le concentrer dans un même espace, de le stocker, de le thésauriser. Toutes les opérations nécessaires au capitalisme sont possibles parce que ce travail est « sorti du social », désencastré.
Contretemps : Les prolétaires ont leurs propres enfants et la question de la reproduction de la force de travail et de leur reproduction biologique et sociale en tant que salarié-es est une question qui se pose pour les capitalistes. Comment se pose-t-elle à propos des esclaves ?
Aurélia Michel : Le passage de l’esclavage au salariat, d’une économie esclavagiste à une économie industrielle avec la révolution industrielle s’est accompagné de toute une réflexion sur le travail et la reproduction de la main-d’œuvre.
Il y a des pressions politiques et morales pour supprimer l’esclavage parce que le niveau de violence de ces sociétés est extrême. Un tel niveau de violence pose problème à tout le monde, y compris aux esclavagistes. Il y a quelque chose qui n’est pas tenable.
Mais ce qui va être très important dans la transition de l’esclavage vers le salariat industriel, c’est la question de la traite : à la fin du XVIIIe siècle, la production, antillaise notamment mais plus largement des plantations coloniales qui s’appuient sur la traite, est fragilisée par une série de difficultés : guerres, conflits avec les partenaires commerciaux africains, appauvrissement des filières… il y a donc des difficultés pour acheminer les esclaves alors que la demande n’a jamais été aussi forte. C’est l’ensemble de l’économie européenne qui en est affectée.
C’est pourquoi, à partir du milieu du XVIIIe siècle, les Européens cherchent des alternatives à la traite. Ils vont commencer par chercher à faire se reproduire les esclaves eux-mêmes. Ils envisagent alors de mettre en place des « fermes à esclaves » et de forcer les esclaves à se reproduire pour avoir une main-d’œuvre pérenne sur place. Cela ne fonctionne évidemment pas. C’est dans ce contexte que s’amorce une réflexion sur le travail libre : « libre » ne désigne pas tant le statut du travailleur (même si dans cette perspective, il y a un bénéfice à ce que la discipline soit intériorisée par le travailleur au lieu d’externalisée, à la charge du contremaître), mais la disponibilité du travail sur le marché : dans les productions antillaises, c’est très compliqué, il faut faire venir des esclaves d’Afrique, alors que dans les campagnes anglaises, c’est plus simple. Il y a une population sur place ou qui se déplace spontanément pour venir travailler, et grâce à ces migrations, le coût de la reproduction de la main-d’œuvre est quasi-nul.
Dans les débats sur l’esclavage, les réflexions sur le coût du travail commencent à prendre en compte le fait que le travailleur doit se nourrir non seulement lui mais sa famille, et que le salaire doit permettre d’assurer les conditions de la reproduction des générations. De nombreux modèles coexistent à ce moment-là : de nouvelles colonisations ou des partenariats commerciaux contraignants dans des régions plus peuplées (sud de l’Inde, Asie du Sud-Est), toujours sur un modèle de plantation. Les travailleurs sont recrutés par la force, le travail est contraint par la violence, leur reproduction ne fait pas partie du projet. On consomme les travailleurs forcés tout comme on consomme des esclaves. Certes, ils n’ont pas le même statut mais la conception du travail dans cette économie et la façon dont on pense la main-d’œuvre sont très proches. C’est une évolution. Et c’est dans cette évolution précisément que la race intervient.
La race est une mutation de l’institution de l’esclavage qui s’adapte au contexte de ce marché du travail, de ce contexte productif : est-ce qu’on va avoir besoin de déplacer de la main-d’œuvre ? Est-ce qu’on va avoir besoin qu’elle se reproduise ? Qu’elle travaille plus intensément ?
De nombreuses questions se posent à la fois dans le monde colonial et dans les métropoles. La race d’une certaine manière va organiser toutes ces nuances, en autorisant le recours à la violence pour déplacer, pour contraindre à rester, pour faire pression sur les salaires.
Contretemps : Vous dites que la race est « une reproduction en termes scientifiques de la rupture fondamentale en humanité qui était opérée par l’esclavage ». Vous faites le lien entre la crise de la société coloniale esclavagiste qui ne peut plus tenir notamment d’un point de vue économique et sur un plan plus social, le besoin pour les blancs de trouver des dispositifs de hiérarchisation pour maintenir leur situation de supériorité à un moment où la rupture maître/esclave s’efface de plus en plus après l’abolition de l’esclavage. Pouvez-vous expliciter ?
Aurélia Michel : Le premier élément important, c’est l’impossible reproduction de cette société esclavagiste, qui explique la charge violente du mot « nègre ». La société coloniale antillaise se reproduit principalement par la traite, et par une faible migration européenne, souvent provisoire. Les Européens ne séjournent pas toujours longtemps, souvent ils ne font pas venir leur famille. Le taux de natalité de la population esclave est très faible et, de même pour les colons, car le marché matrimonial est très étroit.
Ensuite, l’ampleur de l’économie coloniale explique le niveau de violence du système : que ce soit la production d’esclaves en Afrique, le transport, la vente, la répartition dans le continent, l’exécution du travail lui-même, tous les aspects de la vie à chaque moment s’inscrivent dans une immense violence. Il y a un effet d’entraînement de cette violence qui est terrifiant. C’est cette terreur qui est logée dans le mot « nègre », terme qui permet aux colons de tenir cette réalité à distance.
D’autant plus que très rapidement, ces fameux « nègres » sont aussi les enfants des maîtres, leurs neveux, leurs cousins, leurs oncles biologiques. Les maîtres ne sont pas à distance en réalité, ils sont toujours sous la menace d’une proximité avec les « nègres ». Dans cette configuration, le mot « nègre » sert à éloigner, à ré-établir l’esclave dans son statut, y compris quand il/elle n’est plus esclave mais libre, qu’il/elle est affranchi-e ou qu’on noue des liens affectifs avec lui/elle par exemple. C’est à ce moment-là que le mot « blanc » apparaît pour se distinguer du « nègre ». Évidemment, dans les faits, beaucoup sont métis, y compris chez les maîtres. L’historien Frédéric Régent, notamment, l’a bien documenté. À la Réunion par exemple, les trois quarts des maîtres étaient métis. Le terme de « blanc » évoque un statut plus qu’une couleur de peau.
Le phénomène est accentué dans le cadre des révolutions : à la fin du XVIIIe siècle, on n’est pas encore au moment de l’abolition. Des milieux y sont favorables et militent en sa faveur, la question de la traite pose vraiment problème. Les élites commencent à réfléchir, mais on est encore dans des sociétés complètement esclavagistes. En même temps, de nouvelles sociétés politiques comme les États-Unis et la France s’établissent comme des sociétés égalitaires, à partir de la Déclaration d’Indépendance et de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Dans cette révolution, on affirme que « les hommes sont libres et égaux ».
Donc les « nègres », et surtout à ce moment-là les noirs libres – parce que ceux qui sont esclaves vont le rester pour la plupart – ceux qu’on essaie de mettre à distance et sur qui on fait porter cette terreur, deviennent potentiellement des frères, des cousins, des neveux, des enfants, par la loi. Et c’est cela qui est insupportable pour une partie des élites. Elles ont beau être révolutionnaires, elles ont parfois elles aussi des esclaves, ou des intérêts dans une compagnie commerciale.
À ce moment-là, le mot « blanc » devient un mot qui non seulement correspond à une catégorie sociale, mais aussi un mot juridique : il s’institutionnalise. C’est vrai dans les pratiques de l’État étatsunien naissant, dans le recensement par exemple, mais c’est vrai aussi pour l’application du Code civil napoléonien dans les colonies françaises. Là on peut parler de racisme d’État.
Contretemps : Vous parlez de l’importance de ces deux pays que sont les États-Unis et la France, au même moment, et à parts égales. Il y a donc, contrairement à ce qu’on entend souvent dans les médias et même dans l’institution scolaire, une centralité de la race pour l’histoire de la France ? Pourquoi ce déni ?
Aurélia Michel : Il faut situer globalement la construction raciale dans l’expansion coloniale européenne : le Portugal, l’Espagne, puis plus tard les Pays Bas, l’Angleterre, la France et d’autres. Cela correspond certes à différentes séquences. À ce titre, les colonies britanniques qui deviendront les États-Unis ou les colonies françaises aux Antilles posent des problématiques très similaires, même si les monarchies et les cultures politiques ne sont pas les mêmes.
Ce qui distingue alors profondément la France postrévolutionnaire et les États-Unis, c’est que ces derniers se rendent indépendants, s’émancipent du cœur de l’empire. Dans la colonie française de Saint-Domingue, les planteurs qui ont résisté à la Révolution française avaient cependant la même logique que les indépendantistes américains. D’ailleurs, ils les rejoignent et sont accueillis en exil aux États-Unis.
Dans les deux cas, une société coloniale européenne esclavagiste décrète qu’elle se refonde en société égalitaire. Voilà le paradoxe commun.
En ce qui concerne la France, en effet, pourquoi un tel déni ? Ce qui est indéniable, c’est la centralité de l’économie esclavagiste dans l’économie française. Rappelons que, dans l’économie coloniale française qui se déploie avec Louis XIV, le banquier du roi est le financier de la compagnie du Sénégal et de la compagnie de Louisiane. Le projet esclavagiste et colonial est au cœur de l’État.
Aux XVIIIe, XIXe siècle ou même au XXe siècle, l’espace économique français – et là où s’exerce l’autorité de l’État français, que cela soit sous sa forme monarchique ou plus tard républicaine – dépasse l’hexagone, car il inclut les plantations antillaises, le Sénégal, les comptoirs en Inde, etc.…et les main-d’œuvres qui s’y trouvent, tout cela fonctionne ensemble. Les gouvernements, les élites, tout le monde en est tout à fait conscient. Même si un paysan habitant du Jura au XIXe siècle n’a peut-être jamais vu de « nègres » de sa vie, son cousin est peut-être parti en Algérie, ou une partie de sa famille a migré à Madagascar, et en tout cas il en a entendu parler. Une partie de sa consommation, par exemple s’il mange du sucre, vient de là. Cela fait complètement partie de l’expérience française, même dans les milieux populaires et ruraux. Et cela fait surtout partie de la subjectivité dominante. C’est-à-dire que dans la tête des élites qui organisent le capitalisme, il y a un ordre racial, une hiérarchie raciale qui permet de savoir qui fabrique le sucre.
Cette subjectivité, le paysan du Jura ou du Limousin la connaît et l’a intériorisée, peut-être pas forcément consciemment, mais en tout cas, il sait qu’il y a des esclaves quelque part qui produisent, comme nous savons confusément aujourd’hui qui fabrique nos baskets. Il ne l’ignore pas. Et nous ne l’ignorons pas nous non plus aujourd’hui. Les tensions raciales aux États-Unis font figure de repoussoir, mais en réalité, on en est aussi complètement traversé-es.
Par exemple, lorsque le Code civil napoléonien, qui nous inscrit anthropologiquement dans un système de parenté et de succession, est appliqué aux Colonies, il ne s’applique qu’aux Blancs entre eux ou aux non-Blancs entre eux, selon une « ligne » censée être naturelle et nécessaire aux colonies. Cette ligne, cet écart entre société des blancs et des non blancs, c’est là que se loge la race.
C’est une espèce de subterfuge, de subtilisation de la part des élites antillaises qui reprennent leurs billes après le moment révolutionnaire : l’égalité ne concerne que les blancs, et on ne devient pas blanc. On ne devient jamais ni blanc ni citoyen, parce que la blancheur ne s’acquiert pas– c’est le grand principe du racisme -, elle s’hérite.
En revenant sur cette histoire, on interroge le moment de refondation de notre société, où notre anthropologie a été redéfinie (qui appartient au groupe / qui n’y appartient pas). Ces règles sont en effet rejouées au moment des révolutions – la Révolution française, 1848, la Commune, suivies de réactions – Napoléon, le Second Empire ou la Troisième République – au cours desquelles les élites subtilisent l’accès à la citoyenneté, à l’égalité, aux droits acquis.
Contretemps : On comprend ce qui se joue pour les élites économiques, patronales et politiques, mais pour les autres ?
Aurélia Michel : C’est une bonne question que je traite moins dans le livre, parce qu’elle concerne plus le XXe siècle. Ce qui se passe à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, c’est que la fiction de la nation, devenue une nation biologique, naturalisée, devient un instrument politique majeur auprès de l’ensemble de la population. L’école de la Troisième République, où tous les enfants lisent Le tour de la France par deux enfants, contribue largement à la diffusion de cette fiction raciale. On est dans une phase d’expansion du colonialisme où la population est beaucoup plus mobilisée. Il y a une mise à contribution de la population pour aller coloniser, peupler, travailler et mettre en valeur l’empire colonial. Si on repense au paysan du Limousin, il est à peu près sûr que quelqu’un de sa famille ou lui-même est impliqué dans les colonies.
Dans cette économie coloniale, ou de pionniers en Amérique, où il est question d’ouvrir de nouvelles plantations et productions, la situation du petit colon qu’on envoie défricher est bien sûr différente de l’ancien esclave mais elle peut être relativement proche dans les conditions de vie, dans la nature du travail, dans ce que les capitalistes en attendent. Et là aussi, il existe une terreur chez eux d’être assimilés à ce qu’il y a de plus méprisé.
On le voit bien au Brésil par exemple au début du XXe siècle où les nombreux immigrés portugais ou italiens qui viennent travailler dans les plantations de café cherchent souvent à se distinguer de la population noire. C’est aussi ce qui se passe en Afrique du Sud où les ouvriers blancs, malgré des luttes communes, veulent eux aussi à tout prix se distinguer des noirs. Les expériences racistes les plus significatives du XXe siècle, les lynchages aux États-Unis, l’apartheid en Afrique du Sud, se déroulent là où le petit blanc paupérisé est proche économiquement des descendants d’esclaves et ne veut surtout pas être assimilé à lui.
Encore une fois, le procédé de la race, c’est de mettre à distance ce qui menace d’être trop proche. Et dans ces cas-là, ce sont des agressions, des insultes, des actes de violence qui performent la race.
Contretemps : Pourriez-vous revenir plus en détails sur l’existence d’un racisme d’État en France à un moment donné ? Pouvez-vous notamment nous parler de ce qu’on appelle le Code Noir ?
Aurélia Michel : On entend souvent un contresens à propos de l’objectif du Code Noir de Colbert : l’État aurait essayé de protéger ou d’améliorer la condition des esclaves, de réguler la violence des maîtres quand dans le cas précis des colonies françaises, c’est l’État lui-même qui entreprend la traite. C’est justement une caractéristique de l’empire français par rapport à l’empire portugais ou britannique, car on peut parler ici d’un « État négrier » : les compagnies sont créées et financées par le roi et ses alliés, et non pas par le groupe social des planteurs.
Le roi considère d’ailleurs que les planteurs manquent de vision globale et ne se préoccupent que de leur petit pouvoir local, notamment concernant les esclaves qu’ils gèrent et contrôlent mal. Or le système de l’économie esclavagiste est bien plus vaste : c’est la production d’esclaves et les rapports commerciaux avec les États africains, tout le système d’assurances, de crédit nécessaire au financement de la traite, c’est le commerce intra-américain, la transformation des marchandises, le conditionnement, le transport, les raffineries en France, les circuits de commercialisation et plus largement la finance européenne.
L’objectif de Colbert, c’est de mettre au pas les planteurs dans ce système économique, dans lequel l’État lui-même est le moteur et le bénéficiaire. Le Code Noir fait partie des instruments qui mettent en place l’empire français, qui est une économie globale, complexe, à très fort niveau d’investissement et à haut rendement, mais évidemment pas à l’échelle des petits planteurs antillais, qui ne sont qu’un rouage – certains s’en sortent très enrichis, la majorité s’endette.
Beaucoup sont absents et font administrer leur plantation par leurs gérants, leurs contremaîtres, responsables avant toute chose de l’organisation du travail forcé. Pour l’administration royale, il ne s’agit pas d’assurer le bien-être de l’esclave pour des raisons de charité, mais d’exploiter au maximum le travail de l’esclave. Ainsi le Code Noir oblige les maîtres à nourrir les esclaves, les vêtir, les loger, interdit aux maîtres de laisser leurs esclaves travailler le samedi pour qu’ils se nourrissent eux-mêmes, ou de vendre sur le marché des produits de la plantation. Il faut également maintenir l’intégrité de la plantation, ne pas séparer les esclaves – « biens meubles »- du foncier ou des installations (biens immeubles) et donc empêcher que les maîtres vendent leurs esclaves à droite à gauche ou les jouent aux cartes, ou les dispersent au moment des successions.
C’est dans ce contexte qu’il faut entendre l’expression « bien meuble », mais il ne s’agit pas de dire que les esclaves ne sont pas des êtres humains. Si les esclaves n’étaient pas des humains, on n’en aurait pas besoin. Le code noir énonce qu’ils sont à la fois des humains – il faut d’ailleurs les baptiser-, et des biens. C’est la fiction même de l’esclavage, et plus tard celle de la race.
On peut faire un parallèle entre le mot « nègre » et le mot « putain » : on sait bien que les prostituées sont des femmes mais on va les désigner comme ça parce que, ce qui compte dans ce rapport-là, c’est que leur sexualité est marchandisée. Le stigmate consiste à les réduire à la condition de prostituée. Avec les esclaves, c’est pareil. On sait très bien qu’ils sont des êtres humains, mais grâce à l’esclavage, on peut faire comme si leur humanité était marchandisable, et les réduire à cette caractéristique. On peut ainsi leur appliquer les règles juridiques de la propriété. On « fait comme si ». C’est une convention, difficile à supporter dans ce qu’elle implique de violence, car elle permet tous les abus. Elle est d’ailleurs là pour ça.
Contretemps : Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur la police des Noirs ?
Aurélia Michel : Le principe de l’économie coloniale, c’est qu’il existe une production externalisée dans les domaines coloniaux, et avec une main d’œuvre externe à la société. Si les esclaves viennent en métropole, cela vient perturber les règles du jeu. Cela crée des contradictions juridiques notamment avec l’interdiction de l’esclavage sur le sol métropolitain. Le problème se pose au fur et à mesure du développement des plantations, car les maîtres qui voyagent ou retournent en métropole se font accompagner de leurs esclaves. La police des noirs (1777) vise à limiter ces déplacements et surtout à créer des règles d’exception pour contourner ce paradoxe. Ces exceptions concernent les personnes « de couleur », ce qui revient à créer de facto une ségrégation raciale légale.
Contretemps : Par rapport à la place des esclaves et de la race dans l’histoire française, vous insistez sur l’importance des symboles de la présence de la production esclavagiste coloniale sur le territoire (palais de l’Élysée, place Vendôme…). Il y a donc une inscription de cette production sur le territoire hexagonal, même si tout le monde ne veut pas la voir comme telle ?
Aurélia Michel : On parle d’un système esclavagiste qui a construit des pratiques d’État – l’État entrepreneur, l’État mercantiliste qui crée des compagnies, qui met en place des agents, qui coordonne la circulation des capitaux, qui organise les conventions économiques et les circuits financiers qui assurent la croissance européenne. Cette centralité de l’économie esclavagiste nous conduirait, si on devait en effacer les traces matérielles, à détruire beaucoup de choses. C’est sûr que si on commence à réfléchir aux statues, on va vite se retrouver au palais de l’Élysée, à la place Vendôme, et bien d’autres. Et ce serait une bonne chose que d’y réfléchir. Par ailleurs, il existe plein de signes dans notre paysage quotidien qui rappellent que nous sommes dans un ordre racial issu de cette économie esclavagiste : quand on entre dans un bâtiment public, un musée, une université, on ne s’étonne pas de trouver des noirs à la sécurité, des asiatiques du Sud en train de nettoyer les locaux, des blancs aux postes administratifs à responsabilités, etc. On ne le questionne même pas. Imaginons que ces places soient inversées, là on verrait vite les couleurs ! Le spectacle du racisme se situe sur bien d’autres scènes : dans un contrôle d’identité à la Gare du Nord, dans une salle de classe, au moment du conseil de classe, parfois par des gens très bienveillants. L’enjeu de la race va bien au-delà des actes racistes en eux-mêmes, dont on pourrait facilement désigner quelques coupables : on en est tous et toutes imprégné-es, on y est habitué-es. L’antiracisme implique de penser la société dans son ensemble et oblige à la penser ensemble.
Contretemps : Cela renvoie à toutes les questions sur l’existence du racisme structurel, du racisme institutionnel…
Aurélia Michel : Oui, il y a un livre qui est sorti cette année à ce sujet : Racisme d’État ? de Fabrice Dhume, Xavier Dunezat, Camille Gourdeau et Aude Rabaud. Ils et elles décortiquent les différents termes. Ces travaux engagent une réflexion plus large sur les rapports entre société et État, et amènent à des questions radicales : l’État est-il simplement traversé par le racisme comme production de la société, ou alors le racisme serait-il la condition de l’État ? Il y aurait beaucoup à dire…
Contretemps : Dans votre livre, vous citez Claude Rostoland, le gouverneur de la Martinique qui affirme dans le discours même où il proclame l’abolition de l’esclavage le 23 mai 1848 : « Je recommande à chacun l’oubli du passé. » Pouvez-vous développer ?
Aurélia Michel : On retrouve là une spécificité française. C’est un choix politique d’oublier : pourquoi ? Les responsables coloniaux le disent très bien à l’époque : parce que c’est insoutenable. C’est bien pour ça qu’on a retardé si longtemps l’abolition. Les planteurs et les administrateurs sur place disaient : « On ne va jamais pouvoir faire vivre cette société si on n’a plus recours à la violence, cela va être impossible ». C’est sur la base de cet argument que le décret de l’abolition est sans cesse mis en discussion au parlement et que les députés reculent systématiquement.
Un des facteurs essentiels de cette résistance, c’est la question de l’indemnisation des propriétaires.
Les planteurs argumentaient à ce moment-là : « L’État nous a demandé d’assurer la production et la violence qui va avec, de faire fonctionner la machine esclavagiste, de nous endetter, et maintenant l’État nous lâche et nous demande de continuer, mais sans pouvoir recourir à l’esclavage ». Les planteurs négocient pendant 15 ans le fait que l’État renfloue leur trésorerie et assure lui-même l’exercice de la violence (par des lois, le fonctionnement de prisons, de la police). Ils auront gain de cause. Toute une législation du travail suit l’abolition de l’esclavage pour reconstituer par des règles administratives et de police ce qui était assuré jusque-là par l’institution esclavagiste : obligation de travailler, interdiction de changer de plantation en cours de semaine. Pendant des décennies, l’administration coloniale va se charger de poursuivre les « vagabonds », de les parquer dans des centres de détention, de les mettre à disposition des planteurs. Autrement dit, l’abolition de l’esclavage fut une lente transition, si bien que le mot d’ordre des autorités était, plus que l’oubli, le déni.
Contretemps : Pouvez-vous nous parler des liens entre race et nation ? Comment cela se recoupe-t-il ? On voit bien que le nationalisme peut être mobilisé pour défendre des projets racistes mais ce sont deux notions distinctes, donc comment clarifier tout ça ?
Aurélia Michel : L’élaboration politique de l’État-nation est contemporaine de la théorie raciste. D’ailleurs la première utilisation scientifique du mot « race » sert d’abord à distinguer des nations européennes entre elles. Je dirais qu’il y a un parallélisme et même une articulation dans cette élaboration de la race et de la nation : les peuples, les nations, les races deviennent la dynamique de l’histoire, presque comme un être vivant qui aurait des besoins, des pulsions, un destin. La dimension émancipatrice – l’autonomie des peuples – de cette notion est confisquée par les élites, qui construisent la nation comme une différence d’ordre naturel, une distinction qui désigne en réalité un groupe restreint, celui des « blancs », conduits par leurs gouvernements, dont l’expansion serait légitime. La nation aurait besoin de main-d’œuvre, de matières premières etc., et cela passe par le discours sur la race.
Au moment des révolutions et de la fondation des États-nations, on recompose ce qui fonde et détermine l’appartenance à la société, la nouvelle communauté politique, mais en l’établissant comme une fiction naturelle. En même temps qu’on naturalise les peuples, on naturalise la domination coloniale, le travail forcé, la violence, la confiscation de territoires, le vol des ressources…
C’est très clair dans le discours de Jules Ferry à la Chambre en 1885 pour expliquer ce qui adviendra à la conférence de Berlin, à savoir le projet colonial de la France en Afrique. Une première conférence avait eu lieu, également à Berlin, en 1878 et portait sur la population européenne : le Danube, les peuples slaves, l’empire austro-hongrois… Il y avait cette même idée que les Austro-Hongrois avaient le devoir de soumettre les Slaves et de circuler librement sur le Danube. C’est exactement le vocabulaire qui est utilisé quelques années plus tard à propos de la circulation sur le fleuve Congo et du devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures.
Contretemps : Vous citez Aristote au sujet de cette naturalisation de l’esclavage à l’âge classique de la Grèce antique mais les procédés sont-ils les mêmes pour la racialisation à partir du XVIIIe siècle ? L’idée de présenter l’ordre social construit comme un ordre naturel ?
Aurélia Michel : Pour Aristote, l’esclavage, c’est l’ordre des choses, mais il ne s’agit pas de race. La grande différence, et c’est très important pour comprendre la race, c’est que dans la société d’Aristote, il n’y a aucune fragilité de l’institution de l’esclavage. C’est la chose la plus entendue et solide de la société grecque. Ça apparaît comme une évidence, parce que c’est une évidence, il n’y a pas besoin de la naturaliser.
Ce qui se passe au début du XIXe siècle avec la race, ou avec le genre, c’est le besoin de les naturaliser. C’est-à-dire qu’il faut justifier une institution contestée, qui fonctionne mal. Mais ce procédé n’est jamais suffisamment efficace pour figer l’ordre social, lui-même toujours débordé par ses incohérences. Et donc le propre de la race c’est qu’il faut tout le temps re-prouver, ré-établir cette évidence soi-disant naturelle. Très concrètement, il faut par exemple donner un coup de fouet à l’esclave ou au colonisé pour ré-établir le rapport de supériorité constamment démenti. L’aspect instable et fragile de la race est d’autant plus fort que les empires sont très dynamiques, ils sont en guerre tout le temps, il y a des déséquilibres, des résistances permanentes.
L’époque de la conférence de Berlin est justement une période de bouleversement extrêmement rapide. En 20 ans, l’Europe a annexé des dizaines de milliers de km² en Afrique et en Asie, incorporé des millions d’individus : c’est précisément à ce moment de grande instabilité que les discours d’affirmation et de réaffirmation de la naturalité de la hiérarchie des races sont les plus forts. Tandis qu’Aristote utilise la permanence du système social esclavagiste comme fondement d’une réflexion générale, le discours de la race, lui, doit performer. Les recherches de Carole Reynaud-Paligotau sujet de ce qu’elle appelle la « république raciale » le montrent : durant toute la IIIe république, les sociétés savantes qui s’emparent de la race et des discours racistes derrière les colonisateurs leur soufflent à l’oreille tout le temps et les arment idéologiquement, presque psychologiquement.
Contretemps : Quelle analogie peut-on faire entre la race et le genre ? Comment cela peut-il éclairer les dynamiques de l’histoire sociale et politique ?
Aurélia Michel : Il y a une articulation entre sexisme et racisme qui se noue dans l’enjeu de définition de la nation. L’obligation de déclarer un genre à l’état-civil contribue à ce moment-là à une redéfinition des règles anthropologiques de l’appartenance au groupe, par la civilité, la citoyenneté et les règles de sa transmission, c’est-à-dire la filiation. Dans le système du code civil, l’appartenance au groupe est transmise par les pères, puis réservée aux blancs. Or, on ne devient pas blanc, on naît blanc, c’est-à-dire qu’il faut que les mères soient blanches, et qu’elles ne s’unissent qu’avec des hommes blancs- leur mari si possible. Cela implique un contrôle plus fort du corps des femmes blanches, une restriction de leur sexualité, la répression de toute sexualité qui ne soit pas liée à la reproduction du blanc. Et dans cette nouvelle donne, où il faut inclure la liberté, la citoyenneté, la souveraineté, il y a des formes de contrôle qui viennent comme des effets retour, et notamment, le contrôle de la reproduction.
Il se passe à ce moment-là quelque chose de bien précis dans l’histoire du genre : la nécessité du sexisme pour maintenir l’ordre social. Comme la race, il s’agit d’un procédé de naturalisation par lequel on assigne la femme à son statut d’inférieure, et qu’il faut sans cesse performer et répéter.
Le sexisme rejaillit aussi sur les catégories raciales, par exemple dans la terreur des blancs de la sexualité de l’homme noir ou indigène, ou dans l’érotisation des femmes non blanches qui se trouvent doublement exclues de la parenté blanche, et donc ne sont protégées par aucun interdit sexuel.
Contretemps : Votre ouvrage est une contribution scientifique mais n’est-ce pas aussi un outil pour envisager un monde où on en aurait fini avec la race ?
Aurélia Michel : Je l’espère, et je crois que nous vivons une séquence où le déni sur la race est en train de se fissurer. Je suis d’une génération où, en tant que blanche, j’ai été préservée de la conscience de cette histoire et de ses conséquences. C’est de moins en moins possible heureusement et il faut continuer à produire des récits, des analyses, des démonstrations qui sont aujourd’hui de plus en plus audibles, attendus.
Ce que peut apporter ce livre sur le plan théorique, c’est de nous conduire à réinterroger les principes qui fondent notre anthropologie, en particulier la filiation et sa naturalisation. C’est pour ça qu’en conclusion, je reviens sur les questions soulevées par le mariage pour tous, la PMA, etc. Tout ce que je dis là s’inscrit dans un débat plus large : la race nous oblige à revenir sur nos règles sociales, l’appartenance à la nation, à la citoyenneté etc., ce qui implique de questionner d’autres choses essentielles. C’est aussi pour ça qu’il y a une résistance aussi forte. On est en train de remettre en question ce qui a organisé depuis longtemps nos rôles les plus élémentaires. L’égalité même est une question qu’il faut ré-explorer, parce qu’on utilise encore un logiciel qui date de cette époque et qui n’est plus adapté aux enjeux environnementaux.
La réflexion historique sur la race nous ramène à celle sur notre rapport au vivant en général, notre place dans le monde, ce qui fera demain les règles du jeu de nos sociétés. Par exemple, qu’est-ce qui nous oblige encore aujourd’hui, avec tous les moyens techniques et les transformations culturelles qui sont les nôtres, à nous définir socialement en fonction de la parenté biologique ? Ne sommes-nous pas tous et toutes et au même titre, des parents, futurs ou anciens, c’est-à-dire engagés dans des réciprocités de génération ? C’est ce qui fonde notre égalité mais aussi nos différences et nos dépendances, nos responsabilités.
*
Propos recueillis par Grégory Bekhtari.
Illustration : « Traite des nègres », estampe de George Morland, 1794 – source : Gallica-BnF.







![Fascisme : vieux démons et nouveaux monstres [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/734662-150x150.jpeg)

