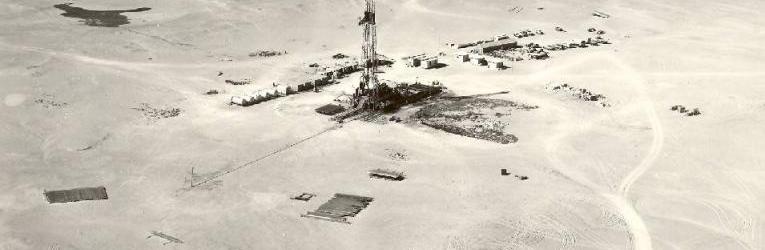
Justice environnementale, ici et là-bas
Emilie Hache s’intéresse ici aux enjeux liés à la justice environnementale, encore peu explorés en France. C’est l’occasion de soumettre la notion d’Anthropocène à la critique, et d’articuler la question des inégalités environnementales aux luttes concrètes, à la veille de la Conférence environnementale pour le réchauffement climatique qui aura lieu en 2015.
Emilie Hache est maîtresse de conférence en philosophie à l’Université de Paris Ouest La Défense. Elle a publié en 2011 Ce à quoi nous tenons. Propositions pour une écologie pragmatique (éd. La Découverte), et a coordonné Écologie politique. Cosmos, communautés, milieux, paru en 2012 (éd. Amsterdam). Ce texte est tiré d’une conférence organisée par Sciences-Po Lille et l’IRTS Nord – Pas de Calais, le 26 mars 2013, ayant pour thème « Environnement et justice sociale ».
*
Alors que les inégalités environnementales entre les populations semblent s’accentuer de plus en plus parallèlement au réchauffement climatique résultant de la très large domination du modèle de production capitaliste, on voit apparaître de manière répétée l’objection selon laquelle cette question des inégalités serait aujourd’hui dépassée par l’urgence, précisément, de ce bouleversement climatique. C’est notamment le cas de la notion d’Anthropocène faisant de l’espèce humaine l’auteure d’une nouvelle ère géologique, ayant pour conséquence tout à fait problématique de minorer les différences passées et présentes des actions et responsabilités des hommes entre eux1. Par inégalités environnementales, on peut entendre dans un premier temps une inégalité entre les populations dans l’accès aux ressources naturelles comme vis-à-vis de l’exposition aux nuisances et aux risques environnementaux.
Cette énième objection, venant contester une nouvelle fois le lien entre enjeux environnementaux et pauvreté, invite à reprendre cette question sous l’angle précisément des attaques qui lui ont été porté. Pour cela, je m’appuierai sur le Mouvement de justice environnementale nord-américain, en partie critiqué et plus largement encore ignoré pour les positions qu’il défend comme les déplacements conceptuels qu’il opère, considérant au contraire qu’il offre des prises pour répondre à ces attaques et invite à penser une histoire des conflits environnementaux élargie. Je proposerai de qualifier ce à quoi se sont confrontés les militants du Mouvement de justice environnementale comme un problème de dépossession. D’une dépossession en réalité double, voire triple : dépossession tout d’abord d’un partage équitable entre les ressources et les nuisances environnementales ; dépossession ensuite de la reconnaissance d’un souci écologique ; dépossession enfin de l’importance même des enjeux posés.
Une double dépossession
Le mouvement de justice environnementale, né aux Etats-Unis dans les années 1980, est le nom donné aux mobilisations de populations défavorisées contre des décisions et pratiques, industrielles comme gouvernementales, à l’origine de nuisances environnementales et sanitaires parfois très graves. Une des histoires tristement célèbres (appartenant au passé de ce mouvement, j’y reviendrai) est connue sous le nom de Love canal. Le scandale auquel fait désormais référence ce nom s’est passé dans la banlieue de Niagara Falls, dans laquelle l’entreprise chimique Hooker Chemical Compagny racheta dans les années 1940 un canal abandonné et construit un demi-siècle plus tôt par un certain Mister Love. Cette entreprise y stocka 21 000 tonnes de déchets toxiques qui s’infiltrèrent dans le sous-sol et contaminèrent les sols, l’eau et l’air. Or, en raison de la pression foncière liée au succès des Chutes du Niagara, devenues grâce au travail de l’architecte paysagiste Frederick Olmsted l’un des sites touristiques les plus visités des Etats-Unis2, l’entreprise céda son terrain à la mairie pour qu’elle y construise des habitations et une école. Se sont alors multipliées dans les années suivantes des problèmes de santé parmi la population pauvre, principalement ouvrière, venue habiter dans ces nouveaux logements. Les enfants se plaignaient de maux de tête, les femmes de problème de fécondité, de fausses couches, etc. Le scandale fut révélé à la fin des années 1970 et donna lieu à une longue bataille juridique au terme de laquelle l’entreprise fut condamnée et le quartier évacué. Maisons et écoles ont été rasées, le quartier est devenu une zone interdite à l’allure bien innocente d’une prairie verte, entourée tout de même de barbelés de plus de 2 mètres de hauteur…
Les récits des conflits qui structurent ce mouvement depuis l’origine témoignent chaque fois de vies qui semblent compter moins que d’autres, auxquelles des entreprises, mais parfois aussi l’Etat, font littéralement payer le prix du mode de vie des populations aisées résultant de choix industriels et technologiques imposés à tous, mais dont seule une partie de la population bénéficie réellement. Les personnes engagées dans ces mobilisations posent les questions suivantes : qui est le plus exposé aux nuisances et aux risques environnementaux ? Qui habite près d’une autoroute ? D’une décharge ? D’une usine polluante ? Qui, à l’inverse, jouit d’un environnement sain, esthétique, épanouissant ? La sociologue américaine Giovanna Di Chiro raconte que lors de la mobilisation de riverains – ou plus exactement de riveraines – contre un projet de construction d’un incinérateur de déchets dans la banlieue pauvre de Los Angeles dans les années 1990, ces dernières, principalement des femmes de couleur, allèrent solliciter l’aide des associations environnementales américaines existantes et très actives, comme le Sierra Club ou l’Environmental defense fund (le Fond pour la défense de l’environnement). Or, dans un premier temps, ces associations leur répondirent que leur combat portait sur un problème de santé publique (i.e. l’empoisonnement d’un quartier par un incinérateur), et ne relevait pas à proprement parler de la lutte environnementale. Certaines associations (comme Greenpeace ou Citizens for a better environment) finirent par les rejoindre, mais les divergences apparues à cette occasion ont amené les acteurs du mouvement de justice environnementale à questionner ce sur quoi porte l’écologie. « Qu’est-ce qui est environnemental et qu’est-ce qui ne l’est pas ? »3. Est-ce que, en particulier, des combats portant sur des enjeux de santé relèvent pleinement d’une problématique écologique ? Comment définir l’écologie de telle façon que cette dernière prenne – ou plutôt reprenne – pleinement compte de ces problèmes4 ?
C’est dire aussi qu’en plus de devoir se battre contre un partage inéquitable des ressources et des nuisances environnementales, le mouvement de justice environnementale doit se battre à propos même de ce sur quoi il porte. C’est ce à quoi je faisais allusion en introduction lorsque je parlais d’une double dépossession : les mêmes personnes confrontées à cette répartition inégale des richesses et des coûts se voient dépossédées dans le même temps d’un souci écologique accompagnant leurs luttes. Vouloir tenir ensemble les questions d’inégalités sociales et environnementales, c’est-à-dire les dimensions à la fois sociale et environnementale d’un problème, serait oxymorique. Cette (seconde) dépossession a longtemps pris la forme d’une accusation d’anthropocentrisme : tous ceux qui ne s’intéressent pas (que) à la préservation de la nature ne s’intéresseraient pas à la nature tout court5. Cette accusation portée par une partie des environnementalistes américains doit être remise dans son contexte : elle s’adressait principalement à ceux qui ne s’intéressaient pas aux enjeux environnementaux et diabolisaient sous les traits d’un anti-humanisme tous ceux qui manifestaient un tel souci. Mais le conflit évoqué plus haut témoigne de ce que des mouvements comme celui de la justice environnementale furent également concernés par cette accusation, expliquant que ses militant-e-s refusèrent l’appellation de « nouveaux environnementalistes », cette expression laissant entendre que cette dimension écologique serait récente au sein de ces populations, comme le fait qu’ils seraient susceptibles de partager une même définition de ce sur quoi porte l’écologie avec ceux que l’on appelle traditionnellement ainsi.
À quoi tenons-nous ?
Or, bien souvent, ceux qui mentionnent ce mouvement de justice environnementale, au lieu de s’intéresser à la manière dont il transforme les possibilités de changements sociaux et environnementaux par ces processus de redéfinition et de construction de nouveaux discours et pratiques politiques, analysent ce dernier à l’aune des théories de la justice existantes6, comme s’il n’avait rien à nous apprendre par lui-même, comme s’il lui manquait une théorie. L’opposition théorie/pratique met en scène une pensée en soi, abstraite au (mauvais) sens de « détachée de tout lien », qui viendrait informer et donner du sens à une pratique par elle-même sans signification. Dans un article intitulé « Pragmatismes et forces sociales », Isabelle Stengers critique précisément la notion de théorie en tant qu’elle« s’oppose à quelque chose », à savoir la pratique – ici un mouvement de mobilisations politiques -, « censé(e) rester aveugle » sans les lumières que « la théorie, seule, (pourrait) lui apporter »7. Face à cette mauvaise division, Stengers défend une autre conception dans laquelle pensée et action ne s’opposent pas, la pensée n’étant pas comprise ici comme quelque chose de séparable, mais au contraire comme quelque chose qui « n’existe que comme attachée, engagée, suscitée », et ce aussi bien dans une pratique philosophique que dans une pratique politique.
Il n’est pas question ici de faire preuve d’anti-intellectualisme, mais de défendre un autre rapport entre des pratiques distinctes, faussement opposées sous les termes de théorie et pratique. Si une ‘théorie’ peut se passer d’expérience pour élaborer une réflexion sur les inégalités, on lui opposera une autre pratique de la pensée ne s’élaborant qu’à son contact, cherchant à se faire le relais des articulations qui s’y élaborent, comme à dramatiser les possibles qui s’y amorcent. Ces mobilisations abordent la question des inégalités par le milieu, à partir d’un problème (issue) auquel des populations sont confrontées, réussissant ainsi à tenir ensemble des dimensions laissées habituellement de côté, en particulier les rapports entre nuisances environnementales et rapports sociaux de « race »8. Loin d’avoir laissé tomber la critique du capitalisme, ces différents conflits contribuent à la reformuler dans des termes articulant ces multiples dimensions.
La vulnérabilité des positions ici défendues, comme des articulations élaborées, liée à leur défense d’une conception minoritaire en milieu capitaliste, explique qu’elles soient régulièrement remises en cause – parce que (soi-disant) égoïstes, pas politiquement correctes, etc. Cette fragilité fait écho à la supposée maladresse de l’opposition entre « l’environnementalisme des riches »et l’« environnementalisme des pauvres » proposée par Guha et Martinez-Alier, fréquemment accusée de son côté d’opérer un partage grossier entre les riches d’un côté, les pauvres de l’autre9. Cette opposition avait été fabriquée pour lutter contre l’idée fausse selon laquelle les populations (pauvres) des pays du Sud se moqueraient des enjeux écologiques, et l’exportation malheureuse de politiques environnementales tout terrain qui s’en est suivie. Partant, il s’agissait moins d’opposer pays du Nord et pays du Sud selon une vision faussement unifiée des positions politiques à l’intérieur d’un même pays, que certaines politiques écologiques, au Nord comme au Sud, ne se souciant pas des questions d’inégalités à d’autres politiques écologiques, au Nord comme au Sud, prenant en compte quant à elles ces enjeux. De fait, le Mouvement de justice environnementale nord-américain appartient à cet environnementalisme des pauvres. On l’a vu, loin d’être indifférents aux enjeux environnementaux, les acteurs de ce mouvement s’en soucient pleinement, mais s’en soucient non pas comme de quelque chose d’extérieur à eux, avec lequel ils entretiendraient un rapport de loisir, même substantiel, mais comme quelque chose de potentiellement dangereux (parce que toxique, contaminé, présentant des risques d’incendie, etc.) constituant le milieu même où ils habitent, travaillent et vivent. Cette autre conception de l’écologie permettrait d’imaginer faire une place à ces multiples mobilisations ne faisant pas partie jusqu’alors de notre histoire environnementale.
A ce titre, on peut comprendre l’invitation de Martinez-Alier à considérer le Mouvement de justice environnementale comme quelque chose ayant « débuté il y a longtemps, à une centaine de dates et d’endroits différents en tant que mouvement interculturel dont l’histoire n’a jamais été racontée, et cela dans beaucoup de pays »10. Une belle – et active – façon d’hériter de ce mouvement serait en effet de (re)lire certains conflits, passés ou en cours, comme celui de Love canal, à l’aune de cette question des inégalités environnementales, faisant de cette dernière, le cas échéant, une puissance de réappropriation, de transformation et d’émancipation.
Justice environnementale ici et maintenant
Cette question des inégalités écologiques n’est évidemment pas propre aux Etats-Unis, et l’on trouve en France les mêmes enjeux de répartition des ressources et d’exposition aux nuisances environnementales11. Le premier conflit que l’on pourrait (re)lire comme un conflit de justice environnementale concerne le Mouvement de grève générale des Antilles françaises, qui eut lieu en Janvier et février 2009, contre le prix des produits exportés depuis la métropole. Le collectif Lyannaj kont pwofitasion (LKP) à l’origine de ce mouvement a dénoncé un grave problème de pauvreté des populations des Antilles résultant, entre autres, d’une politique d’importation scandaleusement chère et absurde écologiquement, liée au passé colonial de ce territoire. Leurs revendications, portant sur une baisse du prix du carburant et des produits alimentaires ainsi que sur une revalorisation des bas salaires, n’aboutirent qu’en partie au terme d’une mobilisation très soutenue. Or si ce conflit a été présenté comme un conflit social (sous entendu « pas environnemental »), on peut ici aussi clairement parler d’un conflit portant sur un problème de justice environnementale : ce mouvement a en effet pointé les problèmes d’inégalité d’accès aux ressources naturelles de la métropole, mais aussi d’accès aux propres ressources du territoire des Antilles par sa population locale en raison à la fois d’une politique régionale fondée sur le tourisme et d’une politique agricole écologiquement et humainement désastreuse. On peut d’autant plus l’affirmer que ce dernier a été qualifié d’écologique dans le Manifeste pour les produits de haute nécessité12 écrit par un collectif d’écrivains et de poètes antillais au cours de cette grande mobilisation. Outre se référer à André Gorz, un des rares philosophes français qui s’est intéressé à l’écologie et qui s’y est intéressé dans sa dimension fondamentalement sociale, ce Manifeste (re)ouvre la question de savoir quels sont les produits de haute nécessité pour lesquels se battre (est-ce que le pétrole en est un ? est-ce que œuvrer pour une autosuffisance énergétique et alimentaire des Antilles – c’est-à-dire inventer une politique caribéenne en est une autre ?), articulant ainsi les dimensions sociales, poétiques et environnementales de ce conflit13.
Faire le récit de ces luttes (sociales et écologiques) nourrit une histoire politique et écologique plus hétérogène, plus inattendue, du mouvement de grève des Antilles à Notre-Dame des Landes en passant par les multiples dimensions du mouvement anti-nucléaire14, mais donc aussi plus robuste face à une soi-disant inertie, et plus généralement contre un sentiment d’impuissance légitime. Il ne s’agit pas de dire que tout conflit social aurait toujours été écologique, mais de constituer une mémoire vive dont l’étendue du répertoire pourrait contribuer à déplacer les conflits à venir.
Outre les mobilisations existantes, on pourrait en effet aussi penser aux situations où ces inégalités n’ont pas fait jusqu’à présent l’objet d’une mobilisation, et qui ne sont pas non plus pensées par les personnes concernées en termes d’inégalités environnementales, mais qui pourraient le devenir. Je pense ici aux situations de misère urbaine encore largement identifiées comme des problèmes d’inégalités sociales, qui sont progressivement en train d’apparaître comme des enjeux écologiques à part entière. Paradoxale pour un « environnementalisme des riches » ayant tendance à identifier l’objet de l’écologie à la préservation de la nature entendue comme un dehors, l’écologie urbaine constitue au contraire une des préoccupations majeures d’un environnementalisme des pauvres, les problèmes d’inégalités environnementales dont il est ici question étant principalement des phénomènes urbains. La prise en compte de ces questions (re)pose de façon critique la question de savoir ce que l’on entend par habiter en zone dite urbaine, tenant compte du fait que cela ne veut plus nécessairement dire habiter en ville comme en témoigne depuis un demi-siècle maintenant l’extension sans fin des bidonvilles au Sud, véritables catastrophes sociales et environnementales, mais aussi, à l’autre bout, l’enrichissement inédit des villes les plus riches au Sud comme au Nord, reléguant une partie de plus en plus grande de la population en zone péri-urbaine, pauvre à la fois culturellement, écologiquement et socialement. Si, « en théorie, les villes sont la solution à la crise écologique planétaire – la densité urbaine (pouvant) entraîner de grandes économies dans l’utilisation de la terre, de l’énergie et des ressources »15, la situation urbaine actuelle constitue au contraire une de ses causes, expliquant que l’avenir (c’est-à-dire la politique) social et environnemental des villes constitue la question environnementale essentielle de ce début du XXIème siècle.
On comprend ici en quoi la réappropriation des déplacements opérés par le Mouvement de justice environnementale pourrait participer à transformer certaines situations : face à ces inégalités sociales et environnementales auxquelles s’ajoute la suspicion rencontrée plus haut selon laquelle les populations des zones urbaines pauvres concernées ne s’intéresseraient pas aux enjeux environnementaux, voire qu’elles seraient les premières à dégrader leur environnement, il s’agirait de poser la question de savoir de quel environnement on parle. De (se) demander à quoi souhaite-t-on les (nous) intéresser ? Par exemple, les habitants de Saint Denis ne se désintéressent absolument pas de l’habitat insalubre dans lequel vivent presque/plus d’une personne sur trois, comportant notamment de hauts risques d’incendie, et de manière générale, des nombreuses nuisances environnementales accumulées sur leur commune, qu’elles proviennent de l’autoroute à ciel ouvert traversant leur commune, de la pollution des sols laissée par d’anciennes industries, ou aujourd’hui de l’installation sans concertation d’immenses data centers16. Au lieu de prétendre, de façon tout à fait condescendante, mais tout autant inefficace, ‘intéresser’ les populations pauvres aux enjeux écologiques (notamment à travers des projets de sensibilisation et d’éducation), une problématisation en termes de justice environnementale appelle à renverser cette question – « qui doit être sensibilisé et à quoi ? », rendant capable collectivement de se réapproprier socialement les enjeux écologiques17.
Yearning
Je conclurai par la troisième forme de dépossession laissée jusqu’à présent de côté, que l’on pourrait formuler ainsi : l’urgence due au réchauffement climatique rendrait désormais la question des inégalités environnementales secondaire. Autrement dit, hier, la question des inégalités environnementales n’ajoutait rien à la problématique environnementale (sinon un anthropocentrisme) ; aujourd’hui, l’importance du réchauffement climatique viendrait définitivement reléguer au second plan cette question, en raison d’une prétendue vulnérabilité partagée entre riches et pauvres face à ce dernier. Si l’on accepte à présent d’admettre qu’une partie des populations défavorisées puisse être sensible aux enjeux écologiques, voire que l’on reconnaît de manière générale la pertinence de cette question des inégalités environnementales, on ajoutera que ce n’est pas du côté de ces mobilisations que l’on peut espérer trouver des réponses à la mesure des questions (vraiment) urgentes concernant notamment la sauvegarde de la biodiversité ou l’adaptation au réchauffement climatique.
Comment répondre à la violence de cette troisième dépossession ? C’est-à-dire comment répondre aussi de sorte à se protéger du désespoir comme de l’usure de ces attaques ? On se tournera pour cela vers les féministes, expertes en attaques violentes et sans fin, et l’on héritera d’elles la réponse précieuse composée de cris de douleur et de colère vis-à-vis du fait que ce lien capital entre écologie et pauvreté soit encore une fois mis en cause. Ces cris appartiennent à ce que l’on appelle en anglais « yearning », un terme issu de la spiritualité black que les féministes noires américaines ont repris pour exprimer la complexité du sentiment associé à une situation d’oppression et dépourvu de victimisme18. Cette notion me semble parfaitement saisir ce dont il est question ici à travers cette triple dépossession, c’est-à-dire traduire la tonalité juste de la disposition affective et politique des personnes engagées dans ces combats, à savoir celle d’une plainte active, tout d’abord devant le scandale que constituent toutes ces vies volées, plainte active ensuite face à la nécessité de se battre pour que soit reconnue la dimension politique de ces conflits ; plainte active enfin à l’égard de cette ultime forme de dépossession consistant à minorer cette dimension sociale de la crise écologique.
Yearning exprime tout à la fois la colère et la tristesse de voir que ces liens entre enjeux environnementaux et inégalités sont encore et toujours combattus, et ce malgré l’urgence, précisément. Face aux conséquences du réchauffement climatique, ces inégalités risquent bien au contraire d’être de plus en plus violentes et de donner lieu à des réponses toujours plus « barbares »19, passant par des politiques d’abandon des populations les plus vulnérables (qui n’ont pas les moyens de partir si besoin est, mais aussi de se soigner, d’accéder à une énergie toujours plus chère, ou encore d’habiter dans des endroits salubres et décents, etc.). Qu’est-ce qui est donc urgent, si ce n’est de faire une place à cette question ? « Yearning ! » devant la difficulté de faire entendre cette position fragile parce que complexe et exigeant du temps pour être déployée, face à l’assurance tout terrain d’un environnementalisme des riches, « yearning ! » comme appel à toutes ces vies volées passées et à venir, c’est-à-dire aussi à tous ces autres mondes possibles, pour continuer à se battre. C’est la raison pour laquelle, si les acteurs du Mouvement de justice environnementale refusent le nom d’écologistes, il me semble crucial au contraire de se réapproprier, « occuper », ce nom, cet usage participant à transformer ces opérations de dépossessions en mobilisations collectives.
à voir aussi
références
| ⇧1 | J.B. Fressoz, C. Bonneuil, L’événement Anthropocène, Paris, Seuil, 2013. |
|---|---|
| ⇧2 | Sur cette question, voir Anne Whiston Spirn, « Constructing Nature : the legacy of F. L. Olmsted », in W. Cronon (ed. by), Uncommun Ground, W. W. Norton and Company , Inc., 1995. |
| ⇧3 | G. Di Chiro, « La nature comme communauté, in E. Hache (dir.), Ecologie politique. Cosmos, communauté, milieux, Editions Amsterdam, traductions de C. Le Roy, 2012. |
| ⇧4 | Rappelons en effet que la naissance du mouvement écologiste aux Etats-Unis est liée en partie au travail de Rachel Carson dénonçant les dangers extrêmes de certains pesticides sur la santé humaine et celle de la faune (voir Printemps silencieux, traduction de J.-F. Gravand, Wildproject, 2011) ; de même, le premier ministère de l’écologie en France comportait le portefeuille de la santé avant que ce dernier ne lui soit retiré. |
| ⇧5 | Sur la fin de ce faux débat, Catherine Larrère, « Peut-on échapper au conflit entre anthropocentrisme et éthique environnementale ? », in A. Fagot-Largeault et P. Acot (dir.), L’éthique environnementale, Sens-éditions, 2000. |
| ⇧6 | Alors même que ces dernières, en particulier celle de Rawls, ne s’intéressent pas à l’écologie. Voir par exemple, Dale Jamieson, « Global environmental justice », in Morality’s progress (1994) ; Catherine Larrère, « Actualité de l’éthique environnementale : du local au global, la question de la justice environnementale », in H. S. Afeissa (dir.), Ecosophie, Ed. Dehors, 2009 ; Fabrice Flipo, « Les inégalités écologiques et sociales : l’apport des théories de la justice », Mouvements, oct-dec 2009 ; ou encore, David Blanchon et al., « Comprendre et construire la justice environnementale », Annales de géographie, 2009/1, n° 665-666. |
| ⇧7 | Isabelle Stengers, « Pragmatiques et forces sociales », Multitudes, 2005/4, n° 23. |
| ⇧8 | Comme le souligne encore Martinez-Alier, le Mouvement de justice environnemental a précisément contribué à transformer l’image « NIMBY » des manifestations environnementales populaires en des manifestations se battant pour un « Not in Anyone’s BackYard » (NIABY). Juan Martinez-Aliez, « Conflits de distribution écologique, identité et pouvoir », art. cit. Sur la notion de racisme environnemental, voir par exemple Robert D. Bullard, Confronting environmental racism. Voices from the grassroots, (ed. by), South End Press, 1993. Ce n’est pas la seule articulation fabriquée par ce mouvement : on peut penser aussi à celle qui a été élaborée entre mouvement environnemental et droit à la procréation pour toutes contre une version du problème de la surpopulation opposant populations riches et pauvres, cf. G. Di Chiro, « Environnementalismes vivants : politiques de coalition, reproduction sociale et justice environnementale », in E. Hache (dir.), Du monde clos à l’univers infini et retour. Essais cosmopolitiques, Editions Dehors, à paraître, 2014. |
| ⇧9 | Ramachandra Guha et Juan Martinez-Alier, « L’environnementalisme des riches », in E. Hache (dir.), Ecologie politique, Amsterdam, 2012. |
| ⇧10 | Joan Martinez-Aliez, « Conflits de distribution écologique, identité et pouvoir », in E. Zaccaï, P. Cornut, T. Bauler, Environnement et inégalités sociales, Ed. de l’Université de Bruxelles, 2007. |
| ⇧11 | Le terme consacré en français est « inégalités écologiques ». Sur l’histoire politique de cette différence terminologique, Geneviève Massard-Guilbaud, Richard Roger, « When environmental and social dimensions meet », in G. Massard-Guilbaud, R. Roger, Environmental and social justice in the city : historical perspectives, The white horse Press, 2011. |
| ⇧12 | Manifeste pour les ‘produits’ de haute nécessité, collectif, Editions Galaade, Institut du Tout-Monde, 2009. |
| ⇧13 | Ce Manifeste entre en résonnance avec les Trois écologies de Félix Guattari qui aurait, à coup sûr, célébré ce mouvement, Félix Guattari, Les 3 écologies, Galilée, 1989. |
| ⇧14 | Sur le mouvement anti-nucléaire, il faudrait notamment faire une place à la mobilisation des populations civiles victimes de pathologies liées aux essais nucléaires, notamment celles de Polynésie française, ayant rejoint un mouvement plus large des Iles du pacifique peu connu en France, contre la nucléarisation de cet espace insulaire par les grands pays industriels et ses effets sociaux et environnementaux, le Nuclear Free and Independant Pacific Movement. Valérie Kuletz, « The Movement for environmental justice in the Pacific Islands », in Joni Adamson, Mei Mei Evans and Rachel Stein (ed. by), The Environmental justice reader. Politics, poetics and pedagogy, The University of Arizona Press, 2002. |
| ⇧15 | Mike Davis, Le pire des mondes possibles, traduction de J. Mailhos, La découverte, 2007. |
| ⇧16 | Fabrice Flipo, Michelle Dobré et Marion Michot, La face cachée du numérique. L’impact environnemental des nouvelles technologies, Ed. L’échappée, 2013. On peut à cet égard souligner l’ironie sinon le cynisme d’avoir choisi la ville du Bourget pour accueillir la prochaine Conférence internationale sur le réchauffement climatique en 2015, considérée comme la conférence de la dernière chance après l’échec des négociations internationales à Copenhague en 2009 et devant la probabilité de plus en plus forte de dépasser les 4° confirmée dans le dernier rapport du GIEC. Mais on peut aussi y voir l’occasion/l’exigence de fabriquer d’ici 2015, une mobilisation s’appuyant précisément sur ces populations soit-disant indifférentes, c’est-à-dire sur les enjeux à la fois sociaux et environnementaux qui sont les leurs – entre autres, l’installation de centres de stockage des données informatiques consommant chacun l’équivalent d’une ville de 25 000 à 50 000 habitants en Seine-Saint-Denis, où une partie de la population est dans une très grande pauvreté énergétique, ou encore le choix du Bourget, premier aéroport d’affaires d’Europe, comme site de cette 21ème conférence sur le climat, symbole malvenu d’une Europe forteresse au sein du département comptant le plus grand nombre de personnes ayant dû faire face à une immigration économique subie. |
| ⇧17 | Ce qui est la définition même de l’empowerment « rendre celles et ceux qui participent à un collectif de penser, de prendre position, de créer ensemble ce dont aucun n’était capable isolément », I. Stengers, La sorcellerie capitaliste, La découverte/poche, 2007, p. 176. |
| ⇧18 | Bell Hooks, Yearning. Race, gender and cultural politics, South end Press, 1990. Voir aussi Maria Puig de la Bellacasa, Politiques féministes et construction des savoirs : « Pensez nous devons ! », L’Harmattan, 2012. |
| ⇧19 | Isabelle Stengers, Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient, Les Empêcheurs de penser en rond, 2009. |







