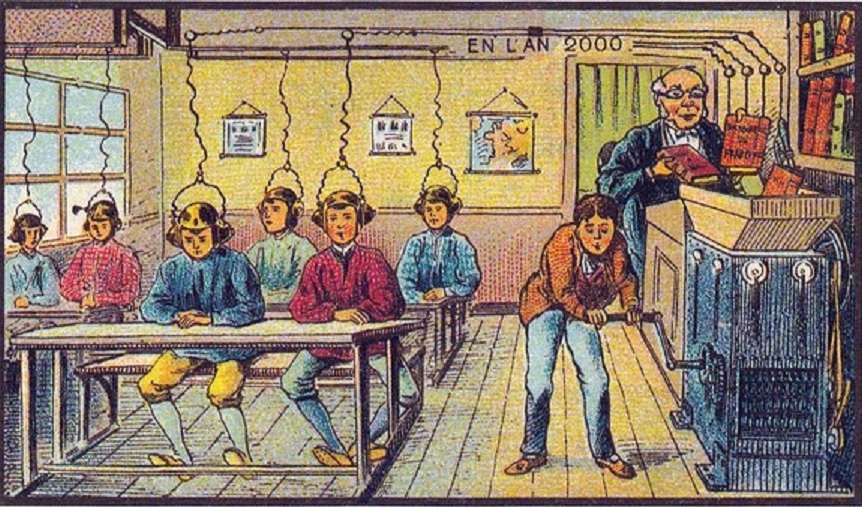
Comment lutter contre l’hégémonie capitaliste ?
Les anticapitalistes considèrent non seulement que le capitalisme est un système oppressif et antidémocratique mais qu’il existe une alternative viable et humaine. La montée de la démocratie de masse a placé les élites économiques et politiques devant une énigme. Comment, avec l’émancipation politique d’une fraction toujours plus grande de la population, pouvaient-elles maintenir un ordre social qui laissait encore tant de monde dans la pauvreté voire la misère ? La montée de la démocratie allait-elle signifier la fin du capitalisme, les travailleurs·ses étant largement majoritaires dans la population ?
Rétrospectivement, leurs craintes peuvent sembler paranoïaques : bien sûr, le capitalisme peut résister à un électorat plus large. Mais leur anxiété les a poussés à agir. En associant la répression à une défense énergique (et bien financée) du système, ils ont atténué les menaces les plus radicales auxquelles il était confronté. Ils ont fait passer la « démocratie capitaliste » pour du bon sens, le meilleur de tous les arrangements sociaux, ou du moins le meilleur de ceux qui sont possibles.
Comme le souligne Ralph Miliband dans l’essai suivant, publié pour la première fois en 1990 dans Socialist Register, le problème pour les classes possédantes est que la vie quotidienne de nombreuses personnes continue à les amener à remettre en question le statu quo. Les hommes politiques parlent de démocratie, d’égalité, d’opportunités, de prospérité, de sécurité, de communauté, d’intérêts communs, de justice, d’équité, etc. Or, la réalité, telle qu’elle est vécue par la majorité, est très différente voire opposée, puisqu’elle inclut l’expérience de l’exploitation, de la domination, de grandes inégalités dans toutes les sphères de la vie, des contraintes matérielles de toutes sortes et très souvent un grand manque spirituel.
Mais existe-t-il vraiment une alternative ? Miliband affirme avec force qu’il y en a une, et se livre à un plaidoyer profond en faveur du socialisme et d’une orientation politique marxiste, en répondant à la fois aux critiques de droite et aux sceptiques de gauche.
Shawn Gude
***
L’hégémonie, au sens où Gramsci l’entend, implique à la fois la coercition et le consentement. En tant que consentement, elle signifie la capacité des classes dominantes à persuader les classes subordonnées d’accepter, d’adopter et « d’intérioriser » les valeurs et les normes que les classes dominantes ont elles-mêmes adoptées et qu’elles considèrent comme justes et appropriées. Ceci pourrait être décrit comme le sens fort de l’hégémonie en tant que consentement. Une version plus faible est la capacité des classes dominantes à persuader les classes subordonnées que, quoi qu’elles puissent penser de l’ordre social dominant, et aussi aliénées qu’elles puissent être, toute alternative serait catastrophiquement pire et que, de toute façon, il n’y a pas grand-chose qu’elles puissent faire pour mettre en place une telle alternative. Aussi faible que soit cette deuxième version, elle n’est pas beaucoup moins efficace que la première pour consolider l’ordre social. Dans l’une ou l’autre version, cependant, l’hégémonie n’est pas une chose que l’on peut considérer comme définitivement et irréversiblement gagnée : au contraire, c’est quelque chose qui doit être constamment entretenu, défendu et reformulé.
Les classes dominantes des régimes capitalistes-démocratiques le comprennent très bien et ne considèrent pas l’hégémonie comme acquise une fois pour toutes. Toute l’histoire de ces régimes, depuis l’obtention du suffrage universel, la création de mouvements ouvriers nationaux et une compétition politique sérieuse entre les partis bourgeois et les partis ouvriers ou socialistes, a été marquée par la « fabrication du consentement » par les forces conservatrices et par leur lutte acharnée pour gagner les cœurs et les esprits de leurs populations subordonnées. Les sources de ces luttes ont été extrêmement variées, et leurs formes ont évolué, des plus sophistiquées et subtiles aux plus démagogiques. L’objectif, cependant, est toujours la ratification populaire de l’ordre social dominant et le rejet par la classe travailleuse (et tout le monde) de toute notion d’alternative radicale à cet ordre qui pourrait s’avérer viable. Il convient d’ajouter que cet objectif est également servi par des concessions réelles à la pression de la base, notamment dans le domaine des services sociaux : ce serait une grave erreur de considérer l’hégémonie en tant que consentement comme une simple question de mystification.
Pour l’hégémonie, une lutte permanente
Quoi qu’il en soit, la principale raison pour laquelle la lutte pour l’hégémonie en tant que consentement ne peut jamais être considérée comme définitivement gagnée dans les régimes capitalistes-démocratiques est qu’il existe un vaste décalage entre le message que les entreprises hégémoniques cherchent à diffuser et la réalité à laquelle est confrontée quotidiennement la grande majorité de la population à laquelle le message est principalement destiné. Le message parle de démocratie, d’égalité, d’opportunités, de prospérité, de sécurité, de communauté, d’intérêts communs, de justice, d’équité, etc. La réalité, par contre, telle qu’elle est vécue par la majorité, est très différente, et comprend l’expérience de l’exploitation, de la domination, de grandes inégalités dans toutes les sphères de la vie, des contraintes matérielles de toutes sortes, et très souvent un grand manque spirituel. La réalité peut ne pas être conçue et articulée en ces termes précis, mais elle est néanmoins ressentie de manière négative et produit de la frustration, de l’aliénation, de la colère, de la dissidence et une pression de la base pour la résolution des injustices. Un objectif crucial des efforts hégémoniques est d’empêcher ces sentiments de se transformer en une disponibilité pour des pensées radicales.
S’il n’y avait pas de décalage entre le message hégémonique et la réalité vécue, il serait évidemment beaucoup moins nécessaire, voire pas du tout nécessaire, de s’attaquer sans relâche à la conscience populaire. Il ne serait pas non plus nécessaire de tenir compte des efforts contre-hégémoniques : ces efforts seraient le fait d’individus isolés, que l’on pourrait qualifier d’excentriques et qui n’auraient aucun espoir d’obtenir une audience sérieuse. En fait, l’écart entre la rhétorique, même si elle est soutenue par des concessions réelles et la réalité telle qu’elle est vécue, fournit un très large terrain pour les efforts contre-hégémoniques. Le terrain est parfois plus favorable, parfois moins, mais il n’est jamais tout à fait stérile, étant donné la nature du capitalisme.
Ces efforts sont aussi divers dans leur forme que les efforts hégémoniques ; l’une des caractéristiques les plus remarquables de l’époque actuelle est la diversité de leurs sources. Par exemple, on a beaucoup parlé, à juste titre, au cours des dernières décennies, de la contribution tout à fait remarquable que les mouvements féministes, écologiques, antiracistes et autres « nouveaux mouvements sociaux » ont apportée à la perturbation du statu quo mental des pays dans lesquels ils ont fleuri. On doit supposer qu’ils continueront à affecter la culture politique et l’agenda politique de ces pays. Il fut un temps, pas très lointain, où l’on considérait comme acquis à gauche que la seule source de dissidence et de contestation « réelles » était la classe travailleuse, et plus particulièrement les luttes ouvrières. La présence des « nouveaux mouvements sociaux » sur la scène idéologique et politique a produit une prise de conscience générale à gauche qu’il s’agissait d’une aberration et que ces mouvements avaient une contribution majeure et indispensable à apporter.
En effet, la boucle est maintenant bouclée, et de nombreuses personnes à gauche sont maintenant persuadées que seuls les « nouveaux mouvements sociaux » sont en mesure de remettre en question le statu quo et que les mouvements ouvriers et socialistes sont trop ancrés dans des modes de pensée anciens (et obsolètes) pour pouvoir le faire. Cette perte de confiance dans les idées socialistes « traditionnelles », sans parler des organisations syndicales et politiques socialistes, a effectivement été le trait dominant de la culture politique de la gauche dans les années 80. « Les temps nouveaux », a-t-on proclamé avec insistance, exigent une nouvelle façon de penser et une nouvelle façon de penser exige l’abandon d’un grand nombre, voire de la plupart, des idées longtemps chères mais désormais sans intérêt, qui ont été au cœur de la tradition socialiste. Le message a été transmis dans de nombreuses versions différentes, mais il s’agit en fin de compte d’un retrait de la recherche et de la lutte pour une alternative socialiste au capitalisme.
Une contribution socialiste à la lutte contre l’hégémonie
Le présent essai est écrit avec la conviction qu’il s’agit d’une perspective gravement erronée, que les socialistes ont une contribution distinctive à apporter aux luttes contre l’hégémonie et que l’alternative socialiste qu’ils proposent est plus que jamais nécessaire dans la lutte contre l’hégémonie conservatrice. Bien sûr, cette contribution socialiste ne s’oppose en rien aux préoccupations des « nouveaux mouvements sociaux ». Au contraire, ces préoccupations, l’anti-sexisme, l’anti-racisme, l’écologie, la libération sexuelle, la paix, etc.., font partie de l’agenda socialiste. Il y a beaucoup de gens dans les « nouveaux mouvements sociaux » qui sont eux-mêmes socialistes et qui conçoivent leurs préoccupations comme liées au socialisme.
Mais la question que je veux soulever ici est de savoir quelles sont les positions fondamentales dont on peut dire aujourd’hui qu’elles constituent la contribution spécifique que les socialistes peuvent apporter aux luttes contre l’hégémonie. Ces positions doivent être réaffirmées sur au moins deux points. La première, comme on l’a déjà noté, est qu’elles sont aujourd’hui si souvent contestées à gauche, ou simplement ignorées. La seconde est que la crise des régimes communistes et l’effondrement de certains d’entre eux, a donné aux forces hégémoniques une merveilleuse occasion de proclamer non seulement que le communisme était mort ou mourant, mais que le socialisme, dans quelque version que ce soit, était dans le même état. Rien, d’un point de vue socialiste, ne pourrait être plus nécessaire que de contrer cela et de fournir un argument raisonné en faveur des principales propositions qui définissent le socialisme.
Le point de départ d’une telle argumentation doit être deux éléments étroitement liés : d’une part, il s’agit d’une critique radicale de l’ordre social dominant ; d’autre part, il s’agit d’affirmer qu’un ordre social entièrement différent, fondé sur des bases radicalement différentes, est non seulement souhaitable (ce qui est assez facile), mais possible.
Ces derniers temps, les critiques de la gauche à l’égard du capitalisme ont de plus en plus tendance à être fragmentaires et à se rapporter spécifiquement à des « problèmes » immédiats, à des lacunes et à des échecs dans une multitude de domaines. En d’autres termes, la critique de la gauche tend à être dirigée vers un aspect ou un autre du fonctionnement d’un ordre social dominé par le capitalisme, sans que cette critique soit liée à la nature du système dans son ensemble. Une critique socialiste, en revanche, se distingue par les liens qu’elle cherche toujours à établir entre des maux spécifiques et la nature du capitalisme, en tant que système entièrement orienté vers la recherche du profit privé, dont la dynamique et l’éthique imprègnent l’ensemble de l’ordre social et qui relègue nécessairement toutes les considérations autres que la maximisation du profit privé à une place subsidiaire, au mieux, dans l’ordre des choses.
Une critique socialiste, contrairement aux critiques libérales ou sociales-démocrates, ne traite pas les défaillances économiques, sociales, politiques et morales du système comme des déviations malheureuses de la normalité, mais au contraire comme des caractéristiques intrinsèques du système. C’est l’atténuation des maux par le biais de l’intervention publique et de la réglementation qui doit être considérée comme une déviation de la dynamique essentielle du capitalisme, et comme contraire à son esprit et à sa finalité. Il y a, de ce point de vue, une logique perverse dans l’argument « libertarien » contre toute intervention et réglementation de ce type : les « libertariens » ont simplement l’audace que les politiciens dévoués à la « libre entreprise » et à la loi du marché ne peuvent se permettre d’avoir.
Les socialistes soutiennent et exigent bien sûr des réformes au coup par coup. Mais ils proposent également une critique de la nature limitée et du caractère palliatif de ces réformes ; ils demandent un élargissement du champ des réformes et luttent contre les contraintes imposées aux réformes par le contexte capitaliste dans lequel elles se produisent ; ils mettent en garde contre l’illusion que les maux profonds générés par le système peuvent être véritablement guéris dans son cadre. Ainsi, une critique socialiste de « l’État providence » ne dénigre pas le moins du monde la valeur des réformes qui sont englobées dans cette rubrique mais elle souligne les insuffisances qui ne manqueront pas d’exister dans un système peu favorable à la fourniture collective. De même, une critique socialiste de la propriété publique souligne la nécessité de lui insuffler un esprit tout à fait différent de celui qui anime l’entreprise capitaliste, mais elle reconnaît également que, pour être pleinement réalisé, cela exige la transcendance du capitalisme lui-même.
Pour une alternative radicale possible
J’ai suggéré précédemment qu’une critique socialiste de l’ordre social dominant est toujours couplée avec l’insistance qu’une alternative radicale est non seulement souhaitable mais possible. « Une alternative radicale », telle que je la comprends, signifie simplement la création d’une société coopérative, égalitaire, démocratique et finalement sans classe, à reproduire en temps voulu dans le monde entier. Tout projet de ce type a toujours été totalement répugnant pour les antisocialistes du monde entier et ils l’ont dénoncé avec acharnement comme une absurdité utopique et une recette, quelles que soient les intentions de ses partisans, pour la création d’un ordre social répressif et totalitaire meurtrier. Cette opinion est cependant aujourd’hui très répandue dans de nombreux secteurs de la gauche. Ici aussi, il existe désormais une suspicion considérable à l’égard des transformations radicales que le socialisme implique indubitablement.
Il ne s’agit pas seulement de dire que le projet doit être conçu comme une affaire à long terme, comme un processus qui s’étend sur une très longue période et qui peut ne jamais être achevé. Tout cela relève du simple bon sens ; si le bon sens ne suffisait pas, l’expérience des régimes communistes montrerait bien que les changements sociaux à grande échelle sont une entreprise très difficile et complexe, même dans les meilleures circonstances, qui ne sont pas susceptibles d’exister partout et qui n’existaient certainement pas dans les pays où les communistes avaient pris le pouvoir. L’opinion que l’on trouve souvent à gauche aujourd’hui part d’une position différente, à savoir que nous ne savons pas vraiment où nous sommes, que nous ne savons certainement pas où nous devrions aller, que tenter d’imposer un « modèle » à ce que l’on appelle la réalité est dangereusement arrogant et que la notion même d’une alternative radicale à l’ici et au maintenant est chargée de conséquences dangereuses. Ainsi parle le « postmodernisme » et d’autres modes de pensée actuellement en vogue.
L’expérience des régimes communistes comporte de nombreuses leçons importantes pour les socialistes. Mais on ne peut pas en déduire que toute tentative de créer une société radicalement différente de ce que le capitalisme a produit est vouée au désastre. C’est une bonne propagande conservatrice que d’affirmer que la seule alternative au capitalisme est le type de régime qui a caractérisé le régime communiste. Mais il s’agit là d’une vision très réductrice de ce qui est possible en matière d’arrangements sociaux ; l’une des tâches de la contre-hégémonie est précisément d’insister, à l’aide de programmes, d’orientations politiques et de modes de comportement et d’organisation « préfiguratifs », sur la distance qui sépare le socialisme de l’expérience communiste.
Il n’y a évidemment aucun moyen de le prouver, si ce n’est dans la pratique. Cela permet aux conservateurs de souligner avec beaucoup de joie le fait, et c’est un fait, que nulle part le type de société préconisé par les socialistes bien intentionnés n’a vu le jour ; ce point est renforcé par le fait que des sociétés se prétendant socialistes ont été créées, mais n’ont pas été, c’est le moins que l’on puisse dire, de bons modèles de ce que devrait être une société socialiste. Ce point ne peut être ignoré, mais il signifie que le cas socialiste doit être présenté en tenant compte des nombreuses questions difficiles qu’il soulève. En d’autres termes, le projet doit être présenté sans les revendications naïves et invraisemblables qui ont souvent été avancées pour le socialisme. Le socialisme n’est pas une doctrine de salut instantané, avec la promesse d’une société parfaitement harmonieuse, sans conflits, dans laquelle tous les maux qui ont toujours affligé l’humanité seront miraculeusement dissipés. Ses prétentions sont plutôt plus modestes. Ce qu’elle offre, c’est la promesse d’un ordre social dans lequel les maux remédiables seraient au moins radicalement atténués et dans lequel l’altruisme et la fraternité seraient rendus possibles par un contexte tout à fait différent de celui fourni par le capitalisme.
À cet égard, il convient de souligner un point fondamental : le projet socialiste repose sur la prémisse que les « gens ordinaires » sont capables de se gouverner eux-mêmes et d’assurer la viabilité d’un ordre social coopératif, humain et rationnel. Il s’agit là aussi d’un message qui va à contre-courant d’une époque qui a baigné dans le sang. Le vingtième siècle a été un siècle de guerres, de massacres et d’horreurs à grande échelle, auxquels des masses de « gens ordinaires » ont participé de plein gré et auxquels des masses encore plus grandes de gens ont apporté leur soutien, ou du moins ont acquiescé. Après les bains de sang de la Première et de la Seconde Guerre mondiale et de toutes les autres guerres dont ce siècle a été témoin, après Auschwitz, le Goulag, Hiroshima et le Vietnam et une foule d’autres noms tristement célèbres, est-il vraiment logique de projeter une image rose de sociétés, voire d’un monde, peuplées d’humains capables de socialité, de coopération, d’altruisme, qui seraient guidés par des modes de pensée et de comportement rationnels ?
La réponse, en termes socialistes, n’est pas de nier la participation, le soutien ou l’assentiment des masses aux horreurs qui ont marqué le vingtième siècle ; mais plutôt de noter le fait crucial que ces horreurs n’ont pas été initiées par « les masses ». L’attribution immédiate de la culpabilité à tout le monde (« nous sommes tous coupables ») masque le fait que les grandes décisions politiques qui ont conduit à ces horreurs ont été prises par les dirigeants, avec très peu, voire aucune « contribution » des « masses ». Ce ne sont pas les « masses » qui ont décidé de construire des chambres à gaz, ou de construire le Goulag, ou de procéder à des bombardements massifs en Corée ou au Vietnam.
Le fait que les « masses » aient soutenu leurs dirigeants et participé aux entreprises que ces derniers ont créées montre bien que les « gens ordinaires » ne sont pas naturellement bons, ce qui n’est pas nouveau, et que beaucoup de gens peuvent facilement développer une vocation de bourreau. Cela donne à réfléchir, mais on ne peut pas en déduire que les gens sont foncièrement mauvais et incapables de socialité et d’altruisme. Ce que toute attribution de ce type – positive ou négative – omet, c’est l’importance du contexte dans lequel fleurissent les « bonnes » ou les « mauvaises » qualités. Au cœur de la perspective socialiste, il y a la conviction que rien dans ce domaine n’est réglé, prédéterminé, et que la nature humaine n’est pas implacablement maudite par une cruauté et une agressivité « innées ».
À cette conviction s’ajoute l’idée que les sociétés fondées sur la domination et l’exploitation, et en proie à des crises qu’elles ne peuvent résoudre, produisent inévitablement de profondes déformations pathologiques, dont le racisme, le sexisme, l’antisémitisme, la xénophobie, les haines ethniques, la cruauté et l’agressivité sont des manifestations courantes. Le socialisme (à ne pas confondre avec le stalinisme) offre le seul contexte possible dans lequel ces déformations peuvent être efficacement combattues et ainsi transformées en phénomènes marginaux et de plus en plus rares. « Socialisme ou Barbarie » est peut-être un slogan trop dramatique, mais dans la mesure où la barbarie est compatible avec une grande sophistication technologique et culturelle, la notion de Socialisme ou Barbarie Civilisée incarne une vérité que les luttes contre-hégémoniques doivent souligner.
Alternative et propriété
Toute discussion sérieuse sur les alternatives socialistes doit, malheureusement, aborder une question extrêmement difficile, à savoir la question de la propriété publique. Je dis « malheureusement », non pas parce qu’elle est difficile, bien qu’elle le soit, mais parce qu’il ne s’agit d’un sujet particulièrement excitant qui ne suscite pas beaucoup d’inspiration. Ce sujet ne compte pas beaucoup de soutien, même à gauche.
La propagande conservatrice, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les mesures de nationalisation faisaient partie du programme des partis sociaux-démocrates, a réussi à faire de l’idée de propriété publique un synonyme de bureaucratie, d’inefficacité, de paresse et de négligence du consommateur. Cette propagande a été renforcée par les formes peu attrayantes des nationalisations mises en place par les sociaux-démocrates. De plus, l’expérience communiste, ici aussi, a servi à renforcer l’opinion selon laquelle l’entreprise d’État est inefficace et qu’elle constitue également un sinistre soutien supplémentaire à un étatisme débridé. De nos jours, la gauche n’est peut-être pas totalement réconciliée avec l’entreprise capitaliste, mais elle est devenue extrêmement incertaine quant à toute alternative à celle-ci. Cette incertitude a été considérablement renforcée par les nouvelles difficultés que les mesures de nationalisation seraient censées entraîner à l’ère de la mondialisation capitaliste.
Les efforts contre-hégémoniques exigent impérativement une discussion approfondie sur ces questions et une défense résolue de la propriété publique comme fondement absolument indispensable d’un ordre social radicalement différent du capitalisme. Il faut dire, par exemple, que la propriété publique n’est pas synonyme de propriété d’État, et qu’elle peut et doit prendre de nombreuses formes différentes, de la propriété d’État des sommets de l’économie à la propriété municipale et coopérative. La propriété publique ou sociale, même sous ses différentes formes, ne doit pas non plus être globale. Aussi désagréable que cela puisse être pour les puristes, il est souhaitable qu’un secteur privé, avec une multitude de petites entreprises, répondant à une variété de besoins, continue d’exister à côté du secteur public : l’intérêt de cette « économie mixte » est que le secteur public doit l’emporter largement sur le secteur privé.
L’affirmation que l’entreprise publique est intrinsèquement bureaucratique, inefficace, paresseuse, etc., n’est que pure propagande et préjugés Il existe de nombreux exemples, tirés de nombreux pays, y compris des pays communistes, qui montrent qu’il n’en est rien. Quant aux dangers d’un étatisme renforcé, tout dépend de la nature du régime dans lequel se trouve l’entreprise publique. Un régime autoritaire, dans lequel l’État domine effectivement la société, ne fera guère des entreprises publiques des modèles de pratique démocratique. Un régime capitaliste-démocratique, pour sa part, conçoit ces entreprises en termes capitalistes plutôt que démocratiques et éprouve donc aussi peu de sympathie que les entreprises privées aux pressions en faveur d’un contrôle démocratique. Un régime socialiste, par contre, devrait, en fait, il serait dans l’obligation, d’inclure l’entreprise publique dans la démocratisation générale de la vie qu’il chercherait à encourager.
L’internationalisation croissante de la vie économique ne peut pas non plus rendre impossible le transfert à la propriété publique de secteurs stratégiques de l’économie nationale. Elle complique sans doute le processus, mais l’idée qu’elle est synonyme de désastre, de ruine et de chaos est, dans ce cas comme dans celui d’autres politiques et mesures qui vont à l’encontre des intérêts puissants et des modes de pensée conventionnels, le fruit d’un parti pris idéologique plutôt que d’une évaluation sérieuse.
Pourtant, il y a ici des problèmes suffisamment aigus pour exiger une réponse convaincante à la question : à quoi bon ? Quel est l’intérêt d’une entreprise aussi exigeante et délicate ?
La réponse se compose d’une combinaison de facteurs économiques, politiques et moraux qui ne peuvent être dissociés de façon nette.
Dans la mesure où l’un des objectifs fondamentaux du socialisme est la création d’une société authentiquement démocratique, il ne peut admettre l’existence d’une formidable concentration de pouvoir entre les mains d’un petit groupe de personnes, qui exercent ce pouvoir avec très peu de contrôle extérieur. Mais tel est précisément le pouvoir exercé par les élites dans les sociétés capitalistes : la concentration économique renforce ce pouvoir chaque jour qui passe.
Les élites dirigeantes capitalistes elles-mêmes ont, bien sûr, tendance à se moquer de cette notion et à souligner les contraintes auxquelles elles sont soumises par l’État, leurs actionnaires, leurs clients, l’opinion publique, le marché, etc.. Il est vrai que leur pouvoir n’est pas absolu et qu’elles ne forment pas un bloc parfaitement cohérent. Mais c’est aussi un mensonge éhonté que de prétendre que parce que le pouvoir capitaliste n’est pas absolu ou parfaitement cohérent, il n’est pas très grand. Au contraire, la puissance du pouvoir capitaliste affecte profondément tous les aspects économiques, politiques et culturels des sociétés, sans parler de son impact sur ce que l’État fait ou ne fait pas. C’est à cet égard une bonne illustration du sens de l’obscurcissement hégémonique que ses idéologues aient pu entretenir l’idée que les « intérêts particuliers » qui avaient un réel pouvoir dans la société et étaient capables de la « rançonner » étaient les syndicats plutôt que les intérêts capitalistes.
Le pouvoir du capital fait de la « démocratie capitaliste » une contradiction dans les termes, une formulation chargée de tensions et de double langage. Car la démocratie, dans n’importe quel sens, sauf un sens formel et guindé, exige une égalité approximative entre les membres de la société : le pouvoir capitaliste l’exclut. Elle exige également que le pouvoir soit orienté vers des objectifs démocratiquement déterminés par la société et qu’il soit exercé par des représentant.e.s responsables de leurs actes. Les entreprises capitalistes échappent à cette exigence.
Les détenteurs du pouvoir des entreprises capitalistes ne peuvent pas être blâmés pour cela. Ils sont eux aussi prisonniers d’un système dont la rationalité exclut autant qu’elle le peut toute considération autre que la maximisation du profit. L’idée qu’il est certain que cela produira les meilleurs résultats possibles pour tout le monde est démentie par toute l’histoire du système. En effet, tout au long de cette histoire, il a été nécessaire que l’État intervienne pour au moins atténuer les effets socialement néfastes de ce que les capitalistes, à la recherche du profit privé, faisaient subir à leurs travailleur.se.s, aux consommateurs et à la société en général. Mais cette intervention, destinée notamment à sauver le capitalisme de lui-même, ne peut (et n’est pas destinée à) remédier au défaut crucial et inhérent au système, à savoir le fait qu’il n’est pas conçu pour assurer l’utilisation socialement bénéfique des immenses ressources qu’il a lui-même engendrées. Sa capacité de production a été et reste véritablement prodigieuse et elle constitue la base de sociétés humaines. Mais le capitalisme, bien qu’ayant créé cette base, est lui-même le plus grand obstacle à la réalisation de telles sociétés.
Il y a beaucoup de gens à gauche qui acceptent tout cela, et plus encore, mais qui soutiennent que les échecs, les défauts et les déchéances du capitalisme exigent, comme remède, une plus grande intervention de l’État, une réglementation, une direction et une interdiction, plutôt que la propriété publique, qui est déclarée sans intérêt. C’est évidemment un argument séduisant, puisqu’il semble éliminer si facilement toutes les grandes complications et tous les problèmes qui ne manqueront pas d’accompagner la mise en œuvre de mesures de propriété publique, même dans des conditions où elle jouit d’un large soutien. Cet argument est d’autant plus séduisant qu’il a déjà été possible de réglementer en partie le capitalisme.
Le problème, cependant, est que cette intervention n’a pas porté atteinte de manière très significative à la liberté des capitalistes de prendre des décisions d’importance majeure au niveau local, régional, national et international sans en référer à qui que ce soit. Une mesure plus radicale d’interventionnisme est possible dans des circonstances de crise, mais il est difficile de la maintenir efficacement, du moins dans des conditions capitalistes-démocratiques, contre l’opposition, la mauvaise volonté, le contournement et le sabotage qu’elle ne manquera pas de rencontrer de la part des capitalistes. De toute évidence, l’interventionnisme ne change pas non plus le caractère essentiel et la dynamique du capitalisme. En bref, l’intervention et la réglementation, aussi nécessaires soient-elles, ne peuvent se substituer à la propriété publique, si l’objectif est bien la transformation radicale du système.
A cet égard, la réhabilitation de la propriété publique doit être une tâche majeure des luttes contre-hégémoniques dans une perspective socialiste. Étant donné l’état actuel de la question, cela risque d’être une entreprise longue et ardue, mais c’est une contribution essentielle que les socialistes doivent apporter. Les socialistes doivent aussi, de toute évidence, apporter des réponses réalistes aux questions posées par le rapport entre le plan et le marché. La planification fait partie du projet socialiste sur le plan économique et politique. Mais comment planifier, et jusqu’à quelle hauteur, restent des questions prioritaires dans l’agenda socialiste.
Propriété et travail
Il y a une autre raison, plutôt différente, pour laquelle la transcendance du capitalisme par la création d’un secteur public prédominant est nécessaire, à savoir que c’est la seule façon d’initier l’un des objectifs cruciaux du socialisme : l’abolition du travail salarié.
Par travail salarié, on entend ici le travail effectué pour un salaire au service d’un employeur privé qui a le droit, en vertu de sa propriété ou de son contrôle des moyens de travail, de disposer du surplus produit par les travailleur.se.s comme il l’entend, et sans aucune référence aux personnes qui ont produit ce surplus. En d’autres termes, l’abolition du travail salarié signifie la fin d’un système dans lequel les gens sont employés dans le seul but d’enrichir leurs employeurs. Le travail salarié ainsi compris est bien sûr l’essence du capitalisme.
On dira aussitôt, à juste titre, que l’exploitation inhérente au travail salarié est également possible, et peut même être bien pire, aux mains de ceux qui contrôlent les entreprises publiques: la propriété publique n’entraîne donc pas la fin du travail salarié. Cette affirmation ne tient cependant pas compte d’une différence cruciale entre la propriété privée et la propriété publique. La propriété publique ne signifie pas automatiquement la fin du travail salarié mais l’exploitation sous ses auspices peut être considérée comme une déformation de celui-ci et peut être évitée par le biais d’un contrôle démocratique. L’exploitation, par contre, est le but même de l’entreprise capitaliste : elle peut, sous ses auspices et par le biais d’une intervention extérieure, être atténuée, mais elle ne peut être éliminée. La propriété publique ou sociale sous contrôle démocratique offre la possibilité et la promesse de réaliser l’abolition du travail salarié. Cette promesse et cette possibilité sont rigoureusement exclues par la nature même du capitalisme.
Ce point peut être illustré par une référence au travail des esclaves. Les conditions dans lesquelles le travail des esclaves s’est déroulé au cours de l’histoire ont varié considérablement, les esclaves étant traités plus humainement ici et moins humainement là. Mais l’esclavage lui-même a perduré, et jusqu’à il n’y a pas si longtemps, il était généralement considéré comme tout à fait « naturel ». Il ne nécessitait pas d’être atténué mais aboli.
Le travail salarié n’est pas un travail d’esclave. Mais s’il peut lui aussi être atténué, et s’il est considéré comme tout à fait « naturel », il doit être aboli. Cela ne peut se faire très rapidement, mais ce n’est pas une raison pour ne pas entamer le processus le plus tôt possible et mettre ainsi en marche un type nouveau et très différent de « rapport de production ». En temps voulu, et avec la pratique généralisée de ces nouveaux rapports, la notion d’une personne travaillant pour l’enrichissement personnel d’une autre sera considérée comme aussi odieuse et « contre nature » que la notion d’une personne en possédant une autre.
Le plus grand succès des idéologues et des politiciens conservateurs dans leur lutte pour l’hégémonie a peut-être été l’appropriation de la démocratie comme leur cause et leur préoccupation premières. C’est d’autant plus remarquable que le conservatisme s’est historiquement battu bec et ongles contre les avancées démocratiques et que, lorsqu’il a été contraint de battre en retraite, il s’est toujours efforcé de réduire autant que possible le sens et la portée des concessions qu’il a dû faire. Mais le succès hégémonique à cet égard n’est peut-être pas si remarquable après tout, étant donné la nature des régimes communistes et l’opportunité que leur caractère répressif et antidémocratique offrait aux idéologues conservateurs de proclamer qu’en s’opposant au communisme, ils défendaient la démocratie contre ses ennemis de gauche, que ces ennemis s’appellent communistes, socialistes ou autres.
Extension ou réorganisation de la démocratie ?
L’une des principales tâches des efforts contre-hégémoniques est clairement d’exposer la superficialité de ces proclamations démocratiques, d’indiquer l’étroitesse de la signification que les conservateurs et les libéraux, ainsi qu’une grande partie du discours social-démocrate, attachent à la démocratie et d’indiquer également les limitations paralysantes qui affectent les formes et les processus démocratiques dans les sociétés dominées par les classes. Il est également nécessaire de souligner que la démocratie bourgeoise n’est jamais en sécurité entre les mains de la bourgeoisie, non seulement dans les périodes de grande tension sociale, lorsque les éléments autoritaires qui font partie de la démocratie bourgeoise se manifestent, mais aussi en temps « normal », lorsque l’hégémonie en tant que coercition cohabite en permanence avec l’hégémonie en tant que consentement. Encore une fois, une partie de la critique socialiste de la démocratie bourgeoise doit être le confinement de cette dernière à des formes strictement « politiques », alors que la démocratie, en termes socialistes, est conçue comme une force omniprésente dans tous les domaines de la vie.
Il est tout à fait nécessaire d’argumenter tout cela, et plus encore, en détail. Mais cela laisse ouverte une question très importante, que les socialistes ont eu du mal à aborder. Il s’agit de savoir si la démocratie socialiste est essentiellement une extension radicale de la démocratie capitaliste, ou si elle constitue un système entièrement différent, qui peut être défini en termes de démocratie semi-directe.
La gauche sociale-démocrate a traditionnellement approuvé la démocratie capitaliste et n’a cherché qu’à améliorer marginalement son fonctionnement. C’est tout à fait logique : l’adaptation au capitalisme est ici parallèle à l’adaptation à la démocratie capitaliste. Pour leur part, les partis communistes ont connu une évolution en deux phases distinctes. Depuis leur création dans les années qui ont immédiatement suivi la Première Guerre mondiale jusqu’au passage au Front Populaire au milieu des années trente, ils ont couplé leur dénonciation en bloc de la démocratie bourgeoise comme étant une imposture totale avec un engagement à la remplacer par une version locale du modèle soviétique, qui était défendu comme étant incommensurablement plus démocratique que la démocratie bourgeoise. Dans une deuxième phase, ils ont abandonné cette position et ont accepté à toutes fins pratiques le cadre de la démocratie bourgeoise, avec diverses propositions pour sa démocratisation ultérieure : c’est leur position aujourd’hui.
Cette position « réformiste » était catégoriquement rejetée par d’autres sections de la gauche marxiste, qui s’accrochaient avec un dévouement sans faille à la vision d’un ordre démocratique dans lequel le pouvoir populaire serait à peine médiatisé par des représentant.e.s qui seraient des délégué.e.s constamment responsables devant ceux et celles qui les avaient choisis et révocables par eux et par elles . C’était bien sûr la vision évoquée par Marx dans sa défense élogieuse de la Commune de Paris dans La guerre civile en France en 1871. Cette vision a également été présentée de manière beaucoup plus détaillée par Lénine dans L’État et la révolution en 1917. Il s’agissait en effet (ou plutôt il s’agirait, si elle avait jamais été réalisée) d’une forme de régime entièrement nouvelle, dans laquelle le pouvoir jusqu’alors accaparé par l’État serait réapproprié par ceux et celles à qui il devrait revenir de droit, à savoir le peuple, qui ne se contenterait pas de gouverner, mais qui gouvernerait aussi, l’État étant dans un processus de décomposition rapide.
Aussi séduisante que soit cette vision, elle représente un saut dans un avenir lointain et ne peut être considérée comme une vision réaliste du type de régime qui serait nécessaire à la construction d’une société socialiste. Un tel régime accueillerait et encouragerait sans aucun doute une grande extension de la participation et du pouvoir populaires. Il chercherait à démocratiser radicalement l’appareil d’État mais il aurait également besoin d’un État qui ne soit pas, dans le vrai sens du terme, « en train de dépérir ».
L’État serait représentatif, responsable, contrôlé et circonscrit. Il aurait néanmoins besoin de beaucoup de pouvoir pour s’occuper de toutes les fonctions que l’État, aux niveaux local, régional et national, est seul capable de remplir. La moindre de ces fonctions ne serait pas le règlement des conflits qui ne manqueraient pas de surgir même dans une société démocratique libérée des entraves du capital. C’est également à l’État qu’incomberait en dernier ressort le devoir de protéger les droits des minorités et de veiller à ce que le pouvoir populaire ne soit pas exercé de manière arbitraire. Le pouvoir populaire et le pouvoir de l’État, dans cette perspective, se compléteraient et se contrôleraient également, selon des procédures convenues.
Loin d’aider les marxistes dans les luttes contre-hégémoniques pour la démocratie, la vision d’un ordre social entièrement nouveau fondé sur la démocratie semi-directe a eu tendance à les rendre inconscient.e.s de la nécessité d’explorer sérieusement les moyens par lesquels les socialistes devraient s’attaquer aux vastes problèmes que la notion d’un système authentiquement démocratique ne peut manquer de poser. Une telle exploration, menée sobrement et sans rhétorique démagogique, est une partie essentielle des efforts contre-hégémoniques.
En attendant, il y a des droits démocratiques et civiques à défendre contre les forces conservatrices qui cherchent constamment à les restreindre. Les socialistes ne sont pas seuls dans cette lutte pour la défense de ce que l’on appelle à tort les droits bourgeois. Les socialistes devraient en être les partisans les plus résolus et les plus attachés à leurs principes et les plus fervents défenseurs de leur extension.
Jusqu’à présent, la discussion s’est concentrée sur les préoccupations socialistes au sein des sociétés capitalistes. Mais le socialisme a toujours eu une forte dimension internationale et internationaliste. Qu’est-ce que cela signifie aujourd’hui ? Qu’est-ce qui, le cas échéant, distingue l’internationalisme socialiste des autres versions de l’internationalisme et dont on peut dire qu’il constitue une contribution socialiste spécifique aux luttes contre l’hégémonie ?
La nécessité de l’internationalisme
Ces dernières années, Mikhaïl Gorbatchev a cherché avec beaucoup d’éloquence à définir le type d’internationalisme dont le monde a besoin aujourd’hui et il l’a fait en termes de valeurs et d’aspirations universelles, au-delà des frontières des nations, des classes et des croyances : des valeurs et des aspirations relatives à la paix, au désarmement, à la protection de l’environnement, etc. Ce sont effectivement des valeurs universelles et les socialistes y souscrivent évidemment. Mais cette adhésion ne peut pas être considérée comme définissant à elle seule l’internationalisme socialiste (et d’ailleurs Gorbatchev ne suggère pas qu’elle le puisse). L’internationalisme socialiste doit partir du fait regrettable mais crucial que, quelle que soit l’adhésion des décideurs des pays capitalistes aux valeurs universelles, ils sont mus par des considérations très différentes en ce qui concerne les affaires internationales.
Au premier rang de ces considérations, depuis la révolution bolchevique et surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, se trouve la détermination des principaux gouvernements capitalistes à contenir, freiner ou écraser les mouvements de réforme radicale et de révolution dans le monde entier et à contenir, freiner, écraser ou mettre au pas les gouvernements qui ont l’intention de poursuivre des politiques que ces gouvernements capitalistes désapprouvent. Une autre façon d’exprimer le même point est de dire que, particulièrement depuis 1945, il existe un état de guerre globale, ou une guerre civile internationale, entre les grandes puissances capitalistes, dirigées par les États-Unis, d’une part, et les mouvements et gouvernements auxquels j’ai fait référence, d’autre part. Ce conflit a pris de nombreuses formes différentes, économiques, politiques, culturelles, militaires. Il a défini une grande partie de la réalité des relations internationales, sans parler de ce qu’il a signifié pour les pays concernés, pendant la meilleure (ou plutôt la pire) partie de ce siècle.
La guerre froide a fait croire que le conflit était avant tout une affaire de confrontation entre les États-Unis et l’Union soviétique et leurs alliés respectifs. Un assaut hégémonique massif sur la conscience des peuples du « monde libre » a transformé en un concept indiscutable faisant partie de la sagesse conventionnelle l’acception que la confrontation était basée sur les conceptions agressives et expansionnistes de l’Union soviétique. En fait, il n’en a jamais été question. La véritable guerre, parfois froide et souvent meurtrière, était toujours celle qui opposait les forces conservatrices, locales et extérieures, aux forces, notamment mais non exclusivement dans le « tiers monde », qui cherchaient à transformer le statu quo; cette volonté de transformation était inacceptable pour ces forces conservatrices.
Dans cette perspective, l’effondrement des régimes communistes en Europe de l’Est (et son effondrement probable ailleurs) constitue clairement un grand renforcement de l’espoir nourri par les forces conservatrices que le monde pourrait être façonné (ou remodelé) à une image acceptable pour elles. Il y a maintenant de très bonnes chances que certains pays communistes au moins s’orientent vers la restauration du capitalisme : certains d’entre eux sont déjà bien avancés sur cette voie. Il est également fort probable que les pays du « tiers monde » qui avaient auparavant proclamé leur attachement au socialisme et au « marxisme-léninisme » suivent la même voie. Il n’est pas étonnant que les défenseurs du capitalisme célèbrent une victoire glorieuse et proclament la fin du socialisme, ce qui est aussi ce que l’on entend par « fin de l’histoire ».
Une telle célébration et proclamation est, cependant, plutôt prématurée. Le communisme de type soviétique, avec son économie planifiée centralisée et son système politique monopolistique à parti unique, a disparu ou est en voie de disparition, et ne sera pas ressuscité. Mais l’idée qu’il s’agit de la fin des efforts socialistes et des progrès éventuels du socialisme ne tient pas compte d’un fait essentiel. Il s’agit du fait que, malgré l’apothéose actuelle du capitalisme, celui-ci n’a résolu aucun des problèmes qui nourrissent les aspirations et les luttes socialistes. Étant donné les défauts inhérents et inaltérables du capitalisme, il n’y a aucune raison de douter que la recherche d’alternatives radicales se poursuivra. Ces efforts sont soumis à des phases de progression et de recul et les années 1970 et 1980 ont, sans aucun doute, été une phase de recul. Mais croire que cela est irréversible est naïvement irréaliste. Personne ne peut dire quand l’avancée reprendra, ni quelles formes elle prendra ; mais elle reprendra.
C’est à la lumière de la lutte permanente à l’échelle mondiale des forces conservatrices contre les forces de réforme radicale et de révolution que l’internationalisme socialiste doit être compris. Cela n’exclut pas de s’intéresser aux grandes (ou petites) questions et causes « humanistes ». Cela n’exclut pas, bien entendu, non plus une collaboration étroite avec des groupes et des mouvements principalement intéressés par ces questions et ces causes. Mais les socialistes ont néanmoins leurs propres perspectives à faire valoir dans le domaine des rapports et des conflits internationaux. Leur tâche la plus évidente est de susciter le soutien des mouvements et des régimes qui sont soumis à l’hostilité et à la déstabilisation des forces conservatrices dans leur pays et à l’étranger. Une autre tâche consiste à faire progresser les explications socialistes des racines de l’interventionnisme dans lequel les États-Unis et leurs alliés ont été et sont engagés à travers le monde. Dans aucun domaine, l’obscurcissement hégémonique, la désinformation et le mensonge pur et simple ne sont plus courants que dans ce domaine.
Il convient d’ajouter que cela ne signifie nullement que l’internationalisme socialiste résout automatiquement tous les problèmes qui se posent fréquemment en rapport avec le soutien qu’il exige. Il existe des mouvements qui proclament haut et fort leur engagement libérateur et anti-impérialiste, mais dont les références, d’un point de vue socialiste, peuvent être extrêmement douteuses. De même, les gouvernements issus des luttes contre la tyrannie et l’impérialisme peuvent s’avérer être eux-mêmes des tyrannies vicieuses, malgré leur rhétorique anti-impérialiste. Le régime iranien en est un exemple évident.
Cela signifie que le soutien fondé sur l’internationalisme socialiste, même dans les cas les plus louables, ne peut jamais être totalement inconditionnel. Staline a un jour décrit un internationaliste comme « celui qui est prêt à défendre l’URSS sans réserve, sans hésiter, inconditionnellement ».. Cette description a longtemps été approuvée et suivie par les communistes du monde entier. L’internationalisme socialiste n’implique pas un tel abandon des facultés critiques en faveur d’un quelconque mouvement ou régime.
Il y a évidemment bien d’autres questions que celles qui découlent de l’exigence de solidarité internationale que l’internationalisme socialiste ne résout pas automatiquement et qui sont susceptibles de faire l’objet de positions diverses et divergentes. L’une de ces questions a trait aux arrangements institutionnels au-delà de l’État-nation. Les socialistes ne peuvent se préoccuper de la préservation de la « souveraineté » nationale en tant que telle. En même temps, ils ne peuvent être indifférents à des arrangements qui, comme dans le cas de la Communauté Economique Européenne et de la pression en faveur d’une structure fédérale pour ses membres, sont susceptibles de confirmer et de solidifier l’hégémonie capitaliste dans les pays concernés. D’un point de vue socialiste, il se pourrait bien que la position la plus acceptable ne soit ni une insistance sur la « souveraineté » nationale, ni une acceptation du fédéralisme sous les auspices capitalistes, mais des structures confédérales régionales dans lesquelles un degré de coopération institutionnalisée entre les pays membres serait allié à un haut degré d’autonomie dans la détermination des grandes questions de politique.
Peut-être plus immédiatement, l’internationalisme socialiste exige la promotion des liens les plus étroits possibles entre les mouvements socialistes (et les mouvements syndicaux) par-delà les frontières dans le but d’un renforcement mutuel et de l’élaboration de politiques communes. La nécessité d’une telle coopération a longtemps été évidente, mais en termes d’efficacité réelle, elle est restée une aspiration largement non réalisée. Compte tenu de l’internationalisation croissante du capital, elle est aujourd’hui plus urgente que jamais. Les chances de la faire progresser sont aujourd’hui meilleures qu’elles ne l’ont été depuis 1917, étant donné l’atténuation des divisions qui ont affligé les mouvements de gauche par la suite.
Retour au marxisme
Il fut un temps où beaucoup, sinon la plupart des socialistes à la gauche de la social-démocratie auraient affirmé sans hésitation que la base indispensable des luttes contre l’hégémonie était le marxisme : sur aucune autre base, aurait-on dit, de telles luttes ne pouvaient être efficacement menées, ou même prises au sérieux par les marxistes. Les affirmations de ce genre étaient basées sur des présupposés simples : l’une d’entre elles était que le marxisme, ou plutôt le « marxisme-léninisme », était un corps de pensée établi et pratiquement sans problème, qui détenait des réponses concluantes à toutes les questions, de l’astronomie à la zoologie, par ordre alphabétique. Un autre présupposé était que le fait de ne pas accepter ces réponses démontrait un alignement déplorable sur la pensée bourgeoise.
À l’exception des quelques régimes communistes où une telle approche de ce qui passe pour du marxisme peut encore être imposée, notamment en Chine, le marxisme s’est depuis longtemps vu attribuer un statut très différent et beaucoup moins exalté au sein de la gauche et a en fait été soumis à une critique et une attaque soutenues et fondamentales de l’intérieur de la gauche. Des personnes qui insistent pour se qualifier de marxistes et qui continuent à affirmer que Marx a eu une influence majeure sur elles ont élaboré une très longue liste d’échecs et de lacunes qui affecteraient le marxisme. La liste comprend des éléments tels que le réductionnisme économique et de classe, la cécité au genre, les déficiences méthodologiques, les propositions indéfendables, une propension à l’autoritarisme, un utopisme dangereux, etc. Quoi qu’il en soit, il est également dit que le monde du XIXe siècle, dans lequel le marxisme a été forgé, est révolu depuis longtemps, à tel point que les transformations que le capitalisme a subies et infligées au monde ont transformé une grande partie, sinon la plus grande partie du marxisme en une sorte de relique historique.
D’autres essais de ce volume traitent de ces restrictions. Je souhaite seulement ajouter à ce propos que les critiques formulées à l’encontre du marxisme en ce qui concerne nombre de ses caractéristiques ne me semblent pas avoir sapé certaines de ses propositions clés. L’une de ces propositions, qui est peut-être la plus importante de toutes dans l’analyse sociale et politique, et celle que les efforts hégémoniques s’efforcent le plus de brouiller ou de nier, est que les sociétés capitalistes sont fondamentalement divisées entre, d’une part, des classes dominantes définies en vertu de leur propriété ou de leur contrôle des principaux moyens de domination, les moyens de production, les moyens d’administration et de coercition, c’est-à-dire l’État, et les moyens de production et de distribution. D’autre part, les classes subordonnées, définies en vertu de leur manque relatif (ou absolu) de propriété ou de contrôle de ces moyens.
Une proposition connexe est que les intérêts de ces classes sont fondamentalement divergents et produisent une lutte permanente entre elles, qui prend différentes formes à différents moments mais qui est inhérente aux sociétés basées sur la domination et l’exploitation. Une troisième proposition est que la domination et la subordination ne sont pas inaltérables, mais peuvent être surmontées par les efforts collectifs des classes subordonnées elles-mêmes.
Les critiques soulignent à juste titre le fait qu’il existe d’autres divisions dans la société que celles fondées sur la classe, à savoir les divisions fondées sur le sexe, la race, l’ethnicité, la nationalité, la religion ou une combinaison de certaines d’entre elles. Les critiques ont tendance à négliger le fait que ces divisions sont souvent liées à la place dans une classe ou sont influencées par elle. Il n’en reste pas moins vrai que le marxisme a traditionnellement accordé beaucoup trop peu d’attention à ces autres divisions.
Il ne semble pas pourtant pas déraisonnable de considérer ces critiques comme des qualifications, aussi importantes soient-elles, de l’accent mis par le marxisme sur la classe plutôt que son invalidation. Il y a de nombreuses raisons de soutenir que la classe et la division en classes ont été et restent, « primaires ». La raison la plus importante est peut-être que même si tous les objectifs des mouvements féministes, antiracistes, ethniques, nationaux et autres pouvaient être réalisés, la société resterait néanmoins fondamentalement divisée en fonction des classes. Il ne fait aucun doute que la composition de la classe dominante et bien d’autres aspects de l’ordre social seraient différents mais la domination et la subordination, fondées sur les lignes de classe, perdureraient. En revanche, l’élimination des divisions de classe rendrait au moins possible l’élimination des divisions fondées sur le sexe, la race, l’ethnicité, etc.
C’est la condition essentielle à la réalisation d’un ordre social d’où ces divisions seraient finalement bannies. Les « nouveaux mouvements sociaux » peuvent bien soutenir que ce n’est pas une condition suffisante pour que cela se produise et qu’il serait insensé de supposer que l’élimination de la classe entraîne automatiquement toutes les autres bonnes choses. Cette observation (importante) n’invalide pas l’accent marxiste sur la « primauté » des divisions de classe.
L’une des caractéristiques les plus raillées du marxisme ces dernières années a été l’accent mis sur la classe ouvrière en tant qu’agent principal de la libération de la société. Cela a un rapport évident avec les luttes contre-hégémoniques. Car si la classe ouvrière n’est pas cet agent et ne pourra jamais l’être, les efforts contre-hégémoniques dirigés vers cette classe n’ont pas lieu d’être et devraient être dirigés vers d’autres agents, plus réceptifs.
Les critiques du marxisme en raison de ce qui est considéré comme sa « métaphysique du travail » reposent également sur différents motifs. L’un d’eux est que la classe ouvrière, qui est considérée comme la classe ouvrière masculine, industrielle, manufacturière, est en constante diminution dans les pays capitalistes avancés et continuera à diminuer dans une ère « post-fordiste« . De toute façon, dit-on également, la notion de classe ouvrière comme classe potentiellement révolutionnaire a toujours été un mythe, comme l’expérience l’a abondamment démontré tout au long de l’histoire de la classe ouvrière. Même si la classe ouvrière avait été une classe révolutionnaire, ajoute-t-on, il n’y a aucune bonne raison de croire, et beaucoup de preuves le suggèrent, que l’ordre social qu’elle instaurerait ne marquerait pas la libération de la société en général.
Une faille évidente de l’argument tient à la signification attachée à la notion de « classe ouvrière ». En effet, c’est clairement une limitation injustifiée de ce sens que de le restreindre à la classe ouvrière industrielle et manufacturière. De tout point de vue raisonnable, elle inclut au contraire la grande majorité de la population des pays capitalistes avancés, en raison de la source de leur revenu (principalement la vente de leur force de travail), du niveau de leur revenu (qui les place dans les groupes de revenus les plus bas et les plus faibles) et, comme nous l’avons noté précédemment, de leur manque de propriété ou de contrôle des moyens de pouvoir et d’influence dans leur société. Ces caractéristiques combinées définissent la classe ouvrière, comme la plus grande partie de la population subordonnée des pays concernés.
Une question très différente est de savoir si cette « majorité sociologique » est susceptible de se transformer en une « majorité politique », c’est-à-dire si la classe ouvrière et ses alliés dans le reste de la classe subordonnée sont susceptibles de vouloir le type de changements radicaux qu’implique la notion de socialisme. À cet égard, il est sans doute vrai que Marx, et les marxistes après lui, ont adopté une vision beaucoup trop optimiste de l’engagement de la classe ouvrière dans le changement radical, en particulier dans le changement révolutionnaire compris comme procédant d’un soulèvement insurrectionnel.
Mais il semble tout de même excessivement prématuré d’affirmer que la classe ouvrière, ou du moins une grande partie d’entre elle, ne pourra jamais être persuadée de soutenir des programmes de changement radical allant dans le sens du socialisme. En effet, cette affirmation va à l’encontre de nombreuses preuves : on a constaté à plusieurs reprises dans de nombreux pays que des majorités, dont les membres de la classe ouvrière constituaient de loin la plus grande partie, ont exprimé leur soutien à des partis qui proposaient précisément de tels programmes. Les raisons de ce soutien étaient sans aucun doute variées et ne peuvent être considérées comme impliquant une conscience et un engagement socialistes généralisés. Il n’en reste pas moins que des populations subalternes ont soutenu un changement radical : le fait que les politiques qui ont ensuite été mises en œuvre n’ont généralement pas été à la hauteur des promesses faites soulève d’autres questions sur les autres conditions du changement radical.
En ce qui concerne le type de société que le changement radical apporterait, j’ai déjà noté que le socialisme doit se libérer des caractéristiques salvatrices et « utopiques » qui l’ont généralement (et de manière compréhensible) imprégné. Mais il est également tout à fait erroné, et débilitant, de prétendre que parce que tout ne sera pas immédiatement et radicalement transformé dans une société évoluant vers le socialisme, les changements qui se produiront peuvent donc être écartés comme étant insignifiants.
De même, il est pervers d’invoquer l’exemple des régimes communistes pour montrer « l’échec du socialisme ». Comme nous l’avons déjà noté, il y a d’importantes leçons à tirer de l’expérience de ces régimes. Elles n’incluent pas la leçon, que les partisans du statu quo sont si désireux de distiller de cette expérience, que le socialisme ne peut pas traiter efficacement le sexisme, le racisme, la discorde ethnique, l’antisémitisme et d’autres manifestations de morbidité sociale. Soutenir cela, c’est insister sur le fait que le socialisme était là et qu’aucune autre version n’est plausible. Ce n’est pas un bon argument. Un changement radical, du type de celui décrit ici, rendrait possible les débuts d’un processus nécessairement lent et ardu de création de sociétés qui seraient de véritables communautés. Cela ne signifie pas un salut instantané, ni même lointain, mais cela offre une promesse d’avancée réelle vers l’émancipation de maux remédiables.
L’analyse de classe dans une perspective marxiste prétend fournir un principe d’organisation pour la compréhension d’une vaste gamme de phénomènes apparemment disparates. C’est un principe qui est vulnérable aux abus réductionnistes, mais ce n’est pas inévitable. La capacité prédictive du marxisme a échoué à maintes reprises, mais ce dernier point montre seulement que les personnes qui veulent connaître l’avenir ne devraient pas consulter Marx mais la voyante Madame Olga. En fin de compte, le marxisme en tant qu’analyse de classe, manipulé avec soin, reste un instrument d’une valeur inégalée dans l’interprétation de la vie sociale et politique et dans l’explication de phénomènes qui, dans d’autres mains, restent inexpliqués ou incompris. Cela signifie également qu’il est d’une valeur inégalée dans les luttes contre-hégémoniques, puisque ces luttes ont pour objet principal la « mise à nu » d’une réalité que les luttes hégémoniques cherchent à dissimuler.
Le socialisme comme « sens commun de l’époque »
Le but ultime des luttes contre-hégémoniques, en termes socialistes, est de faire du socialisme « le sens commun de l’époque ». Si l’on veut être réaliste, il faut considérer qu’il s’agit d’un projet à très long terme, qui s’étale sur de nombreuses générations et qui ne sera probablement jamais complètement achevé. Mais des progrès peuvent au moins être réalisés et il est clair qu’ils doivent être réalisés pour que l’entreprise socialiste elle-même progresse.
Dans ce domaine, rien ne peut bouger tant qu’un grand nombre d’hommes et de femmes n’auront pas « intériorisé » une conscience socialiste et, pour reprendre la phrase de Cromwell à propos de la New Model Army, ne sauront pas ce qu’ils veulent et n’aimeront pas ce qu’ils savent. A cet égard, il est clair qu’il y a eu un recul notable, dans la mesure où des générations d’hommes et de femmes, nourris d’idées socialistes dans les premières décennies du siècle sont partis ou ont perdu courage. Ces générations n’ont pas été remplacées par de nouvelles générations dans les décennies plus récentes. Cela ne veut pas dire du tout que ces nouvelles générations sont moins ouvertes, rebelles, iconoclastes, que les précédentes : c’est plutôt que leur rébellion et leur iconoclasme ne sont pas, dans l’ensemble, orientés dans le sens des idées socialistes. Ce n’est pas non plus, tout bien considéré, très surprenant.
Nombreux sont ceux qui, à gauche, pensent aujourd’hui qu’il s’agit d’une situation irrémédiable dans les conditions de la « postmodernité ». Il s’agit d’une vision à très court terme qui ne tient pas compte de la mesure dans laquelle les circonstances matérielles et morales créées par le capitalisme réorienteront en temps voulu l’attention vers les solutions que le socialisme propose. D’autre part, il est tout à fait certain que ces solutions ne peuvent pas se résumer à une simple réitération d’anciennes recettes et qu’elles devront être en phase avec les besoins et les aspirations de l’époque. Si l’on admet toutefois qu’il s’agit là d’une condition essentielle du renouveau socialiste, il n’en reste pas moins que la formation de la conscience socialiste prendra de nombreuses formes et puisera à de nombreuses sources différentes, mais qu’elle devra également être encouragée et développée par des organisations socialistes.
Des mots comme « éducation politique » et « formation politique » sont aujourd’hui très suspects à gauche, ce qui n’est pas surprenant puisqu’ils évoquent le genre de catéchismes figés qui ont longtemps passé pour de l’éducation socialiste dans les organisations communistes et autres organisations marxistes. De même, d’un point de vue différent, les mots attirent la suspicion et l’hostilité parce qu’on leur attribue une connotation « élitiste » et qu’ils sont considérés comme véhiculant la notion d’expert.e.s transmettant leur sagesse et leur savoir aux ignorant.e.s qui taillent le bois et puisent l’eau.
L’éducation socialiste n’a pourtant pas besoin d’avoir ces connotations. Elle peut être un véritable processus d’apprentissage coopératif, dans lequel la remise en question de tout n’est pas seulement acceptée mais comprise comme étant essentielle à ce processus. Cela répond également à l’accusation « d’élitisme » : ce qui est ou devrait être dans l’éducation socialiste, correctement comprise, n’est pas un processus de communication à sens unique mais au contraire un dialogue dans lequel enseignant.e.s et enseigné.e.s s’éclairent et se stimulent mutuellement dans un échange constant d’idées.
Quoi qu’il en soit, l’éducation socialiste est un élément crucial des luttes contre l’hégémonie et elle nécessite des formes organisées et systématiques, institutionnalisées, ainsi que d’autres formes, individuelles et indépendantes. Cette exigence est quelque chose que les générations socialistes précédentes ont considéré comme allant de soi, et qu’elles ont respecté, bien ou mal, ce n’est pas ici la question. L’expérience stalinienne, dans ce domaine comme dans tous les autres, fournit une leçon salutaire sur ce qu’il ne faut pas faire. Mais le besoin demeure « d’écoles du socialisme », ouvertes, flexibles, critiques et contestataires, capables d’envoyer dans le monde des militant.e.s mieux équipé.e.s pour contrer la propagande qui aide les classes dominantes à se maintenir au pouvoir et pour présenter des arguments convaincants en faveur du socialisme.
Il est bien sûr vrai que ces luttes idéologiques ne sont qu’une partie d’une lutte de classe beaucoup plus large mais elles en sont une partie importante. Elles contribuent à informer et à façonner le langage, l’esprit et les objectifs de la lutte des classes et lui donnent une plus grande résilience qu’elle n’en aurait autrement. Le présent peut sembler être un mauvais moment pour les luttes contre-idéologiques. Mais l’effondrement des régimes communistes et l’adaptation toujours plus grande de la social-démocratie au capitalisme offrent en fait un nouvel espace et de nouvelles opportunités pour de telles luttes et font des années à venir une période d’espoir plutôt que de désespoir.
*
Ralph Miliband (1924 – 1994) était un éminent sociologue marxiste et l’auteur de nombreux ouvrages sur le socialisme et la politique, dont Parliamentary Socialism et L’État dans la société capitaliste.
Shawn Gude fait partie de la rédaction de Jacobin. Il écrit actuellement une biographie d’Eugene Debs.
Traduit par Christian Dubucq pour Contretemps.



![Gramsci, penseur de l’hégémonie [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Gramisci-150x150.jpg)





