
En quel sens Marx est-il écologiste ?
À propos de : Kohei Saïto, La Nature contre le capital. L’écologie de Marx dans sa critique inachevée du capital, Editions Syllepse et Page 2, 2021, 25 euros.
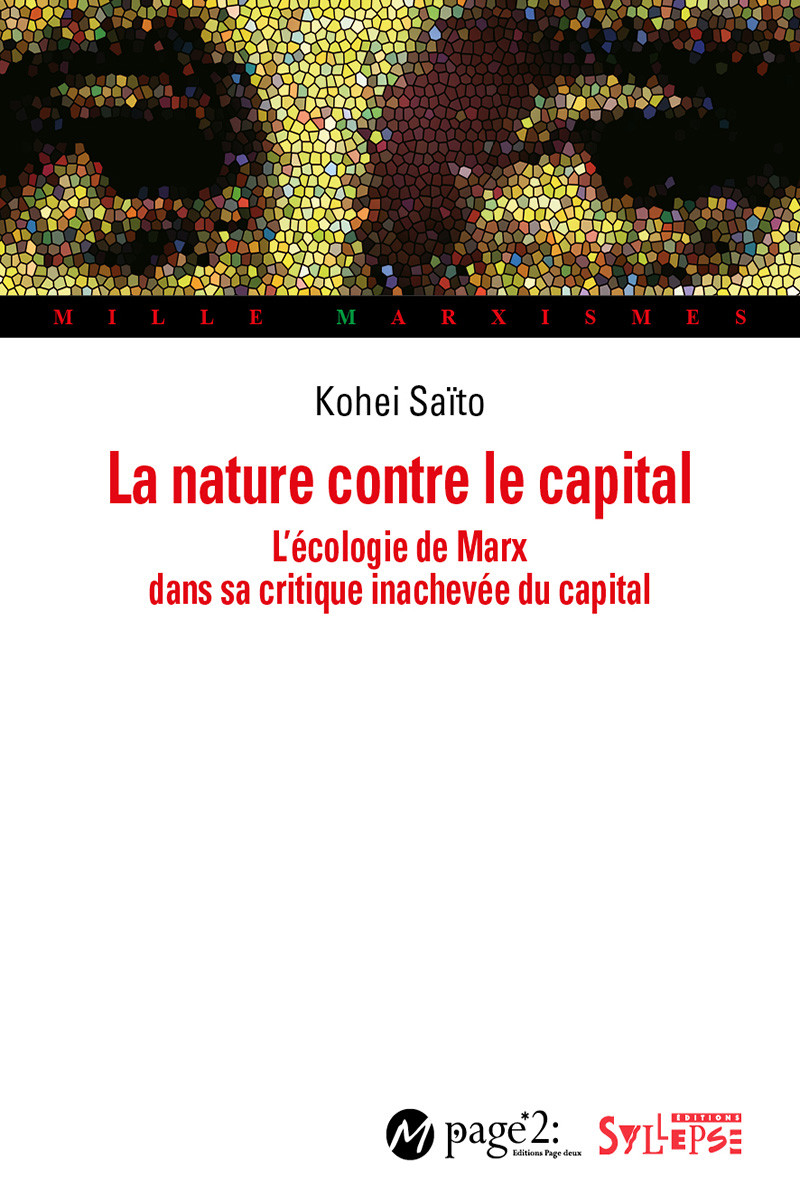
Dans ce texte, Victor Béguin, docteur en philosophie et membre de l’équipe de la Grande Édition Marx Engels (GEME), propose une recension de la récente traduction française du livre La Nature contre le capital. L’écologie de Marx dans sa critique inachevée du capital de Kohei Saito, maître de conférences en économie politique à l’université d’Osaka et membre de l’équipe de la Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA②). Il y insiste sur les apports de ce livre par rapport aux débats liés à l’écosocialisme d’une part, et à l’interprétation du corpus marxien de l’autre, et formule des arguments critiques et pistes de réflexion pour la suite de la discussion au sujet de « l’écologie de Marx », et plus largement de l’articulation entre marxisme et écologie.
****
L’audience des discours tendant à constituer les questions écologiques au sens large (depuis la crise climatique jusqu’aux modalités de la production agricole en passant par la pollution des sols ou le retraitement des déchets nucléaires) comme un – et peut-être le – problème central de notre temps est de plus en plus grande. Il est donc logique que l’articulation de ces problématiques avec les thématiques traditionnelles du mouvement ouvrier et le complexe théorique associé au nom de Marx fasse l’objet d’un nombre croissant de réflexions. Dans cette perspective, la publication en français de l’ouvrage de Kohei Saito La Nature contre le capital[1], dont la version originale allemande a été publiée en 2016, vient apporter une contribution précieuse au versant proprement marxologique de ces discussions, c’est-à-dire à l’analyse des textes de Marx dans une perspective écologiste.
Cet ouvrage se présente en effet comme le point de rencontre entre les deux principales traditions intellectuelles ayant pour l’instant contribué à accréditer la thèse selon laquelle l’œuvre de Marx lui-même témoignerait de sa conscience des enjeux écologiques et de leur intégration à sa critique de l’économie politique. La première, sans doute la mieux connue, est l’écosocialisme états-unien, qui multiplie depuis la fin des années 1990 les publications destinées à démontrer la présence chez Marx d’une théorisations cohérente et subtile des ravages écologiques consubstantiels au mode de production capitaliste. Parmi les différents courants hétérogènes qui constituent cette mouvance, celui réuni autour de John Bellamy Foster bénéficie sans doute de l’audience la plus importante[2], et c’est aussi celui dont l’influence sur le travail de Saito est la plus nette ; de manière significative, la version anglophone de son livre a d’ailleurs été publiée en 2017, sous le titre Karl Marx’s Ecosocialism, par la maison d’édition associée à la Monthly Review de Foster. La deuxième tradition est l’ensemble des recherches menées par les équipes préparant l’édition complète en langue originale des textes, brouillons, notes et lettres de Marx et Engels (la Marx-Engels-Gesamtausgabe ou MEGA②). L’équipe est-allemande chargée de l’édition de notes de lectures prises par Marx sur des ouvrages scientifiques dans les années 1860-1880 a proposé, sur la base de cette documentation, des synthèses théoriques stimulantes sur le rapport entre nature et société chez Marx[3], même si sa préoccupation principale était davantage d’ordre épistémologique. Saito s’inscrit pleinement dans cette seconde tradition, puisqu’il a participé à l’édition des notes de Marx sur l’agriculture (publiées dans la MEGA② en 2018), qui constituent le matériau principal de l’ouvrage aujourd’hui traduit en français.
En un sens, Saito accomplit un double progrès par rapport à ces deux traditions. L’écosocialisme états-unien, tout d’abord, a toujours été confronté à une difficulté interprétative rarement interrogée pour elle-même : aucun texte publié, qu’il s’agisse des brouillons et textes imprimés du Capital au sens large ou des nombreux articles publiés par Marx au cours de sa vie, ne contient de véritable développement explicite et articulé concernant les questions écologiques. De cette manière, l’activité des exégètes écosocialistes a été essentiellement reconstructrice : il s’agissait de collecter l’ensemble des passages (excédant rarement une ou deux phrases) et des articles de presse (sur l’Irlande, le charbon indien, etc.) susceptibles d’être reliés à ces questions, puis de les articuler dans une présentation théorique cohérente. À cet égard, l’impression laissée par la lecture des textes de Foster est ambiguë : d’un côté, il peut sembler que Marx dispose d’une théorie incroyablement précise incorporant et articulant tous les aspects de la crise écologique actuelle, depuis l’agriculture jusqu’à la gestion des énergies fossiles ; mais d’un autre côté, on peut difficilement se défaire de l’impression que cette grande unification s’opère en quelque sorte dans le dos de Marx lui-même, à partir de citations éparses dont la puissante articulation théorique n’apparaît vraiment que dans le texte du commentateur. Le travail de Saito, indissociable de son activité d’éditeur de la MEGA②, apporte ici une contribution décisive : pour la première fois, il met sous les yeux des lecteurs et lectrices une masse considérable de documents explicitement consacrés par Marx à des questions que l’on peut rétrospectivement – selon des modalités sur lesquelles on reviendra plus loin – identifier comme « écologiques ». On passe ici, dans la quête d’un « Marx écologiste », de la récollection de fragments épars à l’analyse d’une masse de documents, sinon parfaitement cohérents, du moins unifiés par un projet intellectuel commun. En ce qui concerne la deuxième tradition, outre le fait que le travail éditorial et interprétatif de Saito constitue en soi un apport de premier plan à la marxologie dans son versant le plus philologique, il présente l’intérêt spécifique de s’appuyer sur un matériau qui était demeuré relativement marginal dans les synthèses théoriques des années 1980-1990 (les notes de Marx sur l’agriculture), et de s’intéresser moins aux dimensions épistémologiques qu’au contenu proprement écologique de ces documents.
L’ouvrage est divisé en deux parties. La première propose, à partir de l’analyse de textes pour l’essentiel déjà connus, une reconstruction de la place de l’écologie dans la critique marxienne de l’économie politique. L’intérêt de cette partie est de proposer une relecture de la formation de la critique marxienne du capitalisme à la lumière de son rapport avec la question des ressources naturelles. Sans pouvoir restituer tous les détails de ces analyses, mentionnons simplement que, dans la droite ligne de l’écosocialisme états-unien, la reconstruction de Saito a pour centre de gravité le concept de « métabolisme » (Sotffwechsel). Ce terme est emprunté par Marx, via son ami Roland Daniels, à la littérature biologique et physiologique de son temps. Saito identifie trois usages du mot « métabolisme » dans les textes de Marx à partir des Grundrisse : ce terme peut renvoyer, soit au métabolisme naturel, c’est-à-dire à l’échange de matière entre un organisme quelconque et son environnement, que Marx nomme généralement « métabolisme universel de la nature » ; soit au métabolisme social, c’est-à-dire à l’échange de matières ayant lieu dans l’échange de marchandises[4] ; soit enfin au métabolisme entre la nature et l’être humain, c’est-à-dire aux interactions socialement médiatisées entre l’être humain et la nature, en particulier dans le procès de production matérielle. Ce dernier sens est au cœur de l’analyse de Saito en ceci qu’il permet selon lui à Marx d’intégrer à sa pensée les recherches les plus avancées de son temps en matière de sciences naturelles sans pour autant sombrer dans le réductionnisme et la vision anhistorique des rapports sociaux qui caractérise aussi bien Ludwig Feuerbach que les « matérialistes scientifiques » comme Jacob Moleschott ou Ludwig Büchner. En un sens, l’historicisation des rapports sociaux s’opère en parallèle à une refondation critique du concept de nature qui surmonte les inconsistances du naturalisme indifférencié et anhistorique de Feuerbach pour proposer une approche différenciée de la place des ressources naturelles et de la matérialité dans le procès de travail et plus généralement dans les activités sociales. Ce faisant, Saito propose (aux p. 85 et suivantes) une réfutation convaincante de l’ouvrage classique d’Alfred Schmidt intitulé Le Concept de nature chez Marx[5], auquel il reproche de s’en tenir à un naturalisme fondamentalement feuerbachien qui le conduit in fine à promouvoir le « changement de conscience » comme ressort principal de la pensée écologique : comme Marx l’avait déjà montré dans sa réfutation implacable du Jeune-hégélianisme à l’époque de L’Idéologie allemande, et comme on le constate chaque jour un peu plus avec la crise climatique actuelle, le simple changement de conscience n’est qu’un ersatz de changement qui ne change à peu près rien… Cette réinterprétation du concept de nature permet à Saito de proposer, dans le troisième chapitre de son ouvrage, une reconstruction extrêmement intéressante de la place de la nature dans la théorie marxienne du capitalisme. Ce faisant, il se livre notamment à une critique très convaincante (p. 134 et suivantes) des interprétations « formalistes » du procès de valorisation, en prenant pour exemple celle proposée par Alfred Sohn-Rehtel. Cela lui permet également d’inscrire la crise écologique au cœur même de l’analyse marxienne du capitalisme, et de proposer ainsi une explication de la différence qualitative entre le mode de production capitaliste et les autres formes de métabolisme nature/société l’ayant précédé. Si tout procès de travail implique un rapport de transformation et de prélèvement à la nature, aucun mode de production n’a consommé les ressources naturelles et détruit des pans entiers de l’environnement – au point de mettre en danger l’équilibre même de l’écosystème terrestre – comme le capitalisme, et la reconstruction de Saito permet de faire apparaître comment Marx a situé cette dimension cruciale au cœur même de la logique propre au capitalisme (sans évidemment pouvoir anticiper l’ampleur de la catastrophe telle qu’elle nous apparaît aujourd’hui).
La deuxième partie de l’ouvrage, quant à elle, présente une étude méticuleuse des sources à partir desquelles Marx a progressivement élaboré cette analyse métabolique du capitalisme. Pour ce faire, Saito présente, contextualise et interprète des documents dont il est également l’éditeur scientifique : les Cahiers sur l’agriculture de 1865-1866 et 1868. Il s’agit d’un vaste ensemble de notes de lectures, couvrant plusieurs centaines de pages, que Marx a prises dans le but d’améliorer la section du livre III du Capital consacrée à la rente foncière capitaliste, dont la première rédaction (qui est peu ou prou celle qu’Engels intégrera à la version publiée de l’ouvrage, en l’absence d’autre manuscrit plus récent) le laissait insatisfait. Afin de fonder sa critique des analyses de David Ricardo en corrigeant la vision insuffisamment informée que ce dernier a de la fertilité des sols, Marx consacre plusieurs mois à éplucher la littérature la plus récente sur tous les aspects de l’agriculture : économie, histoire comparée, agrochimie, chimie des sols, botanique. Il met à jour et approfondit des connaissances qu’il avait commencé à acquérir en 1851 lors d’une précédente campagne de lecture. Deux questions viennent immédiatement à l’esprit, auxquelles le travail de Saito s’emploie à répondre : en quoi peut-on ici parler d’écologie ? Et que peuvent nous apprendre des cahiers dans lesquels Marx ne fait au fond que recopier des passages choisis d’autres auteurs sur sa pensée propre ?
En ce qui concerne la première question, il se trouve que les domaines étudiés par Marx constituent des pièces importantes de ce qui sera plus tard (mais pas beaucoup plus tard) agrégé et unifié sous le nom, avancé en 1866 par Ernst Haeckel, d’écologie scientifique, que ce dernier définit comme la « science globale des relations de l’organisme avec l’environnement extérieur[6] ». Si l’on suit la reconstruction proposée par Jean-Paul Deléage[7], l’agriculture constitue bien – avec les plantes sauvages et l’évolution des espèces – l’un des trois objets privilégiés à partir de l’étude desquels se forme la science écologique dans le dernier tiers du XIXe siècle. On peut donc dire (a fortiori si on songe aux notes ultérieures, publiées ou non, sur la chimie organique, l’agrochimie, la géologie, la géochimie ou encore la physiologie végétale et animale) que Marx acquiert une connaissance très fine d’à peu près tout ce qui constituera, à peine quelques années après sa mort, l’écologie devenue « consciente d’elle-même[8] ». On peut cependant se demander si la connaissance qu’a Marx de cette « proto-écologie » (si l’on peut dire) autorise à parler, comme le fait le titre de l’ouvrage de Saito, d’une « écologie de Marx », c’est-à-dire d’une écologie dont Marx serait non pas le lecteur, mais bien l’auteur. Pour répondre à cette question, il faut distinguer deux sens du mot écologie. Dans le premier sens, celui de Haeckel, l’écologie est une science naturelle étudiant les relations de l’organisme avec son environnement ; mais en un deuxième sens, plus tardif, l’écologie peut aussi être entendue comme la science des relations entre l’être humain et son environnement, c’est-à-dire une discipline se positionnant à l’interface des sciences naturelles et des sciences sociales en ceci qu’elle étudie les dimensions environnementales des activités humaines socialement médiatisées[9]. Il paraît légitime – tout en conservant la prudence terminologique qui s’impose – d’affirmer que les cahiers étudiés par Saito esquissent, sans que Marx n’ait malheureusement eu l’occasion de l’exposer dans un texte rédigé, une écologie entendue dans ce deuxième sens, qui est du reste appuyée sur les connaissances les plus récentes de son époque en matière d’écologie (ou proto-écologie) scientifique. De ce point de vue, moyennant la difficulté terminologique évoquée, le fait de montrer que l’écologie marxiste (ou l’écomarxisme) n’est pas seulement une (re)construction a posteriori, puisqu’elle trouve sa source dans le travail de Marx lui-même, apparaît comme l’un des résultats fondamentaux du livre de Saito.
La difficulté est cependant que les documents sur lesquels s’appuie cette exhumation d’une écologie de Marx n’ont presque jamais Marx lui-même pour auteur, puisqu’il s’agit de notes de lecture dans lesquelles Marx se contente de recopier d’autres auteurs quasiment sans faire de commentaires personnels (contrairement à ce que l’on peut voir dans les notes plus tardives sur l’anthropologie, dont des extraits ont été récemment traduits en français[10]). Ce point soulève de nombreuses difficultés méthodologiques que l’ouvrage de Saito aurait gagné à expliciter davantage, puisqu’il s’emploie dans sa deuxième partie – ce qui ne va pas de soi ! – à reconstituer le cheminement intellectuel sous-jacent à des notes de lecture à peine éclairées par quelques bribes de lettres contemporaines et par l’usage finalement assez parcimonieux qu’en fera Marx dans ses textes rédigés. Sans entrer dans les détails, disons simplement que Saito identifie deux étapes de la réflexion écologique développée par Marx à partir de la question agricole, qui correspondent aux deux grandes campagnes de prise de notes sur ce sujet. Dans le « grand cahier » sur l’agriculture de 1865-1866, qui fait immédiatement suite à la première rédaction de la section sur la rente foncière, Marx rencontre les écrits les plus récents de l’agrochimiste Justus von Liebig, dont il connaissait déjà les travaux antérieurs. Dans ces textes, en particulier dans l’Introduction aux lois naturelles de l’agriculture qui ouvre la 7e édition de sa Chimie agricole (1862), Liebig, qui avait auparavant posé les bases théoriques de l’utilisation d’intrants chimiques en agriculture, donne un tour extrêmement pessimiste à ses réflexions et prophétise l’épuisement rapide des sols et même une crise civilisationnelle majeure sous l’effet de l’agriculture intensive telle qu’elle se développe alors à grande vitesse en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Sans sombrer dans le catastrophisme de Liebig, Marx utilise ses écrits pour incorporer à ses propres travaux la question de la gestion capitaliste des ressources naturelles, comme en témoignent plusieurs références à Liebig dans la deuxième édition du livre I du Capital. De manière générale, le « grand cahier » est particulièrement instructif, car il témoigne de la manière dont Marx entrelace et articule en permanence les lectures proprement scientifiques (sur la chimie des sols, la croissance des plantes, etc.) et la collecte de statistiques et de descriptions permettant de relier le mode de production agricole à ses conditions et effets naturels. Dans les trois cahiers sur l’agriculture de 1868, de nouvelles lectures vont permettre à Marx de prendre une distance critique à l’égard de Liebig. Entre autres points intéressants, Saito montre bien comment Marx identifie chez Liebig une forme de malthusianisme plus ou moins assumé, ce qui le renvoie immanquablement à sa propre critique de Malthus et lui permet de l’approfondir en se mettant sur la piste d’une décorrélation entre croissance de la population et crise écologique : la première n’est pas la cause de la seconde, qui s’explique au contraire par les transformations du mode de production et d’échange des biens agricoles dans un sens capitaliste. Cette réfutation renouvelée du malthusianisme, que l’on peut seulement deviner en suivant le fil des lectures de Marx, mais qui s’insère très bien dans la continuité de ses réflexions sur la question, est évidemment d’une grande actualité, à l’heure où des pseudo-explications de type malthusien polluent constamment le débat public sur la crise écologique. Un autre point du plus haut intérêt, sur lequel Saito s’appesantit d’autant plus qu’il est le premier chercheur à en avoir identifié l’importance, est la lecture que fait Marx de plusieurs textes de Carl Fraas, un haut fonctionnaire, botaniste, ingénieur agronome, historien et philologue bavarois. Marx se prend de passion pour ses écrits, semble-t-il, pour trois raisons principales. Premièrement, en étudiant des formes historiques anciennes de métabolisme nature/société comme l’Égypte ou la Mésopotamie antiques, Fraas suggère que le métabolisme de la nature et de la société n’est jamais neutre lorsqu’il s’agit des pratiques agricoles : la production matérielle socialement médiatisée introduit toujours des modifications dans les processus naturels avec lesquels s’opèrent les interactions métaboliques. Le terme de « modification » ou « transformation » (Veränderung) est ici central, car il permet d’articuler la logique propre aux processus naturels et les inflexions que leur font subir les sociétés agraires : les modifications qui s’ensuivent constituent en quelque sorte la réponse des processus naturels à l’action humaine. Deuxièmement, de manière passionnante, la lecture de Fraas et celle du livre de Georg Ludwig von Maurer sur les formes juridiques anciennes de propriété terrienne semblent mettre Marx sur la piste d’un vaste programme d’enquête comparative sur les formes précapitalistes de métabolisme nature/société, qui se développera dans les lectures ultérieures de Lewis Henry Morgan, Henry Sumner Maine, John Lubbock et John Budd Phear[11], mais aussi de Maksim Kovalevski sur la commune agricole russe[12]. Toutes ces notes de lecture sur les « sociétés précapitalistes » sont désormais bien connues, mais leur articulation avec la question du rapport nature/société est encore en partie à explorer[13]. Et, troisièmement, les analyses de Fraas permettent à Marx d’envisager le métabolisme capitaliste comme une forme historique transitoire, et donc aussi de dégager la possibilité d’un autre métabolisme qui reposerait non plus sur les logiques destructrices de l’extorsion de survaleur dans les royaumes et cités antiques ou dans le mode de production capitaliste, mais sur le contrôle conscient des producteurs, comme il l’écrit à Engels en 1868 : « Le bilan [sc. de l’ouvrage de Fraas Climat et plantes dans l’histoire], c’est que la culture – si elle progresse naturellement sans être contrôlée consciemment (le bourgeois qu’il est ne va naturellement pas jusque là) – laisse derrière elle des déserts, la Perse, la Mésopotamie, etc., la Grèce. Là encore, donc, inconsciemment, la tendance socialiste[14] ! » Les lectures de Fraas viennent donc étayer l’intuition formulée dans le premier manuscrit complet du livre III du Capital, dans lequel Marx parlait déjà de la nécessité du « contrôle des producteurs associés » pour instaurer une véritable « agriculture rationnelle », à laquelle la logique de la valorisation capitaliste s’oppose manifestement[15].
*
On n’a pu donner qu’un bref aperçu des riches analyses contenues dans cet ouvrage. On peut dire qu’il remplit pleinement son objectif de montrer qu’il existe bien quelque chose comme une pensée écologique chez Marx, qui n’est pas seulement disséminée dans des remarques éparses du Capital et de ses brouillons, mais traverse une masse considérable de notes de lecture. Cependant, comme l’indique le sous-titre de l’ouvrage, cette écologie ne se présente pas pour autant comme une théorie explicitement et intégralement articulée par Marx, puisqu’elle existe en bonne partie sous la forme d’un matériau brut que Marx n’a pas eu le temps d’organiser lui-même, bien que l’on puisse y déceler les éléments principaux de sa réflexion en la matière : non seulement le chantier du Capital est dans l’ensemble inachevé, mais, à l’intérieur même de ce chantier, le versant écologique apparaît peu développé. Saito propose cependant une manière convaincante d’intégrer cette dimension aux analyses marxiennes du mode de production capitaliste, dont la force de conviction tient à son souci de respecter l’inachèvement de la critique de l’économie politique sans en réduire la force de frappe intellectuelle.
Cependant, cet ouvrage, qui constitue à certains égards le point d’aboutissement de plusieurs années de réflexions collectives sur l’écologie de Marx, vaut peut-être davantage encore comme point de départ pour de futures discussions. À ce titre, on se permettra de proposer des réflexions prospectives que l’on pourrait grossièrement répartir en deux versants, marxologique et marxiste.
Concernant le premier aspect, si le travail de Saito constitue un apport de grande valeur à la connaissance de l’œuvre de Marx, il soulève cependant un certain nombre de questions qui devront être approfondies à partir de son travail. De manière générale, on pourrait se demander si Saito n’accorde pas trop au grand récit interprétatif d’un « Marx écologiste » construit par l’écosocialisme états-unien, et si ses références à Foster, qui est de très loin l’auteur contemporain le plus cité dans son livre, ne finissent pas par constituer une sorte d’obstacle épistémologique. En effet, l’analyse des nouveaux documents présentés dans son travail aurait gagné à être associée à une réflexion plus profonde sur l’imputation d’« écologie » à Marx et sur la manière dont peut en faire un usage contrôlé. Pour le dire d’une autre manière, on a parfois l’impression que pour Saito, comme pour Foster, Paul Burkett et leurs collègues avant lui, il va de soi que Marx doit avoir une théorie écologiste puissamment articulée, et qu’il faut donc rechercher dans ses textes tout ce qui peut donner corps à ce postulat. Saito est évidemment beaucoup plus nuancé et rigoureux que Foster, dont les textes récents[16] vont parfois très loin dans le côté « Marx a réponse à tout », mais il n’en demeure pas moins qu’il s’inscrit explicitement dans le sillage de ce type d’analyse. Par exemple, en ce qui concerne le fameux concept de « métabolisme », il n’est pas absolument évident que ce concept soit construit par Marx lui-même de manière aussi précise et rigoureuse que ce qu’en dit son commentateur : le fait que le terme soit utilisé par Marx et que l’on puisse en reconstituer les différents usages n’en fait pas nécessairement une catégorie aussi puissamment articulée que celles de travail, valeur ou capital. De même, on pourrait aussi se demander si Saito n’est pas trop spontanément enclin à retrouver, dans les quelques textes marxiens donnant l’impression d’aller dans ce sens, la fameuse théorie écosocialiste de la « rupture métabolique » (selon laquelle le capitalisme introduit une rupture catastrophique dans le métabolisme de la société et de la nature en brisant le cycle de prélèvement et de restitution à peu près équilibré qui caractérisait les formations sociales antérieures). Cela ne veut évidemment pas dire que la reconstruction proposée par Saito de la « théorie marxienne du métabolisme » soit fausse : bien au contraire, elle est largement convaincante, mais le serait peut-être davantage encore si elle s’attachait plus rigoureusement aux conditions scientifiques de la construction de son propre objet. Plus largement, s’il n’est pas question de nier le rôle de l’écosocialisme états-unien dans la promotion de l’idée, qui s’avère confirmée par les textes, selon laquelle Marx lui-même – contrairement à la représentation qu’on se fait souvent de sa pensée – aurait manifesté une sensibilité aux questions que l’on nomme aujourd’hui « écologiques », il apparaît à la lecture de l’ouvrage de Saito que la nature même des sources exige vraisemblablement une approche encore plus différenciée, problématisée et réflexive que celle qu’il développe, quitte à faire davantage apparaître le caractère conjoncturel, l’absence de plan d’ensemble et les points de tension de l’« écologie » marxienne. De manière générale, on gagnerait à mieux distinguer la lumière nouvelle que les interrogations contemporaines jettent sur l’œuvre de Marx (qui n’a rien d’anormal, puisque toute entreprise philologique et interprétative est toujours menée depuis un contexte scientifique, intellectuel et historique déterminé qui configure les questions qu’elle est susceptible de poser aux sources) et le souci d’attribuer à Marx lui-même ce que l’on estime être les thèses « normales » de la pensée progressiste contemporaine. Après tout, pourquoi Marx devrait-il être écologiste, ou antiraciste, anticolonialiste, etc. ? Peut-être pourrait-on gagner en précision sur ces questions en mobilisant les ressources de l’épistémologie socio-historique[17], qui permettrait de mieux historiciser les modes et les contextes de lecture du corpus marxien, et, ce faisant, de mieux faire apparaître dans leur singularité les démarches, ni toujours « actuelles », ni toujours abouties, de Marx lui-même.
Pour ce qui concerne cette fois le versant marxiste, on pourrait essayer de synthétiser et prolonger les réflexions proposées par Saito dans la conclusion de son ouvrage sur l’actualité de l’écologie marxienne telle qu’il la reconstruit. Une telle synthèse pourrait identifier six thèses principales, tirées de Marx sans être nécessairement formulées ainsi par lui, qu’on se contentera ici d’esquisser :
1/ La conceptualisation des problèmes écologiques présuppose nécessairement une distinction de la nature et de la société sur le mode d’un dualisme de propriétés au sein d’un cadre matérialiste. Une telle thèse s’oppose à toutes les tentatives actuelles de faire passer cette distinction (voire la notion même de nature) pour obsolète et de revendiquer ce « dépassement » comme une soi-disant révolution conceptuelle apportant une réponse adéquate à la crise écologique actuelle. De ce point de vue, on pourrait rapprocher l’ouvrage de Saito et le travail d’Andreas Malm[18], qui nous paraît sur ce point impeccablement fidèle au mouvement de fond des textes de Marx.
2/ Il n’y a pas d’harmonie primitive de l’être humain avec la nature, mais des échanges métaboliques (c’est-à-dire des processus de transformation, prélèvement et restitution) toujours socialement médiatisés. L’inspiration marxienne s’oppose de ce point de vue à toute la rhétorique du « retour à la nature » et de « l’harmonie avec la nature », qui là encore est très présente dans de nombreux discours à coloration écologiste.
3/ Le point 2 étant admis, il est tout aussi nécessaire de reconnaître que le mode de production capitaliste introduit une rupture inédite avec les formes antérieures de la production matérielle, et entraîne une crise écologique multidimensionnelle dont les effets sont toujours mieux documentés. Suivre ce fil devrait inciter à la méfiance envers la notion d’« anthropocène », sans doute trop largement taillée pour permettre de penser les ressorts de ce qui se produit actuellement.
4/ L’exploitation capitaliste de la force de travail et l’exploitation capitaliste de la nature sont deux aspects du même processus, qu’il ne faut pas opposer. Ce point est particulièrement crucial, car décorréler et opposer (pour le dire vite) « le travail » et « la nature » est l’une des stratégies majeures de l’idéologie dominante, qui a tout intérêt à construire une opposition entre une soi-disant écologie des urbains diplômés et un soi-disant anti-écologisme des ouvriers et plus généralement des classes populaires défendant leurs « modes de vie » et leurs emplois (opposition d’autant plus nocive qu’elle est partiellement réinvestie par les acteurs eux-mêmes, selon des modalités sur lesquelles on ne peut s’étendre ici).
5/ La soi-disant « surpopulation » n’est pas la cause du désastre écologique ; et, plus généralement, la seule croissance démographique ne peut jamais constituer une cause unique, car elle est bien plutôt elle-même un effet des transformations du mode de production. En ligne de mire, il y a bien sûr ici la perpétuelle réapparition de discours malthusiens lorsqu’il est question d’écologie, par exemple autour de certaines théories de « l’effondrement ».
6/ Enfin, il faut viser une maîtrise collective et consciente des travailleurs et travailleuses sur les interactions avec la nature, appuyée sur les connaissances scientifiques les plus récentes. On songe ici évidemment à l’agriculture, qui constitue l’objet privilégié des textes de Marx étudiés par Saito, mais on pourrait également mentionner la production d’énergie et de biens de consommation ou la répartition géographique des activités productives, tous points sur lesquels Marx ne peut pas être aussi informé.
On pourrait avancer bien d’autres propositions, mais il nous semble que les six points brièvement esquissés ici permettent de résumer une bonne partie de ce qui fait l’intérêt actuel de la pensée de Marx en matière d’écologie. Reste évidemment à évaluer d’une part la pertinence et d’autre part les modalités de leur mobilisation dans l’espace public, ce qui est une tout autre question.
Notes
[1] Kohei Saito, La Nature contre le capital. L’écologie de Marx dans sa critique inachevée du capital, traduction de l’allemand par Gérard Billy, Paris-Lausanne-Montréal, Syllepses-Page deux-M Éditions, 2021, 352 p.
[2] Par exemple en France, depuis la publication d’un recueil de ses articles intitulé Marx écologiste (trad. A. Blanchard, J. Gross et Ch. Nordmann, Paris, Amsterdam, 2011).
[3] Voir notamment Anneliese Griese, « Karl Marx und Friedrich Engels über das Verhältnis von Gesellschaft und Natur », Beiträge zur Marx-Engels Forschung 26, 1989, p. 70-82.
[4] Voir par exemple Marx, Le Capital, livre premier : le procès de production capitaliste, trad. s. dir. J.-P. Lefebvre, Paris, Éditions sociales, 1983, p. 118 : « Dans la mesure où le procès d’échange fait passer des marchandises de mains où elles ne sont pas des valeurs d’usage en des mains où elles le sont, il s’agit d’un échange de matière, d’un métabolisme social […]. Nous devons donc considérer tout le procès sous l’aspect de sa forme et donc n’examiner que le changement de forme ou la métamorphose des marchandises dont la médiation permet le métabolisme social. »
[5] Alfred Schmidt, Le Concept de nature chez Marx [1962], trad. J. Bois, Paris, PUF, 1994.
[6] Ernst Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, Berlin, Reimer, 1866, t. 2, p. 286.
[7] Voir Jean-Paul Deléage, Histoire de l’écologie. Une science de l’homme et de la nature, Paris, La Découverte, 1991, p. 306-307.
[8] L’expression est de Deléage, ibid, p. 61.
[9] Pour une approche complète qui articule ces deux sens, voir par exemple Eugene P. Odum, Ecology: The Link Between the Natural and the Social Sciences, 2e éd., New York, Holt, Rinehart and Winston, 1975 ; Yrjö Haila et Richard Levins, Humanity and Nature. Ecology, Science and Society, Londres, Pluto Press, 1992.
[10] Voir Le Dernier Marx, éd. K. Lindner et les Éditions de l’Asymétrie, trad. Th. Benoît et al., Toulouse, Éditions de l’Asymétrie, 2019, ch. I-III.
[11] Voir The Ethnological Notebooks of Karl Marx, éd. L. Krader. Assen, Van Gorcum, 1972.
[12] Voir Karl Marx über Formen vorkapitalistischer Produktion. Vergleichende Studien zur Geschichte des Grundeigentums, éd. H.-P. Harstick, Francfort-sur-le-Main-New York, Campus Verlag, 1977.
[13] De ce point de vue, on ne peut pas s’empêcher de remarquer que les travaux de Maurice Godelier sur les catégories fondamentales de l’analyse matérialiste-historique en anthropologie (en particulier son ouvrage de 1984 intitulé L’Idéel et le matériel) ont largement déployé une telle articulation, et qu’il est d’autant plus fascinant de constater, à la lumière des documents les plus récemment publiés, que c’est vraisemblablement vers ce genre d’enquête et de méthodologie que s’orientait Marx lui-même.
[14] Lettre de Marx à Engels du 25 mars 1868, in Marx et Engels, Correspondance, trad. s. dir. G. Badia et J. Mortier, Paris, Éditions sociales, t. 9, 1982, p. 194-195.
[15] Voir Karl Marx, Le Capital, livre troisième, trad. C. Cohen-Solal et G. Badia, Paris, Éditions sociales, t. I, 1957, p. 138.
[16] De ce point de vue, un ouvrage comme le récent The Robbery of Nature (New York, Monthly Review Press, 2020), co-écrit avec Brett Clark, est assez paradigmatique : s’il est d’un intérêt certain en ce qui concerne la théorie écologique, sa manière d’attribuer à Marx lui-même tous les aspects de la théorie développée par les deux auteurs sans vraiment s’interroger sur les conditions et les limites d’une telle attribution laisse parfois perplexe. Sur ce point, l’article de Jérôme Lamy « Les palimpsestes de Marx. L’émergence de la sociologie marxiste de l’environnement aux États-Unis », Écologie & Politique, 53, 2016, p. 149-164, propose une intéressante tentative d’objectivation.
[17][17] Comme exemples d’une telle démarche, on peut citer : Norbert Elias, La Dynamique sociale de la conscience. Sociologie de la connaissance et des sciences, éd. s. dir. M. Joly, Paris, La Découverte, 2016 ; Johan Heilbron, « Pour une sociologie historique et réflexive des sciences humaines et sociales », Revue d’histoire des sciences humaines, 30, 2017, p. 277-288 (article qui explicite les principes à l’œuvre dans ses deux volumes sur l’histoire de la sociologie française). Sur la question plus précise des catégories de la pensée environnementale, qui n’est pas sans rapport avec certains problèmes posés par les notes de Marx sur « l’écologie », voir Wolf Feuerhahn, « Les catégories de l’entendement écologique : milieu, Umwelt, environment, nature… », in G. Blanc, E. Demeleunaere, W. Feuerhhan (dir.), Humanités environnementales. Enquêtes et contre-enquêtes, Paris, Publications de la Sorbonne, 2017, p. 19-42.
[18] Voir notamment l’excellente discussion conceptuelle des variantes constructivistes, hybridistes et autres de la négation de la distinction nature/société que l’on trouve dans son ouvrage The Progress of This Storm (Londres-New York, Verso, 2018). En français, voir « Nature et société. Un ancien dualisme pour une situation nouvelle », trad. J.-F. Bissonnette, Actuel Marx, 61/1, 2017, p. 47-63.









