
La naissance du « community organizing » en France. Entretien avec Adeline de Lépinay
Adeline de Lépinay, qui se présente comme une artisane d’une éducation populaire politique et libertaire[1], est une des organisatrices de l’alliance citoyenne qui s’est créée en 2016 à Aubervilliers[2]. L’alliance citoyenne est une des premières associations se réclamant explicitement du community organizing (CO) en France. Pour Contretemps, elle revient sur le début de cette expérience, à partir de son expérience à Aubervilliers et d’autres alliances citoyennes, notamment celle de Grenoble qui a été la première association de ce type[3].
Est-ce que pour toi et les personnes qui avez créé les alliances citoyennes, le community organizing (CO) est un ensemble de principes très précis que vous cherchez à appliquer ou plutôt une source d’aspiration qui vous aide à agir ? Quelle est la part des transferts d’éléments venus des Etats-Unis au départ ? Dans des pratiques anciennes en France, n’y-a-t il pas aussi des éléments inspirants ?
C’est parti de sept personnes à Grenoble qui ont lancé le projet avec d’autres. Pour eux c’est parti de la lecture du livre d’Alinski[4], qui les a conduits à rencontrer des organizers en Grande-Bretagne puis à monter leur association. On peut se dire en effet que le CO n’invente pas grand-chose, mais c’est plutôt une redécouverte, notamment sous l’angle de la méthode. C’est une méthode très carrée, et ça c’est assez particulier. Alinski a formalisé cette méthode mais ensuite, cela a donné lieu à des projets variés, notamment en Angleterre, il ne se passe pas la même chose qu’aux Etats-Unis où là aussi les expériences sont diverses. A Grenoble, suite à leur formation en Grande-Bretagne, ils ont adapté ce qu’ils y avaient appris, c’est-à-dire organiser des communautés et non pas des individus. Et au bout de deux ans, ils se sont rendus compte qu’organiser des communautés autour de combats précis, ça ne favorisait pas la construction d’une organisation et qu’une fois que le combat était terminé, les participants partaient. Au bout de deux ans, ils ont donc petit à petit adapté puis changé leur méthode pour se rapprocher de ce qui se fait dans certaines organisations aux Etats-Unis.
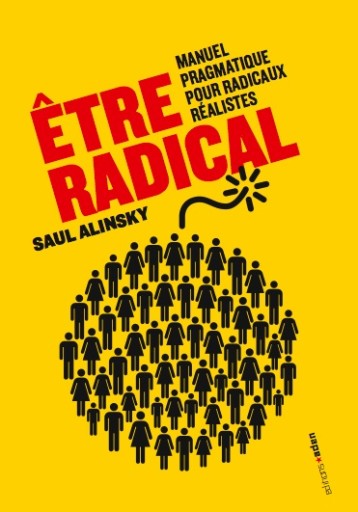
Peux-tu préciser la grande différence que tu fais entre les méthodes du CO ?
Dans les deux cas tu vises à construire une organisation durable, mais dans le premier cas, tu relies des communautés, et donc ce sont les communautés qui adhèrent, ce ne sont pas les individus ; ça peut être les Congolais de France, telle église, etc. Tandis que la méthode des alliances citoyennes en France, c’est une adhésion des individus. On se retrouve donc assez déconnectés des communautés, et avec notre méthode de porte-à-porte, on se retrouve avec des gens qui ne se retrouvent pas ailleurs. Ça part vraiment de l’idée d’organiser les inorganisés.
Le CO est basé sur l’apprentissage de techniques qui nécessite donc une formation préalable à l’engagement, du moins pour les organisateurs. Comment se passe cette formation ? Qu’y apprend-on ? Qui l’organise ?
Ce sont les anciens organisateurs qui forment les nouveaux. A partir de deux ou trois ans d’expérience, tu peux passer accompagnateur, accompagner les nouveaux qui commencent. Avec les organisateurs de l’alliance citoyenne d’Aubervilliers, on est par exemple allés passer trois mois à Grenoble, comme un stage classique, sur le terrain. La formation porte d’abord sur les techniques de mobilisation, donc la première formation c’était le porte-à-porte, et on a passé un mois de porte-à-porte intensif, et dans ces moments-là tu te trouves face à tous les questionnements : c’est quoi l’intérêt de se mettre en collectif, c’est quoi notre projet politique… c’est un condensé. Et à travers ces formations, on devient nous aussi formateurs, car aussitôt on est censé savoir former nos membres.
C’est l’organisateur lui-même qui forme ses membres, on ne fait pas venir des formateurs extérieurs pour avoir des formations qui tomberaient d’un sachant. On bosse ensemble, je lutte avec les gens avec qui je suis sur mon quartier et du coup je leur apporte les formations. Par ailleurs, on propose aussi des formations à l’extérieur de nos associations, pour des structures qui nous en commandent, par exemple des centres sociaux qui ont envie de s’inspirer des techniques du CO. On refuse par principe de former les collectivités territoriales parce qu’on ne forme pas le pouvoir, on forme les contre-pouvoirs. Et il arrive également qu’on fasse des formations ouvertes pour des personnes intéressées par le CO.
Tu parles de porte-à-porte, tu évoques des techniques de mobilisation, mais comment concrètement vous avez commencé à agir à Aubervilliers ?
Grâce à l’expérience précédente de Grenoble, quand on s’est lancés à Aubervilliers, on a n’a pas trop eu d’hésitation, on a commencé directement par aller frapper aux portes. On a choisi les quartiers sur lesquels on allait travailler. On a commencé quand même par aller se présenter auprès des gens qui sont actifs sur le territoire, même les structures institutionnelles, les associations… Il n’y avait personne parmi nous d’Aubervilliers, ce qui est une exigence de la pratique du CO : pour un organisateur, c’est important d’être extérieur au terrain qu’on organise, parce que du fait de notre travail, on a pas mal de pouvoir parce que c’est nous qui avons le premier contact avec les gens ; si les gens décident de rejoindre l’alliance citoyenne, c’est parce qu’ils ont confiance en nous lors de la première rencontre, et donc il y a plein de choses mises en place pour contrecarrer ce pouvoir, notamment le fait de ne pas avoir d’intérêt direct dans les mobilisations. Cette distance au territoire est aussi liée au fait que mon but c’est d’organiser mais aussi d’autonomiser, et donc de convaincre les personnes d’agir plutôt que de le faire à leur place.
Concrètement, tu choisis une barre d’immeuble, et tu vas frapper à toutes les portes. La première phase, c’est quatre heures par jour de porte-à-porte. A la fois c’est surprenant et pas surprenant. Globalement on obtient toujours un peu les mêmes réponses, liées aux problèmes que l’on connait bien : problèmes d’école, de logement, de quartier, etc. Et pour nous, lors de la première rencontre, notre objectif c’est de faire percevoir qu’il y a une injustice sociale liée à ce problème ; c’est ce qu’on appelle verticaliser. Et à partir de là se demander comment faire changer cela, pour en arriver à la conclusion que pour résoudre un problème, la seule solution est de jouer collectif. Quand on demande aux gens comment faire changer cela ou cela, ils répondent souvent en parlant de pétition, donc ils sont déjà dans une démarche collective, et nous on va essayer d’aller les faire un peu plus loin sur un mode d’action directe collective. En tant qu’organisateurs, notre but c’est qu’ils prennent confiance dans leurs propres idées et qu’ils aient envie de la réaliser, et de notre côté on cherche à recruter pour être de plus en plus nombreux.
Mais entre le fait d’avoir une pensée, même vague, du collectif et le fait d’adhérer, de participer et de s’organiser, il y a une distance. Comment faites-vous pour combler cette distance ?
C’est là qu’on est très différents des travailleurs sociaux. Nous, on se mouille dans ce genre de moments, on n’a pas du tout de posture neutre. Quand ils me voient, il faut qu’ils sentent qu’il y a de la rage, de l’énergie, et qu’on peut y aller avec elle. Il faut créer un sentiment d’énergie collective qui donne aux gens envie d’y aller. C’est assez impressionnant de constater que ça marche, comparé à des modes militants plus classiques d’interpellation des gens (par exemple la distribution de tracts, l’invitation à des réunions publiques ou à des manifestations), là on ne leur propose pas quelque chose. Dans les quinze premières minutes de la rencontre, on ne parle que d’eux et des problèmes qu’ils rencontrent, et ce n’est qu’à la fin que je leur dis qu’on est en train de monter une alliance citoyenne sur le quartier.
Bien sûr, dès notre première approche, on cadre ce qu’on veut dire, la façon dont on veut discuter, en faisant appel à la colère, au sentiment qu’il y a des trucs dégueulasses, en prenant certains exemples on cible des conflits avec les institutions. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas des gens qui nous disent qu’il y a trop d’arabes et trop de noirs, mais on essaye de faire passer l’idée que c’est de ces conflits avec les institutions dont on parle. Et en plus je ne me présente pas comme étant en posture neutre, juste pour récolter les problèmes des habitants. J’utilise un vocabulaire pour montrer que je suis en colère et insister sur le fait qu’on va lutter ensemble, et ce n’est pas banal de se faire aborder comme ça. Après le porte-à-porte, tu as un mois ou deux pour faire ta première assemblée qui est préparée par les personnes les plus motivées parmi celles rencontrées. Le schéma c’est : plus on est nombreux plus on gagnera, plus on gagnera plus on sera nombreux. On pense donc en même temps le fait de comment gagner des batailles et comment devenir plus nombreux. Et c’est impressionnant de voir comment cet objectif de se structurer et de s’organiser est partagé par les gens, et donc ils vont aller eux-mêmes recruter.
On met souvent en parallèle le CO et le travail social ou l’éducation populaire. Qu’est-ce qui selon toi différencie ces modes d’action ?
Là où le CO produit quelque chose que le travail social ne fait pas, ou qu’il est plus difficile de faire dans le cadre institutionnel, c’est toutes les questions de dignité, de reprise de confiance en soi, de fierté, d’exigence. En valorisant les quelques victoires qu’on obtient, on se dit qu’on peut, qu’en se mettant ensemble, on peut négocier par exemple avec le directeur de l’office HLM. Et ça c’est très important, ce sentiment de reprise de pouvoir sur soi et sur la société, ce qui construit ensuite une capacité de s’opposer. On ne bosse par pour l’insertion dans la société mais les membres de nos associations, en gagnant le droit de cité, reprennent place dans la société. Passer par le collectif, la prise de décision, c’est une première étape pour cela.
Comment sont définis les objectifs ? Notamment, entre ce qui est gagnable et ce qui apparait hors de portée, comment sont fait les choix ? N’y-at-il pas un risque de limiter à des petites choses, au quartier, l’action du CO, tandis qu’ailleurs se joue la grande politique qui échappe aux gens ?
Le premier principe c’est de ne jamais disqualifier les problèmes, même les problèmes qui sont formulés comme des questions racistes : si les gens se plaignent des roms, c’est qu’il y a un problème à ce moment-là avec les roms. Donc, on va verticaliser cette question, en se demandant pourquoi il y a un problème : peut-être parce qu’ils sont sur un terrain, qu’il n’y a pas de sanitaires… et donc est-ce qu’on ne va pas plutôt lutter avec eux pour qu’il y ait des sanitaires plutôt que de lutter contre eux. Ça c’est notre travail de politisation : toutes ces luttes ont des objectifs en soi, mais c’est aussi un moyen de reconstituer un esprit de classe, en se rendant compte par exemple que ça ne sert à rien de se battre contre les roms, c’est plutôt contre la mairie pour avoir des sanitaires, et de le faire tous ensemble. Ne pas disqualifier les colères, c’est donc les travailler pour les politiser.
Pour le reste, on essaye d’être stratégiques sur la hiérarchisation de nos choix : qu’est-ce qui est gagnable et quel est l’intérêt de viser des objectifs gagnables. C’est là qu’on a cette double réflexion sur le rapport entre structuration et victoire : si on perd on va se démotiver tous et on va s’affaiblir. C’est aussi de la politisation dans le sens où ça conduit les gens à réfléchir sur les rapports de force et sur ce qu’on peut obtenir à partir de ce qu’on est. Mais c’est vrai qu’il n’y pas toujours de réponse. Si on prend la demande de police dans les quartiers, on peut, en fouillant ensemble, s’orienter plutôt vers des demandes de plus d’éducateurs, de médiateurs, mais c’est compliqué, car à court terme la réponse sécuritaire apparait toujours comme plus efficace.
Tu as souligné l’importance des questions de quartier, d’immeuble dans ce que les gens disent de leurs problèmes. Est-ce que la question du travail est aussi évoquée ?
Bizarrement, assez peu. Je constate, et c’est assez effrayant, qu’à propos du travail on a du mal à sortir d’un « y’a pas le choix », d’un fatalisme. Si les problèmes de l’immeuble, de l’école créent de la révolte, par contre le fait de travailler avec des horaires de dingue, etc., c’est moins interrogé, il y a une intégration monstrueuse de la précarité. Le chez-soi, c’est l’endroit où l’on a envie d’être bien, on fait attention à sa famille, et on peut être prêt à s’investir. Par contre le travail c’est pourri mais c’est tout, c’est comme ça. Il peut y avoir une conscience d’abus, mais relativement limitée. Mais j’espère qu’à travers ce qu’on fait, ça revigore une conscience de classe et ça nourrit le désir de sortir de la fatalité, en espérant que ça puisse se transférer dans le monde du travail.
Tu as mentionné le fait que pour toi le CO visait trois objectifs : gagner des luttes ; gagner en politisation et en capacité politique ; changer la société avec un objectif révolutionnaire. Or l’articulation de ces trois dimensions n’a rien d’évident. Et au-delà, comment s’établit le partage, la mise en commun de ces objectifs entre les organisateurs et les membres des associations ? Autrement dit, comment s’effectue le processus de politisation, comment est-il plus ou moins cadré par les organisateurs et par les membres ?
C’est un travail qui s’effectue dans le temps. Si rapidement on part souvent dès la première discussion sur la question des inégalités dans la société, les moments où ça se formalise en tant qu’objectifs, c’est quand on parle de stratégie d’organisation, par exemple quand on discute de structuration nationale. Les effets de reconnaissance de situations semblables d’un endroit à l’autre et le fait de vouloir peser sur les décisions, dans son quartier ou à une plus large échelle, c’est ce qui donne son carburant à la mobilisation collective, c’est le fait de ne pas seulement se battre pour un petit problème local. Et pour moi le troisième objectif –changer la société – c’est le moteur sous-jacent de l’ensemble de la machine. Parce que s’il n’y a pas ça, il n’y a aucun intérêt à se structurer, à prendre des responsabilités…
Par ailleurs, un de nos principes politiques de base est le fait de dire qu’un pouvoir a nécessairement besoin de contre-pouvoirs. On s’organise donc non pas pour prendre le pouvoir mais pour être un contre-pouvoir fort. Ça, en termes de projet de société, c’est déjà quelques chose, c’est-à-dire qu’on n’est pas dans un projet où des gens organisés cherchent à prendre le pouvoir pour diriger les choses d’en-haut vers un monde meilleur, mais les questions de pouvoir sont questionnées non pas d’un point de vue théorique mais en se disant que le problème n’est pas juste celui du mec qui est assis dans le fauteuil. Ça va à l’encontre de la démocratie représentative telle qu’elle fonctionne aujourd’hui, on est dans une démarche de réappropriation ; mais on n’appelle pas ça avec un mot en –isme. Cette question de la méfiance a priori vis-à-vis des pouvoirs et la volonté de construire des contre-pouvoirs résolvent un certain nombre de choses dans notre activité : ne pas s’en remettre aux institutions, comprendre les mécanismes de pouvoir, chercher à s’organiser de façon autonome…
Quel est le profil des personnes qui viennent aux assemblées de l’association ?
Ça peut être très différent, notamment d’un quartier à l’autre. Pour le moment on travaille dans deux quartiers d’Aubervilliers. Dans l’un il y a quelques anciens militants, dans l’autre c’est plutôt des gens qui n’ont jamais été dans un collectif, qui ne savent pas prendre la parole en public, qui partent d’assez loin en termes d’action collective. Les âges sont aussi variés, il y a des salariés et des retraités, mais on a un peu de mal à rencontrer des jeunes, car ceux qui ouvrent la porte, ce ne sont pas le jeunes, ce sont leurs parents. On rencontre beaucoup de femmes, notamment des mères de famille.
A la base du CO états-unien, il y a l’idée de s’appuyer sur ou de constituer des communautés, sachant que le terme a peu à voir avec ses usages en France. A travers votre travail, comment envisagez-vous la constitution de communautés, ou du moins de groupes qui prennent conscience d’intérêts partagés ? Comment est pensé le rapport des individus à leurs attaches sociales ?
La première rencontre est liée à un individu, on va frapper à la porte et on discute avec une personne ou éventuellement sa famille. Mais ensuite, si je continue à faire du recrutement, les personnes que j’ai rencontrées vont aussi aller recruter, et ils vont le plus souvent aller recruter dans leur communauté. D’où l’intérêt à la base d’aller frapper dans plein de directions différentes pour avoir des gens très différents, ce qui donne des rencontres et des actions communes avec des gens qui ne se seraient pas parlé autrement.
Et quel est le profil des organisateurs ? Est-ce que les questions de genre et de race sont débattues de ce point de vue ?
Pour le moment, on est dans une phase transitoire puisqu’on a commencé sans être payés, donc les gens qui ont pu se permettre cela étaient issus de la classe moyenne. Mais notre objectif est de changer ce type de recrutement et pour cela on a besoin de structurer un modèle économique viable afin d’embaucher de nouveaux organisateurs. Notre objectif est vraiment d’en faire un boulot vivable pour pouvoir sortir du profil initial des organisateurs. Mais souvent, si on vient de différents horizons, chacun voyait les limites de son activité et cherchait des moyens d’aller plus loin. Par ailleurs, on est en très grande majorité blancs, et ce problème s’est posé à Grenoble où le conseil d’administration (lequel est composé exclusivement de membres) s’est plaint de cette situation. Il y a donc des tentatives pour ouvrir les postes à des racisés, et pour l’instant on ne trouve pas. Mais ça demeure un objectif. La question raciale est donc très discutée, mais pour le moment on n’arrive pas à dépasser un état de constat ; en revanche, si on est attentifs à la question du genre, on n’identifie pour l’instant pas de biais important qui y soit lié.
Le CO repose sur des salariés, et donc nécessite un modèle économique. Concrètement qu’en est-il ? De même, comme envisagez-vous le fait d’être salarié et organisateur militant ?
Notre idéal c’est l’auto-financement total, par adhésions et par vente de prestations, parce qu’il faut avoir à l’esprit que les techniques du CO sont à la mode, et donc on peut vendre des formations. Mais on complète par des subventions. On refuse les financements locaux pour éviter les conflits d’intérêt et le plus possible les financements publics. Donc on se tourne vers des financements privés, et on a pu notamment être soutenus par des fondations type Abbé Pierre, fondation de France ou des structures plus petites.
A propos du fait d’être salarié, on retrouve les origines pragmatiques du CO aux Etats-Unis et d’Alinski : pour être efficace et construire des organisations, il faut des salariés qui passent leurs journées à cela, mais on met en place le plus possible d’éléments qui vont contrecarrer les logiques produites par la professionnalisation du militantisme. L’objectif d’autonomisation est réel. L’objectif de l’organisateur, c’est d’organiser puis très vite de n’être plus qu’un soutien à un quartier qui s’est autonomisé, ce qui lui permet d’aller organiser un nouveau quartier. De fait l’organisateur a un pouvoir, parce qu’il est permanent, parce qu’il a un rapport direct avec les gens, mais très vite le but c’est d’autonomiser et de partir sur un autre quartier. Pour nous, en tant que salariés, on souhaite également être vigilants quant à nos conditions de travail. Bien sûr, c’est l’engagement qui prime dans notre démarche mais on refuse de reproduire la façon dont le secteur associatif traite ses salariés. On est donc très rigides sur les horaires de travail par exemple.
Mais si on affaiblit la dimension militante, et si on réduit le CO à un certain nombre de techniques de gestion de groupe, il est possible que cela conduise à une moindre politisation du CO et des organisateurs, comme ce qu’ont connu le milieu associatif et l’éducation populaire à travers leur professionnalisation. Pour nous, les salariés ne doivent pas faire à la place des gens, mais être un moyen de construire des organisations de masse qui permettent aux gens d’agir. Cela implique également une structuration qui dépasse l’échelle du quartier. A Grenoble par exemple, il existe une structuration par quartier, c’est le quartier qui a le pouvoir principal, avec l’assemblée de membres souveraine qui élit un comité de quartier avec des responsabilités claires. Au sein de ce comité sont élus des gens qui participent au comité inter-quartiers, et du conseil inter-quartiers émane un conseil d’administration qui s’occupe de la gestion. On débat aujourd’hui d’un CA national qui regroupe les différentes structures.
Mais si l’enjeu est de mobiliser les quartiers populaires, quel est le but d’avoir une structuration au niveau national, voire international ?
Pour le moment, le CA national est provisoire et est en train de se définir, mais le but c’est d’avoir un lieu pour échanger sur nos pratiques mais aussi de se développer le plus possible. On a vocation à être nombreux pour mener des campagnes nationale. Par exemple, en ce moment on lance une campagne sur les problèmes d’ascenseur dans les HLM, et on va essayer de fédérer toutes les initiatives en ce sens ; mais si on était développé dans de nombreuses villes, on serait en capacité d’organiser nous-mêmes de telles campagnes. Quant au niveau international, on est surtout en lien avec le réseau ACORN international[5] (fédération d’organisations communautaires de base présente dans une quinzaine de pays), du moins au niveau des organisateurs, peut-être bientôt aussi pour les membres. On est liés aussi au RéACT[6] (Réseau pour l’Action Collective Transnationale) qui mène des campagnes internationales, notamment la campagne sur les Mac Donald ; pour ce cas précis, RéACT fait le lien entre des organisations syndicales qui militent sur les mêmes questions ; ça passe donc par ce biais syndical, alors que l’alliance citoyenne reste une association centrée sur les quartiers.
Entretien réalisé par Vincent Gay.
[1] Voir son blog www.education-populaire.fr
[2] https://alliancecitoyenne.org/aubervilliers/
[3] https://alliancecitoyenne.org/grenoble/
[4] Saul Alinski, Etre radical : Manuel pragmatique pour radicaux réalistes, Aden, 2012.
[5] http://www.acorninternational.org/
[6] http://projet-react.org/v2/fr/









