
Noir Canada. Entretien avec Alain Deneault
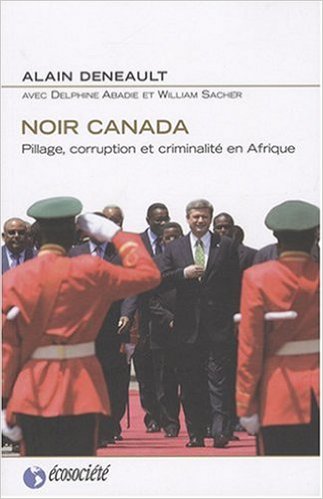 Deneault (avec W. Sacher et D. Abadie), Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en Afrique, Ecosociété, Montréal, 2008.
Deneault (avec W. Sacher et D. Abadie), Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en Afrique, Ecosociété, Montréal, 2008.
A la suite de François-Xavier Verschave, qui avait étudié le pillage et la corruption dont s’est rendue responsable la « Françafrique », Alain Deneault, en collaboration avec William Sacher et Delphine Abadie, analyse dans Noir Canada le fonctionnement d’un réseau politico-économique canadien en Afrique qui, dans le contexte de la mondialisation et de l’instabilité politique des pays africains, produit le même type d’ « externalités négatives », par d’autres moyens.
C’est d’abord par la création d’un espace de non-droit autour de la Bourse de Toronto, dans les interstices entre le droit canadien, le droit international et celui, mouvant au gré des pouvoirs en place des pays africains concernés, espace dans lequel se joue une certaine collaboration entre des compagnies minières canadiennes, des pouvoirs publics tant canadiens qu’africains, et des OIG (Banque Mondiale et FMI essentiellement). C’est ensuite grâce à un effet d’aubaine qui fait que l’Afrique est aujourd’hui le terrain de jeu d’un capitalisme dérégulé. C’est enfin un travail idéologique qui fait s’articuler, parfois au sein des mêmes institutions, les discours sur la « gouvernance », le « développement », l’aide (humanitaire ou non) et la légitimation des pratiques de pillage. Les auteurs et éditeurs de Noir Canada font aujourd’hui l’objet d’une SLAPP (Strategic lawsuit against public participation), une poursuite demandant des dommages et intérêts exorbitants, de la part de Barrik Gold et Banro, deux grandes sociétés minières canadiennes.
G&M : Vous parlez de « pillage » des ressources africaines par des multinationales canadiennes, pourriez-vous schématiser comment s’organise ce « pillage » ?
Alain Denault : Il faut distinguer deux types de contextes : celui de pays en crise profonde et celui de pays « pacifiés ». Dans les pays en paix, le Canada s’associe à des chantiers industriels d’envergure financés par la Banque Mondiale, le FMI ou autres bâilleurs de fonds, par exemple dans la construction du barrage de Manantali, sur le Fleuve Sénégal, ou dans la gestion du chemin de fer qui relie Bamako à Dakar. Le prétexte en est que le bienfait en rejaillirait sur tous. Pourtant ces projets se sont souvent révélés catastrophiques pour les populations : le barrage de Manantali a inondé un nombre important de terres arables ou d’élevage et annulé de la pêche. Sur la ligne Bamako-Dakar, les gares ferroviaires ont été fermées au public. Mais le gouvernement ou les sociétés du Canada se félicitent, ici, de participer ainsi au « développement » du Sud… Et sans doute la ligne Bamako-Dakar, gérée par la Transrail SA, alors canadienne, est-elle bien plus rentable transformée en ligne de fret que si elle assurait le transport des passagers, et contribue ainsi à vider le continent de ses ressources, comme à la belle époque coloniale.
Et puis il y a les pays en guerre. Le Congo-Kinshasa, par exemple. Le sous-sol congolais est prodigieusement riche de matières très prisées dans les pays du Nord. Au moment où le pouvoir de Mobutu chancelait, où les troupes du Front patriotique rwandais et celles de l’État ougandais s’apprêtaient à entrer dans l’Est du pays, Barrick Gold, le N° 1 de l’or aujourd’hui, se dotait d’un « Conseil consultatif international » composé de personnalités de premier plan, telles que les anciens chefs d’État George Bushsr et Brian Mulroney, les investisseurs Paul Desmarais et Peter Munk, mais aussi des proches de la famille Clinton comme Vernon Jordan. Il ne s’agit pas d’un club de bridge. Leur influence visait vraisemblablement à obtenir des contrats dans un contexte où la kleptocratie de Mobutu s’effondrait sans aucun projet démocratique pour la relever. Les conflits entre mobutistes et rebelles d’abord, et ensuite entre différentes factions aussi incontrôlables que versatiles dans l’Est du Congo, visaient notamment le contrôle et la sécurisation de gisements que plusieurs sociétés minières canadiennes, l’American Mineral Fields International, Banro et Barrick Gold, de même que la pétrolière Heritage Oil, détenaient ou convoitaient. Le rôle de ces sociétés est controversé si on se fie à certaines sources et seuls les travaux d’une commission d’enquête indépendante pourraient faire la lumière.
Si une société dans les années 1982-2000 entreprend des démarches pour extraire des minerais dans la région des Grands Lacs africains, il est difficile d’imaginer que ces démarches se fassent sur le mode du « doux commerce ». D’ailleurs, lorsque Barrick Gold se dote de ce Conseil consultatif international constitué de très grands financiers, d’anciens hommes politiques, de représentants de courants divers aux Etats-Unis, se positionnaient, pas très loin de cette constellation, des factions armées pro-ougandaises ou pro-rwandaises. De même, le fondateur d’Heritage Oil n’était pas dans le pétrole initialement mais dans le mercenariat. Que Heritage Oil, coté en bourse à Toronto, soit un expert du mercenariat et revendique son « profil risque » dans un de ses rapports annuels ou dans des entrevues publiques, montre que c’est par des voix vraisemblablement armées que l’on se fraie l’accès au pétrole.
Dans la région que contrôlait Kinshasa dans ces années de crise aiguë, dont les morts se comptent par millions, la commission d’enquête dirigée par le député d’opposition Christophe Lutundula a fait état de très nombreux « contrats léonins » signés par des sociétés canadiennes. Ces contrats se révèlent outrancièrement favorables à la partie privée et laissent bredouille la partie étatique. Ils ont été signés tantôt par un Laurent-Désiré Kabila pas encore président mais cherchant à financer son avancée vers Kinshasa, puis par un Kabila enfin à la tête de l’Etat mais aux abois pour financer sa guerre… Emaxon, Lundin, First Quantum Minerals, Kinross comptent parmi les sociétés canadiennes qui ont signé de telles ententes, selon les travaux de la commission Lutundula. La Gécamines, société publique vouée jadis à l’exploitation de plusieurs sites au Congo, a été dépecée sans que jamais les Congolais n’en tirent un profit substantiel.
G&M : Sur quoi reposent les profits de ces sociétés ?
D. : Parmi ces sociétés, beaucoup ont profité de leurs acquisitions à vil prix pour faire monter leur titre à la Bourse de Toronto sans s’intéresser à l’exploitation des mines comme telle, c’est-à-dire sans contribuer au développement du pays concerné. Les fruits de ces contrats léonins sont donc gagés à la Bourse de Toronto et les titres des sociétés minières titulaires font l’objet d’une spéculation très lucrative.
Et quand exploitation il y a, celle-ci peut avoir lieu dans des conditions si difficiles pour les travailleurs, et si destructrices pour l’environnement, qu’il n’y a pas souvent lieu de s’en réjouir. Les produits chimiques utilisés pour l’extraction de l’or peuvent provoquer des fausses couches en série dans des communautés entières, comme ce fut le cas à Sadiola, au Mali, autour d’une mine co-détenue par la canadienne IamGold (littéralement : « Jesuisdel’Or » !). Les populations voient ainsi atteintes leur généalogie même en raison de négligences industrielles. Sadiola est-elle le premier cas d’une série qu’il nous reste à découvrir ? Reste que ces investissements sont d’autant plus destructeurs qu’ils ne durent que quelques années, le temps de vider la mine de ses ressources et de repartir en laissant aux populations un paysage désolé.
G&M : Quel est le rôle des pouvoirs publics canadiens dans ce pillage ?
D. :Nos sources nous permettent de défendre l’hypothèse que le gouvernement canadien soutient des sociétés pratiquant le délit d’initié, la corruption, le trafic d’armes… à l’instar des pays « impérialistes » dont il a tellement cherché à se démarquer ces dernières décennies. Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province de l’Ontario ont tout mis en œuvre pour susciter à Toronto un « climat d’affaires » favorable au développement des sociétés minières. De sorte que de nombreuses sociétés étrangères ont été attirées à Toronto. Un plan de relance important, adopté dans les années 1990, visait non seulement à soutenir l’exploitation minière à l’intérieur du Canada en attirant des capitaux étrangers, mais aussi à soutenir les investissements canadiens à l’étranger. Outre la concentration de compétences que l’on retrouve à Toronto (Bourse, géologues, universités, cabinets d’avocats spécialisés, équipementiers…), on a fourni des avantages fiscaux ainsi qu’un encadrement « souple » : les modalités de divulgation du potentiel des gisements dont les sociétés se portent acquéreurs s’accommodent d’un flou qui convient tout à fait à la spéculation des juniors(les sociétés d’exploration qui n’ont pas les moyens d’exploiter elles-mêmes les gisements) et les minières toutes catégories confondues ne sont tenues de fournir des informations sur leurs opérations que si le cours de leur action s’en trouve affecté.
Et puis, il y a la couverture juridique : le Canada souscrit aux principes de l’OCDE, il lui revient donc d’encadrer juridiquement les sociétés cotées en Bourse ou enregistrées chez lui, mais il appert que c’est davantage pour offrir à ces sociétés une couverture juridique que pour les contraindre, puisque le Canada ne prévoit aucun recours en justice à l’intérieur de ses frontières pour des crimes que ses sociétés auraient commis à l’étranger, ou ne s’en prévaut pas s’ils existent. L’État canadien se place lui-même au service des intérêts privés : il crée une bourse sur mesure, donne un cadre fiscal et juridique sur mesure.
Toute la perversité du système repose sur le fait que les actifs des Canadiens, leur épargne, leurs cotisations dans les programmes d’assurance, leurs impôts, gérés par l’État, sont placés dans ces sociétés via des caisses publiques de placements, des fonds de retraite, et croissent en fonction de l’évolution de l’activité minière. Une diplomate canadienne que nous citons dans Noir Canada a déclaré que, si son pays épaulait l’industrie minière, ce n’était que parce que l’épargne des canadiens se trouve indexée sur l’évolution de cette industrie… On a fait des Canadiens les complices de cette industrie, à leur insu. Ils ont désormais un sérieux problème de société dont ils doivent répondre.
Une question persiste : qu’est-ce qu’il en coûte pour qu’une action monte à la Bourse de Toronto ? C’est la question que soulève Noir Canada. Est-ce qu’il faut qu’à l’autre bout, des sociétés entrent en collusion avec des seigneurs de guerre, est-ce qu’il faut pratiquer la corruption, armer des camps qui vont violer des femmes du camp adverse ou enrôler des enfants-soldats de force dans la guerre, cela pour obtenir les meilleurs rendements, ou encore à déverser des produits chimiques dans les seuls cours d’eau potable d’une région ? Est-ce qu’il faut pratiquer l’évasion fiscale à grande échelle ? Nous posons la question avec d’autant plus d’insistance que la circulation de l’information à la Bourse de Toronto ne nous permet pas d’obtenir de réponse à cela. C’est pourquoi on demande aux gens de s’enquérir eux-mêmes de ce coût humain, environnemental, politique et culturel de la croissance de leurs actifs.
G&M : On est frappé à vous lire par la porosité extrême entre les mondes politiques, diplomatiques, et les milieux d’affaires…
D. :Prenons l’exemple de la famille Desmarais : avec la famille Frère de Belgique, elle a des intérêts chez Total. Paul Desmarais était dans le Conseil consultatif de Barrick Gold. Au Canada il possède des maisons d’édition, des journaux, il est l’éditeur au Québec de La Presse(Montréal), Le Soleil (Québec), Le Droit (Ottawa-Gatineau) et Le Nouvelliste (Trois-Rivières) – tous les principaux journaux du Québec. Enfin, la famille Desmarais soutient la carrière politique de la plupart des premiers ministres depuis 1967 : Pierre-Elliot Trudeau, Brian Mulroney, Jean Chrétien… Du point de vue diplomatique, la figure emblématique, c’est Maurice Strong qui, par son rôle dans de nombreux organismes internationaux – il a été secrétaire du Sommet de la terre de Rio, il a fondé et dirigé le Programme des Nations unies pour l’environnement –, est parvenu à colporter à l’étranger cette image candide d’un Canada défenseur de la paix, des valeurs universelles, tout en ayant fait fortune dans le domaine pétrolier et en s’assurant que les intérêts financiers du Canada sont bien défendus à l’échelle internationale. Il est le co-auteur à l’ONU d’un rapport devenu fameux : Libérer l’entreprenariat dont le sous-titre éloquent est : « Mettre le monde des affaires au service des pauvres » : comme si c’était par un libéralisme économique qu’on allait réaliser les grandes valeurs universelles !
Dans les conseils d’administration des compagnies dont il est ici question, les consultants sont souvent des anciens ministres ou anciens Premiers ministres. L’absence de frontières s’observe entre l’État, ou ce qui est censé être l’État, et les détenteurs du capital, c’est-à-dire entre les acteurs du domaine public, qui ultimement sont censés garantir l’État de droit, et les actionnaires, les investisseurs qui ont des intérêts privés. Mais cette porosité est à deux sens. On a des gens qui, ayant réussi dans le domaine des affaires, se proposent de gérer l’État comme une entreprise et sont appréciés pour cela. Par exemple des émissaires de milieux ultra libéraux, comme l’actuel Premier ministre du Canada, Stephen Harper, qui a pour maîtres à penser deux universitaires de Calgary, Tom Flanagan et Robert Mansell, l’un se spécialise dans l’activité économique là où il y a des populations amérindiennes au Canada et l’autre sur le domaine énergétique, et c’est à partir de cet enseignement-là que notre Premier ministre s’est donné des compétences pour conduire un pays. Auparavant, on avait eu Paul Martin qui, tout en étant Premier ministre et ministre des finances pendant dix ans, était à la tête d’une compagnie de transports maritimes, la Canada Steamship Lines, gérée via des holdings et des sociétés écrans un peu partout sur le vaste réseau des paradis fiscaux et des ports francs. Il était l’unique actionnaire de sa société tout en étant ici ministre des Finances. Cette pratique, il l’a rendue plausible en droit canadien en confiant la gestion de sa société à une fiducie sans droit de regard, les gens géraient ses actifs sans qu’il ait le droit d’entrer en contact avec eux, de s’enquérir de la façon dont les choses évoluaient, ce qui est une pure fiction juridique.
Nous nous sommes inquiétés dans Noir Canada des pratiques en aval, celles de Premiers ministres, comme Jean Chrétien ou Joe Clark, qui, en tant qu’hommes d’État, se sont constitué des carnets d’adresse et ont eu accès à des informations, et qui en font profiter le domaine privé après coup. Il est gênant de voir par exemple Jean Chrétien, qui a été Premier ministre de 1993 à 2003, représenter des sociétés pétrolières au Niger et au Nigeria. Surtout quand on sait à quel point le Nigeria est corrompu et à quel point l’exploitation pétrolière au Nigeria fait souffrir les Nigérians. Sans parler des filiales canadiennes au Congo-Kinshasa, ou de la société pharmaceutique Millenia Hope Biopharma, sise à Montréal, qui aurait fait des expériences controversées en Afrique, et qui a requis les services de Jean Chrétien.
G&M : Vous indiquez que ce qui se passe en Afrique peut être considéré comme signe avant-coureur de ce qui va se passer au Canada dans un avenir plus ou moins proche…
Nous avons cité dans Noir Canada des cas inquiétants quant à l’exploitation pétrolière dans l’Alberta, et l’exploitation de l’uranium dans certaines régions du Québec. Les méthodes et les titulaires sont les mêmes : on ne voit aucune raison qui puisse amener à terme ces gens à être plus cléments ici qu’en Afrique. Le respect des normes repose sur des rapports de force et non sur des convictions. L’Abitibi, région minière et forestière du Québec, présente des symptômes parfois similaires à ceux qu’on observe dans les régions minières africaines. Et il y a un lobby soutenu par les médias conservateurs, qui œuvre pour qu’on privatise les dernières institutions publiques comme Hydro-Québec. Bien sûr, ce sont les mêmes que ceux qui ont des parts dans des sociétés actives dans une Afrique immergée dans la criminalité. Le Canada est en passe de ressembler à moyen ou long terme à l’Afrique, à une grande colonie, avec du bois, du pétrole, du minerai à la disposition de ceux qui peuvent s’en emparer.
G&M : Est-ce à dire que l’État, en défendant les intérêts du capital, n’est plus en mesure de défendre un droit public protecteur ?
Il y a moins d’État de droit mais un État du droit. L’État ne sert plus qu’à gérer un droit outrancièrement avantageux à ceux qui détiennent des capitaux. Ses fonctions consistent à épauler les intérêts privés par tout un ensemble de lois, de normes, de juridictions, d’impôts. Ceux qui ont les moyens d’accéder aux paradis fiscaux peuvent louer des souverainetés, se créer des entités politiques faites sur mesure, sans obligation, sans contrôle ; ces acteurs offshore jouissent de monopoles et de privilèges auxquels n’accèderont jamais les citoyens sont maintenus sous le fait de la loi, de la juridiction défendue par l’État de droit. Mais à l’intérieur de l’État de droit, on accède à des figures avantageuses du droit essentiellement en vertu des capitaux que l’on détient. On peut se revendiquer actionnaires, titulaires, propriétaires, clients, partenaires financiers, etc. et c’est en vertu de ces titres que l’on peut faire agir le droit en sa faveur mais aussi le tourner en la défaveur de ceux qui n’ont pas les moyens d’avoir accès à ces titres-là.
G&M : Qu’en est-il des discours critiques, des résistances possibles au Canada, face à ces pratiques ?
D. : Depuis plusieurs années déjà, quelques universitaires, experts et responsables d’ONG au Canada sauvent l’honneur en cultivant des données sur la question minière au Canada et esquissent des formes de protestation. Mais la chose tourne souvent court parce que certains de ces acteurs se trouvent financés directement ou indirectement par le gouvernement fédéral et sont tenus de nuancer continuellement leurs discours. Le gouvernement fédéral a entrepris depuis plus d’une quinzaine d’années d’animer lui-même le débat sur le thème de la bonne gouvernance, barbarisme qui désigne une « gestion » hissée au rang de la politique elle-même, qu’elle disqualifie en lui retirant toute portée polémique. Ces experts canadiens organisent des forums, des tables rondes, des concertations qui permettent à différents acteurs de la « société civile » (représentants des communautés, ONG, experts, lobby minier, fondations privées, parlementaires, universitaires…) d’échanger dans un impératif de « consensus » et de « décisions unanimes ». La gouvernancene débouche pour l’heure que sur des propositions faibles que le gouvernement n’arrive même pas à adopter : la création d’un ombudsman[1]pour colliger les plaintes de populations lésées par l’exploitation canadienne et l’établissement d’un cadre normatif d’exploitation soutenu en vertu de mesures « incitatives » et d’engagements « volontaires » de la part des sociétés privées…
G&M : Et en Afrique ?
D. : En Afrique, quand des puissances financières financent des dictatures, pactisent avec des dictatures, soutiennent des dictatures, pour transformer cet ordre, on ne peut compter sur des gens forts. On a considéré que notre objet d’étude devait être le Canada : on a trop rencontré d’Africains qui nous ont dit qu’ils ne comprenaient pas quelles étaient ces sociétés qui occupent leur territoire et l’exploitent, pour se prendre en Afrique pour des ethnologues et y restreindre notre champ d’étude ! C’est ici que se trouvent les informations intéressantes pour permettre aux Africains de comprendre quelles sont les structures, les sociétés qui s’interposent dans le cours de leur histoire.
G&M : L’enjeu serait donc de redonner une portée politique à l’information et aux analyses que vous apportez ?
D. :Sans dénigrer le rôle qu’ont dû jouer les représentants de la « société civile » au sein de ces forums de la gouvernance, nous avons cherché, avec Noir Canada, à désenclaver la pensée politique de ces cadres opaques de réflexion. Il n’y a aucune raison que ce discours feutré alimente et sature l’espace public. Notre travail repose sur l’expertise et on imagine mal la vie politique sans ses experts. Mais nul n’est propriétaire de ce débat. Il revient aujourd’hui à chacun de penser des formes de mobilisation pour s’assurer que nos institutions politiques n’épaulent pas une industrie dont nous désapprouvons les modalités d’exploitation et pour que notre épargne ne dépende pas de sociétés dont on ne peut contrôler l’activité. Pour établir nos thèses, il nous fallait un diagnostic à partir de ce qu’avancent des sources crédibles dans le monde et en évitant les termes mous en vigueur dans les forums de la gouvernance, où l’on dit « dérapages » là où il y a un système, « abus » là où s’observent des crimes, « mauvaise gouvernance » là où prévaut une corruptionconcertée entre des agents du Nord et des chefs d’État du Sud…
Cela, ici, évidemment, ni les experts patentés, ni la presse conservatrice ne nous le pardonnent. Les sociétés minières Barrick Gold et Banro, que j’ai évoquées plus tôt, nous poursuivent pour 11 millions $can, selon des arguments judiciaires qui se ressemblent tellement qu’on peine à imaginer qu’elles ne participent pas de la même stratégie. La société Barrick nous poursuit pour 6 millions $can pour « diffamation ». Nous nous en sommes pourtant tenus à des documents de l’ONU, du Congrès américain, de juristes sérieux ou de journalistes réputés… Aucune de nos sources n’avaient fait l’objet préalablement de poursuites judiciaires.
Aux États-Unis, on a baptisé « Slapp » ce type de poursuites que ces minières nous intentent. L’acronyme désigne une claque au visage, et le Slapp (Strategic Lawsuit Against Public Participation), manifestement, ne vise pas tant à aller au fond des choses qu’à épuiser financièrement et psychologiquement des auteurs via les procédures judiciaires qu’on souhaite ainsi « punir » de s’être engagés dans le débat public.
La poursuite pour « diffamation » de cinq millions $can que nous intente pour sa part Banro, dans la province anglophone de l’Ontario où le livre n’a pratiquement pas été distribué et où prévaut un autre code de loi, a aussi des allures de « Slapp ». Une société pour qui des frais d’avocats sont un détail comptable n’a plus aujourd’hui qu’à expédier à une cour de justice une lettre, truffée de fautes, manifestement bâclée, dans laquelle elle taxe de « diffamation » tout ce qu’elle lit sur son compte, sans même envoyer de mise en demeure au préalable à ceux qui sont mis en cause, pour les menacer à terme de faillite. Ces détournements à répétition de l’appareil judiciaire ont amené plusieurs États américains à adopter ces dernières années des mesures « anti-slapp » et le législateur québécois a annoncé cette année son intention d’emboîter le pas, dans la suite de notre affaire et après plusieurs antécédents touchant notamment les groupes environnementaux.
G&M : Pourtant on voit toutes les précautions que vous prenez pour avancer vos thèses…
D. :Dans Noir Canada, nous avons essentiellement analysé des rapports et documents nationaux et internationaux des plus crédibles portant en tout ou en partie sur le rôle de sociétés ou de politiques canadiennes en Afrique. Ils existent déjà dans l’espace public. Ce sont pour le Congo par exemple, les rapports des experts mandatés par le Conseil de sécurité de l’ONU, auditionnés au Congrès à Washington (Wayne Madsen et Keith Harmon Snow notamment), le rapport de la Commission congolaise sur l’investissement minier présidée par Christophe Lutundula, les articles ou rapports de Colette Braeckman, Dominic Johnson ou François Misser, les rapports d’organisations comme Amnesty International, Human Rights Watch ou Global Witness. Les sources abondent. Nous les avons colligées, synthétisées et analysées pour n’avancer qu’une seule chose : l’existence manifeste de sources abondantes témoignant d’un Canada occulte pillant l’Afrique par des moyens illégaux. Tant de témoignages, rapports, dépositions, articles, livres et expertises émis dans tant de villes de trois continents différents, de la part d’organisations qui n’ont souvent rien à voir les unes avec les autres, ne peuvent avoir erré à l’unisson sur les très nombreux cas litigieux qu’ils rapportent. Notre travail prend appui exclusivement sur des études de cas référencés, il ne prend pas la responsabilité ultime de ce qu’avancent ces sources mais en apprécie le nombre et la tendance. À partir de documents dûment annotés que tout lecteur peut consulter à sa guise, on peut retracer les analyses de Noir Canada à la condition d’y consacrer du temps et de la bonne volonté.
Le livre fait l’objet d’une attention sans précédent. C’est dire à quel point l’Afrique est le référent de la mauvaise conscience occidentale… Seulement, si on ne peut plus mener ce type de travaux à l’intérieur de la sphère publique sans se voir confrontés à des pressions judiciaires, il reste plus qu’à réduire les chercheurs à de placides conseillers du Prince, ne connaissant plus de la « recherche » que celle de subventions.
[1] Équivalent d’un « médiateur de la République » en France.
Nos contenus sont placés sous la licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 FR). Toute parution peut être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d’origine activée.







