
À propos de L’Ombre d’Octobre, de P. Dardot et C. Laval
Pierre Dardot et Christian Laval, L’Ombre d’Octobre. La Révolution russe et le spectre des soviets, Montréal, LUX, 2017.
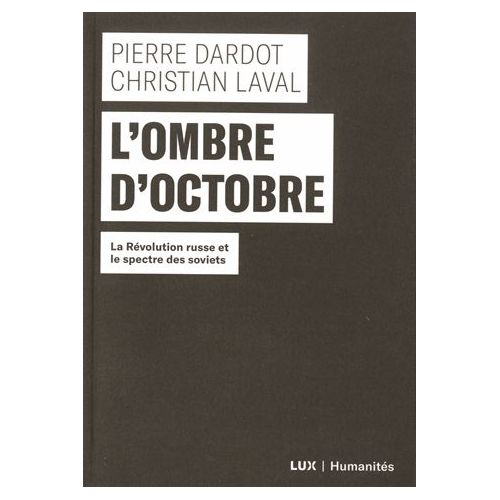
Dans cet ouvrage, paru dans le cadre du centenaire de la révolution russe, Pierre Dardot et Christian Laval proposent une interprétation d’Octobre – et de son élection au rang de modèle par la tradition marxiste-léniniste – nourrie des acquis conceptuels de leurs ouvrages précédents, notamment Marx, prénom Karl (2012) et Commun (2014). L’ouvrage se compose de cinq chapitres, dont les trois premiers proposent une histoire schématique de la révolution russe lue comme le remplacement de la démocratie soviétique par le règne du Parti-État, tandis que les deux derniers tirent le bilan de cette substitution, d’un point de vue historiographique tout d’abord (les autres révolutions occultées par Octobre et/ou déformées par son prisme), théorique ensuite (la nécessaire pluralisation des communismes).
Ouvrage de circonstance, le livre se présente également comme un texte polémique. Son titre est en effet une réponse implicite aux Leçons d’Octobre de Trotski, érigé ici en paradigme d’une certaine littérature marxiste habituée à juger les événements révolutionnaires à l’aune de leur conformité à ce « modèle » qu’est la révolution d’Octobre, du fait de son caractère victorieux. Cette pratique historiographique aurait eu pour corrélats, outre une méconnaissance du processus révolutionnaire de 1917 lui-même, un effacement ou un travestissement des autres processus révolutionnaires du XXe siècle, les exemples pris ici étant d’une part la révolution mexicaine et d’autre part la révolution espagnole, mais également un déni de la pluralité que recoupe le vocable « communisme ».
La révolution mexicaine, qui a vu peu à peu se radicaliser ses mots d’ordre libéraux de départ, et la révolution espagnole, révolution contre l’État, sont en effet deux exemples de révolution « par en bas », dont l’espace-temps est ainsi très différent de la révolution bolchevique (dont l’insurrection allemande manquée de 1923 constitue pour les deux auteurs une caricature) : montée en puissance progressive, depuis la base, construction d’institutions propres (et donc diverses selon les contextes), municipalisation de la propriété etc.
On peut résumer l’idée centrale de l’ouvrage de la manière suivante : du fait de leur schéma instrumentaliste, les bolcheviks (du moins ceux ralliés à Lénine) ont cherché avant tout à conquérir l’État comme un outil en vue de mettre en œuvre un programme préexistant, et ce indépendamment de toute dimension démocratique, les revendications « soviétistes » n’ayant jamais été que des mots d’ordre conjoncturels et stratégiques destinées à assurer la popularité du parti bolchevique.
On peut donc lire dans Octobre un simple changement de propriétaire, le Parti-État ayant remplacé le capital tout en étant pris dans la même extériorité que lui vis-à-vis de ce dont il s’agit d’assurer la gestion, une propriété (ici élargie à l’échelle d’un pays tout entier) définie indépendamment de celles et ceux qui en ont l’usage au quotidien. Or, ce schéma est contradictoire avec le communisme entendu comme association des producteurs, et donc constitution de « municipalités » aux projets inséparables des discussions démocratiques qui les font émerger. Il s’agit donc de faire entendre la pluralité de la notion de communisme, afin notamment de décorréler le terme de l’expérience soviétique.
Le premier reproche que l’on peut faire à l’ouvrage est historiographique. Sur la révolution à proprement parler, les sources mobilisées sont utilisées de manière assez curieuse. En effet, les ouvrages de M. Ferro[1] et d’A. Rabinowitch[2] mobilisés avaient été écrits dans le but, notamment, de complexifier les représentations que l’on pouvait se faire de la révolution d’Octobre en l’inscrivant dans un désordre ambiant (général et interne au parti bolchevique) plutôt que dans un plan mûrement réfléchi et simplement mis à exécution. Or, pour les deux auteurs, cela ne semble valoir que jusqu’en Octobre, ce qui permet d’opposer une « bonne » révolution de février (véritablement soviétique) à la prise du pouvoir par les bolcheviks.
Dans un tel cadre, on oublie d’une part que la révolution de février avait laissé le pouvoir véritable aux mains des anciennes élites (comme en témoigne le choix de la poursuite de la guerre, la timidité des rares mesures sociales, etc.) et n’avait rien réglé aux problèmes économiques et sociaux, notamment les pénuries en tous genres. D’autre part, assimiler Octobre à une rupture absolue interdit de mesurer l’ampleur de la mobilisation populaire qui suit la révolution d’Octobre[3], sous des formes diverses, certes, mais très réelles. On comprendrait d’ailleurs difficilement sinon la victoire de l’Armée rouge. Les sources historiques qui nourrissent le propos concernant l’après Octobre sont beaucoup plus traditionnelles (et liées à l’école « totalitarienne »[4]) que celles utilisées pour l’année 1917. Enfin, l’historiographie de la révolution russe est pléthorique[5] et l’on pourrait reprocher aux auteurs d’adopter sans le dire dans leur ouvrage une perspective ancienne et située, puisque, dans ses grandes lignes, elle regroupe, outre l’école totalitarienne, les premières analyses mencheviques d’Octobre ainsi que celles de certains anarchistes[6].
Mais il n’y aurait là qu’un simple problème factuel si cette perspective historiographique ne charriait pas avec elle un schéma explicatif global très problématique. En effet, la principale structure qui donne ici sens au récit et aux analyses est celle qui oppose les masses au Parti-État considéré dans son extériorité vis-à-vis de ces dernières. C’est là le schéma habituellement brandi par l’école totalitarienne, notamment en vue de remplacer la perspective « de classe » qui a longtemps prévalu parmi les historiens marxistes (staliniens ou non) de la révolution russe. Mais ce schéma est extrêmement partiel : elle ne rend absolument pas compte de la manière dont les masses, certaines masses du moins, ont investi l’État (d’où la notion de révolution « plébéienne » forgée par M. Lewin[7]) et dont ce dernier s’est peu à peu transformé et bureaucratisé tout au long des années 1920 et 1930.
Plus généralement, le fait de ne voir dans les événements post-révolutionnaires que le seul affrontement entre ces deux sujets interdit de considérer d’autres conflits tout aussi importants : la guerre civile et l’invasion étrangère, les conflits de classe à la ville et dans les campagnes, etc. Tout cela permet parfois de rendre compte de certaines pratiques du « Parti-État » autrement qu’en les référant à ce qui serait son essence intrinsèque.
La question est certes complexe, et il est normal d’attendre de la réflexion sur Octobre qu’elle permette d’extraire des concepts et des idéaux-types politiques. Mais l’angle d’attaque nous semble trop large ici. En effet, ce qui est remis en cause dans le schéma « instrumentaliste » des bolcheviks semble frapper d’illégitimité toute perspective politique structurée autour d’un projet de long terme, remplacée par la nécessité de laisser émerger les perspectives de manière immanente à partir des pratiques collectives ponctuelles. Tout militant, et plus généralement toute personne ayant participé à un mouvement social d’ampleur sait bien évidemment qu’il se passe des choses lors des Assemblées Générales, lors des discussions, des actions etc. Chacun-e est alors amené-e à modifier son point de vue et des solutions émergent qui n’étaient pas toujours imaginables auparavant. C’est un fait.
Mais il est tout aussi vrai que les individus qui animent les mouvements sociaux sont des individus convaincus par certaines idées et porteurs de certains discours systématiques (qu’ils appartiennent formellement à une organisation ou non). C’est ce qui s’est passé en 1917 (comme en témoigne notamment, pour les premiers mois, la correspondance à peu près exacte entre les décisions prises par le soviet de Petrograd et les débats internes au parti menchevique). Aussi est-il sans doute nécessaire de réfléchir de façon plus différenciée à la manière dont il est possible – et nécessaire – d’articuler l’élaboration théorique et stratégique aux pratiques et aux institutions de la démocratie sociale (Assemblées générales, coordinations etc.) afin de construire un discours susceptible de dépasser le simple appel à la démocratie des communs, qui apparaît parfois très formaliste quelle que soit par ailleurs sa valeur ponctuelle dans des contextes précis.
Notes
[1]M. Ferro, La Révolution de 1917 [1967], Paris : Albin Michel, 1997 ; M. Ferro, Des Soviets au communisme bureaucratique, Paris, Gallimard, 1980.
[2]A. Rabinowitch, Les Bolcheviks prennent le pouvoir. La révolution de 1917 à Petrograd [2004], Paris : La Fabrique, 2016.
[3]On trouve un témoignage saisissant de cet état de fait dans la lettre – désespérée – que Martov, dirigeant menchévique internationaliste, envoie à Axelrod un mois environ après l’insurrection. On se permet de renvoyer à notre édition de la lettre en question dans G. Fondu (ed.), Devant la révolution, Paris : Les éditions sociales, 2017.
[4]C’est notamment le cas de la principale référence historiographique qui nourrit la réflexion sur cette période, L. Schapiro.
[5]Pour une approche de cette historiographie, envisagée à travers le cas français, on se référera au petit ouvrage très dense d’É. Aunoble, La Révolution russe, une histoire française. Lectures et représentations depuis 1917, Paris : La Découverte, 2016.
[6]En 1917, cette lecture ne fait toutefois pas l’unanimité chez les anarchistes, comme en témoignent certains textes rassemblés dans Devant la révolution, op. cit.
[7]Cf. notamment la troisième partie de l’ouvrage de M. Lewin que mentionnent P. Dardot et C. Laval dans leur ouvrage : M. Lewin, La Formation du système soviétique, Paris : Gallimard, 1987.









