
Otto Bauer et l’austro-marxisme : une histoire méconnue
Le socialiste autrichien Otto Bauer, comme d’autres figures de l’école dite « austro-marxiste » trop souvent négligée, aspirait à bâtir un mouvement ouvrier de masse capable de conquérir la démocratie parlementaire, puis d’aller plus loin en instaurant une république socialiste. L’échec de cette voie ne devrait pas conduire à méconnaître les apports de cette tradition et à esquiver les questions stratégiques qu’elle a soulevées – y compris en analysant les impasses dans lesquelles Otto Bauer et les dirigeants socialistes autrichiens se sont enfermés.
***
La fin de la Première Guerre mondiale marqua un tournant historique majeure. L’effondrement des empires russe, allemand, austro-hongrois et ottoman, jadis puissants, mit un terme à ce conflit catastrophique tout en ouvrant paradoxalement la voie à une nouvelle conflagration. Dans une Europe centrale et orientale profondément remaniée, les peuples tentèrent de remettre en question le règlement imposé par les puissances alliées victorieuses.
Le rôle prédominant de l’Allemagne et de la Russie soviétique dans cette contestation, qui mènera finalement à la Seconde Guerre mondiale, relégua souvent au second plan l’histoire des plus petits États de la région. Éclipsés par les grands récits de l’époque, qui les réduisent à de simples pions ou à des acteurs secondaires de la politique des grandes puissances, ces pays restent encore largement méconnus à l’international.
La Première République d’Autriche faisait partie de ces États méconnus. Autrefois centre de pouvoir d’un vaste empire multinational de 55 millions d’habitants, l’Autriche, réduite à 6 millions de citoyens après la dissolution de l’Empire austro-hongrois en 1918, voyait un tiers de sa population concentré à Vienne, l’ancienne capitale impériale. Mis à part son annexion brutale par l’Allemagne nazie en 1938, cette république, pourtant fascinante, retenait peu l’attention des historiens étrangers.
C’est pourquoi la traduction de l’ouvrage classique Otto Bauer The Austrian Revolution, par Walter Baier et Éric Canepa, constitue une contribution précieuse à la littérature anglophone sur l’histoire autrichienne. (Disponible en français). Publié en 1923, ce livre analyse les premières années de la république à travers le regard d’un théoricien majeur du socialisme européen et d’un acteur de premier plan en Autriche. Profondément influencé par l’expérience politique concrète de son auteur, il reflète son engagement en faveur d’une approche marxiste pour comprendre les événements en cours.
La vie politique d’Otto Bauer
Otto Bauer (1881-1938) était un intellectuel aux intérêts et aux talents multiples. Né en 1881 dans une famille juive libérale et aisée, il étudia le droit à l’Université de Vienne où, en tant que membre de la Ligue des Étudiants Socialistes, il rejoignit un cercle de jeunes intellectuels – considérés plus tard comme les fondateurs de l’« école austro-marxiste » – . Ils se donnaient pour mission « d’approfondir la théorie sociale de Marx et Engels, de la soumettre à la critique et de l’ancrer dans la pensée intellectuelle moderne ». Malgré des spécialités disciplinaires diverses, ses compagnons, dont Karl Renner (1870-1950) (droit), Max Adler (1873-1937) (philosophie) et Rudolf Hilferding (1877-1941) (économie politique), partageaient une approche non dogmatique de la théorie marxiste.
Au départ, Bauer se consacrait principalement à la « question des nationalités », un enjeu majeur de l’Empire austro-hongrois, où Tchèques, Slovaques, Croates, Italiens, Ukrainiens, Hongrois et Polonais, entre autres, revendiquaient leur place dans un système semi-absolutiste dominé par les Autrichiens d’origine allemande. En 1907, à seulement vingt-six ans, il publie La question des nationalités et la Social-démocratie, une tentative de théoriser les efforts de la social-démocratie pour bâtir un mouvement ouvrier interterritorial et interethnique, tout en garantissant les droits culturels et juridiques des myriades de nationalités de l’empire. Si cette ambition s’est soldée par un échec, elle a néanmoins imposé Otto Bauer comme l’un des penseurs socialistes les plus influents de son époque.
Entre-temps, en tant que membre du Parti Ouvrier Social-Démocrate (SDAP), Otto Bauer fait preuve d’une énorme capacité de travail politique. En 1907, Bauer fonde Der Kampf (la lutte), qui devient la principale revue théorique du Parti. Il écrit également presque quotidiennement sur une multitude de sujets dans le journal phare du SDAP, Die Arbeiter-Zeitung (Le Journal des Travailleurs). En 1914, il accède au poste de secrétaire du Parti, s’imposant comme le successeur naturel de son leader vieillissant, Victor Adler. (1852-1918)
Lorsque la direction du SDAP décida de soutenir la déclaration de guerre du gouvernement impérial à la Serbie en août 1914 – décision qui précipita la Première Guerre mondiale –, Bauer ne s’y opposa pas. Fait prisonnier, il est libéré après la chute du tsar et rentre en Autriche en septembre 1917, marqué par son séjour dans la Petrograd révolutionnaire. Radicalisé par cette expérience sans pour autant adhérer au bolchevisme, il revient à Vienne, où il joue un rôle clé alors que l’empire s’effondre sur des bases ethniques. À la mort de Victor Adler, il lui succède de facto à la tête du Parti.
En novembre 1918, l’Assemblée nationale provisoire autrichienne met en place un gouvernement dominé par les sociaux-démocrates, avec Karl Renner (1870-1950) comme chancelier et Bauer comme ministre des Affaires étrangères. Il assiste alors de près à la naissance de la nouvelle République autrichienne, mais aussi à une décision lourde de conséquences : la signature, sous contrainte, du Traité de Saint-Germain-en-Laye. Ce traité impose à l’Autriche d’assumer la culpabilité de l’Empire austro-hongrois dans le déclenchement de la guerre, l’accable d’un lourd fardeau de réparations et lui interdit toute unification avec la nouvelle République allemande.
Convaincu qu’une Autriche réduite à ses seules frontières n’est pas viable économiquement, Bauer fait de l’unité avec l’Allemagne le pilier de sa politique étrangère. Toutefois, après la ratification du traité par le gouvernement en septembre 1919, il démissionne et se consacre entièrement aux affaires du Parti et à la politique parlementaire.
La révolution autrichienne
L’histoire de Bauer retrace les premières années de la république démocratique autrichienne, une période à la fois porteuse d’espoir et marquée par une profonde crise économique et politique, révélant rapidement les limites du nouvel ordre parlementaire.
Divisée en cinq sections chronologiques, la première partie de son ouvrage s’attarde sur la question des nationalités et son lien avec la guerre et la révolution. Dans quatre chapitres détaillés, Bauer analyse comment les tensions d’avant-guerre entre la monarchie des Habsbourg et les groupes ethniques soumis à son autorité ont conduit à la guerre en 1914, puis à l’implosion de l’Empire austro-hongrois quatre ans plus tard. Selon lui, c’est la crainte des Habsbourg face aux aspirations nationales des Slaves du Sud, longtemps maintenus dans un état de « servitude, de fragmentation et de silence historique sous la domination des Allemands, des Italiens, des Hongrois et des Turcs, qui les poussa à déclarer la guerre à la Serbie.
Si le conflit a d’abord semblé estomper les divisions ethniques et sociales au sein de l’Empire, il a, en réalité, accéléré un processus de révolution nationale amorcé depuis plusieurs décennies. En 1918, après quatre années de pertes humaines massives, de privations et d’échecs militaires, l’Empire a perdu toute légitimité et n’a plus les moyens de contenir les forces de la réforme démocratique et de l’indépendance nationale.
Pour les Autrichiens allemands, la question nationale se pose différemment. Bauer observe que « le conflit entre notre germanité et notre autrichité traverse toute l’histoire récente de la Germanie-Autriche ». Il analyse les oscillations des différentes classes sociales germano-autrichiennes entre deux orientations : l’unité avec l’Allemagne ou le maintien d’un empire multiethnique sous leur domination.
En 1914, la bourgeoisie considère ce dilemme résolu : l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie sont unies dans une guerre patriotique et défensive. Elle est d’ailleurs rejointe dans cette attitude par le mouvement ouvrier qui, malgré ses engagements internationalistes, est saisi par la crainte d’une victoire russe.
Toutefois, cette adhésion à l’effort de guerre s’effrite avec le temps. À mesure que le conflit s’éternise, le sentiment anti-guerre s’intensifie, en particulier au sein du mouvement ouvrier. Bauer décrit en détail comment le SDAP a évolué d’un soutien initial à l’hostilité envers la guerre, finissant par défendre l’autodétermination des peuples de l’Empire.
À la fin d’octobre 1918, le régime des Habsbourg s’était effondré. Dans la deuxième partie, Bauer décrit l’effondrement de l’effort de guerre et la victoire des rébellions populaires qui ont créé de nouveaux États nationaux dans l’ancien empire, y compris en Autriche allemande. C’est là, selon Bauer, que s’est déroulé un processus révolutionnaire à la fois national, démocratique et social.
La révolution démocratique autrichienne, écrit-il, s’acheva le 12 novembre 1918 avec la création d’une Assemblée nationale provisoire. Mais la révolution sociale, elle, se poursuivit encore quelque temps. Pendant deux ans, jusqu’à sa défaite aux élections parlementaires d’après-guerre, le SDAP domine cet organe. Durant cette période, sous ce que Bauer appelle « l’hégémonie de la classe ouvrière », l’État met en place d’importantes réformes en faveur des travailleurs :
• Journée de travail de huit heures
• Droits de négociation collective
• Conseils ouvriers sur le lieu de travail
Mais la transformation de la société autrichienne rencontre de nombreux obstacles, tant internes qu’externes. Comme de nombreux dirigeants sociaux-démocrates, Bauer se voit comme un révolutionnaire socialiste, tout en redoutant le chaos et la violence que la révolution pouvait entraîner.
Son analyse des événements de Vienne montre clairement qu’il ne partage pas l’enthousiasme bolchevique. Lorsque des soldats radicalisés brisent la discipline militaire, s’emparent de biens privés et de rations de l’État, et tentent de créer une « Garde rouge », Bauer qualifie ces actes de « romantisme révolutionnaire du bolchevisme ». Il est soulagé de voir la plupart des soldats rentrer chez eux et soutient la formation d’une nouvelle armée, la Volkswehr, majoritairement composée de travailleurs sociaux-démocrates. Selon lui, elle « sauve le pays du danger imminent de l’anarchie » et des menaces extérieures.
Pour Otto Bauer, le cadre parlementaire, renforcé par de nouvelles institutions comme les conseils d’usine, constitue le socle d’une progression vers le socialisme. Il estime que la révolution sociale débute dans les casernes de la garnison de Vienne, où les soldats se révoltent contre leurs officiers, avant de s’étendre à la classe ouvrière, qui se mobilise en faveur d’une république. Il voit dans ce mouvement l’aboutissement de décennies d’efforts sociaux-démocrates pour ancrer la classe ouvrière dans une culture démocratique. « La révolution nationale, écrit-il, est devenue l’affaire du prolétariat, et la révolution prolétarienne le moteur de la révolution nationale. »
Les événements du 12 novembre 1918 bénéficient d’un soutien large, même dans les campagnes conservatrices. Mais Bauer insiste : c’est avant tout l’action concertée de la gauche unifiée qui a permis l’instauration de la république sans bain de sang. Il est convaincu que l’ordre parlementaire, structuré par des institutions comme les conseils ouvriers, offre un cadre stable pour une transition socialiste progressive, évitant ainsi les « violences » du bolchevisme.
Les sociaux-démocrates au pouvoir
Dans la troisième partie de son ouvrage, Otto Bauer examine les tentatives du gouvernement social-démocrate (SDAP) d’améliorer les conditions des travailleurs et expose ses idées pour organiser une nouvelle économie socialiste.
Cependant, il ne passe pas sous silence les obstacles majeurs qui freinent ces ambitions :
• L’isolement politique de l’Autriche sur la scène internationale,
• Les divisions internes, notamment entre la paysannerie catholique antisocialiste, la bourgeoisie urbaine et les centres industriels acquis aux socialistes,
• Une crise économique aiguë, marquée par une inflation galopante et des pénuries de nourriture, de carburant et de matières premières.
Bauer décrit comment le gouvernement de gauche doit naviguer entre ces écueils, évitant la guerre avec les voisins convoitant le territoire autrichien, repoussant l’ingérence des puissances occidentales, inquiètes de la propagation de la révolution communiste, et se tenant à l’écart des troubles révolutionnaires en Hongrie, où l’instauration d’une république soviétique en mars 1919 déclenche un conflit aboutissant à une contre-révolution victorieuse.
Dans ce contexte explosif, Bauer est convaincu que la tâche du mouvement ouvrier n’est pas d’instaurer une “dictature du prolétariat” à la manière bolchevique, mais plutôt de jouer un rôle de “serre-frein” de la révolution. Selon lui, les travailleurs doivent exercer leur pouvoir avec prudence, et il incombe à la social-démocratie d’empêcher des actions irréfléchies aux conséquences désastreuses. Pour ce faire, écrit-il, le gouvernement du SDAP entretient un dialogue constant avec les principaux organes non gouvernementaux du mouvement ouvrier – syndicats, conseils d’ouvriers et de soldats – afin de proposer des réformes pouvant être adoptées par l’Assemblée nationale.
Mais cette politique de compromis s’avère périlleuse et impopulaire. Les travailleurs, exaspérés, réclament plus que ce que le gouvernement est en mesure d’offrir. Bauer insiste néanmoins sur l’importance de ce processus, essentiel à l’éducation politique de la classe ouvrière et à l’élévation de sa conscience sociale. Selon lui, le SDAP a fait tout son possible dans un contexte particulièrement difficile.
Toutefois, Bauer surestime la capacité du SDAP à imposer son hégémonie idéologique. Il affirme que, “à travers des luttes purement intellectuelles, [les travailleurs] ont élargi leur horizon, aiguisé leur agilité intellectuelle et renforcé leur volonté d’auto-détermination”. Comme d’autres austro-marxistes, il considère l’éducation politique comme la mission fondamentale de l’intellectuel socialiste. Pourtant, l’échec ultérieur du SDAP à obtenir des majorités électorales révèle les limites de cette approche et son incapacité à conquérir durablement la classe ouvrière et d’autres catégories sociales.
Dans les quatrième et cinquième parties, Bauer analyse l’évolution des rapports de force entre les classes sociales autrichiennes et la manière dont elles s’affrontent ou collaborent sur la scène politique. Dès l’automne 1920, avant même que le SDAP ne perde les élections législatives face aux chrétiens-sociaux (son ancien partenaire de coalition), il est clair que la paysannerie et la bourgeoisie se sont relevées du choc révolutionnaire et ne veulent plus composer avec les socialistes.
Les chrétiens-sociaux, en désaccord avec les nationalistes pangermanistes, ne disposent pas de la majorité absolue au parlement. Bauer reste persuadé qu’un “équilibre des forces de classe” permet au mouvement ouvrier de conserver du pouvoir, via le SDAP, les syndicats et d’autres organisations. Cependant, en 1922, il constate que les chrétiens-sociaux, avec l’aide de la haute finance internationale, sont parvenus à former une coalition regroupant la paysannerie, la petite-bourgeoisie et l’ensemble des élites industrielles et financières. La bourgeoisie impose alors progressivement sa domination sur la république.
Toutefois, cette mainmise n’est pas totalement acquise. Bauer souligne que le SDAP conserve une forte implantation dans l’armée républicaine et dans la « Vienne rouge », où le Parti obtient systématiquement la majorité absolue et met en place un vaste ensemble de réformes urbaines et sociales. Il sait que ces acquis pourraient être remis en cause par un gouvernement bourgeois renforcé, mais il reste convaincu que le SDAP peut rebondir. Selon lui, la droite échouera à résoudre les crises économiques et sociales, ce qui offrirait une opportunité aux sociaux-démocrates pour rallier les employés et les petits commerçants à leur cause, renverser le gouvernement bourgeois et reconquérir le pouvoir des travailleurs.
Malgré cette rhétorique radicale, Bauer rejeta l’utilisation de l’action de masse à moins que la bourgeoisie ne tente de détruire la constitution républicaine. La victoire doit être obtenue dans le cadre de la politique parlementaire.
Le dilemme du socialisme démocratique
Les événements ne se déroulèrent pas comme Bauer l’espérait. La social-démocratie ne retrouva jamais le pouvoir, tandis que les chrétiens-sociaux, méthodiquement, préparaient la chute de la république, qui fut renversée en 1934. Bien que le mouvement ouvrier autrichien ait opposé une résistance armée, ses dirigeants, Bauer compris, n’appelèrent à la lutte qu’une fois l’issue déjà scellée, rendant leur intervention inefficace.
Bien que La révolution autrichienne de Bauer ait été publiée dix ans plus tôt, son analyse de la révolution et du système qui en est issu éclaire sa vision politique. Celle-ci a joué un rôle majeur dans l’échec de la république et illustre ce que Peter Gay (1923-2015) a appelé « le dilemme du socialisme démocratique ».
À la tête d’un parti de 600 000 membres – soit 10 % de la population – et remportant plus de 40 % des voix aux élections législatives, Bauer devait maintenir l’unité du SDAP face à la rivalité communiste. Pour cela, il adoptait souvent une rhétorique révolutionnaire, exaltant la lutte des classes et appelant à la transformation radicale de la société capitaliste.
Dans les faits, cependant, il restait fermement attaché à la voie parlementaire et refusait d’envisager d’autres stratégies. Face à une droite antirépublicaine prête à recourir à une violence sans scrupule, l’issue était inévitable : la république était condamnée.
*
William Smaldone est professeur d’histoire E. J. Whipple à l’Université de Willamette, coéditeur d’une collection en deux volumes sur l’austro-marxisme et auteur de Rudolf Hilferding : The Tragedy of a German Social Democrat.. Son dernier ouvrage s’intitule « Freedom is Indivisible » : Rudolf Hilferding’s Correspondence with Karl Kautsky, Leon Trotsky, and Paul Hertz, 1902-1938 (La liberté est indivisible : la correspondance de Rudolf Hilferding avec Karl Kautsky, Léon Trotsky et Paul Hertz, 1902-1938).
Publié initialement par Jacobin. Traduit de l’anglais pour Contretemps par Christian Dubucq.
![Le moment Poulantzas de la gauche française ? [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/images-10-150x150.jpeg)





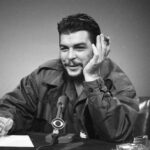
![1848. Marx et l’épreuve de la révolution [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/marx_engels-150x150.jpg)

![Le jeune Marx, ou comment Marx est devenu révolutionnaire [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/2022-02-09-11.47.07-150x150.jpg)