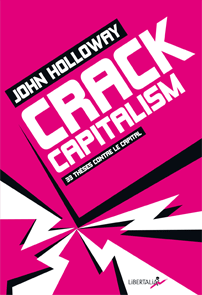
A propos de « Crack Capitalism » (de John Holloway)
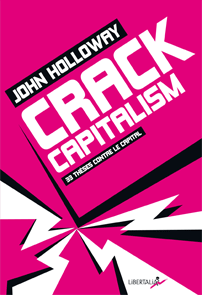
John Holloway, 2012 [2010], Crack Capitalism, 33 thèses contre le capital. Traduction de José Chatroussat, Padoue, Libertalia, 464 pages.
Nous lançons une pierre sur la couche de glace qui recouvre le lac des possibilités. La pierre provoque un trou dans la glace mais la glace est épaisse, la journée est froide et, bientôt, le trou disparaît. Nous gardons avec enthousiasme en mémoire quelque chose de beau, nous avons entrevu un antre futur possible. Nous jetons une nouvelle pierre et, cette fois, nous ne provoquons pas seulement un trou, mais des brèches qui jaillissent dans différentes directions, certaines se connectant avec d’autres brèches qui se sont propagées à partir du trou provoqué par la pierre lancée par quelqu’un d’autre. Si la glace doit être brisée complètement, alors cela se peut se produire que d’une seule façon : par toutes sortes de gens lançant des pierres et par le jaillissement de brèches qui parfois se connectent. (p. 134).
John Holloway propose dans son ouvrage 33 thèses pour l’émancipation et contre le capital. Il ne s’agit pas d’un essai proposant une boussole pour une avant-garde du prolétariat qui voudrait affronter le capital et son Etat, puisqu’il prolonge la réflexion après Changer le monde sans prendre le pouvoir1. Pour Holloway, opposer au système une force capable de le renverser, c’est jouer sur son terrain et reproduire des formes d’oppression. Il faut donc regarder le problème de l’autre côté : « comprendre le capitalisme non pas comme domination, mais à partir de la perspective de sa crise, de ses contradictions, de ses faiblesses » (p. 32).
Pour reprendre l’initiative, Holloway nous propose de concentrer notre attention non sur l’ennemi mais sur nous même, et de reprendre l’idée de la Boétie : faire la révolution, c’est simplement refuser de continuer à soutenir le capitalisme, et faire les choses autrement. C’est donc le tableau de ces multiples refus, résistance ou pas de côté que dresse l’auteur, souvent issu des expériences en Amérique Latine. Pour donner un sens global à tous éléments, s’organiser sans pour autant s’institutionnaliser – même en parti, Holloway développe la méthode de la brèche : penser le monde, « tout simplement, à partir de notre inadaptation à celui-ci » (p. 31), concevoir « le changement radical du monde […] comme la multiplicité de mouvements interstitiels découlant du particulier » (p. 35).
L’inadaptation de chaque particulier au monde tel qu’il est permet de penser les contradictions du système dans leur diversité plutôt que d’en choisir une principale. Si bien que les brèches n’ont pas à se rejoindre automatiquement : « c’est seulement si la lutte est comprise comme étant notre lutte qu’il peut y avoir une jonction réelle entre les brèches » (p. 128). Dans chaque cas, notre non-conformité avec la logique du capital, qu’elle que soit sa forme, nous ouvre sur un autre futur possible. C’est cet élan vitaliste qu’Holloway nous propose comme moteur et comme perspective pour une dynamique émancipatrice. Une brèche, « c’est aussi un moment au cours duquel le rire fait une percée à travers le sérieux de la domination et de la soumission, non pas le rire individuel mais le rire collectif qui ouvre un autre monde » (p. 65).
Les brèches s’affrontent à l’Etat et en subissent la répression. C’est pourquoi, Holloway concède qu’une forme d’autodéfense peut être nécessaire. Néanmoins, l’auteur insiste essentiellement sur les risques qu’elle comporte : lorsque nous nous défendons, c’est à nouveau l’Etat qui fixe le cadre et la temporalité de l’affrontement. Et surtout, la résistance sur le terrain de la violence engendre la reproduction des structures de pouvoir. Même en dehors de l’affrontement direct, les organisations politiques qui se concentrent sur l’Etat sont condamnées à se positionner en extériorité à la société, produisant une politique de direction des « masses » plutôt qu’une politique « de la dignité » prenant « sa source dans une reconnaissance du pouvoir créateur du sujet opprimé » (p. 109).
Les brèches s’affrontent également à la loi de la valeur, la « fondation de la synthèse sociale », « la force réelle de cohésion » (p. 121) qui se tient derrière l’Etat. Dans cette section sur la valeur, Holloway parvient à conserver l’écriture très accessible du livre pour exposer sa conception très dialectique du capital comme relation sociale : « la valeur est incompatible avec l’autodétermination ou avec n’importe quelle sorte de détermination consciente. […] Les capitalistes sont des capitalistes, non pas parce qu’ils contrôlent la valeur, mais parce qu’ils la servent » (p. 123). Ici encore, Holloway nous indique les limites et les risques inhérents à chaque alternative à la loi de valeur davantage qu’il ne nous propose une orientation. La planification ne peut servir l’autodétermination, les expériences d’usines récupérées et de coopératives, de même que les revenus sociaux de subsistance, constituent pour Holloway des alternatives qui subissent les attaques permanentes de la valeur. « La question est à coup sûr qu’il n’y a aucune pureté en la matière. […] Le défi est toujours de voir jusqu’à quel point nous pouvons utiliser l’argent sans être utilisé par lui, sans lui permettre de déterminer nos activités et nos relations » (p. 127-128).
L’économie solidaire ou alternative peut n’être qu’un complément du capitalisme, si elle perd sa dimension conflictuelle. Par opposition au travail, c’est-à-dire « un faire qui est désagréable ou soumis à une contrainte ou à une détermination extérieure », la substance de la brèche est « l’activité qui est potentiellement autodéterminée » (p. 150). « L’autre-faire est un acte de rébellion, un contre-et-au-delà » (p. 129). Puisque la valeur et l’Etat sapent en permanence les brèches, elles sont donc toujours précaires : « la possibilité des brèches réside dans leur mobilité. Réfléchissons aux usines occupées ou aux coopératives par exemple. […] C’est en tant qu’élément d’un mouvement de lutte que l’occupation de l’usine devient importante, […] comme un présent ouvert » (p. 133). Les organisations non plus ne peuvent se stabiliser, s’institutionnaliser, sans risquer de perdre leur potentiel transformateur ou du moins de se fermer à certaines sortes d’autre-faire. Elles doivent donc rester ouvertes et réceptives, quitte à paraître moins radicales.
La double nature du travail
La thèse principale de ce livre concerne la double nature du travail. « Tout simplement, la vie est l’antagonisme entre le faire et le travail abstrait » (p. 311). Le faire prend la forme du travail dans la société capitaliste ; plus précisément, le faire est « aliéné ou abstrait en travail » (p. 163). Le fétichisme qui nous place sous la domination de différentes abstractions n’est pas une illusion. La logique de la valeur, le besoin d’avoir un revenu et la répression nous forcent à travailler, nous enferment chacun dans un rôle au point que nous nous identifions à notre rôle. Pour Holloway, la citoyenneté n’est que l’abstraction de l’individualité produite par l’abstraction du faire en travail. On retrouve ici la détermination de la superstructure par l’infrastructure, puisque pour Holloway l’Etat n’est qu’un sous-produit de la forme que prend l’activité humaine sous le capitalisme, de la loi de la valeur. Mais il s’agit surtout de décentrer l’attention de la lutte pour le pouvoir vers notre propre activité. En effet, si le faire est réellement aliéné en travail, l’aliénation n’est pourtant jamais complète, et l’inadéquation entre notre faire et sa forme travail, ce qui sépare notre humanité de notre rôle social, c’est précisément ce qui rend possible la constitution de brèches partout et toujours, plutôt que la lucidité d’un intellectuel ou d’une avant-garde. Puisque c’est ce travail, fragilisé par sa contradiction avec le faire, qui structure la société, le capitalisme lui-même est précaire. Il doit toujours répéter la violence de l’accumulation primitive, opérer une « réitération performative »2 de l’abstraction du faire dans le travail. Holloway reprend donc à son compte la critique ad hominem (au nom de l’humain) de Marx : la vitalité humaine est le fossoyeur du capital. Ce sont les êtres humains qui font la société et la font tenir. Mais ce faire n’est pas totalement subsumé dans le travail, « il déborde de la forme ou il existe dans-contre-et-au-delà de la forme » (p. 173). La brèche est donc toujours potentiellement présente dans chaque activité humaine.
Contre toute forme de téléologie, cette potentialité s’oppose au socialisme comme « destin historique » de la classe ouvrière. La critique d’un certain positivisme du marxisme orthodoxe va jusqu’à remettre en cause les Lumières et leur raison ; « Le travail abstrait est la base de la raison instrumentale, la formalisation de la raison qui émerge au siècle des Lumières pour devenir la base de la pensée bourgeoise moderne où la vérité n’a de sens que comme mesure de l’efficacité des moyens pour atteindre une fin, où les gens eux-mêmes en viennent à être considérés uniquement comme des moyens pour une fin. Dans cette totalité, la seule signification est quantitative : […] le progrès » (p. 244). Les mobilisations contre les méga-projets scientifiques-industriels (aéroports, trains à grande vitesse, OGM, etc.) prennent alors un sens plus profond qu’une simple sensibilité écologique ou une appréhension face à la modernité : il s’agit d’un refus de l’extension de la logique de capital, d’une résistance du faire là où il n’est pas encore devenu du travail.
Non sans humour, Holloway se refuse à proposer une stratégie, à se poser en leader politique ou simplement intellectuel, et ne donne donc aucune ligne à suivre : « Le capital est un ensemble de règles qui canalisent le flot de nos activités : pour briser le capital, nous brisons les règles. Comment les brisons-nous ? Certaines règles sur la façon de le faire avaient l’habitude d’exister. Mais heureusement, elles ont été brisées. » (p. 245). On cherchera en vain des indications plus précises. La lecture du livre est donc fort frustrante pour les militant·e·s : toute stratégie pour renverser le capital est une impasse, et Holloway ne nous offre en échange qu’une invitation à l’ébrécher à chaque occasion. Pourtant, le ton de ce livre et le pari vitaliste de son auteur nous laissent avec une envie militante renouvelée. Le livre nous offre une nouvelle définition de la révolution, modeste mais concrète : « assumer notre responsabilité en tant que créateurs de la réalité sociale, assumer socialement notre pouvoir-de-faire » (p. 245).
Nos contenus sont sous licence Creative Commons, libres de diffusion, et Copyleft. Toute parution peut donc être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d’origine activée.
à voir aussi
références
| ⇧1 | John Holloway, 2007 [2002], Changer le monde sans prendre le pouvoir, Paris/Montréal, Syllepse/Lux. Voir également la critique de Daniel Benaïd. |
|---|---|
| ⇧2 | J. Bulter, cité par M. Stoetzler (2009), « Adorno, Non-identity, sexuality » in Holloway, Matamoros et Tischler, Negativity and revolution: Adorno and Political Activism, London, Pluto, pp. 151-188 |
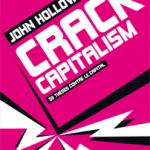



![Récits de militantes : Annick Coupé, de mai 68 au mouvement altermondialiste [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/annick-coupe-150x150.jpg)

![Une organisation non capitaliste de la vie : discussion avec Jérôme Baschet – partie 3 [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/chiapas-manda-el-pueblo-150x150.jpg)

![Une organisation non capitaliste de la vie : discussion avec Jérôme Baschet – partie 1 [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Chiapas_school_in_zapatistaland-150x150.jpg)
