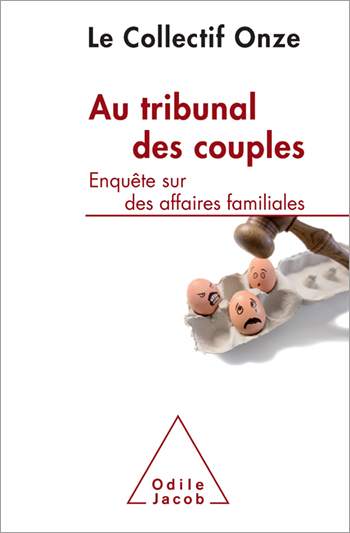
Recension : « Au tribunal des couples. Enquête sur des affaires familiales »

Au tribunal des couples. Enquête sur des affaires familiales, Le Collectif Onze, éd. Odile Jacob, 2013, 309 pages
Plus qu’une enquête sociologique
Au tribunal des couples présente les résultats d’une enquête sociologique, mais l’ouvrage n’est pas qu’un exercice académique : il constitue un outil très intéressant pour les militant·e·s qui se penchent sur la famille, en particulier sur les inégalités entre hommes et femmes telles qu’elles sont structurées dans la sphère familiale, et à la manière dont le droit et le système judiciaire agissent sur ces inégalités. Comme le titre l’indique, l’enjeu de cette étude collective est de comprendre des « affaires familiales » de séparation, de divorce, de dispute sur le montant d’une pension alimentaire ou sur la garde des enfants en se penchant sur l’institution judiciaire : les tribunaux de grande instance. La justice familiale constitue ce que les auteur·e·s appellent une « justice de masse » : 400 000 nouvelles procédures sont engagées chaque année, 190 000 jugements sont rendus annuellement sur la prise en charge des enfants de couples séparés ou divorcés (pension alimentaire, hébergement). Dans les quatre tribunaux étudiés par les sociologues, chaque juge aux affaires familiales a traité en moyenne 885 affaires pour l’année 2010. Analyser le fonctionnement et les effets de la justice familiale permet non seulement de saisir une expérience vécue par un grand nombre de personnes issues de tous les milieux sociaux, mais aussi de comprendre comment l’État, par le droit et la justice, contribue à donner forme à la famille, à en définir les contours et le fonctionnement légitimes. Nous verrons en particulier que la régulation juridique des affaires conjugales distribue des rôles différenciés aux hommes et aux femmes, ces dernières étant chargées d’office de l’entretien quotidien et de l’éducation des enfants.
Une des grandes forces de l’ouvrage est de s’appuyer sur un travail véritablement collectif : l’enquête de terrain a été réalisée par 47 personnes, étudiant·e·s, doctorant·e·s et chercheuses·eurs titulaires. Le matériau récolté est imposant : plus de 120 heures d’audience observées, soit 330 affaires, des entretiens avec 21 juges, avec des greffières, des avocats, des enquêteurs sociaux, et une étude statistique à partir de dossiers archivés dans les tribunaux. Les résultats de l’analyse statistique et de l’observation du fonctionnement de quatre tribunaux sont régulièrement mis en regard des données disponibles pour l’échelle nationale. Le livre a été rédigé collectivement par onze personnes, il ne s’agit pas d’une juxtaposition de chapitres écrits par des auteur·e·s différent·e·s, ce qui contribue à faire de l’ouvrage un texte cohérent et facile d’accès.
Le livre est organisé en cinq chapitres. Les deux premiers analysent le fonctionnement de la justice des affaires familiales (chap. 1) et la façon dont la vie privée des justiciables est mise en scène ou soustraite au regard des magistrat·e·s (chap. 2). Les trois derniers chapitres abordent des questions plus directement politiques : d’abord en s’attaquant, preuves à l’appui, à l’affirmation masculiniste que l’importante proportion de femmes dans la magistrature aboutit à des décisions qui léseraient les pères (chap. 3) ; puis en analysant la manière dont la justice aux affaires familiales reproduit l’attribution de la prise en charge des enfants aux femmes, aux dépens de leur activité professionnelle (chap. 4) ; enfin en se penchant sur le rôle de la justice dans le renforcement des inégalités économiques entre hommes et femmes (chap. 5). En traitant chacun de ces thèmes, les auteur·e·s prêtent une grande attention aux rapports de classe et à la reproduction des inégalités sociales.
Sans pouvoir en restituer toute la richesse, je résume ici quelques enjeux saillants de l’ouvrage : tout d’abord le fonctionnement de la justice aux affaires familiales et les effets différenciés de ce fonctionnement selon la classe sociale des justiciables ; ensuite le rôle de la justice aux affaires familiales dans la reproduction du pouvoir des hommes sur les femmes et les enfants ; et enfin la façon dont le règlement judiciaire des séparations conjugales assure la préservation de l’ordre social et du pouvoir de la bourgeoisie.
La justice aux affaires familiales : une justice « de masse » inégalitaire
La justice subit, comme d’autres institutions publiques ou para-publiques (l’éducation, la santé, le travail social etc.), une transformation du mode de gestion qui vise à imposer des impératifs de productivité. Les affaires familiales sont particulièrement ciblées par des mesures de réduction des coûts et d’augmentation de la « cadence », car elles représentent la moitié des affaires traitées dans les tribunaux de grande instance (TGI). Les juges sont ainsi incité·e·s à clore les affaires le plus rapidement possible, et donc à accorder moins de temps à chacune.
« Or, ces techniques de gestion de la masse n’ont pas des effets uniformes sur tous les publics des affaires familiales. Elles creusent les inégalités sociales entre les justiciables des classes moyennes et supérieures – qui bénéficient de délais plus rapides et peuvent davantage s’entourer de professionnels pour les assister – et ceux des classes populaires, qui font davantage face à la justice sans avocat, et avec des délais plus longs. » (p. 16)
La contraction des moyens accordés aux affaires familiales a pour conséquence, par exemple, qu’aucune des affaires observées par les chercheurs/euses qui impliquaient des justiciables maîtrisant mal le français n’a inclus le recours à un·e interprète. L’injonction à « faire du chiffre » a également des effets sur la durée des procédures : alors que les justiciables de classes populaires sont entendus moins longtemps par le juge, ils·elles doivent attendre plus longtemps la décision finale. Cet écart entre classes populaires et classes moyennes et supérieures tient notamment au fait que ce sont les divorces qui sont retenus comme indicateur de performance des tribunaux : les juges sont incité·e·s à réduire la durée des procédures de divorces. Or les personnes de classes populaires sont relativement moins nombreuses que les personnes de classes moyennes et supérieures à se rendre au tribunal pour divorcer : d’une part parce qu’elles se marient moins souvent (elles vivent plus souvent en concubinage), et surtout parce qu’elles se rendent plus souvent au tribunal pour faire modifier une décision antérieure, à la demande notamment de la caisse des allocations familiales (CAF). En termes de division du travail au sein des tribunaux, ce sont les greffières (toutes des femmes dans les tribunaux étudiés) qui subissent en première ligne une surcharge de travail qui les oblige à faire des heures supplémentaires probablement non rémunérées. Le « nouveau management public », qui importe les outils de la gestion privée dans le secteur public (indicateurs de performance, primes à la productivité etc.) et impose un objectif de rentabilité, touche ainsi avant tout les justiciables de classes populaires et les travailleuses moins qualifiées et moins rémunérées1.
Les personnes de classes populaires sont majoritaires dans le recours aux chambres des affaires familiales : d’une part parce qu’elles sont majoritaires dans la population en général, et aussi parce qu’elles sont plus souvent confrontées aux institutions étatiques d’encadrement et de contrôle social comme la CAF ou encore la préfecture de police. Ces institutions demandent des documents fournis par le/la juge aux affaires familiales (JAF) pour répondre à une demande : par exemple, la préfecture exige une attestation d’autorité parentale avant de renouveler le titre de séjour d’un parent, ou la CAF demande la déclaration par le/la juge de l’impécuniosité d’un homme (c’est-à-dire la reconnaissance par le/la juge qu’il n’a pas les moyens de verser une pension alimentaire) pour verser à son ex-conjointe une allocation de soutien familial (ASF). Presque un tiers des affaires observées par les sociologues répondaient à une demande institutionnelle de ce type, les séparations proprement dites constituent donc deux tiers des contentieux. De l’autre côté, les juges ont un parcours scolaire et professionnel et des revenus qui les placent dans la fraction culturelle des classes dominantes : un·e juge gagne environ 6 500 € en fin de carrière, on peut par ailleurs supposer (les auteur·e·s ne le mentionnent pas) qu’ils/elles ont l’opportunité d’acquérir un patrimoine si ils/elles ne l’ont pas hérité. Aussi, la familiarité et la connivence notée entre juges et avocat·e·s, que les auteur·e·s rapportent à l’exercice d’une profession qui les met régulièrement en contact, peut-elle être interprétée en même temps comme une connivence de classe. Cette connivence entre petits ou grands bourgeois jouent aussi dans le rapport entre les juges et certains justiciables aux revenus confortables et/ou qui occupent une position prestigieuse. Les juges n’accordent pas le même intérêt ni le même temps aux affaires selon qu’elles concernent des familles prolétaires ou bourgeoises.
« Certes, les situations exceptionnelles de certains enfants de milieux défavorisés mobilisent le temps et l’attention des juges bien au-delà de ce qu’ils consacrent à la moyenne des dossiers. Les protagonistes de ces affaires sont d’ailleurs souvent fortement encadrés par la justice et les travailleurs sociaux, leurs dossiers pouvant être également suivis au pénal ou par le juge des enfants. Mais nous verrons que les juges aux affaires familiales peuvent passer aussi beaucoup de temps à entendre les parents de classes moyennes et supérieures débattre de l’organisation de la scolarité et des loisirs de leurs enfants.
Ce à quoi les JAF refusent, explicitement, de passer du temps, ce sont les pensions alimentaires. […] Or, les magistrats manifestent d’autant moins d’hésitation à aller vite que les montants des pensions sont faibles et les écarts entre les demandes des conjoints paraissent minimes. […] Par contraste, les juges aux affaires familiales s’intéressent de bien plus près aux dossiers des couples fortunés, présentant des enjeux financiers d’envergure. » (p. 58-59)
Les affaires familiales mettent ainsi en rapport « les masses » au double sens d’un très grand nombre de personnes, et d’un ensemble de personnes des classes populaires, avec des juges situé·e·s dans la bourgeoisie (et bien souvent issus de famille bourgeoise). Ces juges font preuve d’une sorte « d’inconscience de classe » : ils ne comprennent pas quelles sont les conditions matérielles d’existence des justiciables lorsque ceux-ci et celles-ci sont de classe populaire, et émettent un jugement juridique et moral depuis leur position bourgeoise.
Une justice patriarcale ? Pouvoir des hommes sur leur ex-conjointe et appauvrissement des femmes séparées ou divorcées
Si les auteur·e·s de l’ouvrage ne se disent pas directement engagé·e·s et encore moins militant·e·s, elles·ils accordent cependant une grande attention à la façon dont le règlement judiciaire des conflits conjugaux reproduit ou accentue les inégalités entre les femmes et les hommes. Le Collectif Onze a d’ailleurs publié une tribune dénonçant le traitement asymétrique des femmes et des hommes dans un projet de loi qui vise à étendre les « droits des pères » :
« Si le devoir des femmes de s’occuper des enfants ne s’allège guère, puisqu’il n’est toujours pas question de contraindre les pères à les prendre en charge ne serait-ce qu’en exerçant régulièrement leur droit de visite et d’hébergement, ce sont bel et bien les droits des pères à peser sur l’éducation de leurs enfants, sans contrepartie, qu’on ne cesse d’étendre. Cela se fait au détriment de la liberté de celles qui payent le prix – financier, professionnel, conjugal – de la prise en charge quotidienne des enfants. L’idée de soumettre le parent chez qui réside l’enfant (donc le plus souvent la mère) à l’accord de son conjoint en cas de déménagement est une atteinte aux droits des femmes à refaire leur vie ou à trouver un emploi2. »
L’enquête de terrain effectuée par les sociologues offre une description et une analyse précieuses de la manière dont la domination des hommes sur les femmes est reproduite par le traitement judiciaire des affaires familiales.
Un chapitre de l’ouvrage est consacré à la question de savoir si les décisions rendues par les juges varient en fonction de leur sexe. Il s’agit d’une réponse à l’accusation portée par des groupes masculinistes, qui prônent la domination des hommes sur les femmes (comme « SOS papas »), envers les juges des affaires familiales : ces juges étant majoritairement des femmes, elles avantageraient les mères en leur octroyant la garde des enfants, alors que les pères verraient leurs droits bafoués. Les auteur·e·s montrent que les juges hommes et femmes rendent les mêmes décisions à la fois en termes de résidence des enfants, qui est fixée dans 73 % des cas chez la mère (72 % des cas quand le juge est une femme, 78 % des cas quand le juge est un homme), et en termes de montant des pensions alimentaires. Il faut aussi souligner que les conflits entre ex-conjoints portent bien plus souvent sur les questions financières (pension alimentaire, division des biens du couple, prestation compensatoire) que sur la résidence des enfants : dans 80 % des cas de résidence chez la mère, le père est d’accord. On est donc bien loin d’une « guerre des sexes » décrites par les masculinistes pour « l’appropriation » des enfants.
Par ailleurs, les auteur·e·s expliquent que les juges femmes et hommes n’ont pas les mêmes parcours au sein de l’institution judiciaire. Les juges femmes ont souvent commencé leur carrière comme juge des enfants, une fonction dont elles valorisent le caractère « pédagogique » (et passent sous silence le caractère répressif) ; elles mettent en avant un sentiment d’utilité sociale que ce soit dans un rôle de juge des enfants ou de juge aux affaires familiales (JAF). Par contraste, les juges hommes rejettent souvent la fonction de JAF qu’ils jugent inintéressante et répétitive. Le passage de juge des enfants à JAF correspond souvent à la nécessité pour les femmes juges de s’occuper de leurs propres enfants : la fonction de JAF permet de moduler son emploi du temps et s’avère moins « pesante » mentalement et émotionnellement que la fonction de juge des enfants. Les femmes occupent plus longtemps que les hommes, en moyenne, la fonction de JAF ; or la mobilité géographique et le changement de fonction sont des critères majeurs pour l’avancement des carrières, les femmes juges sont donc confrontées à un « plafond de verre » : elles occupent beaucoup moins souvent que les juges hommes des fonctions de direction et les fonctions les plus prestigieuses.
D’après les masculinistes, les juges femmes avantageraient les mères en leur confiant plus souvent qu’il n’est juste la garde des enfants: on a vu que les femmes juges prennent les mêmes décisions que les hommes juges, mais il faut aussi questionner l’idée que la garde des enfants seraient un « avantage » dont les mères priveraient les pères. Il n’est pas question ici de nier l’importance émotionnelle, subjective du contact entre un parent et ses enfants, mais de se pencher sur la répartition du travail domestique et parental (soin et éducation des enfants) entre les femmes et les hommes et les effets de cette répartition. De nombreuses études montrent en effet que la prise en charge quotidienne des enfants repose essentiellement sur les femmes, aux dépens de leur trajectoire professionnelle (moindre avancement, moindres responsabilités) et de leurs revenus (temps partiel, emplois moins rémunérés). Comme le « surtemps » professionnel des pères est inférieur au « surtemps » parental des mères, les femmes bénéficient de moins de temps de loisir et de moins de temps de sommeil que les hommes.
Le Tribunal des couples offre une analyse précieuse du principe de « coparentalité », c’est-à-dire de partage de « l’autorité parentale » entre les mères et les pères, qui a succédé au principe juridique de « puissance paternelle » en 1970.
« Point essentiel, à compter de cette date et jusqu’à une période récente, le droit désignait un seul parent comme responsable des enfants après la désunion du couple. En l’occurrence, la loi ne dissociait pas la garde physique de l’enfant de la responsabilité parentale : ainsi, quand le couple divorçait, seul le parent » gardien » était détenteur de l’autorité parentale – c’est-à-dire, massivement la mère – l’autre parent – généralement le père – ne bénéficiant que d’un droit de visite et de surveillance. […] En comparaison avec cette situation historique, on comprend immédiatement que le principe contemporain de coparentalité constitue un rééquilibrage évident au bénéfice des pères. […] En 1987, l’article 287 du code civil est modifié pour introduire la notion nouvelle » d’exercice en commun de l’autorité parentale », le juge devant désormais fixer, non plus la » garde » de l’enfant (et l’autorité parentale qui en découle) mais, comme on l’a vu, sa » résidence ». Le passage du terme de » garde » à celui de » résidence » est en soi remarquable : il minimise d’emblée l’importance juridique et morale conférée à la prise en charge quotidienne de l’enfant. […] Il s’agit donc de faire comme si cette situation n’avait pas d’implication en termes de contrôle et de la charge de l’éducation, de la vie quotidienne des enfants. » (p. 180-181)
En imposant le principe d’« autorité parentale conjointe », il s’agit de garantir aux pères un pouvoir de décision sur l’éducation de leurs enfants, quand bien même ils n’en assurent pas la prise en charge quotidienne. Tout l’enjeu ici est que ce pouvoir du père sur les enfants passe par un pouvoir sur la mère : lorsque c’est elle qui vit avec les enfants et les élève – et c’est la majorité des cas – c’est elle qui « applique » les décisions ou les préférences du père (par exemple en termes de scolarisation, de loisirs). Ce pouvoir des hommes sur leur ex-conjointe est de plus garanti par l’obligation de la mère (quand elle est le parent gardien) de rester à proximité du domicile du père. « Tout se passe comme s’il incombait en propre à la justice de contenir cette potentielle émancipation féminine en matière éducative » (p. 183), notent les auteur·e·s du Tribunal des couples.
Si le principe d’autorité parentale conjointe garantit le maintien du pouvoir des pères sur leur ex-conjointe et leurs enfants, il n’oblige en aucun cas ces derniers à s’investir dans la prise en charge des enfants.
« Il faut […] souligner que le droit de visite et d’hébergement n’est pas un devoir : bien que d’abord mis en place au nom des pères, il laisse donc toute liberté à ces derniers de l’exercer effectivement. Or cette liberté s’entend volontiers, dans les faits, comme une opportunité pour les pères d’arbitrer en faveur d’investissements non directement éducatifs (dans la carrière professionnelle, surtout), aux dépens donc du temps passé avec les enfants. » (p. 189)
Si les hommes séparés ou divorcés continuent de passer plus de temps en moyenne que les femmes à exercer une activité rémunérée, ces dernières peuvent difficilement augmenter leur temps de travail lorsqu’elles ont des enfants à charge. Il convient ici de différencier les femmes des classes populaires des femmes des classes moyennes et supérieures : les femmes occupant des emplois de cadres ont les moyens de déléguer une partie du travail parental et domestique à des employées de service, en plus d’avoir souvent des emplois du temps plus souples. Cependant, la séparation conjugale entraîne en moyenne une très nette détérioration de la situation économique des femmes : alors que les femmes gagnent en moyenne 25 % de moins que les hommes (ce qui signifie que les hommes gagnent presque 40 % de plus que les femmes !), le revenu médian3 des femmes divorcées est inférieur de 32 % à leur revenu médian avant la séparation. À l’inverse, le niveau de vie des hommes séparés augmente après la rupture : ils n’ont plus à supporter le coût de l’entretien de leur conjointe et de leurs enfants. Les auteur·e·s du Tribunal de couples insistent sur le fait que les pensions alimentaires ne sont pas pensées ni appliquées comme un dispositif de redistribution des richesses entre hommes et femmes. Elles sont censées être une participation du parent non gardien (en majorité les pères) à la prise en charge des besoins matériels de l’enfant.
Mais dans les faits, les pensions alimentaires sont d’un montant relativement faible : dans un tiers des cas, le père ne verse rien, le reste du temps les pensions sont comprises entre 90 € et 300 € mensuels (par débiteur, et non pas par enfant). Lorsque le père est déclaré impécunieux par le tribunal ou est introuvable, la caisse des allocations familiales verse une allocation de soutien familial (ASF) de 95 € par mois et par enfant. Dans le cas du montant de la pension alimentaire, comme pour la résidence des enfants, les juges valident systématiquement la proposition des parents lorsque ceux-ci sont d’accord entre eux, quand bien même la somme proposée semble dérisoire comparée aux revenus du père. Cela tient à la fois à la nécessité pour les juges de « faire vite », et de se passer de discussion, et au principe de fonctionnement de la justice aux affaires familiales qui est censée respecter les vœux des ex-conjoints, dans la limite de la légalité. Le résultat est un appauvrissement des femmes et des enfants qui n’est pas compensé par la contribution financière des hommes.
« La façon dont les magistrats mettent en pratique le principe de la contribution à l’entretien pose deux difficultés : elle suppose d’abord qu’on puisse distinguer besoins des enfants et besoins du parent gardien ; elle suppose ensuite que l’investissement spécifique du parent gardien dans la prise en charge des enfants n’a plus de coût personnel qui mériterait compensation par l’autre parent après la séparation. » (p. 245)
La détermination d’une pension ne prend absolument pas en compte les besoins de la mère ni ses revenus, et au moment de la rupture conjugale « le droit n’offre aucune forme de compensation aux trajectoires professionnelles divergentes des hommes et des femmes » (p. 236).
Une justice de classe ? La reproduction des classes sociales par le maintien du pouvoir des hommes
Les auteur·e·s du Tribunal des couples montrent de façon convaincante la manière dont la reproduction des classes sociales est liée à la reproduction de la domination masculine, en ce qui concerne le règlement judiciaire des séparations conjugales. Les sociologues observent en effet que les juges cherchent à préserver le capital des hommes, notamment immobilier. Ainsi dans le calcul du revenu d’un homme, qui sert de base à la détermination du montant d’une pension alimentaire, le crédit immobilier est considéré comme une charge incompressible. Les juges préservent donc la capacité d’un père à acquérir et transmettre un patrimoine. De la même manière, les juges rechignent à prendre en compte les biens hérités (notamment immobilier) par les hommes pour calculer une prestation compensatoire, c’est-à-dire une somme versée à une ex-épouse pour « compenser » les disparités de niveaux de vie liées au mariage (ce dispositif concerne une petite minorité de couples divorcés). Les pensions alimentaires sont en pratique plafonnées, mais leur montant varie en fonction des besoins supposés des enfants : lorsqu’il s’agit d’enfants de classe moyenne ou supérieure, les loisirs (sport de compétition, musique), la scolarisation particulière (école privée) ou encore les études supérieures sont posés comme des besoins. Ce qui n’est pas le cas pour des enfants de classe populaire, pour lesquels les juges estiment que la priorité doit être l’insertion rapide sur le marché du travail. Les débats sur les pensions alimentaires et sur les décisions éducatives des parents (le type d’école, le type de loisirs) révèlent que ces dernières contribuent à l’intégration d’un enfant dans une classe sociale, à sa formation subjective comme bourgeois ou prolétaire.
« Il est paradoxal […] que les pensions alimentaires soient d’autant plus élevées que les enfants sont âgés, quand on sait que le coût en temps et en frais de garde est plutôt important pour les enfants en bas âge. C’est que les pères ne payent pas pour ce que la garde des enfants coûte aux mères : ils doivent avant tout payer ce qui permettra visiblement à leur descendance d’accéder à un statut social respectable, en particulier les études et les pratiques culturelles. […] les montants auxquels peuvent prétendre les femmes, pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, sont conditionnés non seulement par les revenus des hommes mais aussi par la préservation de leur patrimoine familial. L’institution judiciaire assure ainsi le maintien d’une place spécifique des hommes dans la transmission du statut social, au-delà des ruptures conjugales. » (p. 251)
Si la justice aux affaires familiales garantit l’accumulation et la transmission d’un patrimoine par les hommes des classes moyennes et supérieures, elle joue pour les hommes de classe populaire un rôle de rappel à l’ordre et de « mise au travail ». Le rôle de pourvoyeur est rappelé par les juges aux hommes pauvres, qui sont incités à conserver ou trouver un emploi. Les hommes mais aussi les femmes de classe populaire sont en outre bien plus souvent soumis à l’inquisition intime des juges que les justiciables de classes moyennes et supérieures.
« Les couples issus de classes populaires font ainsi plus souvent l’objet de questions et d’investigations intrusives, à la fois parce que leurs situations sont plus difficilement compréhensibles par des magistrats socialement distants, et parce que ces justiciables n’ont pas les ressources qui leur permettraient, face à l’institution, de faire respecter leur intimité. Dans ces conditions, la volonté judiciaire de connaître se mue en pratique d’encadrement, et l’on passe souvent de l’exposition au contrôle de la vie privée. » (p. 120).
Le rôle des juges ne se limite pas à trancher des conflits ou entériner des décisions, mais les magistrat·e·s jouent aussi un rôle de contrôle social et moral des classes populaires. Ils/elles rappellent les ex-conjoints à la division « traditionnelle » entre rôle féminin et rôle masculin, discréditent un homme sans emploi ou encore surveillent les postes de dépenses jugés « superflus ». L’analyse de la justice aux affaires familiales rend ainsi compte du rôle conservateur de l’institution judiciaire : conservation de la hiérarchie et des positions différenciées entre hommes et femmes, conservation des classes sociales. Plus précisément, la justice aux affaires familiales contribue à créer les conditions de cette conservation et à empêcher la mise en place des conditions d’une remise en cause de l’ordre social.
Un bon outil sociologique et militant
Sans être un texte militant, cet ouvrage est un excellent outil pour celles et ceux qui cherchent à comprendre le rôle du système judiciaire dans la conservation de l’ordre social et qui luttent pour une société plus égalitaire. Le grand atout de ce livre est d’offrir une investigation poussée et la présentation d’un matériau riche sans se perdre dans un foisonnement de données ni se restreindre à une approche « micro » et dépolitisée. Si la réserve des auteur·e·s, qui cherchent sans doute à se prémunir des attaques envers un livre « engagé », est compréhensible, elle les mène parfois à des périphrases compliquées et des atténuations que l’on peut regretter. Mais reste que le Tribunal des couples offre une analyse claire et convaincante de la justice aux affaires familiales. Si ce domaine du droit et de la justice peut sembler a priori anodin et peu relié aux enjeux politiques, il se révèle en fait, à la lecture de l’ouvrage, un domaine où sont produits et reproduits l’oppression des femmes et la division en classes.
à voir aussi
références
| ⇧1 | Les auteur·e·s ne mentionnent que les greffières, elles/ils ne se sont pas penché·e·s sur la situation des autres travailleuses/eurs des tribunaux : secrétaires, agents de sécurité… |
|---|---|
| ⇧2 | Collectif Onze, « Mères séparées: que des devoirs et pas de droits? », Médiapart (en ligne), 17 juin 2014. http://blogs.mediapart.fr/edition/les-batailles-de-legalite/article/170614/meres-separees-que-des-devoirs-et-pas-de-droits, consulté le 18 juin 2014. |
| ⇧3 | Le revenu médian est le revenu défini de telle façon que la moitié des femmes gagnent moins, la moitié gagne plus. Il s’agit d’une indication plus « représentative » qu’un revenu moyen, car si un très petit nombre de femmes gagne des revenus très élevés, le revenu moyen augmente sans que cela implique d’une majorité de femmes gagnent mieux leur vie. |









