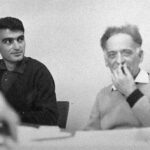Reconnaître l’État de Palestine, au milieu des ruines ?
Depuis octobre 2023, l’assaut colonial d’Israël contre Gaza a produit l’une des plus grandes catastrophes de l’histoire récente — un génocide en cours rendu possible par les puissances occidentales qui soutiennent Israël, et qui se poursuit sans relâche malgré l’immense solidarité mondiale pour la Palestine.
En réponse à cette catastrophe, plusieurs États européens ont commencé à reconnaître l’État de Palestine. En septembre 2025, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, entre autres, ont reconnu l’État palestinien. La vague récente de reconnaissances symboliques, initiée en 2024, semble désormais être la seule mesure que beaucoup de puissances européennes soient disposées à prendre face au génocide, après deux années de soutien moral, militaire et diplomatique continu au régime israélien.
Parce qu’il est impératif de faire entendre les voix palestiniennes à ce sujet, nous publions ce texte de Khalil Allahham, chercheur postdoctoral à l’Université de Birzeit, qui montre notamment comment ces reconnaissances – et le discours prétendant œuvrer à la « paix » qui les accompagnent – ne visent pas seulement à détourner l’attention vis-à-vis du génocide, qui se poursuit à Gaza malgré le cessez-le-feu (toujours avec la complicité des puissances occidentales), mais aussi à légitimer une nouvelle gouvernance coloniale.
***
Depuis son compte X, le président Macron a annoncé le 24 juillet vouloir reconnaître l’État de Palestine sur le territoire occupé depuis 1967, comprenant la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza. D’autres États occidentaux, dont le Canada et le Royaume-Uni, ont évoqué la possibilité de suivre cette voie. L’initiative a associé ensuite la Ligue des États arabes, l’Union européenne ainsi que d’autres États d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud.
Le projet se présente comme une réponse à la « guerre » à Gaza. Il a donné lieu à l’adoption d’une déclaration par les ministres des affaires étrangères des États concernés le 29 juillet 2025[1], en vue de la préparation d’une conférence internationale au niveau des chefs d’État et de gouvernement. À la demande de l’Arabie saoudite, l’Assemblée générale des Nations unies a repris l’initiative par une résolution adoptée le 6 septembre. Un sommet international de haut niveau sur la solution à deux États s’est tenu le 22 septembre à New York.
Les dirigeants qui se sont réunis à New York ont créé un débat parallèle contribuant à dissimuler la complicité d’un certain nombre entre eux dans la commission du génocide et d’autres crimes de masse à l’encontre des Palestiniens. Il leur incombe portant au titre du droit international de mettre fin à ces crimes et à prévenir leur répétition. En l’état, le projet de reconnaissance reflète une escroquerie, qui cherche à détourner l’attention des véritables actions et devoirs des dirigeants et des États face aux crimes coloniaux attribués à l’État d’Israël.
Ce projet de reconnaissance rappelle des tentatives de règlement « pacifique » de la question israélo-palestiniennes pendant les années 1990. En parallèle des négociations de paix entre l’Organisation de libération de Palestine (OLP) et l’État d’Israël, le philosophe français Jacques Derrida confie en 1998 sa vision d’une véritable « paix » entre Palestiniens et Israéliens. C’est « le jour où la paix viendra dans les corps et dans les cœurs ». Derrida se laisse dire comment y parvenir :
Cette paix « viendra […] quand le nécessaire aura été fait par ceux qui ont le pouvoir ou qui tout simplement ont le plus de pouvoir, le pouvoir d’État, le pouvoir économique ou militaire, national ou international », à qui il appartient « d’en prendre l’initiative de façon d’abord sagement unilatérale[2]. »
Loin de construire une véritable paix, le Sommet de New York vient invisibiliser les corps mortifiés et massacrés des Palestiniens. Il réactive la dynamique ancienne des négociations, ayant permis de réorganiser et de légitimer le système colonial israélien. Avant de reconnaître la Palestine comme entité abstraite, il est nécessaire de reconnaître les Palestiniens comme égaux en humanité. Car c’est la déshumanisation de cette population dans le discours politique et médiatique occidental qui a permis en partie la violation systémique de leurs droits pendant des décennies, et qui atteint un niveau de criminalité sans précédent depuis octobre 2023.
Dans ces conditions, l’initiative d’Emmanuel Macron ayant conduit au Sommet de New York propose une transaction de rechange à une situation de grave injustice et de violations des droits des Palestiniens. Elle alimente par ailleurs une gouvernance coloniale légitimée historiquement au nom de la paix.
Légitimer et renforcer un système de gouvernance coloniale
La déclaration du 29 juillet, adoptée par des ministres des États associés à l’initiative franco-saoudienne, reprend une rhétorique ancienne qui se veut équilibrée, tout en faisant abstraction d’une situation de violence coloniale et d’un rapport de force asymétrique. L’objectif affiché des États consiste à « parvenir à un règlement juste, pacifique et durable du conflit israélo-palestinien reposant sur une mise en œuvre véritable de la solution des deux États »[3].
Le projet de reconnaissance s’apparente en l’état à une solution de rechange, venant dissimuler l’inaction des États et des dirigeants politiques face aux crimes de masse commis à l’encontre de la population palestinienne au cours de ces 24 derniers mois. À moins de reconnaître parallèlement la violence extrême que subissent les Palestiniens et d’en engager véritablement les responsabilités, le sommet de New York risque de perpétuer les conditions politiques d’une violence structurelle à l’encontre des Palestiniens. La déclaration du 29 juillet de New York reprend le discours ancien d’une promesse de paix par le soutien financier à l’Autorité palestinienne, en mettant l’accent sur la nécessité d’une coopération sécuritaire de celle-ci avec l’armée israélienne. Une coopération parrainée historiquement par les États-Unis[4].
Dans ce contexte, la dissociation entre politique et justice rappelle fortement de la manière dont les États-Unis ont conduit, pendant les années 1990, les négociations de paix entre l’Organisation de libération de Palestine (OLP) et l’État d’Israël. Au nom d’une realpolitik, l’administration étasunienne a dirigé les négociations selon le principe « d’ambiguïté constructive »[5]. Celui-ci a notamment consisté à exclure les références explicites au cadre juridique international ainsi que dans l’« absence criante de principes directeurs d’ordre conceptuel et organisationnel »[6].
Dans le même temps, la machine militaire israélienne n’a cessé de poursuivre sa politique du fait accompli sur le terrain, en intensifiant la construction des colonies et en consolidant les moyens de contrôle et d’oppression à l’encontre des populations palestiniennes. Le « processus de paix » fixé par les accords d’Oslo a perpétué le déni des droits des Palestiniens. Il a banalisé l’idée d’une paix sans justice qui, dans un rapport de force asymétrique, ne sert qu’à justifier et à dissimuler une violence coloniale généralisée. Le temps a changé depuis, la violence à l’encontre des Palestiniens s’est amplifiée, mais la gouvernance coloniale de ces derniers est restée la même.
À la suite de l’occupation du reste du territoire de la Palestine mandataire en 1967, et pendant près de trois décennies, l’objectif stratégique et politique des gouvernements israéliens successifs consistait à empêcher la création d’un État palestinien. La création de celui-ci est devenue le pilier principal du projet politique de l’OLP depuis juin 1974, ayant fait l’objet du consensus de ses différentes factions partisanes lors du Conseil national palestinien qui s’est tenu au Caire. La stratégie israélienne d’entraver le projet de l’OLP a été officialisée en 1977 avec l’arrivée du Likoud[7] pour la première fois au pouvoir en Israël. Elle a tiré sa légitimité de l’interprétation israélienne de certaines dispositions des accords de Camp David I entre Israël et l’Égypte (1978), évoquant sobrement la nécessité de trouver une solution pour la question palestinienne.
Appelé curieusement le « plan d’autonomie », le projet du Likoud est devenu de fait le projet des gouvernements israéliens successifs. Malgré la différence des programmes politiques des différents gouverneaux israéliens, les pratiques d’oppression à l’encontre des Palestiniens n’a cessé de s’intensifier depuis. Se limitant principalement à une « autonomie administrative », la réalisation de ce projet s’est concrétisée en déchargeant l’État d’Israël de ses responsabilités de puissance occupante en maintenant les Palestiniens dans une situation permanente de privation de leurs droits fondamentaux.
Le plan d’autonomie a donné lieu à un ensemble de pratiques dont l’objectif est de normaliser l’occupation de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem-Est. Avec l’échec des négociations de paix entre l’État d’Israël et les Palestiniens, et le déclenchement de la seconde intifada en 2000, les autorités israéliennes ont consolidé l’architecture d’une occupation coloniale dans le Territoire palestinien occupé (TPO).
En poursuivant l’occupation et le nettoyage ethnique ayant d’ores et déjà commencé avec l’établissement du Mandat britannique sur la Palestine. Sur le territoire occupé depuis 1967, seule occupation illicite du point de vue du droit international, les autorités israéliennes ont intensifié la violence à l’encontre des populations palestiniennes, accentué leur enfermement et amplifié la construction des colonies en Cisjordanie[8].
Un ensemble de pratiques institutionnelles est venu dès lors renforcer un système colonial de domination ethnique, infériorisant les populations palestiniennes et maintenant les privilèges des populations juives israéliennes sur l’ensemble du territoire de la Palestine mandataire. Ces pratiques sont constitutives de crimes de masse du point de vue du droit international. Elles varient dans leur intensité en fonction des conjonctures politiques, mais restent constantes dans leur logique. Des organes onusiens et de nombreuses ONG qualifient ces pratiques de crimes contre l’humanité, d’apartheid, de violations massives, graves et sérieuses du droit international des droits humains et du droit international humanitaire ainsi que des actes constitutifs du crime génocide depuis octobre 2023.
Parallèlement à l’oppression continue des populations palestiniennes dans le TPO depuis 1967, les autorités israéliennes y ont réduit de fait l’ensemble des institutions palestiniennes à des sous-traitants de l’occupation, en leur léguant la gestion directe des affaires civiles et sociales des populations. Si la création de l’Autorité palestinienne à la suite des accords d’Oslo a changé la forme de certaines de ces pratiques, elle n’a jamais rompu avec cette vision gestionnaire qui est toujours à l’œuvre. C’est dans ces conditions d’oppression que les États participants au Sommet de New York ont imposé la reconnaissance de l’État de Palestine comme priorité.
Déresponsabiliser l’État d’Israël de ses crimes
Dans ce contexte, et après de 24 mois de guerre d’anéantissement contre la population civile dans la bande de Gaza, les dirigeants réunis à New York proposent de réagir par la reconnaissance de l’État de Palestine, reconnu d’ores et déjà par 148 États dont certains États européens. Le projet de reconnaissance risque de devenir un moyen de tordre la réalité en invisibilisant les crimes de masses en cours, et en suscitant un débat parallèle ne correspondant pas aux préoccupations actuelles de justice, qui sont celles des victimes et d’une majorité de l’opinion politique internationale. Le débat sur la reconnaissance de l’État de Palestine vient camoufler l’inaction des États face à ces crimes, en proposant une équation diplomatique biaisée à une situation de graves violations des droits des Palestiniens qui dure depuis des décennies.
Contrairement à l’affirmation du président français, qui prétend qu’il appartient aux historiens de qualifier de « génocide » ce qui se passe à Gaza, ce sont les États et les dirigeants politiques qui sont les destinataires et les opérateurs principaux du droit international. Il leur appartient à ce titre de nommer les violations massives des droits des Palestiniens et de prendre toute mesure pour les faire cesser et prévenir leur répétition. De multiples rapports de l’ONU documentent la violation des droits des Palestiniens en incitant les États à agir, sont rendus ineffectifs par l’inaction des États puissants.
Lors d’une visite en Israël en juin 2025, Anne-Claire Legendre et Romarci Roignan, respectivement conseillère Afrique du Nord et Moyen Orient d’Emmanuel Macron et directeur du Ministère des affaires étrangères de cette zone, ont déclaré auprès du site israélien Ynet qu’« il n’est pas question d’isoler ou de condamner Israël, il s’agit d’ouvrir la voie à la fin de la guerre à Gaza », rapporte Le Monde (le 6 juin 2025). Les diplomates français présentent la reconnaissance de l’État de Palestine comme une concession française, un recul dans leur politique à un soutien inconditionnel à l’État d’Israël.
L’initiative d’Emmanuel Macron prétend équilibrer la situation en posant des conditions supplémentaires : la démilitarisation du Hamas et la réforme de l’autorité Palestinienne comme préalable à la mise en place d’une gouvernance de la bande de Gaza. De même, et surtout, Paris a tenté de convaincre l’Arabie saoudite et d’autres États arabes de reconnaître l’État d’Israël en parallèle de la reconnaissance de l’État Palestinien par la France, le Royaume-Uni et le Canada.
L’initiative d’Emmanuel Macron à l’origine du sommet de New York contribue, d’une part, à déresponsabiliser l’État d’Israël des atteintes graves au droit international. Elle se présente, d’autre part, comme une dynamique multilatérale de reconnaissance, en apportant le soutien des États de la région à l’État d’Israël à un moment où les appels au boycott étatique et citoyen se multiplient à l’encontre de celui-ci.
Ainsi, en se présentant comme une dynamique égalitaire, ce projet sous silence la réalité sur le terrain. En évoquant la normalisation des relations de certains États arabes avec l’État d’Israël, l’initiative cherche à restaurer l’image détériorée de celui-ci au sein de l’opinion publique internationale. Sans reconnaissance des crimes commis et d’engagement la responsabilité de l’État et dirigeants israéliens, une telle initiative contribue à dissimuler la violence extrême subie par la population palestinienne, en banalisant ces violations et en déshumanisant davantage les victimes par le déni.
Les pratiques militaro-civiles israéliennes ont créé des conditions profondes de domination, d’oppression, d’expropriation, d’accaparement, de pillage, d’humiliation, de déshumanisation et de répression à l’encontre des populations palestiniennes. Les autorités israéliennes poursuivent sans cesse un projet de nettoyage ethnique à l’encontre des Palestiniens, en créant délibérément des conditions de vie avilissantes pour ces populations.
Le choix qui s’impose à ces dernières aujourd’hui est, soit d’accepter la situation d’assujettissement qui leur est infligée, soit de fuir le territoire occupé[9]. La cessation et la prévention des crimes de masses qui sont commis en Palestine nécessitent de mettre à l’arrêt une machine d’oppression et de déshumanisation, créée et légitimée historiquement par le colonialisme occidental à travers des discours et des actes ayant conduit à la situation actuelle[10].
La logique de marchandage qui a animé les initiatives de paix dans le passé, et sa réactivation actuelle avec l’initiative en cours, fait abstraction des rapports de force asymétriques inhérents à une situation coloniale. Elle alimente une représentation biaisée réduisant une situation de violence extrême à une « guerre contre l’islamisme ». Cette représentation fait écho à la position de certains chercheurs qui font circuler des préjugés encourageant la complicité dans la continuité des crimes en cours.
Le système colonial israélien déshumanise à la fois les Palestiniens et les Israéliens, en les assignant à leurs places respectives d’opprimés et d’oppresseurs. Les jeunes Israélien.ne.s qui doivent effectuer un service militaire obligatoire (pendant 2 ans et huit mois pour les jeunes hommes et deux ans pour les jeunes femmes) sont amenés régulièrement à accomplir des exactions, des actes de tortures, de meurtre et d’humiliation à l’encontre des populations palestiniennes.
L’idéologie sioniste se trouve au fondement du système éducatif israélien et elle banalise l’infériorisation des Palestiniens et leur oppression. Face à cela, il est essentiel de reconnaître une violence coloniale structurelle pour mettre à l’arrêt une machine de mort afin qu’une solution politique soit imaginable. Reconnaître l’État de Palestine parallèlement ? Pourquoi pas, mais encore ?
*
Khalil Allahham est chercheur postdoctoral à Birzeit University.
Illustration : Jaber Jehad Badwan / Wikimedia Commons.
Notes
[1] Déclaration de New York sur le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution des deux États adoptée le 29 juillet 2025 : (La déclaration se trouvant sur la page du MAE : Déclaration de New York du 29 juillet 2025).
[2] Jacques Derrida, « Avouer —l’impossible. “Retours”, repentir et réconciliation », in Le dernier des Juifs, Paris, Galilée, 2014, p. 26 ; ce texte fut publié d’abord dans les actes du XXXVIIe Colloque des intellectuels juifs de langue française [1998], Comment vivre ensemble ?, Jean Halérin et Nelly Hansson (dir.), Paris, Albin Michel, 2001, p. 179-216.
[3] § 2 de la déclaration.
[4] Voir § 19 de la déclaration du 29 juillet 2025.
[5] J. al-Husseini et R. Bocco, « Les négociations israélo-palestiniennes de juillet 2000 à Camp David: Reflets du Processus d’Oslo », Relations internationales, PUF, 2008/4 n° 136, p. 64.
[6] Ibid.
[7] Parti politique israélien regroupant différentes factions de droite. Il est actuellement le parti politique du premier ministre actuel Benjamin Netanyahou.
[8] Le sociologue Abaher El Sakka parle de première colonie pour désigner l’occupation du territoire palestinien en 1948, et de seconde colonie pour nommer l’occupation du territoire de 1967, voir EL SAKKA Abaher (en arabe), « naḥwa iʿādat al-tfkīr fī al-ʾūṭūr al-mfāhīmīẗ ltḥlīl al-sīāq al-istʿmārī fī flsṭīn, (trad. Repenser les cadres conceptuels dans l’analyse du contexte colonial en Palestine) », Omran, Issue 39, vol. 10, 2022, pp. 39-68
[9] Voir Khalil Allahham, « La détention des Palestiniens, instrument et reflet du nettoyage ethnique », Tumultes, numéro 64/2025, S. Dayan-Herzbrun et A. Kadri (dir.) Déplacement forcés, histoires de vies, histoires de mort, pp. 87-106.
[10] Voir Sbeih Sbeih, « La Palestine, de la SDN à l’ONU : histoire d’une hypocrisie occidentale », Recherches internationales, n° 133, été 2025, pp. 53-73.




![La libération de la Palestine : un combat anticolonial et antifasciste [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/15_mg_8417-modifier_0-150x150.jpg)