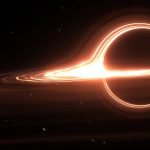Reconstruire les infrastructures de la contestation
Dans ce long entretien, David McNally, auteur de Global Slump[1] (PM Press, 2010) revient sur les origines de la première grande crise du capitalisme du XXIe siècle et sur ses conséquences pour le développement des résistances.
Les premiers signes de la crise économique mondiale que ton livre analyse se sont clairement fait sentir il y a quatre ans, durant l’été 2007. En quoi est-il toujours pertinent de tenter de cerner les causes et conséquences de cette crise ?
Je crois qu’il est important d’analyser cette crise et de comprendre ses racines profondes car plusieurs éléments indiquent que ce n’est pas une récession comme les autres. Il s’agit d’une crise systémique, en d’autre mot une période de profonde instabilité dans le processus d’accumulation du capital qui perdurera pendant plusieurs années, nonobstant les oscillations tantôt positives, tantôt négatives de certains indicateurs économiques. On a souvent tendance à oublier que ce fut aussi le cas lors de la Grande Dépression : il y eu une chute marquée de l’activité économique de 1929 à 1933, suivie d’une reprise de quatre ans de 1933 à 1937, avant que l’économie ne chute à nouveau. Mais nous sommes tous d’accord sur le fait que tous ces mouvements formèrent tout de même un ensemble, une période distincte au cours de laquelle le capitalisme fut incapable de dépasser une série de contradictions. Depuis 2007, le capitalisme est entré dans un moment historique du même type.
Pour comprendre cela, nous devons analyser les causes profondes de la crise. Car s’il est vrai que nous avons pu assister à une très faible reprise fin 2009 et début 2010, elle s’est limitée à une récupération de la profitabilité mais n’a eu des répercussions que très faibles sur l’embauche et les salaires. Si on replace cette crise dans la longue période néo-libérale qui a débuté à la fin de la récession de 1982, il apparaît que ce fut une période d’expansion qui a produit un profond problème de suraccumulation que la récession de 2008-2009 n’a pas réussi à régler. Et, comme pour la période des années 1970 et des années 1930, il faudra plus ou moins une décennie, pour que le capitalisme puisse résoudre le problème. Bien sûr notre espoir est qu’il ne pourra le faire par lui-même et que des mouvements de résistance vont émerger pour faire émerger une alternative au capitalisme.
Les turbulences des derniers mois, liées aux crises de la dette souveraine de la Grèce et d’autres pays européens tels que l’Irlande, le Portugal, l’Espagne et l’Italie laissent craindre que la crise puisse en effet perdurer. S’agit-il d’une nouvelle étape de la même crise ?
Le sauvetage des banques qui a débuté en 2008 et a mobilisé plusieurs milliers de milliards de dollars n’est pas terminé. Conjugué au effets d’une contraction économique ayant réduit les revenus des gouvernements, ce sauvetage a contribué à une forte hausse de la dette publique. Il se poursuit aujourd’hui via des « plans d’aide » aux États faisant face à une crise de la dette publique et qui s’accompagnent de coupes dans les caisses de retraite, dans l’éducation, les programmes sociaux et l’emploi public affectant la vie de millions d’individus. Fondamentalement, ces politiques visent à transférer des fonds publics vers les banques et la finance en général.
À la mi-2011, les banques allemandes avaient prêté l’équivalent d’environ 170 % de leur capital aux gouvernements grecs, irlandais, portugais et espagnol. L’équivalent d’environ 100 % du capital détenu par les banques françaises était aussi exposé[2]. Ces chiffres augmentent considérablement si on prend en compte l’Italie. Parallèlement, les banques américaines sont en possession de titres de la dette publique de ces cinq économies européennes à hauteur de 700 milliards de dollars.
Alors qu’un défaut de paiement de la part de la Grèce semble inévitable, un tel scénario va déclencher une série de crises et de nouveaux défauts de paiement menant à la faillite de certaines banques. Des pertes de plusieurs milliards de dollars pour les banques apparaissent aussi de plus en plus probables. C’est la raison pour laquelle les actions de banques telles que BNP Paribas et la Société Générale ont chuté si fortement au cours des derniers mois. Et c’est aussi pour cela que de très grandes sociétés, banques et autres fonds d’investissement ont retiré leurs avoirs des banques européennes. Bref, nous sommes à l’aube d’une nouvelle crise financière.
La Banque centrale européenne, le FMI et les grandes puissances européennes affirment vouloir sauver de la faillite des pays tels que la Grèce, l’Irlande ou le Portugal. Mais la priorité demeure les intérêts privés des banques. Il faut suivre le chemin emprunté par l’argent octroyé par l’Europe et le FMI : lorsque les gouvernements endettés reçoivent des centaines de milliards en nouveaux prêts, cet argent est immédiatement transféré vers les coffres des banques privées afin de rembourser des dettes contractées par le passé. Les banques sont ainsi une fois de plus sauvées par le peuple. Tout comme lors de la crise des institutions financières de 2008-2009, les profits des banques sont privatisés alors que leurs pertes sont assumées par les budgets publics. Il ne s’agit pas vraiment de libre-marché. Mais c’est une excellente affaire pour les banquiers !
Quels sont les obstacles à une « création destructive » qui pourrait mener à une reprise économique soutenue ? Tu as mentionné les années 1970. Un des facteurs déterminants ayant permis de sortir de cette crise a été le choc monétaire de Volcker et la défaite politique des travailleur·ses dans les pays du Nord. Est-ce qu’un tel « remède » pourrait à nouveau être asséné à cette classe et serait-il suffisant pour relancer le processus d’accumulation de façon soutenue ?
Sans aucun doute, la classe des travailleur·ses subit à nouveau un assaut d’une grande ampleur. Il suffit d’observer ce qui se passe aux États-Unis où l’organisation du mouvement ouvrier est la plus faible par rapport aux autres pays du Nord : il y a eu des destructions massives d’emploi, mais aussi une énorme augmentation de la productivité du travail qui se traduit par une chute du coût unitaire de production d’environ 5 % en 2009, ce qui signifie qu’il en coûte environ 5 % moins aux capitalistes pour produire un bien ou un service donné. C’est une diminution énorme. Plusieurs des méthodes néo-libérales – augmentation du rythme du travail, production « juste-à-temps », etc. – que les capitalistes ont utilisées depuis 30 ans s’intensifient. Les travailleur·ses doivent faire face à cette reconfiguration des processus de travail alors même que, dans la plupart des pays du Nord , leur organisation collective s’est considérablement affaiblie par rapport à ce qu’elle était lors de la crise des années 1970. Évidemment, le capital profite de cette position de faiblesse.
Mais on oublie souvent que le capitalisme ne peut se sortir d’une crise simplement en intensifiant l’exploitation du travail. Cela peut restaurer les profits et mettre fin à la série de faillites d’entreprises liée à la crise. Mais pour se sortir d’une crise dont les germes se trouvent dans la longue période de croissance qui l’a précédée, le capitalisme a besoin de détruire beaucoup de capital suraccumulé – c’est-à-dire qu’il doit se départir de beaucoup d’usines, de mines, de tours à bureaux, de centre commerciaux, etc., qui ne peuvent plus être utilisé de manière profitable. C’était là un des problèmes auxquels voulait répondre le choc monétaire de Volcker en 1979 : face à la hausse massive des taux d’intérêts, les capitalistes qui ne pouvaient payer leurs dettes ont fait faillite et une restructuration du capital a été ainsi imposée.
Au cours de la crise actuelle, nous n’avons eu pour l’instant qu’une restructuration de ce genre très réduite et limitée à certaines parties des États-Unis. Quelques usines automobiles ont fermé, mais, de façon générale, très peu a été fait pour restructurer le capital. En Europe et au Japon il n’y a pratiquement pas eu de destruction de capital excédentaire. Il n’y en a pas eu davantage en Chine où, au contraire, des investissements massifs ont été réalisés venant encore aggraver le problème. Les grandes restructurations restent donc devant nous : en plus d’une augmentation de l’exploitation des travailleur·ses, de nombreuses fermetures d’usines seront nécessaire avant que le système puisse retrouver une croissance économique prolongée et soutenue.
Une simple statistique permet d’illustrer le problème. Le programme de relance économique chinois a été, toutes proportions gardées, beaucoup plus important que celui de Bush et d’Obama aux États-unis. Parmi les mesures comprises dans ce programme, certaines ont conduit à une augmentation des capacités annuelles de production d’acier de 15 millions de tonnes. La Chine possédait déjà une surcapacité de 150 millions de tonnes, leurs capacités excédentaires atteignent désormais 200 millions de tonnes, soit autant que l’ensemble des capacités de production de l’Union Européenne.
Penchons-nous maintenant sur les causes de la crise. La Grande Dépression des années 1930 a été associée à la spéculation financière, au crash financier du « Lundi noir » d’octobre 1929, qui a marqué l’imagination collective. Et la même chose semble se produire avec la présente crise économique. Pourquoi penses-tu que les explications de la crise identifiant la spéculation financière comme cause première, voire unique, sont insatisfaisantes ?
Il y a plusieurs raisons. Une première est simplement empirique. Les historiens de la Grande Dépression nous montrent que la production industrielle a commencé à chuter en 1928, avant même l’effondrement boursier de 1929. Il y eu d’autres chocs financiers, dans les années 1920, par exemple en 1927, qui n’enclenchèrent pas de grandes récessions, parce que la profitabilité demeurait robuste à ce moment. De façon similaire, en ce qui concerne la crise actuelle, on peut noter que les taux de profits ont plafonné dès 2006 aux États-Unis. Cela a fait en sorte que le système est devenu plus vulnérable à un choc financier. Les indicateurs économiques nous montrent aussi que le ralentissement de l’activité économique est intervenu, dans le secteur manufacturier notamment, avant l’éclatement de la bulle immobilière.
Deuxièmement, l’éclatement de cette bulle immobilière a débuté dans les lieux où les effets de ce ralentissement de l’activité économique se ressentaient déjà fortement. Détroit en est un excellent exemple. Les pertes d’emplois dans cette ville ont eu pour conséquence qu’un nombre croissant de débiteurs de subprimes n’étaient plus en mesure de s’acquitter de leur dette. Ainsi, la hausse du chômage, qui s’est amorcée en 2007 a nourri l’augmentation des défauts de paiement. Les différents facteurs sont donc interconnectés.
Enfin, sur un plan théorique, je trouve insatisfaisante la thèse selon laquelle la « dérégulation » financière est la cause de la crise car elle présume que ce sont les politiques permettant cette dérégulation qui sont l’élément déterminant dans l’évolution économique au cours de la période néo-libérale. Au contraire, comme je l’explique dans Global Slump, la dérégulation a suivi l’internationalisation de la finance, plutôt qu’elle ne l’a précédée. Au moment où la dérégulation s’est vraiment mise en branle, les corporations multinationales qui doivent s’adonner à des activités financières dans divers marchés nationaux et diverses juridictions et zones monétaires, misaient déjà sur les avantages que leur procuraient la finance off-shore. À partir des années 1960, elles échangeaient déjà sur le marché des eurodollars (opérations en dollars en Europe qui échappent tant à la régulation du gouvernement américain qu’à celle des autorités européennes). Cela n’était pas le résultat d’une libéralisation des marchés financiers. Cela découlait du rôle central du dollar américain dans l’économie mondiale et du fait qu’il circulait massivement hors des frontières des États-Unis. Les firmes multinationales ont alors cherché à obtenir des financements à des taux plus intéressant que ceux pratiqués aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Ce fut seulement lorsque les banques opérant dans le cadre régulé des juridictions nationales réalisèrent leur désavantage face à celles intervenant sur le marché des eurodollars qu’elles commencèrent à exiger des politiques de dérégulation. La plus grande partie de cette dérégulation a réellement débuté à la toute fin des années 1970 et n’a pris son véritable envol qu’au cours des années 1980. Ma position est donc que cette dérégulation est une réaction à cette mondialisation du capital manufacturier et financier.
Tu critiques les analyses qui, comme celle développée par Robert Brenner[3], présentent la crise actuelle comme l’aboutissement d’une chute du taux de profit menant à un ralentissement économique remontant aux années 1970. En quoi ta propre compréhension de la période néo-libérale du capitalisme diverge-t-elle d’une telle lecture de l’évolution économique des dernières décennies ?
Oui. Ce n’est pas que je crois que l’évolution du taux de profit ne soit pas importante – je crois au contraire que c’est un élément essentiel. Mais il existe une série de problèmes associés au type d’analyses produites par Brenner et par d’autres. Le premier est qu’on peut constater, à partir de données recueillies par Brenner lui-même, une remontée du taux de profit à partir de 1982. Il y a eu une chute aux alentour de 1987 et ensuite une nouvelle remonté jusqu’aux abords de la crise actuelle, en 2006. La raison pour laquelle Brenner et d’autres analystes insistent sur la faiblesse problématique du taux de profit au cours de cette période découle du fait qu’ils le comparent à celui qui prévalait au cours des années 1950 et au début des années 1960. De leur point de vue, si les taux actuels ne sont pas aussi élevés que ceux d’alors, c’est qu’il y a crise. Je crois quant à moi qu’il s’agit là d’un raisonnement a-historique. La période d’après-guerre a été exceptionnelle et précédée du plus grand épisode de destruction de capitaux de l’histoire du système sous l’effet combiné de la Grande Dépression et de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été suivies d’une période d’expansion économique spectaculaire au cours de laquelle le capital a dû être reconstruit à l’échelle mondiale. Cette période d’expansion exceptionnelle ne peut servir de point de référence pour juger des la profitabilité des dernières décennies.
De plus, affirmer qu’il y aurait eu une crise au cours des quarante dernières années nous fait perdre de vue le dynamisme du capitalisme au cours de cette période. Ceci ne correspond pas à notre expérience historique pour plusieurs raisons. D’abord, nous avons vécu, au cours de ces décennies, une révolution technologique, surtout articulée à la microélectronique et à l’ordinateur digital, qui a notamment profondément transformé les processus de production, mais aussi la vie quotidienne qui est envahie pour toute une série d’appareil électroniques (téléphones portables, iPads, ordinateurs portables, etc.). Ensuite, l’analyse de Brenner passe sous silence le fait qu’une région entière du globe est devenue un nouveau pôle d’accumulation : l’Asie de l’Est, et tout particulièrement la Chine. Jusqu’à l’ère néo-libérale, on peut dire que le Japon était une exception dans cette région. Ce n’est plus le cas, la région dans son ensemble est devenue le pôle d’accumulation capitaliste le plus dynamique du monde. En ne considérant que les États-Unis, l’Allemagne et le Japon, Brenner tend à ignorer l’essor de cette nouvelle zone d’accumulation.
Le capitalisme a été très dynamique au cours de la période 1982-2007, ce qui ne veut pas dire qu’il n’a pas connu de crises. Le système a traversé des crises – et il n’y a là rien de surprenant tant dynamisme et instabilité du capitalisme vont de pair – mais il a aussi connu un processus de restructuration technologique et géographique en profondeur.
Tu mentionnes dans ton livre que le capitalisme néo-libéral comporte trois dimensions fondamentales : la création du nouveau pôle d’accumulation que tu viens de mentionner, la défaite politique de la classe des travailleur·ses et l’intensification de son exploitation, ainsi qu’un transfert massif de richesses des pays du Sud vers ceux du Nord. Ces trois facteurs réunis ont permis une reprise de la croissance qui, à son tour, a jeté les bases d’une nouvelle crise, dans laquelle nous sommes plongés depuis 2007. Comment expliques-tu cette imbrication de la croissance et de la tendance à la résurgence d’une crise la compromettant ? En quoi Marx est-il utile pour comprendre cette relation ?
Partir de Marx est crucial pour répondre à cette question. Marx constate que la marchandise a un double caractère. Il s’agit tout à la fois d’une valeur d’usage, qui satisfait un besoin humain, et d’une valeur, ou valeur d’échange, qui peut être échangée contre de l’argent. Le capitalisme implique donc ce phénomène très contradictoire suivant lequel on ne peut obtenir les valeurs d’usages qui permettent le maintien de la vie humaine que sous la forme de valeurs d’échanges. C’est-à-dire qu’on doit accéder au marché pour se les procurer. Il s’agit là du résultat des processus de dépossession associés au capitalisme qui détachent les gens des moyens nécessaires pour produire par eux-mêmes ces valeurs d’usage – notamment l’expropriation des paysans de leur terre avec les enclosures qui les privèrent d’accès aux terres communes. Une fois mis en place, ce système contradictoire fait en sorte que la force motrice du mode de production devient la profitabilité et l’accumulation d’argent. La compétition pousse les capitalistes à accumuler de façon systématique, faute de quoi ils seront poussés à la faillite, surpassés par leurs concurrents devenu plus performants car ils ont davantage investi. Tous les capitalistes tentent donc de battre la compétition en puisant dans leurs profits afin de les réinvestir et de les transformer en de nouveaux moyens de production, en se procurant la technologie la plus avancée afin de produire les même biens et services un peu plus rapidement et à des coûts un peu moindre que leurs concurrents. Mais, bien sûr, s’ils et elles font tout cela, et si tout ce qui les intéresse n’est pas la valeur d’usage qui satisfait des besoins humains, mais bien la production pour le profit, on peut alors facilement comprendre qu’après un long cycle d’accumulation les capitalistes vont se retrouver dans une situation où ils ont créé trop d’usines, de mines, de centres d’achat, de McDonalds, etc. dont les produits ne peuvent plus être absorbés par le marché. C’est une situation classique de suraccumulation.
L’autre aspect du problème, est la propension à la mécanisation de la production qui implique une forme de course à la technologie la plus avancée. Celle-ci tend à remplacer des travailleur·ses par des machines. Je ne veux pas dire que ça implique nécessairement une réduction absolue de la main-d’œuvre – bien que ce soit possible, comme le montre la vague de désindustrialisation qui a frappé le Canada, les États-Unis ainsi que certains pays européens au cours des dernières années. Mais, en tous cas, cette main-d’œuvre aura tendance à croître moins rapidement que ce que Marx appelle le capital constant – la machinerie, l’équipement de production, les édifices, etc.. Comme seul le travail vivant produit de nouveaux profits, ironiquement, à travers cette compétition maniaque pour la saisie de parts de marché, les capitalistes sapent ce qui sous-tend la profitabilité. Ceci produit donc une autre tendance qui pressurise les profits à la baisse.
En fait, l’analyse de Marx est beaucoup plus complexe que ne laisse croire le résumé que je viens d’en faire. Il identifie avec raison toute une variété de contre-tendances qui contribuent à renforcer les taux de profit. Toutes ces tendances et contre-tendances agissent simultanément et sont inter-reliées, mais à certains moments une tendance ou une autre devient dominante. Sur une longue période d’accumulation, il existe des périodes-charnières aux cours desquelles la tendance à la réduction relative du travail vivant utilisé dans la production tend à dominer, ce qui mène à une baisse de profitabilité. En parallèle, la tendance à la suraccumulation pressurise aussi les profits, puisqu’elle force les capitalistes à tenter d’augmenter leurs ventes frénétiquement. Ainsi, quelqu’un voulant acheter une automobile en ce moment sera bombardé d’offres et autres rabais.
Ces deux tendances – à la suraccumulation et à la baisse relative du travail vivant utilisé dans la production – sont donc des éléments imbriqués des contradictions du capitalisme. L’analyse de Marx demeurent pertinente dans la mesure où elle est la seule qui permet réellement de saisir le caractère contradictoire inhérent de l’accumulation capitaliste. Mais aussi parce qu’elle éclaire des événements tels que la dernière crise davantage que toute autre théorie disponible.
Tu expliques dans ton livre que ces tendances débouchant périodiquement sur des problèmes de profitabilité sont aussi à relier à une transformation structurelle de la finance au cours des dernières décennies. Peux-tu nous expliquer plus en détail la nature de cette transformation ainsi que ses conséquences ? En quoi est-ce que ta position sur ce problème diverge de la thèse de l’hégémonie du capital financier développée par Duménil et Lévy ?
Je suis d’accord avec l’idée qu’un processus de financiarisation est advenu au cours de la période néo-libérale. Mais, je ne crois pas que la thèse de la « dérégulation » soit très convaincante.
Pour la plus grande partie de l’histoire du capitalisme, la monnaie, et particulièrement la monnaie mondiale, la devise mondialement dominante, a été rattachée à une marchandise ou une autre. Le plus souvent, ce fut l’or. Ça n’a pas à être l’or, et Marx en était bien conscient. Mais à partir des années 1850, le capitalisme avait clairement opté pour l’étalon-or. Au cours du siècle qui a suivi, il préserva de différentes manières cet étalon-or. Après la Deuxième Guerre mondiale, la devise dominante – le dollar américain – pouvait être échangée pour de l’or : les banques centrale hors des États-Unis pouvaient obtenir de l’or en échange des dollars qu’elles détenaient.
Tout ceci changea en 1971 lorsque les États-Unis ne purent plus se permettre d’assurer la conversion de dollars en or, dans la mesure où leurs réserves d’or étaient insuffisantes pour satisfaire les demandes de conversion dont le rythme s’accélérait. Nixon a alors mis fin à cette convertibilité, et a annoncé que le dollar ne serait plus rattaché à la valeur de l’or. Ceci eut plusieurs conséquences, mais la plus importante, selon moi, fut que les valeur des devises sont alors devenues beaucoup plus volatiles qu’auparavant. Le système de l’étalon-or de Bretton Woods assurait que les devise demeuraient dans un rapport très stable entre elles sur de longues périodes. Ceci signifiait qu’une personne transférant son capital d’un pays à l’autre n’avait pas à se soucier du risque qu’une dévaluation soudaine puisse brutalement dévaloriser son investissement. Après 1971, il n’y avait plus de telles garanties. En conséquence, on a assisté à un énorme processus d’ingénierie financière ; les banques et d’autres institutions financières se sont mises à développer des instruments visant à limiter les risques liés à cette volatilité. En clair, je peux maintenant acheter une forme de police d’assurance qui me protège des variations importantes d’une devise ou d’une autre. Quelqu’un peut me garantir, par exemple, que je pourrai racheter mes dollars en yen , ou en euros, etc. à un prix fixe, peu importe les fluctuations de la valeur de ces devises sur les marchés.
Ces instruments financiers sont appelés produits dérivés et il faut bien sûr payer pour les obtenir. De façon générale, il s’agit d’une police d’assurance peu coûteuse. Mais certains investisseurs ont rapidement découvert que ces instruments conçus pour réduire le risque, qui sont en fait des paris sur le futur, pouvaient être utilisés pour spéculer. On peut ainsi faire des paris énormes sur le mouvement de devises, mais aussi sur l’or, le pétrole, les denrées alimentaires, et sur n’importe quelle marchandise. Et pas seulement des marchandises : Enron à la fin des années 1990 s’est mis à faire des affaires en or grâce à des produits dérivés liés à la météo. En effet, la météo affecte la production d’oranges en Floride ou la quantité d’hydro-électricité nécessaire pour alimenter l’air climatisé durant l’été en Californie, ce qui a aussi un impact sur le prix du pétrole…
Il est donc vrai que la création de ces instruments financiers a engendré beaucoup de spéculation, ce que l’on nomme souvent la « financiarisation ». Et je suis d’accord avec l’idée selon laquelle le secteur financier est devenu beaucoup plus vaste et qu’il concentre une plus grande part des profits totaux. Mais je rejette l’idée que ce soit la conséquence d’un « coup de force » fomenté par la finance, comme l’affirment notamment Duménil et Lévy. Je crois plutôt que la cause fondamentale de cette financiarisation est la fin de la convertibilité du dollar en or et la volatilité des différentes devises nationales qui en a résulté et qui a mené au développement de tous les dérivés qui existent aujourd’hui. Je ne crois donc pas qu’on puisse dire que les capitalistes financiers aient imposé leur hégémonie. En fait, des firmes manufacturières majeures se sont elles aussi lancées dans cette orgie de spéculation. Ford, General Motors, General Electrics, Volkswagen, etc., investissent toutes dans les produits dérivés. Le problème ne réside pas tant dans le capital financier en lui-même qu’en des changements structuraux du capitalisme qui ont rendu certaines formes de profits spéculatifs plus faciles à réaliser. Ce n’est bien entendu pas fortuit qu’elle ait débuté dans le secteur financier, au sein du marché des prêts hypothécaires aux États-Unis. Très rapidement, les banques et autres institutions financières qui vendaient ces instruments financiers sophistiqués ont découvert qu’on pouvait faire la même chose avec des prêts hypothécaires, ce qui a plu aux investisseurs qui percevaient alors l’investissement immobilier comme un investissement sûr. Ceci, on le sait, a mené à la plus grande bulle immobilière de l’histoire, dont l’explosion a laissé de nombreuses personnes qui croyaient que cette bulle ne pouvait pas exploser en possession d’actifs financiers toxiques. Les grandes banques d’investissement ne furent pas toutes épargnées puisque certaines furent contraintes à la faillite.
Tu tentes d’explorer la relation dialectique, la relation interne, qui existe entre cette tendance à la financiarisation, à l’essor de bulles spéculatives, d’une part, et la tendance à la suraccumulation et à la baisse du taux de profit, d’autre part. Peux-tu nous parler de la façon dont tu perçois cette relation ?
Oui. Durant le boom économique de 1982-2007, on a pu observer une remontée prolongée du taux de profit sur les nouveaux investissements de capitaux, parallèlement à une profonde restructuration de la production avec le développement et l’usage de nouvelles technologies. Les États-Unis, par exemple , ont perdu 300 000 emploies dans l’industrie de l’acier, alors que cette industrie continue de produire des quantités massive d’acier. On obtient donc une production de biens beaucoup plus élevée relativement à la main-d’œuvre utilisée pour la réaliser. On a ensuite un boom d’investissements associé aux nouvelles technologies dans les pays du Nord et un mouvement massif de capitaux vers les régions à bas salaires des pays du Sud. La Chine fut le pays central dans ce mouvement, mais il faut aussi considérer les maquilladoras du Mexique, ainsi que les investissement allemands, par exemple, en ancienne République démocratique allemande et dans l’ancien Bloc de l’Est, ou encore les zones franches émergeant au Proche et Moyen-Orient, par exemple en Égypte. Il s’agit là d’une réorganisation géographique du capitalisme et du développement de nouveaux centres d’accumulation.
Mais un nouveau cycle de suraccumulation peut facilement émerger de ces transformations. Tout le monde se rue dans la même direction : Volkswagen, Ford, General Motors, Toyota, Microsoft, Dell, Samsung, etc. se dirigent toutes vers la Chine pour construire de nouvelles usines. La plupart du temps elles font cela sans fermer leurs installations dans leur pays d’origine. Tôt ou tard, on obtient donc une capacité de production excessive. Il s’agit là de la première partie de l’histoire – une suraccumulation de capitaux.
Mais bien sûr, en parallèle, on a aussi une destruction massive d’emplois liée aux nouvelles technologies et à l’informatisation de la production. Ceci est à relier à la production « juste-à-temps » et à la « lean production » dont l’objectif est de minimiser le travail nécessaire pour la fabrication d’un produit. Une telle logique d’économie de travail finit par conduire à une pression à la baisse sur les profits. Et les taux de profits aux États-Unis ont en effet atteint un sommet en 2006, avant de chuter. Cela a plusieurs conséquences. D’abord, les firmes les moins performantes et les moins profitables sont fragilisées. Deuxièmement, cela les encourage à contracter des dettes afin de demeurer compétitives. Mais dès que les marchés financiers et les marchés du crédit font face à une tempête, les banques, qui ont besoin de revenus pour se recapitaliser, refusent de faire rouler les crédits qu’elles accordent habituellement aux firmes. Les entreprises les plus vulnérables sont alors dans l’incapacité de rembourser leurs dettes, entraînant des faillites en cascade. Ce ne sont pas simplement les banques qui ont provoqué la crise actuelle. On doit garder à l’esprit que Chrysler et General Motors étaient en faillite à l’automne 2008 et que ceci était directement lié à la dynamique que je viens de décrire.
Souvent, lorsque les gens lisent Marx, elles et ils voient d’un côté une analyse de la suraccumulation et d’un autre côté une analyse de la tendance à la baisse du taux de profit. Je considère qu’il est impossible de séparer ces éléments. Il s’agit de différentes dimensions d’un même processus – le processus par lequel la croissance économique capitaliste mine elle-même les conditions qui la sous-tendent. C’est ce qui fait la richesse de la théorie de Marx, elle permet de saisir des tendances distinctes d’un même processus social global. Et je crois qu’il s’agit toujours de l’approche la plus fertile pour comprendre ce qui s’est passé depuis 2006 et 2007.
Certains suggèrent que cette crise va affaiblir la classe et le mouvement des travailleur·ses, ainsi que la résistance sociale de façon générale. Il existe bien sûr de nombreux arguments pour soutenir une telle position. Mais tu affirmes aussi dans ton livre que les crises sont des périodes au cours desquelles la subordination du travail au capital doit être réorganisée et au cours desquelles, conséquemment, de nouveaux espaces et de nouvelles formes de résistance peuvent émerger. Peux-tu développer ce point ?
Laisse-moi d’abord aborder le problème de façon empirique et historique. Je crois que les données historiques montrent que les travailleur·ses se sont battu·es face aux conséquences de la grande récession qui a débuté en 2007, en faisant preuve d’une combativité renouvelée. On a par exemple assisté à la première occupation d’usine depuis des décennies aux États-Unis, dans l’entreprise Republic Windows and Doors, en décembre 2008, alors que la crise s’intensifiait. Dans le sud de l’Ontario, où j’habite, cinq usines de fabrications de pièces d’automobiles ont été occupées en réponse à des menaces de licenciement et de fermeture. Il y a eu des occupation similaires en Irlande, en Écosse, en Angleterre. En France, il y aussi eu des séquestrations de patrons. On a assisté à une dizaine de grèves générales en Grèce. Il y a eu d’énormes mobilisations de masse dans les rues françaises.
Comme j’aime le rappeler aux gens des pays du Nord, la grève générale ayant eu le plus de succès au cours des dernières années a eu lieu en Guadeloupe et en Martinique au début de l’année 2009. Il s’agissait de soulèvements formidables contre un capitalisme raciste et néo-colonial qui ont permis a des coalitions sociales menées par des syndicats d’obtenir des augmentations de salaire de l’ordre de 200 euros par mois pour les travailleur·ses les plus pauvres, ainsi que toute une série d’autres avancées.
Plus récemment, on a pu assister au renversement de régimes par des mouvements sociaux. Ce fut par exemple le cas en Tunisie où, à un stade avancé de la révolution, des éléments radicaux ont pu prendre le contrôle de l’Union générale tunisienne du travail, non pas au niveau de la direction nationale, mais à la base et au niveau local de l’organisation. Ils ont ainsi pu lancer des grèves générales dans diverses villes. Les commentateurs qui ont vraiment suivi de près le processus révolutionnaire en Tunisie ont pu comprendre qu’il s’agissait là de l’élément-clé dans la chute de Ben Ali. De la même façon, je ne crois pas que ce soit une coïncidence que la chute de Moubarak en Égypte soit advenue au cours d’une semaine où a débuté une vague de grèves de masses. En fait, la révolution égyptienne trouve ses racines dans une vagues de luttes ouvrières qui remonte à 2004. Au moment de la chute de Moubarak, des dizaines, et peut-être des centaines, des milliers de travailleur·ses n’étaient pas simplement en grève, mais participaient aussi à des sit-ins, à des blocages de routes, à des combats contre les escouades policières anti-émeute, à des occupations d’usines et d’hôpitaux, à un blocage du système d’autobus public du Caire, etc. Ce à quoi on a donc pu assister représente une renaissance de luttes politiques de classe dans différentes parties du monde.
Et il faudra aussi bien sûr surveiller de près et participer aux campements qui ont émergé à travers le monde à la suite du mouvement Occupy Wall Street.
Le problème, cependant, est que la plupart de ces mouvements n’ont pas réussi a hausser leur résistance et leur combativité au niveau nécessaire pour répondre aux attaques auxquelles ils font face. On sait que le capitalisme est entré dans une phase d’austérité. On nous annonce une décennie ou plus de coupes dans les programmes sociaux afin de payer pour le renflouement des banques. Dans ce contexte, la classe dominante a décidé qu’elle pouvait faire face à des grèves générales d’une journée sans broncher. Ça ne lui plaît pas, mais elle peut y survivre. De telles mobilisations, en elle-même, ne la feront pas reculer. Il faut rappeler que la grève général en Guadeloupe a duré quarante et un jours, et plus de trente jours pour celle en Martinique. Pour être couronnée de succès, ces luttes ont pris la forme de grèves générales illimités accompagnées d’actions insurrectionnelles dans les rues, incluant l’érection de barricades, des occupations d’usines, la mise sur pied de comités de quartiers, etc. Bref, le développement, si je puis m’exprimer ainsi, de formes embryonnaires de dualité du pouvoir, qui commencent à remettre en question le contrôle que le capital exerce sur la vie quotidienne.
Les mouvements sociaux liés au monde du travail font face à des défis majeurs. S’ils n’arrivent pas à développer de nouvelles formes de résistance, ils se retrouveront dans une situation désastreuse. Les vieilles méthodes de luttes ne vont plus être suffisantes. Comme je l’ai dit, les grèves générales d’une journée ne vont plus suffire. Ils auront besoin de développer des formes de résistance plus combatives, plus radicales et plus prolongées pour pouvoir bloquer les programmes d’austérité. Mais il y a des signes d’espoir, dont ceux que j’ai décrits. On peut aussi être encouragé par la lutte qui a eu lieu au Wisconsin. Il faut reconnaître le caractère exceptionnel d’un mouvement qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes en soutien à l’occupation d’un édifice parlementaire organisé par les syndicats et visant à bloquer un processus politique et à préserver des droits syndicaux. Il faut noter que lorsque que Michael Moore s’est rendu en face du Capitole à Madison, au Wisconsin, pour faire un discours devant une foule de 70 000 personnes, il a parlé de ces gens rassemblés en les présentant comme des travailleur·ses et a utilisé un discours de classe. Ce à quoi cette foule à répondu par des applaudissements approbatifs. Il faut aussi noter que ce mouvement fut marqué par une grève illégale de dizaines de milliers d’enseignant·es du secteur public. Tout cela représente des développements très importants. Je suis bien d’accord pour dire que ça ne suffit pas. Mais ça nous montre qu’il existe des capacités réelles de résistance.
Il faut aussi garder à l’esprit que les cinq premières années de la Grande Dépression des années 1930 furent caractérisées par une relative passivité du mouvement ouvrier en Amérique du Nord, alors même qu’une offensive patronale majeure faisait rage et que le chômage atteignait des sommets. Les syndicats furent broyés, les grèves défaites et le mouvement dans son ensemble enregistra de forts reculs. Mais à la suite du travail des quelques radicaux qui lancèrent et menèrent quelques petites grèves victorieuses, la situation commença à s’inverser au cours de la deuxième moitié de la décennie. En 1937 émergea le mouvement du « sit-in » au cours duquel des travailleurs occupèrent leurs usines et obtinrent d’importants droits syndicaux.
Les moments de crise peuvent donc être des mouvements où le capital se réinvente pour développer une nouvelle stratégie d’accumulation, mais aussi au cours desquels les formes et les stratégies de luttes se réinventent. Il n’existe bien sûr aucune garantie. Une telle réinvention ne peut qu’être le résultat d’un dur travail de militant·es de gauche s’organisant à la base des mouvements.
Comment les luttes contre les politiques d’austérité dans un contexte de crise économique prolongée pourraient-elles servir à développer des idées et éventuellement des mouvements qui pourraient en venir à remettre en question l’organisation capitaliste de l’économie et de la société ?
Je crois que ceci doit se faire a des niveaux multiples. En partie, il faut agir au niveau idéologique et politique où on doit à nouveau rendre crédible des idées telles que la propriété sociale des moyens de production, du contrôle démocratique de la production exercé par les travailleur·ses, du dépassement du marché comme instrument d’organisation économique, etc. Pour la gauche, ceci implique aussi de développer un nouveau vocabulaire et de nouvelles façons d’exprimer les idées anti-capitalistes qui soient adaptées au contexte politique et culturel au sein duquel nous sommes plongés. Nous sommes au début d’un tel processus. Nous ne devons pas simplement assumer que les slogans du passé auront nécessairement un écho au sein de mouvements sociaux offensifs qui pourraient réémerger après trente ans de défaites. Prenons l’exemple des plans de sauvetage des banques. La gauche doit arriver à développer un discours qui insiste sur le fait qu’on utilise des fonds publics afin de sauver des entreprises privées et que celles-ci devront donc devenir des institutions publiques qui ne fonctionneront plus suivant un modèle de maximisation des profits mais qui réaliseront des investissements répondant à l’intérêt public afin, par exemple, de construire les logements sociaux dont nous avons besoin, de développer des sources d’énergie renouvelables et de reconvertir les usines automobiles qui seront fermées afin qu’elles produisent, par exemple, des panneaux solaires.
Il faut ensuite développer des formes institutionnelles à l’aide desquelles la gauche pourra propager ces idées dans une partie plus large de la population. Lors d’une période de défaite, toute une série d’espaces sociaux à travers lesquelles la gauche développait et disséminait ses idées sont détruites. Il faut donc reconstruire ce que mon ami Alan Sears appelle des « infrastructures de contestation » : tous ces groupes et réseaux de base tels que les syndicats locaux, les comités de quartiers, etc. où les gens peuvent se rassembler et parler de politique, échanger des idées et développer des stratégies.
Enfin, il faut développer, parallèlement à tout cela, une nouvelle culture de résistance. Il s’agit de faire de la politique de la résistance un moment culturel de la vie des gens. Ceci prendra une forme musicale et impliquera le développement de nouvelles formes d’art public. Toutes les grandes périodes de soulèvement de la gauche ont été accompagnées par de tels développements de théâtres de rue, de productions cinématographiques, de musiques, etc.
Il faut aussi réaliser que lorsque des individus se joignent à de nouveaux mouvements de masse, elles et ils ne cherchent pas nécessairement à acquérir une carte de membre d’un groupe spécifique. Elles et ils pensent plutôt à se joindre à la lutte dans la rue, dans leurs lieux de travail et dans leurs quartiers afin de faire partie de cette expérience, de ce processus excitant leur permettant de reprendre le contrôle de leur vie. C’est ce qui est arrivé par exemple sur la place Tahrir au Caire. Les gens ont pu observer un tout nouvel ensemble de relations sociales. Les gens qui s’y sont rassemblés ont pu développer une conscience de leur propre pouvoir. Les gens développent ainsi leurs capacités non pas parce qu’on leur dit qu’elles et ils ont ces capacité, mais parce qu’elles et ils les découvrent en en faisant l’expérience.
Pour développer cette nouvelle gauche, il est nécessaire que des groupes d’activistes ayant une connaissance des luttes passées puisse la propager. Il ne s’agit pas d’affirmer que ces expériences passées puissent fournir toutes les réponses à nos questions. Mais leur connaissance nous permet d’imaginer des formes d’organisation de masse que la gauche n’a pas pu développer depuis un long moment. La gauche doit donc réfléchir aux moyens de s’émanciper des marges de la vie politique afin de commencer à jouer un rôle modeste dans des mobilisations de masse. Il faut d’autant plus être prêt à cela que la crise conduit à l’émergence de telles mobilisations un peu partout dans le monde.
Dans le contexte actuel de crise économique prolongée, pourquoi est-il utile et nécessaire, de penser et d’organiser notre résistance en terme de lutte de classes comme tu tentes de le faire dans ton livre et sur ton blog (http://www.davidmcnally.org), en analysant les mouvements sociaux qui ont émergé en Bolivie, à Oaxaca au Mexique, en Tunisie et en Égypte au cours des dernières années ? En quoi le concept de classe est-il à relier à d’autres formes d’oppression dans la période actuelle ?
Une conclusion très importante qui doit ressortir de ce que j’ai dit précédemment est que la gauche doit toujours remettre en question sa propre compréhension de ce que sont les classes. Trop souvent, la gauche pense à partir de conceptions périmées tirées d’une période historique spécifique et nous agissons comme si ces construits historiques particuliers pouvaient être extraits de leur contexte historique et comme si ces entités – la classes des travailleur·ses des années 1970, ou encore celle de 1937 ou de 1968 – existaient toujours aujourd’hui. Les classes sont des formations sociales historiques. J’aime toujours faire remarquer que la classe des travailleur·ses d’aujourd’hui est plus globale, plus multi-ethnique, et plus genrée que jamais. Elle n’est pas formée en majorité de vieux hommes blancs. Les hommes blancs forme une très petite majorité de cette classe à l’échelle mondiale. Au cours des vingt-cinq dernières années, la classe ouvrière est-asiatique est passé d’environ cent millions à neuf cent millions de personnes. Les effectifs de cette classe ont au moins doublé à l’échelle mondiale. On peut maintenant observer de nouvelles classes des travailleur·ses massives en Indonésie, en Malaisie, en Chine, en Bolivie, en Argentine, etc.
Face à cette évolution, il m’apparaît inimaginable qu’on puisse développer une analyse de classe qui ne soit pas à la fois anti-raciste et féministe. Nous devons par exemple être conscient de l’oppression spécifique des travailleur·ses de couleur ici à Toronto, qui forment maintenant une majorité de la classe de cette ville. Il y a aussi des secteurs entiers de l’économie mondiale où les femmes forment une majorité de la main-d’œuvre, et c’est parfois le cas dans certaines partie des pays du Nord. En conséquence, l’oppression de genre et son impact spécifique sur le marché du travail, sur les salaires, la sécurité d’emploi, les congés de maternité, etc. doit faire partie de la façon dont nous comprenons et construisons notre politique de lutte des classes. C’est donc le premier point à considérer : la classe des travailleur·ses a changé et la façon dont nous la conceptualisons doit donc aussi changer.
Il n’y a pas de doute que l’anti-racisme, l’anti-impérialisme et le féminisme auraient toujours dû faire partie de l’engagement politique de la gauche et certaines sections de la gauche ont effectivement toujours tenté d’intégrer ces éléments. Il me semble donc qu’il est important aujourd’hui de relire des auteur·es comme C.L.R. James sur les dimensions anti-coloniales et anti-racistes de la lutte des classes. Il était de plusieurs façon en avance sur son temps sur toutes ces questions. Il faut redécouvrir toute ces grandes figures de la gauche qui avaient une longueur d’avance et qui ont anticipé plusieurs phénomènes qui se sont généralisés dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui.
Reconnaître l’imbrication des relations de classes et d’autres formes de relations sociales et de rapports d’oppression ne signifie pas que les classes soient une réalité moins importante dans la société contemporaine. Il s’agit simplement de reconnaître qu’il n’existe pas de classe, comprise comme une formation sociale, qui ne soit pas racialisée, qui ne soit pas genrée ou qui ne soit pas organisée sur la base d’un système dominant de régulation sexuelle, etc. Il faut donc retourner à cette notion dialectique voulant que tout phénomène est une unité de divers aspects, comme le dit Marx dans l’introduction des Grundrisse, et que la classes des travailleur·ses ne prend donc jamais une forme unique. Les travailleur·ses sont uni·es au-delà de leur diversité, mais cette diversité est aussi un élément crucial à considérer. Les expériences spécifiques d’oppression ne se résument pas aux contradictions de classe mais, heureusement, dans la mesure où nous partageons cette condition de classe, nous avons un espace – le mouvements des travailleur·ses – au sein duquel nous pouvons développer une politique partagée de résistance anti-raciste, féministe et pro-queer. Ce que tou·tes les travailleur·ses ont en commun, c’est leur dépossession et la marchandisation de leur force de travail. C’est en luttant contre cette situation qu’on découvre notre unité réelle.
Propos recueillis par Xavier Lafrance
[1] « Crise globale », NdR.
[2] Voir les données rassemblées par Martin Wolf, « The Eurozone after Strauss-Kahn », The Financial Times, 17 mai 2011.
[3] Robert Brenner, The Economics of Global Turbulence, Verso Books, New York, 2006.
Nos contenus sont sous licence Creative Commons, libres de diffusion, et Copyleft. Toute parution peut donc être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d’origine activée.