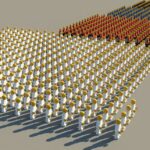Rosa Luxemburg, un marxisme pour le XXIe siècle
Il semble exister une secrète complicité entre la redécouverte de Rosa Luxemburg et les époques contestataires. La dernière fois que la vie et l’œuvre de Rosa Luxemburg ont suscité autant d’intérêt en France, ce fut dans les années 1960 et 1970, quand « le fond de l’air était rouge ». La publication récente de plusieurs ouvrages à son sujet serait-elle le signe d’une nouvelle époque « critique » ? En tout cas ses idées sont très présentes aujourd’hui, non seulement en Europe, mais aussi en Amérique latine, dans le contexte du débat sur le « socialisme au XXIe siècle ».
Les trois ouvrages ici recensés[1] sont très différents, et reflètent la diversité des intérêts et des questionnements que suscite ce personnage hors pair de l’histoire du socialisme. Suivant l’ordre de publication, commençons par celui de Claudie Weill, une des meilleures spécialistes de l’œuvre de la fondatrice de la Ligue Spartakus, et l’éditrice en français de son essai sur l’autonomie nationale : ce remarquable petit livre est un recueil d’articles qui explorent des aspects peu abordés dans la littérature « luxemburgiste ». Par exemple, les paradoxes de sa « panthéonisation » en Allemagne, par des plaques commémoratives, des timbres-poste, des statues, des films, qui témoignent de la fascination qu’elle continue d’exercer, mais aussi de la concurrence des mémoires et des tentatives d’instrumentalisation. Un des chapitres les plus intéressants est dédié à la question de la culture nationale chez Rosa Luxemburg. Claudie Weill rappelle son opposition au nationalisme et son internationalisme intransigeant, mais, à son avis, ce qui la distingue de la façon la plus nette du marxisme de la IIe Internationale, c’est son attitude critique en vers les « illusions du progrès » et sa sympathie pour les « communautés primitives » laminées par la pénétration du capitalisme et du colonialisme. Les autres essais discutent de ses rapports (conflictuels) avec le courant menchevik, dont elle semble partager les aspirations unitaires – par rapport aux fractions du POSDR (Parti Ouvrier Social-Démocrate Russe) – mais dont elle critique sévèrement la posture à la traîne des forces bourgeoises en 1905 et 1917 ; ou encore sa place comme « femme étrangère » – juive polonaise émigrée en Allemagne – dans le socialisme international, qu’elle compare à celles de Flora Tristan et Anna Kuliscioff, émigrée russe en Italie, militante anarchiste convertie au socialisme. En introduction à son livre, Claudie Weill évoque ses célèbres lettres de prison, témoignage précieux de la richesse de sa personnalité : sensibilité, culture, humour, passion, mais aussi froideur tranchante et ironie mordante – sans oublier, ajouterai-je, la colère, cette qualité intrinsèque à tout esprit révolutionnaire.
Un choix de ces lettres vient d’être publié par Anouk Grinberg, comédienne dont l’émouvant spectacle de lecture a été enregistré par France Culture (un disque CD de cette émission est inclus dans le livre). Plusieurs de ces lettres avaient déjà été publiées par le regretté Georges Haupt dans deux recueils parus aux éditions Maspero dans les années 1970. Retraduites ici avec l’aide de Laure Bernardi, ces lettres, adressées à ses amies – Louise Kautsky, Sonia Liebknecht, Mathide Wurm, Mathilde Jacob – mais aussi à ses amants – Leo Jogisches, Kostia Zetkin, Hans Diefenbach – sont des documents politiques et personnels uniques, expression, comme l’écrit Anouk Grinberg, d’une certaine « manière de vivre ». Comment se fait-il, demande-t-elle, que
« cette femme a pu rester si vaste au fond d’un cachot, et ouvrir sans arrêt les portes de la vie ? D’où lui venaient cette joie, ce tact, cette grandeur ? Par quel miracle ont-ils résisté à une si longue adversité ? ».
Dans une très belle préface, Edwy Plenel tente de répondre à ces questions. Ce qui a donné à Rosa sa force inouïe, et ce qui lui a gagné l’attirance de tant de générations, c’est sans doute
« cette jeunesse d’une colère qu’aucune combinaison, manœuvre ou tactique, n’est venue éroder ; cette fraîcheur d’une révolte qu’aucune atmosphère, ambition ou trahison, n’est venue vicier ».
Si ses lettres de prison ont quelque chose d’unique, d’irremplaçable, c’est qu’elles « donnent à voir et à comprendre la vérité de cette forme d’engagement total pour la cause des opprimés, des exploités et des démunis, à rebours des vulgates conservatrices qui, proliférant de nos jours tel le fumier sur les décombres du communisme réel, assimilent ces choix de vie à des folies criminelles ». C’est pour toutes ces raisons que Rosa était un être humain véritable, « comme l’on dirait en yiddish, un mentsch – l’exact contraire d’un imposteur ou d’un frimeur ». Comme son ami et camarade de combats Karl Liebknecht, elle a su s’opposer, dès août 1914, au chauvinisme militariste de la Grande Guerre :
« Dans ce monde bancal, Rosa Luxemburg, cette femme qui marchait en boitant, était une des rares personnes à se tenir étonnamment droit ».
Le crime de janvier 1919, son assassinat par les corps francs au service du gouvernement social-démocrate de Noske, Ebert et Scheidemann, c’est le premier acte, l’acte décisif, « sans retour ni excuses », de la longue suite de catastrophes « dont l’ombre portée obscurcit encore, de nos jours, l’horizon de la gauche européenne ».
Edwy Plenel mentionne son optimisme révolutionnaire, son attachement à l’espérance. Certes, mais il aurait fallu rappeler qu’elle est à l’origine de la formule « socialisme ou barbarie » : l’avenir n’est pas garanti, le socialisme n’est pas une fatalité de l’histoire, le pire est possible, si les opprimés ne se soulèvent pas. Cette vision d’une histoire ouverte, imprévisible, traversée de « bifurcations » (pour reprendre les termes de notre ami Daniel Bensaïd) est un des apports les plus importants de Rosa Luxemburg au socialisme moderne.
Le troisième ouvrage, celui de David Muhlmann, est sans doute le plus ambitieux : il propose non seulement une présentation synthétique de la vie et de l’œuvre de Rosa, mais aussi une perspective, inspirée par ses idées, pour le monde actuel. Réconcilier marxisme et démocratie annonce déjà ce programme, mais le nom de Rosa Luxemburg n’apparaît pas du tout dans le titre, ce qui est tout de même curieux pour un ouvrage qui se veut, comme l’explique la quatrième de couverture, une réflexion sur « le bon usage de Rosa Luxemburg ». J’éprouve beaucoup de sympathie pour le point de vue qui informe ce livre : celui d’une nouvelle radicalité, capable d’articuler l’anticapitalisme militant et l’esprit libertaire, et de proposer, au-delà de la social-démocratie et du socialisme autoritaire « par en haut », une perspective révolutionnaire nouvelle, socialiste et démocratique.
L’ordre d’exposition suit les principales étapes de l’œuvre de la révolutionnaire judéo/polonaise : la querelle du révisionnisme (contre Eduard Bernstein) et la critique de la théorie du parti de Lénine, les écrits sur la révolution russe de 1905, l’impérialisme et la question nationale, l’opposition à la guerre impérialiste de 1914-18 et la fondation du Spasrtakusbund, la critique de la politique des bolcheviks au pouvoir (1918), et la révolution allemande de 1918-19. Dans une deuxième partie du livre, David Muhlmann a interviewé une série de penseurs contemporains, au sujet de leur rapport à Rosa Luxemburg : Daniel Bensaïd, Toni Negri, Paul Le Blanc (USA), Paul Singer et Isabel Loureiro (Brésil), Michael Krätke (Allemagne), Narihiko Ito (Japon), et l’auteur de la présente recension.
La présentation de la vie et des écrits de Rosa est essentiellement fondée sur une lecture de ses écrits, et une synthèse réussie de la littérature existante – les ouvrages de Nettl, Frölich, Badia, etc. Mais l’ensemble est aussi porté par une évidente intention polémique : montrer l’opposition de Rosa Luxemburg au bolchevisme, aussi bien en ce qui concerne les conceptions organisationnelles de Lénine avant 1905, que la pratique des bolcheviks au pouvoir en 1917-18. L’auteur est convaincu que le Parti bolchevik contenait en germe la dégénérescence bureaucratique de l’État soviétique, et que l’URSS, loin d’être un pays « socialiste » ou un « État ouvrier », n’était en fait qu’une sorte de capitalisme d’État – thèse développée, entre autres, par le marxiste anglais Tony Cliff. Personnellement, je ne trouve rien de choquant dans ces thèses, qui font partie du débat courant au sein de la mouvance marxiste révolutionnaire internationale, depuis plusieurs décennies.
Par contre, dans certains passages du livre, David Muhlmann force le trait et finit par attribuer à Rosa Luxemburg des idées qui sont assez éloignées de celles que l’on trouve effectivement dans ses écrits. Quelques exemples :
Selon lui, pour Rosa Luxemburg et les spartakistes,
« seuls les acquis de février étaient durables, au sens d’un dépassement de l’absolutisme et de l’entrée de la Russie dans la révolution bourgeoise ; le coup d’État bolchevik était par contre éphémère, il venait forcer le cours du développement réel, et surimposait l’idée de la dictature du prolétariat qui était décalée par rapport à la situation » (p. 51).
Est-ce vraiment le point de vue de Rosa – qui avait, déjà en 1908, proposé, au congrès du POSDR, le même mot d’ordre que Trotsky : « la dictature du prolétariat appuyée par la paysannerie » – ou plutôt celui des mencheviks russes ? Muhlmann ne cache pas sa sympathie pour le point de vue de ces derniers :
« Les mencheviks se montraient à la fois plus réalistes et plus fidèles au marxisme, lorsqu’ils soulignaient le caractère irréductible de la succession historique des modes de production, et rappelaient les présupposés évolutionnistes et « étapistes » de la théorie de Marx ».
Laissons de côté Marx – qui est tout de même l’auteur de la formule « révolution permanente » dans un document de 1850 – pour nous limiter à Rosa Luxemburg : partageait-elle l’analyse des mencheviks ? En fait, les passages de l’essai de la révolutionnaire allemande sur la Révolution russe, cités par Muhlmann lui-même, ne confirment nullement son interprétation. Non seulement elle ne condamne pas la révolution d’Octobre comme un « coup d’Etat », mais elle la salue avec enthousiasme :
« Les Lénine et Trotsky […] ont montré l’exemple à la tête du prolétariat mondial, ils sont jusqu’ici les seuls qui puissent s’écrier avec Hutten : j’ai osé. »
Loin de dénoncer la dictature du prolétariat et les mesures socialistes, sa critique des bolcheviks concerne en fait l’absence de démocratie, nécessaire pour atteindre les objectifs socialistes :
« Cette dictature consiste dans la manière d’appliquer la démocratie, non dans son abolition, dans des interventions énergiques et résolues […] sans lesquelles la transformation socialiste ne peut se réaliser. »
Loin de vouloir en rester, comme les mencheviks, à la « révolution bourgeoise de février », elle critique les bolcheviks pour avoir oublié que « c’est la mission historique du prolétariat, quand il arrive au pouvoir, de créer à la place de la démocratie bourgeoise une démocratie socialiste, et non de détruire toute démocratie ». On pourrait multiplier les citations. Muhlmann lui-même écrit que
« certains passages de La Révolution russe appellent à l’écrasement impitoyable de la résistance contre-révolutionnaire et du sabotage des mesures socialistes ».
Où sont les « présupposés étapistes » chers aux mencheviks ? Bref, Rosa Luxemburg critique, avec une profonde et prophétique justesse, les errements autoritaires des bolcheviks ; elle ne met nullement en question le programme socialiste de la Révolution russe.
L’autre aspect polémique s’adresse à Trotsky et ses partisans. Autant la critique de la thèse de l’URSS comme « État ouvrier » – qui a suscité, comme le rappelle Muhlmann, des multiples scissions dans le mouvement, depuis Max Schachtmann jusqu’à Natalia Sedova – me semble tout à fait digne d’intérêt, autant la présentation de la « révolution politique » antibureaucratique prônée par Trotsky comme un simple « changement du personnel politique », ou la définition du trotskysme comme « l’idéologie de la fraction de la bureaucratie en exil », me semblent des caricatures peu consistantes.
Muhlmann accuse aussi les trotskystes d’avoir voulu « identifier Rosa Luxemburg tout simplement au bolchevisme », et il cite, dans ce contexte, entre autres, une préface rédigée par Carlos Rossi à un recueil de textes de Rosa, L’État bourgeois et la Révolution, publié aux éditions La Brèche en 1978. Or, dans ce texte, mon ami Rossi n’a pas voulu « identifier Rosa Luxemburg au bolchevisme », mais mettre en évidence certaines affinités entre la révolutionnaire allemande et Trotsky, sans pour autant cacher ses désaccords avec les bolcheviks sur la démocratie socialiste :
« A cet égard », écrit-il, « les critiques de Rosa Luxemburg aux bolcheviks n’ont rien perdu de leur actualité ; au contraire, elles nous paraissent prophétiques dans la mesure où elles attirent l’attention sur les dangers que contenait la politique de restriction sévère des libertés démocratiques appliquée par le pouvoir révolutionnaire en Russie. »
C’est d’ailleurs, à peu de choses près, l’opinion défendue par Daniel Bensaïd dans l’entretien avec Muhlmann :
« Voilà qui nous ramène à Rosa et sa fameuse critique dans La Révolution russe. Tout son discours sur la vitalité démocratique, la société qui doit être irriguée par le débat, par la controverse, par la presse, par la contradiction, voilà une leçon fondatrice et fondamentale pour tous ».
Il me semble important que, au-delà des clivages du passé, les anticapitalistes d’aujourd’hui réfléchissent à cette leçon…
Cet article a paru initialement dans le n° 8 de Contretemps en 2011.
Notes
[1] Claudie Weill, Rosa Luxemburg. Ombre et Lumière, Paris, Le Temps des Cerises, 2009 ; Rosa, la Vie. Lettres de Rosa Luxemburg, textes choisis par Anouk Grinberg, introduction de Edwy Plenel, Paris, Editions de l’Atelier, 2009 ; David Muhlmann, Réconcilier marxisme et démocratie, Paris, Seuil, 2010.