
Sur la « tyrannie de la valeur »
Cette lecture de l’ouvrage dirigé par Eric Martin et Maxime Ouellet La tyrannie de la valeur. Débats pour le renouvellement de la théorie critique (Ecosociété, Montréal, Québec, 2014, 277 p., 19€) présente les différentes contributions à un effort collectif visant à établir une refondation complète de la théorie critique à partir d’une analyse radicale de la valeur comme médiation centrale de la société capitaliste. On rejoint par là des enjeux dont des publications précédentes se sont faites l’écho, à l’occasion notamment d’un dialogue entre Antoine Artous et Jean-Marie Harribey.
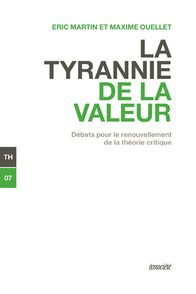
Les onze auteurs de cet ouvrage dirigé par Eric Martin et Maxime Ouellet proposent de faire le point sur une refondation complète de la théorie critique à partir d’une analyse radicale de la valeur comme médiation centrale de la société capitaliste. L’enjeu n’est rien de moins que de poser les bases d’un dépassement de la question de la recherche du sujet de l’émancipation, tout en proposant une vision réellement articulée des différentes oppressions et exploitations. Les questions stratégiques qui découlent de cette réflexion théorique ne sont pas éludées : comment éviter les écueils de l’économicisme – la revendication d’une meilleure répartition du revenu nous enferme dans la logique capitaliste de la valeur – sans tomber dans une posture pessimiste de critique de la critique ? Quelques pistes sont proposées au fil du livre, composé d’une introduction des deux directeurs suivie de 9 chapitres.
La tyrannie de la valeur s’empare de trois nouvelles approches théoriques contemporaines et propose de les faire converger. Les travaux de Moishe Postone, en particulier Temps, travail et domination sociale, écrit en 1993 et la sociologie dialectique de Michel Freitag produite tout au long des années 1980, 1990 et 2000 sont rapprochées de la relecture de Marx centrée sur la critique de la valeur (Wertkritik) entreprise par le groupe Krisis à partir de la fin des années 1980. Dans le premier chapitre, Anselm Jappe revient sur les apports du principal auteur de ce courant, Robert Kurz. On retrouve chez ce dernier une critique du marxisme orthodoxe et du mouvement ouvrier, critique commune aux trois courants qui nous intéressent : la lutte des classes est « un conflit à l’intérieur du rapport capitaliste », si bien que « les sujets collectifs, comme les classes, ne sont pas les acteurs de l’histoire mais ils sont eux-mêmes constitués, et ensuite dissous, par le mouvement de la valeur » (p. 55).
Pour le courant de la critique de la valeur, le concept de valeur a été mal compris par les lecteurs de Marx. Ou plutôt, il s’agit « de reprendre ses intuitions les plus fécondes, même si cela implique de s’opposer à d’autres idées du maître » (p. 60). Loin de naturaliser le travail comme une capacité proprement humaine à agir sur l’environnement en vue d’une fin, Marx « critique plutôt le fait que le travail ait une fonction de médiation sociale dans les sociétés capitalistes » (p. 15), c’est-à-dire qu’il constitue le terrain de mise en relation des activités humaines. Sous le capitalisme, cette mise en relation est une abstraction deshumanisante : la valeur est faite de travail abstrait, qui n’est pas du « travail individuel et isolé » mais plutôt « l’expression du travail en tant que puissance sociale » (p. 15). Il serait alors vain de chercher à mesurer, tout au long du processus productif, le temps de travail concrètement dépensé dans la production d’une marchandise. Il faut au contraire faire porter l’attention sur les effets sociaux du règne de la valeur : l’obligation de vendre sa force de travail, la poursuite effrénée de la croissance, la consommation comme épanouissement, etc.
Contre Althusser et avec Holloway qui propose de Lire la première phrase du capital, la critique de la valeur se fonde sur le premier chapitre du Capital et son analyse du fétichisme de la marchandise, un fétiche qu’il faut comprendre comme une abstraction réelle ayant vraiment cours dans les sociétés marchandes et non comme une illusion subjective. Historiquement, le travail dans la société capitaliste apparait comme une « libération à l’égard des formes sociales antérieures et des formes de domination personnelles [qui] n’a pas pour effet de libérer le sujet ; elle le plonge au contraire dans une aliénation d’autant plus glaciale (pour parler comme Marx) que celle-ci se trouve expurgée de la normativité qui caractérisait encore le rapport traditionnel » (p. 23).
Les luttes traditionnelles du mouvement ouvrier contre l’exploitation s’arrêtent au concept de valeur de Ricardo, une valeur-travail substance de la valeur d’échange qui « s’est avérée utile historiquement en ce qu’elle a fourni une justification normative pour assurer une redistribution plus juste de la richesse produite socialement » mais « s’avère incapable […] de critiquer de manière adéquate la forme de domination abstraite qui est au fondement de la société capitaliste » (p. 17). Ce concept est donc intrinsèquement réformiste : il naturalise le travail et donc dépolitise les luttes. « Le positivisme et le structuralisme qu’on retrouvait dans la théorie de la valeur-travail en vogue jusqu’aux années 1970 étaient tout à fait adaptés à l’idéologie technocratique de la planification, partagée tant par les bureaucrates des régimes sociaux-démocrates à l’Ouest que par ceux du socialisme réellement existant à l’Est ». L’horizon d’émancipation véhiculé par une critique centrée sur la valeur-travail, ce sont les idéaux modernes d’égalité et de liberté abstraites, des idéaux encastrés « dans les catégories du capital qui régissent une société dont [on] prétend s’abstraire » (p. 31-32). Pour penser une autre société, il faut donc s’attaquer à la valeur comme médiation sociale plutôt qu’à son partage.
Jacques Mascatto entreprend dans le second chapitre une critique approfondie quoiqu’un peu unilatérale des régimes communistes à partir de cette perspective. À moins d’abolir la valeur, et donc le travail et la classe ouvrière, on reste sous son emprise. Pour « Lénine, la dictature du prolétariat [… c’est] fonder une société dans laquelle chacun serait membre de la classe ouvrière afin d’institutionnaliser l’universalisation du capital » (p. 75). Ainsi, le « capital peut se passer des capitalistes, mais non du prolétariat, c’est-à-dire du temps de travail » (p. 77). L’auto-valorisation de la valeur s’est donc poursuivie à l’Est. Si les régimes communistes n’ont pas survécus, ce n’est pas face à la concurrence économique ou militaire de l’Ouest, mais parce qu’ils « se sont avérés incapables de produire, comparativement à l’Occident, de l’aliénation » (p. 68). Bien qu’ils partagent une même dynamique d’accumulation de valeur, le capitalisme de marché l’emporte sur le capitalisme d’Etat lorsqu’il s’agit d’entretenir l’adhésion et la subjectivité adéquate.
Gilles Labelle complète dans le troisième chapitre la critique du marxisme orthodoxe pour lequel le social serait sériel (juxtaposant le travail, le capital, l’État, etc.), quand il faudrait l’analyser comme une totalité. Dans le premier cas, « seule une « force » ou une « volonté » extérieure aux séries peut faire tenir ensemble les éléments qui les composent », la lutte consistant alors à faire évoluer le rapport entre ces « forces » pour recomposer une nouvelle série, socialiste. Or une démarche davantage dialectique doit permettre de penser la co-construction des éléments et de leurs rapports : le travail est « nécessairement aliéné, en tant qu’il médiatise (c’est-à-dire qu’il manifeste à l’échelle de la partie) la dynamique propre au tout que constitue le capital » (p. 103). La métaphore du langage permet d’éclaircir cette approche du social comme totalité dynamique : « ni la partie (les sujets parlants), ni le tout (la langue) n’est le fondement de l’autre ; la totalité linguistique existe plutôt comme un échange continu, comme un dialogue entre l’objectivité, commune et héritée (la langue instituée), et la subjectivité comprise comme exercice de la liberté (la puissance instituante) » (p. 113). Ce chapitre ouvre également d’intéressantes perspectives stratégiques à partir d’une conception de la « liberté concrète, située, liberté qui « peut combattre et résister », qui non seulement n’a rien à voir mais qui se situe aux antipodes de la liberté abstraite, déliée, promue unanimement par les néolibéraux et les défenseurs de la « transgression » à l’infini » (p. 117).
Dans le chapitre 4, Pierre Dardot revient sur la lecture ricardienne de Marx et répond aux économistes hétérodoxes français André Orléan et Frédéric Lordon, mais aussi à Moishe Postone. Dans le Capital, « la valeur n’est pas une substance » (p. 118) au sens métaphysique ; le travail n’y est pas essentialisé en catégorie transhistorique. La valeur est plutôt le quelque chose de commun qui permet de mettre en relation quantitative deux marchandises, de même que « le rapport de distance présuppose comme sa condition de possibilité l’appartenance des deux choses qu’il relie à l’espace ». Il n’y a pas de substance métaphysique valeur, comme il n’y a pas d’éther remplissant l’espace : la valeur et l’espace n’existent pas « en dehors et indépendamment des rapports qui sont construits en [eux], parce qu’il[s sont] co-engendré[s] en même temps qu’eux et à travers eux » (p. 127-128).
Franck Fischbach revient sur la similarité entre valeur et espace dans un chapitre centré sur l’ouvrage de Lukács, Histoire et conscience de classe. Le processus d’abstraction typique de la modernité s’appuie sur « la conception newtonienne de l’espace-temps, qu’on peut décrire comme abstraite, mesurable, universelle et objective [et] qui rend possible la quantification de l’activité sociale et donc l’échangeabilité des produits du travail de tous et chacun dans un espace homogène » (p. 24). Suivant cette logique, le temps n’est qu’une dimension de plus de l’espace, l’espace abstrait de la physique opposé à l’espace différencié de la géographie. C’est donc la fin de l’histoire, au sens où le temps ne fait que passer, sans que rien n’arrive d’autre qu’une accumulation quantitative de valeur. Les perspectives d’émancipation – c’est-à-dire d’en finir avec cette abstraction du temps (de travail en valeur) pour redonner au temps une dimension qualitative, historique – apparaissent alors bien illusoires : la spatialisation est trop avancée et les sujets de l’émancipation trop évanescents. Comment trouver un sujet historique de rechange si la classe ouvrière est elle-même partie prenante du capital et s’il n’y a plus d’histoire ?
Marie-Pierre Boucher propose de faire le point sur l’articulation des analyses critiques du patriarcat et du capitalisme, en confrontant les tentatives de la théorie critique de la valeur à celles des féministes matérialistes françaises et de la revue Théorie communiste. Le concept de « dissociation-valeur » propose d’appréhender la binarité des catégories de sexe comme branchée sur l’opposition valeur/non-valeur, le féminin étant associée à la non-valeur. Cette approche prometteuse permet d’« historiciser les catégories de sexe » en lien avec l’évolution du capitalisme : avec le fordisme, « le rôle de la ménagère sera consolidé puis […] abandonné au profit du salariat flexible, de la double tâche, de la superwoman et de la consolidation des figures de ‘‘la femme’’ » (p. 168). Ainsi, la généralisation du salariat féminin peut contribuer à expliquer le parallèle entre « la hausse des heures de travail, de son intensité, la segmentation de l’emploi et sa porosité, l’investissement de soi » qui caractérisent « le rapport contemporain au travail […] avec l’asservissement des femmes, le sexage et « la mise à disposition de soi » » (p. 191).
Face à l’aliénation, il ne suffit pas de s’emparer du pouvoir d’État, ni même du contrôle des moyens de production : « le capitalisme est un système fétichiste et inconscient, régi par le « sujet automate » (l’expression est de Marx) de la valorisation de la valeur » (p. 59). En plus de l’aliénation, la logique de la valeur est celle d’une accumulation illimitée qui « induit une contrainte temporelle, celle de l’accélération continue […et] de l’innovation technologique perpétuelle » (p. 25). C’est pourquoi (et c’est un nouveau désaccord avec l’essentiel du mouvement ouvrier), « la technique n’est pas neutre mais bien la matérialisation des rapports sociaux et de valeurs » (p. 27). C’est ce dont traite le chapitre de Louis Marion : « la machine ne libère pas l’homme du travail, mais au contraire l’assujettit au travail total, sans qualité, abstrait et aliéné » (p. 199). Capital et technique fonctionnent de façon similaire et conjointe, si bien que « le principe d’économie est égal au principe de raison » (p. 202). Ils gèlent de concert la vie dans la valeur, comme l’espace rigidifie le temps dans le chapitre de Fischbach. Au-delà du seul travail concret, l’aliénation investit l’ensemble du « temps historique objectivé, lequel correspond au patrimoine intellectuel, culturel et scientifique de l’humanité, ce que Marx appelait dans les Grundrisse le general intellect, qui est désormais au fondement de la productivité » (p. 40).
Il faut donc désenchanter la raison et ne rechercher aucun espoir du côté du développement scientifique. La recherche d’un sujet de l’émancipation est tout aussi vaine dès lors que tout sujet « est dialectiquement lié à la forme de médiation sociale dominante et constitué par elle » (p. 33). Ce raisonnement conduit une partie du courant de la critique de la valeur à rejoindre l’école de Francfort et ses perspectives très pessimistes, où la seule issue à l’accumulation aliénante de valeur est dans « l’auto-effondrement du capitalisme sous le poids de ses contradictions » (p. 44). Une issue synonyme de destructions sociales et environnementales cataclysmiques.
Perspectives stratégiques
Face à tous ces mécanismes cohérents d’aliénation, Yves-Marie Abraham se demande « comment arrêter l’automate ? » (p. 222). Les tenants de la théorie critique de la valeur proposent non que « nous libérions le travail du capital […] mais que nous nous libérions du travail » (p. 226) sans pour autant formuler de stratégie d’action. Yves-Marie Abraham nous invite à suivre Bernard Friot et de voir dans le salaire socialisé et la qualification une alternative déjà là à la valeur capitaliste, un instrument ouvrant vers « un projet postcapitaliste réfléchi ». En effet, les cotisations reposent « sur une toute autre conception de la valeur (économique) que celle qui s’est imposée avec le capitalisme » (p. 228). Une valeur plus qualitative – puisque fondée sur la qualification – et moins quantitative – puisque déconnectée du temps de travail.
Jean-François Filion compare dans le dernier chapitre la théorie de la valeur à la sociologie dialectique de Michel Freitag. Le cœur commun de ces approches, c’est l’attention portée sur les médiations « constitutives des formes de subjectivité et d’objectivité, donc des pratiques ainsi que des connaissances » (p. 239). Face au matérialisme froid et aliénant « qui nie l’existence d’entités immatérielles et non quantifiables » (p. 241), Freitag soutient « que la dimension transcendantale du symbolique oriente de manière plus ou moins consciente nos pratiques et nos choix de société » (p. 261). Il s’agit alors de rechercher des « formes de médiations non aliénées » (p. 45) dans les identités, les liens et les pratiques communes, y compris des « médiations précapitalistes », quitte à assumer une forme de conservatisme émancipateur. Dans la mesure où « la totalité du monde n’est pas – pour l’heure – irrémédiablement réduite à n’être qu’un signe de la jouissance narcissique du capital », certaines de ces médiations rendent encore possible de « retrouver un sens par rapport à ce que vaut notre vie commune par-delà le fétiche et le règne des abstractions » (p. 45).
Si le livre appelle la recherche de ces médiations alternatives « moins ruineuses », les auteurs sont avares en propositions. En dehors de la qualification et du salariat promu par Friot, Martin et Ouellec mentionnent rapidement la Commune de Paris. Doit-on chercher du côté de La société des affects de Lordon ? Des revendications identitaires, nationales par exemple, la plupart des auteurs étant québécois ? À partir de la critique du moteur et de la technique, on pourrait également penser à des symboliques plus écologiques, en opposant la Pachamama au fétiche de la marchandise. Si on peut regretter que le livre reste assez abstrait, il donne de nombreux outils pour légitimer chacune des dynamiques revendicatives, dès lors qu’elles sont suffisamment partagées pour prétendre accéder au statut de médiation.
Nos contenus sont placés sous la licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 FR). Toute parution peut être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d’origine activée.
Image en bandeau : © Lourival Cuquinha (via Canal Contemporâneo).








