
Qui contrôlera les robots ? Notes sur Four Futures. Life After Capitalism de P. Frase
Peter Frase, Four Futures. Life After Capitalism, Londres/New York, Verso, 2017.
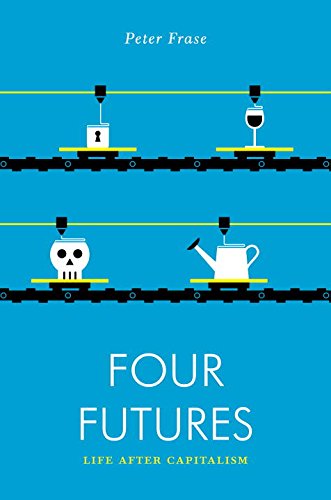
On estime, dans une vingtaine d’années, à 47% le nombre d’emplois perdus aux États-Unis en raison de l’automatisation massive du travail[1]. Tandis que la « quatrième révolution industrielle » se déroule sous nos yeux, on peut observer la prévalence de deux points de vue paradigmatiques sur la question : une position “technophobe”, qui tend à souligner les aspects les plus menaçants de la technologie, et une position “technophile”, pour le rêve de libération du travail que la technologie représenterait.
Il semble cependant que l’on puisse avoir recours à des termes moins passivement apocalyptiques que ceux de la première position, et en même temps moins naïvement optimistes que ceux de la seconde. Au-delà des caractéristiques spécifiques de chaque perspective, les pôles de cette fausse antithèse semblent partager, sans le savoir, l’idée de fond selon laquelle l’automatisation serait une sorte de processus s’auto-déroulant de façon indépendante des êtres humains, possédant les caractéristiques d’un phénomène naturel hors de notre contrôle. Derrière leur opposition, ces pôles partageraient ainsi une tendance particulière consistant à naturaliser l’automatisation, voire à dépolitiser le rapport entre technologie et travail.
Peter Frase compte parmi ceux qui nous invitent à considérer la question de l’automatisation du travail humain d’un point de vue irréductible aux deux pôles mentionnés. Il souligne plutôt l’urgence de se mesurer à sa nature politique au-delà d’une prétendue « inévitabilité scientifique » (p. 15) caractérisant la plupart des discours. Dans son livre qui vient de paraître aux éditions Verso, Four Futures. Life After Capitalism, il problématise ces idées courantes par le biais d’une « fiction sociologique » représentant quatre futurs possibles dans un scénario post-capitaliste – une pluralité qui veut souligner la nature contingente des choix humains et la dépendance des enjeux technologiques vis-à-vis de ces choix.
Au lieu de reconduire la dichotomie stérile entre technophobes et technophiles, l’auteur affirme : « ce que je voudrais injecter dans le débat, c’est de la politique, notamment la lutte de classe » (p. 21)[2]. Le mérite principal de la contribution de Frase consiste donc précisément à repositionner la question d’un niveau prétendument neutre et déterministe, scientifique-technologique, au niveau clairement conflictuel et risqué de la politique. Par ailleurs, un autre livre récemment paru invitait à un repositionnement similaire, Inventing the Future de Nick Srnicek et Alex Williams, ceux-ci s’engageant dans la dénonciation d’une gauche incapable de s’approprier le défi technologique.
D’une manière générale, l’objectif du texte de Frase consiste à encourager une réflexion dans laquelle la technologie pourrait mener à un système de « prospérité partagée » plutôt qu’à un système d’« inégalité croissante » (p. 21). Comme le souligne l’auteur, même ceux qui envisagent la possibilité d’un futur de prospérité grâce à la technologie, manqueraient de se mesurer à un élément central : « la classe capitaliste et les rapports de propriété ». Les bénéfices et risques liés à l’automatisation ne dépendent pas, en fait, des robots en tant que tels, mais de ceux qui les contrôlent (cf. p. 22).
Afin de politiser le regard sur la technologie dans son rapport avec le travail humain, le livre croise la perspective sur la pénurie due à la crise écologique avec celle sur l’abondance potentiellement liée à l’extraordinaire développement technologique. Pénurie écologique et abondance technologique sont analysées selon les grilles de lecture de l’égalité et de la hiérarchie. Ce croisement donne lieu à quatre scénarios idéaux possibles et non exclusifs : le communisme, où abondance et égalité coexistent ; le « rentism », dominé par l’abondance et la hiérarchie ; le socialisme, caractérisé par un état de pénurie et d’égalité ; l’« exterminisme », combinant pénurie et hiérarchie.
Bien sûr, le futur ne prendra pas nécessairement l’une de ces quatre formes. Cette stratégie heuristique conduite par l’expérience de pensée de ces quatre futurs permet de représenter efficacement les enjeux de la question technologique par rapport au travail humain, sans aucune prétention prédictive : il s’agit, plutôt, d’utiliser la force paradigmatique de ces modèles afin de mettre en lumière les possibles implications des tendances actuelles (p. 25), en soulignant la place du « politique et [du] contingent » au-delà de tout « déterminisme techno-utopique » (p. 31).
Le premier idéal-type de futur proposé par l’auteur est le scénario communiste discuté au prisme de deux questions : le dépassement du travail tel que nous le connaissons aujourd’hui, et le rapport entre hiérarchie économique et hiérarchie sociale. En effet, un monde caractérisé par l’abondance et par le manque de travail pour cause d’automatisation ne pourrait que susciter la préoccupation de ceux qui voient dans le travail une source irremplaçable de « signifié et dignité ». Dans cette perspective, un monde automatisé serait donc considéré comme nécessairement menaçant par ceux qui attribuent une charge éthique d’une telle importance au travail. C’est pourquoi le futur communiste demanderait un effort de remise en cause des sources du sens et des buts humains au-delà des paradigmes du travail traditionnellement entendu (p. 38).
Particulièrement intéressante à ce propos est la citation d’une recherche montrant que le lien entre le malheur et le chômage ne serait qu’une conséquence de la considération sociale fortement normative du travail[3] : si celui-ci est généralement considéré comme la principale source de sens et de dignité dans nos sociétés, il s’ensuit que le manque de travail prendrait la forme détestable du stigmate et du mépris, intériorisés à leur tour par les chômeurs. C’est pourquoi ces derniers, une fois qu’ils sont entrés dans l’âge de la retraite, présentent des niveaux de bonheur bien plus élevés que ceux vécus pendant le chômage. Il s’agirait donc une question de normes sociales, et non de valeur intrinsèque du travail (cf. p. 45).
Dans cette perspective, on peut comprendre la raison de la rupture du lien normatif entre travail et revenu, et donc du lien de dépendance entre travailleurs et capitalistes, qui se développe autour du concept de basic income, décrit comme le rappelle l’auteur comme une « réforme non réformiste » par André Gorz, ou comme une « voie capitaliste vers le communisme », selon la célèbre expression de Robert Van der Veen et Philippe Van Parijs[4]. Par ailleurs, quel que soit le futur qui nous attend, la tendance à envisager une « fin du travail » dans les discours sur l’automatisation est fréquente et, à mon avis, trompeuse ; la représentation du problème en ces termes risque en outre de contribuer à l’invisibilisation des formes de travail dont l’automatisation est elle-même un moyen.
De toute façon, un aspect intéressant est que la société communiste « libérée du travail » ne serait pas une société privée de toute hiérarchie. En effet, si le partage de la disponibilité abondante de biens, à l’instar des réplicateurs de Star Trek selon l’exemple de l’auteur, éliminerait toute division matérielle entre capitalistes et prolétaires, le scénario aurait néanmoins ses limites : hors du capital, la société communiste continuerait en fait d’être susceptible de formes de domination extra-matérielles, face auxquelles elle ne serait pas équipée. Frase semble en dernier ressort avoir tiré les leçons des débats sur la reconnaissance et l’irreductibilité des logiques de statut aux logiques de classes des dernières décennies, lorsqu’il affirme que « aucune hiérarchie ni conflit, même à présent, n’est réductible à la logique du capital » (p. 58).
Je voudrais rappeler à ce propos que, dans sa typologie des formes d’exploitation, John Roemer avait d’ailleurs déjà décrit, en 1982, le communisme comme un mode de production libéré de toute forme d’exploitation : par contre, il serait caractérisé par une forme d’« exploitation de statut »[5]. Loin de cesser dans le communisme, les hiérarchies et les formes d’exploitation se limiteraient à changer de statut : au lieu des ressources, elles finiraient par s’appuyer sur les positions sociales.
L’auteur prend l’exemple du cas limite d’une « économie réputationnelle » telle que celle décrite par Cory Doctorow dans son roman paru en 2003, Down and Out in the Magic Kingdom, où les récompenses sont dispensées sous forme de ‘j’aime’ de Facebook au lieu d’argent. Dans ce cas, la réputation et l’estime sociale créent de nouvelles formes d’inégalités indépendantes des rapports de production. En dernier ressort, les hiérarchies statutaires ne pourraient pas être réduites aux hiérarchies de classe. De manière intelligente donc, Frase est loin de présenter le futur communiste comme privé de toute tension interne : au contraire, il souligne qu’il faut mettre en lumière « la complexité de toute utopie ».
Témoignant de la nature politique de tout futur, un scénario tout à fait différent serait possible dans le cas où l’abondance ne prend pas la voie égalitaire : le « rentism » serait un régime où une élite très limitée contrôle l’accès à toute ressource ; dans une société automatisée, ces ressources ne pourraient être que les machines et, plus précisément, les informations qui permettent de mettre ces dernières en œuvre. On trouve aujourd’hui un modèle analogue de propriété de biens immatériels dans la forme de la propriété intellectuelle : ce qu’il s’agit de contrôler est, en fait, l’accès aux informations nécessaires pour la reproduction de patterns, et non des objets physiques – du moment que, après tout, « who owns the robots owns the world » (citation de R. Freeman, p. 70).
Le contrôle de l’accès aux ressources informationnelles donnerait donc lieu à une rente produite perpétuellement au bénéfice de l’élite, ce qui ne permettrait pas à tous de jouir des fruits de l’abondance. Dans un contexte similaire, les rentiers n’auront plus besoin des travailleurs, sauf pour les travaux créatifs non encore automatisés : mais il faut à ce propos prendre en compte que même certains travaux créatifs seront susceptibles d’automatisation dans un avenir qui n’est pas si lointain.
Le troisième scénario, en revanche, combine égalitarisme et pénurie de ressources. Dans le socialisme, le problème pressant de la pénurie devrait faire face au rationnement des « basic inputs » de la production, ce qui rendrait nécessaire certaines formes de planification. Ici, deux modèles sont portés à l’attention : l’économie du partage et le socialisme de marché. Si le revenu de base pourrait assurer une allocation égalitaire des ressources produites par les machines, l’organisation de la production devrait être menée de façon égalitaire sans que nos ressources cumulées auparavant conditionnent notre position dans le marché.
L’auteur présente à ce propos les exemples contemporains de AirBnb, TaskRabbit et Uber. Ces plateformes ont évidemment contribué à redéfinir le rapport de travail traditionnel en permettant virtuellement à tous d’accéder au marché en offrant des services. Toutefois, ces plateformes sont gérées par des compagnies privées qui décident unilatéralement les termes du rapport. On voit en dernier ressort persister des fortes inégalités même dans des modèles de travail innovants inspirés des principes de l’économie du partage. C’est pourquoi Frase invite à considérer la proposition de « socialiser Uber » (p. 118) pour un possible dépassement dans un sens égalitaire du modèle de la sharing economy qui, dans ses formes actuelles, malgré les apparences présente des limites importantes en termes de participation démocratique des “digital workers”.
Le quatrième futur envisagé par Frase consiste dans l’« exterminisme », un terme que l’auteur a emprunté à l’historien E. P. Thompson. Ce système est décrit en termes de « communism for the few », où la pénurie s’accompagnerait de hiérarchie : ici, « abondance et liberté du travail sont possibles pour une minorité, mais les limites matérielles rendent impossible d’étendre le même niveau de vie à tous. Dans le même temps, l’automatisation a rendu superflues des masses de travailleurs ». Il s’agit du cas limite où l’automatisation finirait par rendre tout à fait superflu non seulement le travail mais, en dernier ressort, la vie humaine.
D’où la question inquiétante : le futur aura-t-il encore besoin de nous ?[6] « Le résultat serait une société de surveillance, de répression, d’emprisonnement » et même de génocide (p. 148). Selon Frase, on retrouve dans l’actualité quelques noyaux de ce modèle dans le cas des « villes privées » et des « opt-in societies ». Une société profondément sélective s’accompagne ici de la disparition de la « dépendance mutuelle » (p. 123) entre travailleurs et détenteurs des moyens de production caractérisant le capitalisme. Toutefois, l’élimination du lien de dépendance, au lieu de concrétiser un parcours de libération, n’aboutirait qu’à une version dystopique du rêve automatisé.
Le mérite de l’expérience de pensée proposée par Peter Frase est donc de solliciter notre conscience sur la nature tout à fait politique de la question de l’automatisation, au-delà de toute dichotomie simplifiée entre ‘apocalyptiques’ et ‘intégrés’ en matière de technologie. Aucun futur n’est prévisible et aucun futur n’est dépourvu de contradictions, mais on ne saurait déléguer à un monde technologique prétendument impersonnel la détermination de notre destin.
Notes
[1] C.B. FREY, M.A. OSBORNE, The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization?, Oxford University Programme on the Impacts of Future Technology, 2013.
[2] «The thing I want to inject into this debate, is politics, and specifically class struggle». Cette citation et les suivantes sont de notre traduction.
[3] C. HETSHKO, A. KNABE, R. SCHÖB, Identity and Wellbeing: How Retiring Makes Unemployed Happier, VoxEU, 4.5.2012.
[4] R. VAN DER VEEN, R. VAN PARIJS, « A Capitalist Road to Communism », Theory & Society, v. 15:5, 1986, pp. 635-655.
[5] J. ROEMER, A General Theory of Exploitation and Class, Harvard University Press, Cambridge MA 1982.
[6] Cette question donne son titre à l’ouvrage de J.-M. BESNIER, Demain les posthumains. Le futur a-t-il encore besoin de nous ?, Hachette 2009.









