
Un capitalisme vert est-il possible ?
Cette contribution vise à mobiliser de manière prospective la méthodologie de la théorie des ondes longues, développée notamment par Ernest Mandel (1995), pour essayer de répondre à la question posée dans le titre. Après avoir très brièvement rappelé la problématique de la théorie des ondes longues (voir Husson, 2007), on discute les conditions de viabilité d’un nouveau régime d’accumulation, baptisé par commodité capitalisme vert.
La théorie des ondes longues
La théorie des ondes longues analyse la succession au sein du capitalisme de phases alternées (expansive et récessive). Elle insiste sur l’asymétrie dans l’alternance de ces phases. L’épuisement des phases expansives est endogène, autrement dit il résulte du jeu des mécanismes fondamentaux du système capitaliste, à savoir la recherche du taux de profit maximal et la concurrence entre capitaux individuels. En revanche, le passage à une nouvelle phase expansive est exogène, ce qui veut dire qu’il n’est pas automatique (contrairement au cycle des affaires courant) mais dépend de la mise en place d’un ensemble de conditions, technologiques, sociales et institutionnelles qui définissent un « ordre productif » ou un « régime d’accumulation ».
L’histoire du dernier demi-siècle est caractérisée par la succession de deux phases : une phase expansive « fordiste » jusqu’à la récession généralisée du milieu des années 70 ; puis une phase « néo-libérale » qui s’installe avec le tournant libéral du début des années 80. Par rapport à la précédente, la phase actuelle se caractérise par des gains de productivité, une croissance et un taux d’accumulation inférieurs. Elle se caractérise aussi par un rétablissement du taux de profit à des niveaux élevés. Contrairement à des phases antérieures du capitalisme, ce rétablissement du profit n’a donc pas été consacré à l’accumulation mais à la distribution de rentes financières prélevées sur la valeur créée, au détriment de la part salariale. Cette phase se caractérise également par une hyper-concurrence qui résulte, à la fois, de la mondialisation (mise en concurrence directe des salariés à travers le monde), d’un phénomène de remarchandisation généralisée (services publics et protection sociale) et de l’extension du mode de production capitaliste à l’intégralité de l’économie mondiale.
Cette phase présente donc des caractéristiques relativement inédites dans l’histoire du capitalisme : on ne peut parler au sens strict d’une phase récessive dans la mesure où le taux de profit est très élevé, mais pas non plus d’une phase expansive dans la mesure où le taux d’accumulation reste à un niveau relativement bas. Cette configuration est révélatrice d’une crise systémique où le mode de reconnaissance capitaliste des besoins sociaux conduit à la non-satisfaction et au « déni » des plus élémentaires et des plus urgents de ces besoins.
Viabilité du capitalisme vert et taux de profit
C’est dans ce cadre théorique que l’on examinera la possibilité d’existence d’un capitalisme vert. Il s’agirait, pour aller vite, d’un capitalisme qui réussirait à prendre en charge les problèmes environnementaux « à sa manière » (marchande) et réussirait en même temps à s’ouvrir de nouveaux champs d’accumulation et de nouveaux débouchés
****
Le scénario du capitalisme vert
1. une écotaxe (ou un système de permis d’émission, ce qui revient au même à ce degré de généralité) est mise en place ; cela revient à renchérir le prix relatif de l’énergie en tant qu’élément du capital constant (capital circulant) ;
2. en augmentant le coût de l’énergie, l’écotaxe rentabilise des méthodes de production plus économes en énergie qui permettent d’alléger l’impact sur le capital circulant ;
3. ces nouveaux processus requièrent éventuellement un surcroît de capital fixe couvert en tout ou partie par les recettes tirées de la taxe ;
4. la part des salaires (taux d’exploitation) peut également compenser l’évolution du taux de profit.
****
La viabilité d’un tel modèle pose plusieurs questions que l’on essaiera de bien distinguer. La première est celle de la viabilité économique abstraite du point de vue du taux de profit : à quelles conditions le capitalisme vert est-il compatible avec le maintien du taux de profit ? La deuxième question porte sur les autres éléments permettant de définir un régime d’accumulation cohérent : structure des débouchés, configuration de l’économie mondiale, organisation de la concurrence. La troisième question est plus transversale, et concerne les modalités de passage du capitalisme néo-libéral au capitalisme vert.
L’examen de la première question est mené dans l’annexe 1. La conclusion générale est qu’un régime d’accumulation vert garantissant un taux de profit inchangé est virtuellement possible à condition de supposer une efficacité suffisante de l’investissement vert. La variable-clé est ici l’élasticité qui compare le pourcentage de baisse d’intensité énergétique obtenu par un investissement vert équivalant à 1 % du capital engagé. L’autre variable d’ajustement est la part des salaires dont la baisse peut également contribuer, transitoirement ou non, au maintien du taux de profit.
Cette première analyse met d’emblée en évidence un constat essentiel : les conditions de viabilité d’un capitalisme vert entremêlent étroitement des facteurs technologiques (la fonction de production « verte ») et des facteurs sociaux (la répartition des revenus). Mais, encore une fois, ce premier résultat ne porte que sur les déterminants du taux de profit, ce qui ne suffit pas à définir un régime d’accumulation stabilisé. On reviendra sur ce point, mais on peut d’ores et déjà aborder la question du passage d’un régime d’accumulation à un autre.
La transition vers le capitalisme vert
La discussion nécessite en effet de distinguer deux phases : celle de l’amorçage qui correspond à l’introduction de la taxe, et celle de la montée en puissance des effets compensateurs qui assure la stabilisation du taux de profit à un niveau suffisamment élevé. Dans la phase d’amorçage, le taux de profit ne peut être maintenu que par une baisse de la part des salaires ou des impôts payés par les entreprises puisque l’introduction de nouvelles techniques de production n’a aucune raison de porter immédiatement ses fruits. Mais cette éventuelle compensation réduit d’autant le caractère incitatif de la taxe. Il faut alors distinguer à quel niveau se réalise cette compensation. Si elle tend à se faire entreprise par entreprise, donc au prorata de leur dépense en énergie, l’effet incitatif est nul. Si la compensation est réalisée au niveau global, on modifie alors la structure sectorielle des taux de profit : le taux de profit baisse dans les entreprises fortes consommatrices d’énergie mais se maintient, voire s’élève, dans les branches moins voraces en énergie. L’effet incitatif n’est pas supprimé mais amoindri d’autant.
Une première conclusion consiste donc à souligner la contradiction qui existe entre l’efficacité d’une écotaxe et l’existence d’une contrainte de rentabilité propre au capitalisme. L’efficacité de l’écotaxe n’est optimale que si elle frappe réellement la rentabilité des entreprises à forte intensité énergétique à travers un choc initial de rentabilité. Les ressources procurées par l’écotaxe devraient, durant cette première phase, être consacrées par l’Etat qui en est le bénéficiaire à des programmes publics d’investissement vert. Mais cette distorsion des taux de profit s’oppose au fonctionnement « naturel » du capitalisme.
La péréquation des taux de profit
Le capitalisme est un système fondé sur la concurrence entre « capitaux nombreux ». Concrètement, cela veut dire qu’il faut envisager un système d’incitations permettant de doper certains secteurs du capitalisme au détriment d’autres secteurs et d’insuffler ainsi une dynamique d’ensemble. Les secteurs producteurs de biens de capital verts seraient les moteurs de ce nouveau dynamisme en bénéficiant d’un taux de profit supérieur, tiré par des débouchés croissants. Mais cette représentation est en grande partie une fiction qui oublie la loi de la valeur, autrement dit le principe selon lequel des taux de profit plus élevés obtenus par certains secteurs sont compensés par des taux de profit inférieurs dans les autres secteurs.
On déboucherait alors sur un schéma de reproduction déséquilibré où une section I’ produisant des biens de production verts croîtrait plus vite que le reste de l’économie, en captant une partie croissante de la plus-value créée dans la section II produisant des biens de consommation. Un tel schéma n’est pas stable et doit se résoudre en une baisse relative du capital variable : là encore, on retrouve la répartition des revenus comme variable d’ajustement.
Une voie de sortie pourrait être une accélération de la productivité dans les secteurs verts. Ces gains de productivité ne seraient pas redistribués aux salariés mais répartis entre les différents secteurs à travers les mécanismes de prix relatifs. Mais il est difficile d’imaginer qu’un moindre recours aux technologies « sales » permettrait d’économiser du travail direct à un rythme supérieur à ce qu’il est aujourd’hui. On peut au contraire postuler le contraire.
Il faut en effet distinguer les modifications dans les types de produits qui seraient entraînées par le passage à un capitalisme vert. Il y aurait d’une part des changements dans la nature même des marchandises, passant encore une fois par l’incorporation de coûts supplémentaires. Il y aurait d’autre part, un changement des méthodes de production. Dans les deux cas, on voit mal comment la quantité de travail incorporé dans les nouveaux biens de consommation et d’investissement tendrait à baisser plus vite qu’auparavant. En règle générale, les produits les plus « propres » sont au départ plus chers, reflétant une dépense de travail supplémentaire. Même si ce différentiel était progressivement réduit par la montée en charge des nouvelles technologies, on ne voit pas comment les économies de travail « vivant » pourraient s’accélérer de manière à compenser l’augmentation des dépenses de travail « mort » incorporées dans les nouvelles technologies.
Les modalités de la concurrence
Il existe aujourd’hui une abondante littérature qui s’interroge sur la compatibilité entre les objectifs environnementaux et la concurrence entre capitaux. On prendra ici comme exemple de cette littérature un article récent qui, au-delà de son formalisme, pointe bien ce type de préoccupation (David, 2007). Son point de départ est le constat suivant : « Les dispositifs mis en place par une agence environnementale peuvent aller à l’encontre des objectifs d’une autorité de la concurrence, qui veille au fonctionnement concurrentiel des marchés ». Ce conflit est particulièrement net quand « les firmes les plus efficaces pour produire sont les plus polluantes ».
L’auteur oppose donc clairement « efficacité environnementale » et « efficacité économique ». Son modèle conduit à des résultats qui pointent les effets pervers possibles des solutions marchandes, avec par exemple cette proposition : « Dans un duopole polluant dans lequel la firme efficace est plus polluante que sa rivale, l’introduction d’une taxe sur les émissions peut engendrer une hausse de la part de marché de la firme inefficace » et son corollaire : « Lorsque la part de marché de la firme inefficace augmente avec l’introduction d’une taxe sur les émissions, la production de la firme efficace baisse toujours avec la taxe alors que la production de la firme inefficace peut augmenter ». Paradoxalement, cette même étude montre qu’une « norme de procédé qui porte exclusivement sur les choix d’investissement des pollueurs (…) présente une propriété de neutralité sur la concurrence ». C’est reconnaître, même d’un point de vue capitaliste, la rationalité supérieure d’une gestion par les quantités (normes de procédés) par rapport à une gestion par les coûts (écotaxe). Ce résultat met à mal le postulat théorique néo-libéral selon lequel les solutions libérales (écotaxe ou marché des permis d’émission) conduirait à une affectation optimale des ressources du point de vue environnemental : la soumission aux lois de la concurrence montre au contraire que des effets pervers, propres aux règles du jeu capitalistes, viennent réduite l’efficacité de telles mesures.
La fonction de production verte
L’approche libérale est délibérément optimiste. Par exemple, elle ne considère pas l’épuisement des ressources fossiles comme une véritable menace. Si l’augmentation du prix du pétrole continue, elle va finir par rendre rentables des gisements qui ne le sont pas au prix actuel – voire susciter la découverte de nouveaux gisements – ou encore rendre rentables de nouvelles sources d’énergie. En admettant qu’il puisse fonctionner, ce scénario optimiste réglerait la question de la disponibilité de ressources ; mais il n’apporte aucune réponse au problème du coût supplémentaire et de la ponction qu’il exerce sur le taux de profit.
L’optimisme libéral invoque alors ce que l’on pourrait appeler le « pari néo-classique » en matière de méthodes de production. Il postule une sorte de théorème d’existence selon lequel on peut toujours trouver, pour un système de prix donné, une méthode de production disponible qui permette de ne pas augmenter le coût global de production. Mais il n’y a aucune raison de compter sur un flux ininterrompu d’innovations techniques adéquates aux exigences du capital pour n’importe quel niveau d’économie d’énergie. Rien ne garantit que l’économie réalisable du côté des dépenses d’énergie compense automatiquement le surcroît d’investissement nécessaire à réaliser ces économies. On peut admettre que les gains de productivité liés à l’échelle de production permettront de faire baisser le prix des nouveaux équipements verts mais on ne peut affirmer que ce sera dans une proportion suffisante pour annuler à terme ces coûts supplémentaires. Dans ces conditions, la variable d’ajustement risque à nouveau d’être trouvée du côté des salaires.
On peut faire ici un rappel : depuis au moins un demi-siècle, l’expansion capitaliste a bénéficié d’une énergie à bas coût, et ce facteur, a joué un rôle décisif dans la mise en place de toute une série de méthodes de production intensives qui ont servi de base aux gains de productivité. Avec un coût plus élevé de l’énergie, ces gains de productivité n’auraient pas forcément compensé l’alourdissement du capital comme ils ont pu le faire. Dans le cas de la France, on peut en tout cas mettre en lumière un lien très étroit entre les fluctuations du taux de profit et le coût de la consommation d’énergie (graphique 1).
Graphique 1 – Taux de profit et coût de la consommation d’énergie (France 1949-2006)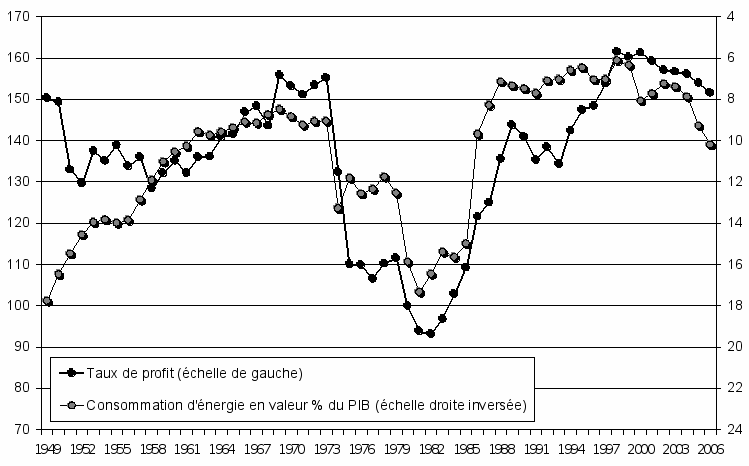
Sources : Villa (1994), Insee (1981), Ministère de l’économie (1997)
En admettant la viabilité d’un capitalisme vert, définie au regard des critères capitalistes, rien ne garantit par conséquent qu’elle soit adéquate aux objectifs d’économie d’énergie fixés par ailleurs. Autrement dit, le cheminement capitaliste va forcément raisonner à la marge, par tâtonnement et expérimentation empirique des réponses aux incitations, bref à l’aveuglette. Le point d’arrivée qui serait la généralisation de nouvelles techniques garantissant le maintien du taux de profit n’existe pas forcément et, dans la logique capitaliste, on ne peut s’en approcher que progressivement. On retrouve là une caractéristique essentielle du capitalisme qui est l’inversion des moyens et des fins. C’est le respect des contraintes propres au capitalisme – qui ne devraient être que des moyens – qui déterminent les objectifs que l’humanité a le droit de se fixer. Autrement dit, l’intensité énergétique ne pourra baisser que jusqu’au point où cette baisse constitue une menace pour le taux de profit, même si les objectifs environnementaux nécessiteraient d’aller au-delà.
Le modèle de « capitalisme vert » examiné ici a en effet été défini à partir de l’introduction d’une écotaxe, mais sans préciser quel est l’objectif fixé en termes d’économie d’énergie. Or, selon toute vraisemblance, le rendement des innovations est décroissant au-delà d’un certain seuil. Dans un premier temps, on peut postuler que l’introduction de technologies vertes permet des économies d’énergie dont le volume est équivalent à celui de l’écotaxe et des dépenses supplémentaires en capital. Mais, au-delà d’un certain seuil, ce rendement décroît, en ce sens que le coût net d’une économie supplémentaire d’énergie augmente et que le taux de profit baisse en conséquence.
Le graphique 2 illustre cette configuration. Dans la zone claire, les économies d’énergie sont compatibles avec le maintien du taux de profit. Puis on entre dans une zone sombre où le taux de profit se met à baisser doucement : on peut alors concevoir un régime d’accumulation s’accommodant d’un taux de profit modérément réduit. Mais on arrive ensuite dans la zone sombre où le taux de profit descend dangereusement. Toute la question est de savoir dans laquelle de ces trois zones se situe l’objectif d’économie d’énergie. Bref, s’il est possible d’imaginer un « capitalisme vert » compatible avec une certaine dose d’économie d’énergie, rien ne garantit que celle-ci soit suffisante pour une réelle maîtrise de l’environnement. C’est de ce point de vue qu’il faudrait examiner les rapports de référence qui reposent tous sur une hypothèse extrêmement optimiste de non-linéarité. Ils évaluent en effet le coût total de la réduction des émissions en multipliant le coût actuel de réduction d’une tonne de CO2 par la quantité totale de réduction fixée comme objectif. Mais les procédés que l’on peut introduire à moindre coût aujourd’hui risquent de se révéler impossibles à mettre en œuvre – ou beaucoup plus coûteux – à plus grande échelle. Ted Trainer (2007, 2008) insiste particulièrement sur les limites physiques, plutôt qu’économiques, à l’extension possible des procédés disponibles et en conclut à la non-soutenabilité de la société de consommation.
Graphique 2 – Taux de profit et économies d’énergie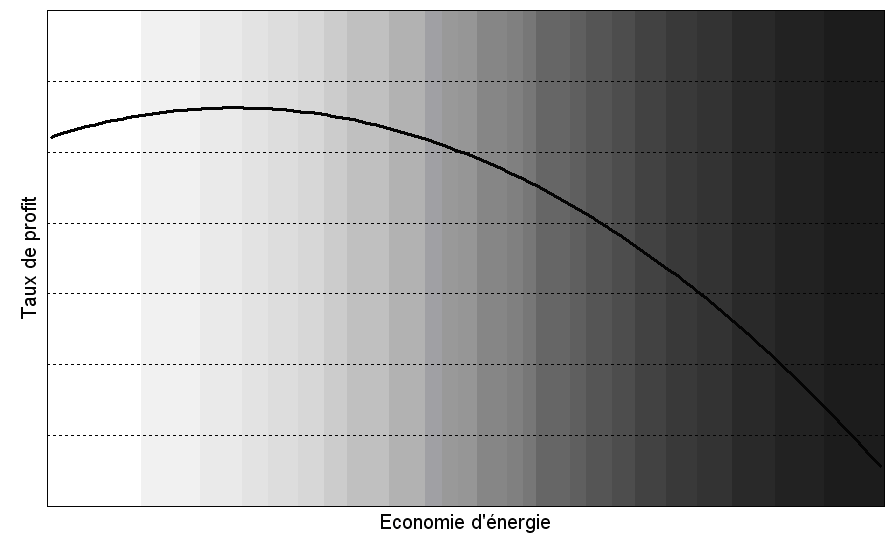
La structuration de l’économie mondiale
Ces considérations sur le taux de profit ne font pas le tour de la question. L’un des grands apports de la théorie des ondes longues est de montrer que le maintien d’un taux de profit élevé suppose un certain nombre d’arrangements techniques, sociaux et institutionnels. On a vu que l’un des éléments clé de cet ensemble de conditions porte sur les modalités de la concurrence qui s’exerce entre capitaux mais qui admet aussi une dimension géographique. C’est d’ailleurs une condition essentielle d’existence d’un « capitalisme vert » : il faut que la nouvelle norme introduite par l’écotaxe ou le marché des permis d‘émission soit établie de manière universelle, à l’échelle planétaire. Dans le cas contraire, on verrait apparaître toute une série d’effets pervers mettant en cause à la fois l’une des règles fondamentales de fonctionnement du capitalisme (la concurrence sur un marché mondial) et la réalisation des objectifs environnementaux.
Imaginons par exemple une écotaxe qui ne soit effectivement appliquées que dans certains pays et pas dans d’autres. La concurrence entre les entreprises installées dans ces différents pays serait faussée et conduirait à des relocalisations vers les pays « hors taxe » où l’incitation à mettre en place des technologies vertes serait nulle ou inférieure. Les mêmes effets pervers peuvent se concevoir, encore plus facilement peut-être, dans le cas des marchés de permis d’émission.
Certains imaginent une issue partielle à ces contradictions qui passerait par la croissance des débouchés offerts par les pays émergents. Ils imaginent une configuration relativement stable de l’économie mondiale, où le bouclage se ferait de la manière suivante : les pays avancés vendraient de la technologie verte aux pays émergents et leur achèteraient les marchandises à bas prix produites de manière croissante avec ces nouvelles technologies. Mais cela suppose que soit instaurée une instance de régulation à l’échelle mondiale. Toutes les questions soulevées précédemment, notamment à propos de la concurrence, se déploient à l’échelle du marché mondial.
De plus, le renchérissement du coût de l’énergie va augmenter les coûts de transport et ralentir le degré d’intensification des échanges qui contribue aux baisses de coûts. Là encore, on voit apparaître une contradiction entre l’objectif de profit maximum et celui de réduction des dépenses d’énergie.
La question des débouchés
L’obtention d’un taux de profit potentiellement élevé est une condition nécessaire mais non suffisante de la mise en place d’un régime d’accumulation cohérent. Il faut encore que la structure de la demande soit adéquate. Se pose alors la question de la reproduction : comment écouler la production verte ? Le profit doit en effet être réalisé, autrement dit la production doit être vendue. L’« ordre productif » associé à une nouvelle phase expansive doit également traiter cette question des débouchés.
Sur ce point, le capitalisme vert ne peut qu’enregistrer des difficultés supplémentaires. Du côté de la demande, la volonté de maintenir le taux de profit par un ajustement sur les salaires, va tendre à rétrécir relativement la demande salariale disponible. Du côté de l’offre, sa composition va changer, au moins transitoirement, dans le sens d’une croissance plus rapide de la section « verte » des moyens de production qui devrait trouver des débouchés dans les investissements verts réalisés par les autres branches. Un tel schéma où l’on assiste à une auto-croissance de la section 1 n’est pas indéfiniment viable, et on retrouve ici le risque que la croissance du capital fixe vienne peser sur la rentabilité.
Par ailleurs, le prix des marchandises vertes aura tendance, au moins dans un premier temps, à augmenter et donc à réduire la capacité d’absorption de la demande salariale. Elle conduira aussi à réorienter la demande vers des services moins coûteux en énergie mais moins susceptibles de gains de productivité élevés et donc de profits. De manière encore plus importante encore, la logique de réduction des dépenses d’énergie devrait conduire à la fabrication de biens « durables » et à un ralentissement de la vitesse de circulation du capital. Mais celle-ci est contradictoire avec le soutien au taux de profit qui passe aujourd’hui par le raccourcissement de la durée de vie des biens produits.
Le capitalisme vert est un oxymore
La théorie des ondes longues insiste sur deux aspects centraux du capitalisme : son historicité et sa nature de modèle social global. Son utilisation permet donc de balayer l’ensemble des conditions de viabilité d’un régime d’accumulation spécifique d’une phase de l’histoire du capitalisme. Elle conduit à quelques conclusions générales.
Sur le plan « strictement économique » il est possible d’imaginer un capitalisme vert compatible avec le maintien du taux de profit. Mais rien ne garantit que cette compatibilité soit assurée pour des niveaux d’économie d’énergie correspondant aux objectifs requis. Il faudrait postuler la possibilité de gains de productivité élevés et durables dans les branches produisant les technologies vertes qui rendraient viable un « fordisme vert » où ces gains de productivité compenseraient les coûts initiaux et permettraient (à condition de supposer que la part des salaires cesse de baisse, voire remonte au détriment des rentes financières) de garantir une croissance correspondante des débouchés salariaux. Dans le cas contraire, bien plus vraisemblable, on irait vers un capitalisme verdi plutôt qu’un capitalisme vert.
Le scénario du capitalisme vert suppose que l’on impose au capitalisme des règles qui ne lui sont pas naturelles. Sur bien des points, un tel scénario entre en contradiction avec les mécanismes fondamentaux de ce mode de production. L’introduction massive d’une écotaxe perturberait profondément le principe de concurrence entre capitaux individuels, elle freinerait la rotation du capital et ne déboucherait pas sur une structuration stable de l’économie mondiale.
Fondamentalement, l’hypothèse du capitalisme vert suppose un « choc exogène » brutal qui viendrait bouleverser profondément la configuration actuelle du capitalisme. Elle suppose en outre l’existence d’une instance planétaire assurant un degré accru de centralisation et l’édiction de normes mondiales qui vont, encore une fois, à l’encontre de l’essence concurrentielle du mode de production capitaliste.
Le capitalisme vert est donc un oxymore. L’hypothèse d’un tel régime d’accumulation repose sur une mauvaise compréhension des lois du capitalisme et sur une surestimation de sa capacité à faire face de manière rationnelle au défis environnementaux. Cette conclusion négative permet de pointer les spécificités d’une alternative éco-socialiste. Elle implique une planification à l’échelle mondiale et une remise en cause des modes de production et de consommation adéquats à la logique capitaliste. En termes économiques, cette alternative revendique une baisse significative du taux de surplus social ou en tout cas une transformation profonde de son contenu. Pour ne prendre qu’un exemple, la durabilité accrue des biens de consommation est en soi un facteur de baisse de la rentabilité.
*
Article paru dans Contretemps n°1 (nouvelle série), janvier 2009.
Références
David M. (2007), « Politique environnementale et politique de la concurrence », Économie et Prévision n°178-179.
http://gesd.free.fr/a125138.pdf
Husson M. (2007), La théorie des ondes longues et le capitalisme contemporain, mai.
http://hussonet.free.fr/mandel07.pdf
Insee (1981), Le mouvement économique en France 1949-1979.
Mandel E. (1995), Long waves of capitalist development, deuxième édition révisée, Verso.
Ministère de l’économie (1997), L’énergie en France.
http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/pdf/reperes.pdf
Trainer T. (2007), Renewable Energy Cannot Sustain A Consumer Society, Dordrecht, Springer.
Trainer T. (2008), « A short critique of the Stern Review », real-world economics review, n°45.
http://www.paecon.net/PAEReview/issue45/Trainer45.pdf
Villa P. (1994), Un siècle de données macro-économiques, INSEE Résultats n°303-304.
http://www.cepii.fr/francgraph/bdd/villa/mode.htm







