
De l’usine globale à la mine planétaire. Entretien avec Martín Arboleda
Le capitalisme du XXIe siècle est devenu essentiellement « extractiviste » : diverses dynamiques qui étaient propres à la production primaire trouvent aujourd’hui une réplique dans d’autres secteurs de l’économie. Cela rend nécessaire de procéder à une lecture élargie de l’extractivisme.
***
Nous savons que les minéraux arrachés à la terre se retrouvent dans nos appareils électroniques et de haute technologie. Mais cela ne désigne que des points de départ et d’arrivée. Pour analyser le parcours complet nous devons en saisir le mouvement en partant des sites d’extraction, et en suivant le cheminement jusqu’aux usines chinoises où sont manufacturés les produits qui retournent sur les mêmes sites de production primaire au Chili, en Argentine, au Brésil et dans le monde entier, dans un déploiement d’intelligence artificielle, de big data et de robotique à rendre jaloux Google lui-même.
C’est ce monde qu’analyse Martín Arboleda dans son livre Planetary Mine: Territories of Extraction under Late Capitalism (Verso, 2020), une des grandes nouveautés éditoriales et une analyse fondamentale pour qui veut comprendre le capitalisme contemporain. Pour Arboleda, le système de « mine planétaire » est le produit d’une double transformation globale du mode de production capitaliste : une nouvelle géographie de l’industrialisation tardive, dont l’axe se déplace vers le Pacifique, et un processus inédit d’intégration par ce qu’on désigne sous le nom de « révolution logistique ». L’extractivisme déborde alors les limites du secteur primaire à proprement parler et projette sa logique dans les technologies numériques, les systèmes logistiques, le secteur immobilier et financier, etc.
Penser en termes de « mine globale » ou de « mine planétaire », d’après lui, exige de développer des mécanismes théorico-méthodologiques pour pouvoir saisir les rapports d’interdépendance de l’économie globale. C’est également l’occasion d’attirer l’attention sur un problème à caractère politico-stratégique de premier ordre : la nécessité de redoubler d’efforts pour dépasser la fragmentation de la subjectivité productive des classes laborieuses.
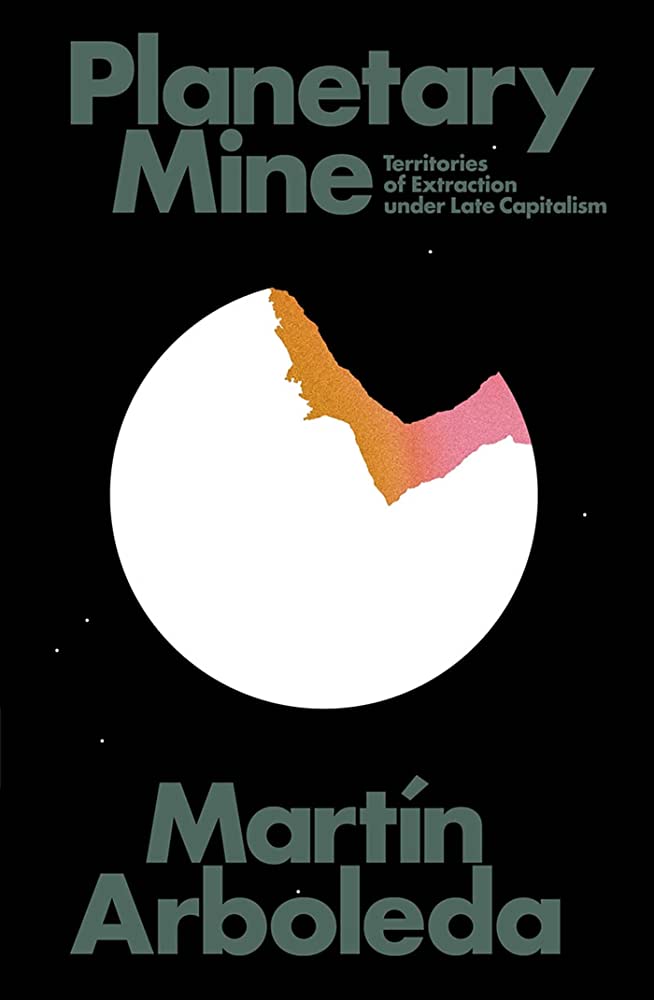
Nicolas Allen : Il me semble que l’un des éléments les plus subversifs de ton livre tient à ce qu’il nous conduit à penser l’industrie extractive comme partie intégrante du capitalisme industriel, alors qu’elle est traditionnellement considérée comme quelque chose d’extérieur à l’industrie manufacturière. En quoi l’extractivisme détermine-t-il le modèle d’accumulation actuel ?
Martín Arboleda : Affirmer que le processus extractiviste déborde la sphère extractive peut paraître une vérité de la Palice. La plupart des analyses en la matière se limitent à l’étude des rapports qui s’établissent entre une entreprise, l’État et la communauté d’un territoire délimité. Elles permettent souvent d’en comprendre la nature mais sans prendre en compte le fait que la mine, le puits de pétrole ou l’exploitation agroindustrielle ne sont que le point de départ d’un vaste réseau de rapports sociaux et d’infrastructures socio-techniques qui s’étendent souvent à une partie considérable de la planète. Ces études partent bien des prémisses que la production primaire est globalisée, mais elles ne recherchent pas les mécanismes, réseaux, flux et rapports de pouvoir qui rendent possible cette globalité.
En d’autres termes, cela revient à prendre pour acquis ce qu’il faudrait précisément expliquer. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu’on appelle le supercycle des matières premières en Amérique latine sans comprendre, au préalable, comment la reconfiguration de l’industrie électronique (aux mains d’entreprises comme Apple, Microsoft, Foxconn, Huawei, etc.) a ouvert la possibilité d’un nouveau paradigme d’organisation industrielle et d’urbanisation qui influe directement sur les logiques et les stratégies d’extraction des ressources naturelles dans la région. Ce paradigme industriel, communément appelé « wintelisme », repose sur une nette séparation fonctionnelle de la conception et de la fabrication dans la production des appareils électroniques.
Cette séparation entre la conception et l’exécution dans la chaîne de production a stimulé à son tour la spécialisation et l’intégration verticale de l’industrie manufacturière en Asie, donnant naissance à des systèmes de production qui opèrent à une échelle gigantesque, comme en témoigne l’impressionnant travail photographique d’Edward Burtynsky. La plus grande usine de Foxconn à Shenzhen comptait près de 400 000 employés à son apogée, soit quatre fois plus que le complexe industriel River Rouge de Ford aux États-Unis. Cette extension de l’échelle industrielle s’est naturellement traduite par une augmentation exponentielle de la demande de ressources ainsi que du type de ressources requis. Rappelons-nous qu’un smartphone de dernière génération peut contenir jusqu’à trente minéraux différents. À soi seul cela réclame une chaîne d’approvisionnement mondiale hautement sophistiquée qui puisse connecter ces usines mondialisées à de multiples espaces d’extraction à travers le monde.
Mais l’un des phénomènes qui rend particulièrement urgent de penser l’extractivisme en termes de phénomène interconnecté est peut-être ce que l’on peut considérer comme un « tournant logistique » dans les industries extractives. Avec l’essor d’une nouvelle division internationale du travail structurée autour des économies asiatiques, les très grandes distances sur lesquelles sont transportés les minerais ont conduit à une modernisation technologique de la chaîne logistique afin d’éliminer asymétries d’information et inefficacités entre les différents maillons.
Au cours des trois dernières décennies du XXe siècle, le Japon, la Corée du Sud et la Chine ont développé de nouvelles avancées technologiques dans le transport maritime et les infrastructures portuaires, qui ont permis une réduction importante des temps d’acheminement des matières premières à travers l’océan Pacifique. Par la suite, la mise en œuvre de technologies de traçabilité du minerai et de cartographie des chaînes d’approvisionnement a généré un processus plus systématique et sophistiqué d’intégration fonctionnelle entre la production primaire, le système portuaire et le transport, tant terrestre que maritime.
Les opérations minières n’ont plus comme préoccupation première les effondrements provoqués par l’excavation et l’exploitation à ciel ouvert : il s’agit maintenant de se focaliser également sur la vitesse de circulation, l’homéostasie des systèmes logistiques et le flux ininterrompu des minéraux. La thèse de Planetary Mine consiste à affirmer que ce processus d’intégration logistique dans la chaîne extractive exige un travail conceptuel permettant simultanément d’élargir et de complexifier le cadre conceptuel dans lequel la production primaire est traditionnellement analysée ainsi que ses liens avec d’autres secteurs de l’économie.
N. A. : Les technologies du transport ont toujours eu une incidence plus ou moins directe sur l’organisation industrielle. Je pense à l’eau où les progrès technologiques ont permis l’utilisation de la vapeur, ou plus tard au gaz, qui ont entraîné une double réorganisation tant dans la forme de production manufacturière que dans le transport des marchandises. Tu préconises d’étendre cette idée à la production primaire, n’est-ce pas ?
M. A. : Exactement. Tout au long de l’histoire moderne, les systèmes de transport ont joué un rôle important dans l’innovation technologique pour permettre l’accès aux ressources naturelles géographiquement éloignées. Les grandes entreprises économiques ont dû mettre au point des techniques de transport et de navigation de plus en plus efficaces pour réduire les coûts de transport et, partant, préserver leur hégémonie commerciale. On peut mentionner par exemple les brigantins utilisés par l’Espagne pour transporter l’or et l’argent à travers l’Atlantique au XVIe siècle, le fluyt hollandais pour transporter le bois au XVIIe siècle, la mécanisation des navires utilisés par l’Empire britannique pour transporter le guano et le caoutchouc depuis l’Amazonie au XIXe siècle ou encore aujourd’hui le Valemax, le plus grand cargo jamais construit, qui transporte du fer du Brésil vers la Chine à travers l’océan Pacifique.
Mais ce qui fait de la révolution logistique de ces dernières décennies un phénomène historiquement unique, c’est que les limites séparant le transport d’autres types d’activités productives sont devenues floues. Traditionnellement, la logistique était réduite au transport et au stockage. Mais plusieurs innovations technologiques récentes lui ont permis de se réinventer en tant que science de la circulation générale, visant à la gestion intégrée de la chaîne d’approvisionnement en tant que système global.
À mon avis, l’une des grandes contributions des études critiques de la « révolution logistique » est le fait qu’elles soulignent l’importance croissante de la sphère de la circulation dans le processus d’accumulation du capital. Le fait que des entreprises comme Walmart et Amazon, dont le business est éminemment logistique, soient considérées comme le fer de lance d’un nouveau paradigme d’organisation industrielle au XXIe siècle, témoigne de l’importance de la circulation dans l’économie mondiale.
La politique de la circulation a justement pour enjeu la possibilité de contribuer au développement d’une théorie élargie de l’extraction. Mon travail part d’une analyse critique de la circulation du capital qui comprend la production, la circulation, la distribution et la consommation comme des moments distincts d’un processus unique de transformation socio-métabolique. Penser de façon critique la circulation du capital implique à son tourde faire de la valeur une instance méthodologique pour comprendre l’interdépendance. L’accent méthodologique mis sur la valeur nous rappelle que la mine est un produit du travail humain et qu’il est donc nécessaire d’analyser la réalité quotidienne des différentes catégories de travailleurs (qu’ils soient salariés ou non) ainsi que l’organisation technologique et productive des sites d’extraction.
L’importance de se focaliser sur la valeur dans l’analyse des processus d’extraction tient aussi au fait que, comme Marx le met en évidence dans les Grundrisse, le capital est une « valeur en cours ». De ce point de vue, la valeur est une entité dynamique qui est créée dans le processus de production mais ne se réalise que dans l’économie de marché grâce à des processus et des pratiques qui se situent au-delà de la relation capital-travail (et qui impliquent des activités de conditionnement, de transport, de stockage, de financement, de capitalisation de rente, de commercialisation, de consommation).
Il ne sert à rien d’avoir accès à un gisement si l’on ne dispose pas des technologies nécessaires pour l’exploiter de manière rentable. Il ne sert à rien non plus d’extraire des minéraux si ceux-ci ne peuvent pas être mis sur le marché rapidement et en toute sécurité. En outre, si les minerais sont vendus sur le marché et qu’une partie des bénéfices n’est pas réinvestie dans le processus de production, le risque est de succomber à la concurrence entre les entreprises et aux progrès technologiques. Cette « valeur en cours » doit donc être réalisée sur le marché pour devenir une réalité et assurer les fonctions du capital. La valeur doit transiter de manière constante entre ses différentes phases ou modes d’existence, sous peine d’être dévaluée, détruite ou rendue obsolète. Comprendre la valeur en termes de potentialité qui acquiert une existence concrète dans la sphère de la circulation est, à mon avis, une stratégie méthodologique fructueuse pour rendre visible la géographie élargie de l’extraction.
Ce déplacement de la dynamique d’accumulation vers la circulation a suscité un intérêt inhabituel dans le tome II du Capital, dans lequel Marx, dépassant une conception plus restreinte du processus de production de marchandises, analyse la réalisation de la valeur en termes de processus par nature tumultueux, sujet à différents épisodes de crise et de perturbation. Dans les industries extractives, l’élargissement et la complexification de la sphère de la circulation ont évolué conjointement à sa politisation croissante. On pourrait même dire que certaines des formes émergentes de lutte et de mobilisation sociale qui affectent le plus l’extraction aujourd’hui relèvent du domaine de la circulation (les installations portuaires, les oléoducs, les voies ferrées, les autoroutes, les supermarchés, les couloirs terrestres ou maritimes, etc.). Les goulets d’étranglement des chaînes d’approvisionnement mondiales, aussi appelés choke points, sont ainsi devenus des espaces clés du nouveau paysage de la lutte territoriale et de l’insurrection globale au XXIe siècle.
N. A. : Quels sont les points principaux qui rendent nécessaire cette nouvelle approche des industries extractives ?
M. A. : Le principal tournant historique qui rend nécessaire une compréhension unifiée du processus global d’accumulation du capital est peut-être ce qu’on appelle la Nouvelle Division Internationale du Travail (NDIT). La NDIT a fait des économies d’Asie de l’Est le centre gravitationnel d’un nouveau système mondial structuré autour de l’océan Pacifique. Cet événement géohistorique sans précédent dans l’histoire moderne a bouleversé la géométrie du pouvoir d’un système mondial qui, depuis le XVIe siècle, s’était organisé autour de l’océan Atlantique avec les puissances européennes et les États-Unis.
Avec la NDIT, le système capitaliste s’élargit et se complexifie. Par voie de conséquence, le modèle traditionnel d’une économie capitaliste organisée autour des puissances occidentales et des périphéries non occidentales entre en crise. En ce sens, une des contributions importantes de la théorie de la NDIT consiste à souligner le fait que le capitalisme n’est pas un phénomène « occidental ». Sa phase occidentale ne serait que la longue préhistoire d’une formation sociale qui a pris aujourd’hui un caractère véritablement global. Pour Marx, l’unicité globale du capital – sous la forme d’un marché mondial – n’était qu’une question abstraite qu’il devait traiter dans le tome V du Capital, qu’il n’a jamais écrit. Aujourd’hui, cependant, la réalisation concrète de ce marché mondial que Marx avait anticipé soulève d’importants défis politiques et théorico-méthodologiques.
N. A. : Là où certains voient dans l’ascension de la Chine l’émergence d’une nouvelle superpuissance mondiale ou l’émergence d’un ordre mondial multipolaire, tu penses pour ta part qu’il s’agit d’une forme supérieure, plus « pure », du capitalisme. Quelles en sont les implications pour l’avenir de l’impérialisme ?
M. A. : Oui, en effet. L’une des implications importantes de la NDIT, dont le point culminant a été l’ascension de la Chine au début de ce siècle, est que cela met en tension le modèle des cycles systémiques d’accumulation qui a placé chaque période de développement capitaliste sous la conduite d’une économie hégémonique (les empires ibériques au XVIe siècle, le royaume des Pays-Bas au XVIIe siècle, l’Angleterre aux XVIIIe et XIXe siècles et les États-Unis au XXe siècle). Le déplacement de l’axe de l’économie mondiale vers l’océan Pacifique est un événement géohistorique d’une telle ampleur qu’il est peu probable que puisse se perpétuer le schéma de dynamiques interétatiques qui a marqué l’ère occidentale du capitalisme. C’est, notamment, la conclusion à laquelle est parvenu Giovanni Arrighi dans son livre Adam Smith à Pékin, publié peu avant sa mort en 2009, dans lequel il remet en question le schéma des cycles systémiques qu’il avait lui-même élaboré.
L’ascension de la Chine a donné lieu à divers événements qui ont été qualifiés d’impérialistes, tels les différends territoriaux qui ont concerné le mégaprojet d’infrastructure Belt and Road (également connu sous le nom de « Nouvelle route de la soie »), le port de Gwadar au Pakistan ou encore les installations minières chinoises en Afrique, pour ne citer que quelques exemples. La première chose que l’on observe est que les visées chinoise ne sont pas de nature militaire ni d’occupation territoriale (comme ce fut le cas pour les puissances européennes), mais qu’elles ont plutôt une dimension essentiellement commerciale. Pour des auteurs tels Parag Khanna cette vocation mercantiliste de la Chine se manifeste dans le fait que ce pays ne cherche pas à occuper d’autres pays, mais à assurer l’acheminement de marchandises à travers leurs territoires. Le fait que la Chine agisse dans une logique plus mercantiliste que territoriale suggère que nous sommes peut-être confrontés à une rupture du réseau des relations interétatiques qui était le propre des puissances européennes.
En Amérique latine, par exemple, certains ont considéré que le Consensus de Washington avait été remplacé par un « Consensus des Commodities » qui aurait placé la Chine au centre des relations historiques de dépendance. Bien que cette affirmation formule une hypothèse très importante, je crois que l’extrapolation mécanique des réalités anglo-européennes au contexte latino-américain doit être prise avec plus de prudence, car elle risque d’ignorer la spécificité du contexte actuel. On peut mentionner, par exemple, les études concernant l’agriculture de ces régions, publiées dans des revues spécialisées, qui montrent que l’idée d’une « appropriation des terres par l’étranger » (que ce soit la Chine ou les banques d’investissement des puissances du Nord) n’a pas de fondement empirique concret et obéit surtout à des élucubrations et à des outrances journalistiques concernant l’investissement chinois dans la région.
En fait, les données empiriques semblent indiquer qu’une grande partie des récents accaparements de terres dans la région est due à l’activité de compagnies nationales ou de compagnies « translatines » ou « multilatines » qui acquièrent des terres dans les pays voisins. Cette réalité met de facto en cause les thèses « étatico-centriques » de l’extraction des ressources en Amérique latine et souligne également le rôle (tout aussi important) des bourgeoisies nationales. Elle met aussi à rude épreuve les thèses « étatistes » sur la nature de l’impérialisme et appelle de nouvelles perspectives qui, comme l’a écrit Jeffery Webber, permettraient de rendre compte de la « stratification complexe » qui caractérise le système mondial du capitalisme tardif.
N. A. : Nous abordons sans doute là l’un des thèmes les plus complexes mais aussi les plus intéressants de Planetary Mine, qui est la façon dont le système de concurrence interétatique pourrait perdre de sa validité alors que l’impérialisme est toujours en vigueur.
M. A. : Je pars de l’idée que l’impérialisme est, à un niveau systémique, une expression politique de la tendance à l’augmentation de la composition organique du capital, autrement dit le rapport du capital fixe au capital variable, ou encore des machines au travail humain. Cette conception se nourrit principalement de la théorie de la reproduction élargie développée par Rosa Luxemburg dans L’Accumulation du capital. L’augmentation de la productivité par la production d’une plus-value relative non seulement accroît la demande de ressources naturelles dans les économies manufacturières, mais sature également les marchés de consommation nationaux.
À cet égard, le processus de reproduction élargie crée des pressions systémiques qui sont en-deçà de l’autorité politique de l’État, car elles résultent justement du processus d’accumulation. L’un des aspects pertinents des théories de l’impérialisme développées par les auteurs de la Deuxième Internationale (comme Luxemburg, Lénine, Hilferding, etc.) est précisément le fait qu’ils se sont détachés des théories purement politiques de l’impérialisme et ont développé des explications de ce phénomène qui mettaient davantage l’accent sur ses aspects économiques et systémiques.
En d’autres termes, la contribution de ces théories a consisté à déchiffrer les forces économiques qui sous-tendent ce qui, en surface, semblait être des stratégies étatiques supposées autonomes. C’est précisément cette même intuition qui, par exemple, a conduit Hannah Arendt à définir l’impérialisme moderne comme « l’émancipation politique de la bourgeoisie » à travers un dédoublement de l’État dans son essence politique. Aujourd’hui, nous assistons à une exacerbation des dimensions traditionnelles de l’impérialisme telles que la spoliation par la force des populations rurales, un recours croissant à la violence extra-économique pour contenir le mécontentement et la révolte sociale ou encore l’extermination des communautés autochtones et des défenseurs de l’environnement, entre autres. Cependant, y voir pour causalité directe la Chine ou toute autre puissance étatique, comme c’était le cas à d’autres époques, devient de plus en plus difficile. Cela implique la nécessité de repenser l’impérialisme ou, plus précisément, de mettre à l’épreuve les conceptions plus conventionnelles de ce phénomène qui partent du présupposé que l’État en est l’élément primordial.
La militarisation, comme l’a bien saisi Raúl Zibechi dans un essai récent, est la phase avancée de l’extractivisme. Cependant, cette militarisation ne se produit plus dans un cadre de relations discernables entre États antagoniques, mais se présente essentiellement comme un mécanisme propre à chaque État lui permettant de contrôler sa propre population face aux besoins systémiques du processus de reproduction élargie. Dans le langage de l’intelligentsia économique, tant néolibérale que néo-développementiste, les besoins systémiques découlant de la production de la plus-value relative à l’échelle planétaire doivent être compris comme un impératif pour assurer le « progrès », le « développement » et la « croissance économique ». Comme plusieurs études l’ont montré, ces discours sur le progrès sont souvent très largement compatibles avec les pratiques d’expulsion, voire même d’extermination des populations dans les zones d’extraction.
N. A. : L’État-nation serait donc une forme, de plus en plus rigide et autoritaire, comme tu le soulignes, dont le fondement résiderait dans l’économie mondiale. Si je comprends bien, tu as ici recours à une approche théorique particulière que l’on appelle l’« analyse de formes ».
M. A. : Un aspect très important de ce courant de pensée est qu’il remet en question la séparation méthodologique entre le politique et l’économique propre à des variantes plus structurelles du marxisme. Les reconstructions hégéliennes de l’œuvre de maturité de Marx postulent que l’État libéral ne constituerait pas une sphère indépendante ou d’« autonomie relative » (pour reprendre les termes d’auteurs comme Althusser ou Poulantzas) du processus d’accumulation, mais plutôt une forme fétichisée ou le mode d’existence d’un contenu sous-jacent, qui comprend les relations sociales dans leur matérialité concrète.
Cette compréhension dialectique de l’État offre une alternative aussi bien aux lectures « hyperglobalistes », qui proclament l’érosion de la souveraineté de l’État-nation devant la force écrasante des compagnies transnationales et du capital financier (c’est le cas des théories sociologiques de la globalisation apparues avec des auteurs comme Manuel Castells, Zygmut Bauman, Michael Hardt et Antonio Negri, entre autres) qu’aux lectures « politicistes » qui voient dans le système mondial le résultat direct des relations conflictuelles entre États-nations supposément autonomes (comme c’est le cas, par exemple, de certaines théories de la dépendance, de l’échange inégal et de l’impérialisme).
Pour Werner Bonefeld, l’État moderne est « la forme politique de la liberté de marché ». En Amérique latine, cette lecture hégélienne et dialectique de l’État capitaliste a été développée initialement dans l’ouvrage de référence d’Enrique Dussel Vers un Marx inconnu, puis par Juan Iñigo Carrera. Pour Iñigo Carrera, les dynamiques qui sous-tendent la NDIT seraient globales quant à leur contenu et nationales quant à leur forme. C’est précisément cette lecture de l’État capitaliste qui, à mon avis, permet de saisir la façon dont l’État néolibéral, toujours plus autoritaire et emmuré, et l’ordre mondial fonctionnellement intégré par des chaînes d’approvisionnement ont besoin l’un de l’autre.
N. A. : Notre discussion porte sur une théorie élargie de l’extraction. L’extraction est effectivement un terme utilisé aujourd’hui à propos de divers types d’exploitation qui se réalisent en dehors des sites de production à proprement parler. Y a-t-il des considérations stratégiques, comme celles qu’ont développées certains courants féministes à propos de l’extraction financière, qui découlent de ta théorie d’une « mine globale » ?
M. A. : Ce que des auteurs tels Mariarosa Dalla Costa et Antonio Negri ont défendu à l’époque, c’est que la production capitaliste a débordé l’espace individuel de l’usine et commencé à se répandre dans tout le tissu social : dans les foyers, dans les écoles, dans l’art et la culture populaires. De même, aujourd’hui, nous pouvons observer comment l’extractivisme commence à déborder les limites du secteur primaire proprement dit et à projeter ses logiques et ses relations sociales sur les technologies numériques, les systèmes logistiques, ou encore le secteur immobilier et financier.
Penser en termes d’une mine globale ou d’une mine planétaire implique précisément de développer des outils théoriques et méthodologiques pour pouvoir saisir ces relations d’interdépendance dans l’économie globale. Cela implique un retour critique sur l’étude des circuits de capitaux, des chaînes globales de marchandises, de l’analyse des systèmes-monde et d’autres approches connexes qui permettent précisément de comprendre ce réseau complexe de processus qui relient des mines, des ports, des cargos, des usines, des bourses de valeur et des espaces de consommation de masse.
Mais le concept d’une mine globale inclut aussi une problématique de caractère politico-stratégique essentielle et postule une tentative de surmonter la fragmentation de la subjectivité productive des classes laborieuses qui tendent à réduire l’extractivisme à un problème de « communautés locales » et qui ignorent la réalité des travailleuses et des travailleurs, non seulement dans les mines, mais aussi dans d’autres maillons de la chaîne logistique. En ce sens, cette approche s’inspire du livre classique Patriarcat et Accumulation à l’échelle mondiale, dans lequel Maria Mies établit que la nature fétichiste de la marchandise capitaliste tend à invisibiliser les relations de médiation sociale, la femme productrice dans les usines du Sud Global et la femme consommatrice du Nord Global de plus en plus appauvrie n’étant que deux faces d’une même pièce.
Cette opacité est également patente aujourd’hui avec cette fragmentation qui rend difficile la compréhension de la façon dont les communautés indigènes et paysannes de l’espace extractif sont reliées aux espaces de logistique, de fabrication et de consommation dans d’autres parties du monde. Mettre au jour la manière dont les différents espaces de la division de genre et de la division internationale du travail sont corrélés n’était pas, pour Maria Mies, un problème purement théorique mais avant tout un problème de stratégie socialiste. C’était la condition pour pouvoir imaginer et construire un véritable internationalisme des masses laborieuses.
N. A. : Dans une certaine mesure, c’est le vieux dilemme de la socialisation croissante du travail et de la fragmentation concomitante de la classe ouvrière… Pourrait-on dire que les nouvelles dynamiques d’extraction dont nous discutons ici sont porteuses de la possibilité d’une nouvelle subjectivité révolutionnaire ?
M. A. : Il n’est pas imaginable que l’impressionnant processus d’intégration fonctionnelle qui s’est présenté dans la chaîne extractive n’ait pas eu son propre corollaire politique. L’importance croissante due la sphère de la circulation dans l’accumulation du capital a entraîné de nouvelles confrontations tant territoriales que politiques. Ce n’est pas seulement le fait que la révolte sociale ait débordé les sites de production et qu’elle s’étende désormais plus largement à tout le tissu social. L’une des particularités des crises du XXIe siècle est qu’elles ont fait renaître l’ancienne figure du mouvement de masse.
Le mouvement féministe est peut-être l’exemple le plus paradigmatique de ce paysage émergent de la révolte sociale car, comme l’a affirmé Veronica Gago, c’est un mouvement qui se distingue parce qu’il combine massivité et radicalité. Il en va de même pour le mouvement Black Lives Matter ou celui pour la justice climatique, qu’incarne Greta Thunberg, qui s’en prend aux deux grands piliers de l’économie capitaliste : la croissance infinie et les industries fossiles.
Cette interdépendance croissante et cette socialisation du travail imposent de comprendre la subjectivité révolutionnaire comme une subjectivité socialement médiatisée. Traditionnellement, on a eu tendance à penser que les fondements de l’action transformatrice consciente se trouvaient dans des éléments culturels (la dignité ou le courage particuliers d’un peuple), moraux (l’idéal de la liberté ou de l’égalité) ou transhistoriques (la solidarité intrinsèque des communautés primitives) de la vie sociale. Bien que ces lectures soient pertinentes, elles ne prennent pas en compte les capacités transformatrices qui se développent au sein même de l’évolution globale du capitalisme.
C’est peut-être l’une des conclusions les plus importantes auxquelles Marx est parvenu dans ses écrits ethnologiques tardifs sur les communautés archaïques. Dans les « Cahiers Kovalevsky » et dans les brouillons de sa lettre à Véra Zassoulitch en 1881, Marx ébauche une remise en question de l’idée que le prolétariat industriel puisse être « la sage-femme de l’histoire ». Il cherche à identifier dans les sociétés primitives et non occidentales une série de composants essentiels et de potentialités qui pourraient définir une civilisation post-capitaliste avancée. Mais les rapports sociaux des communautés archaïques sont restés limités à une existence paroissiale en raison de l’état de leurs connaissances techniques. C’est un système complexe d’interdépendance sociale, comme celui qui s’est développé avec la science et la technologie capitalistes, qui permettrait la généralisation de ces relations à une échelle planétaire.
Dans ses écrits de jeunesse Álvaro Garcia Linera a, parmi d’autres, défendu l’idée que l’essence communautaire de la communauté archaïque pourrait trouver une nouvelle incarnation sous une forme supérieure grâce à l’échange métabolique global que rend possible la modernité capitaliste. La réapparition de cette forme communautaire archaïque aurait alors une dimension planétaire, précisément en raison de la socialisation du travail moderne. Cette forme supérieure de la société, l’« ayllu universel » pour Garcia Linera ou la « modernité ch’ixi » pour Silvia Rivera Cusicanqui, serait la conjugaison du communautaire et du planétaire. Je trouve intéressant que dans la nouvelle figure du mouvement de masse (qu’il soit féministe, antiraciste ou éco-socialiste) se reflète une nouvelle conscience planétaire d’où pourraient émerger les premières formes de ce qui pourrait devenir cet ayllu universel ou cette modernité ch’ixi.
Je crois, en définitive, que toute alternative réelle au capitalisme doit assumer la difficile mission d’élaborer une articulation plus nuancée entre l’ancien et le nouveau, afin de ne pas tomber dans les extrêmes d’un productivisme acritique ou d’une nostalgie de la société pastorale. De tels manichéismes interdisent de saisir les trajectoires civilisationnelles complexes, baroques et hétérogènes dans lesquelles, comme l’a écrit Bolivar Echeverría, la vie sociale peut rester moderne tout en étant radicalement alternative.
Concevoir une société qui puisse se construire autour de la valeur d’usage et de la reproduction sociale n’implique pas de renoncer aux possibilités offertes par la technique. La tradition éco-socialiste offre un important travail d’élaboration théorique visant à imaginer un type d’anticapitalisme qui soit technologiquement avancé et démocratiquement planifié (au travers d’interactions multiples entre communautés autogérées et instances techniques) mais qui, dans le même temps, respecte, préserve et restaure les limites naturelles de la planète et de ses équilibres biophysiques.
*
Titulaire d’un doctorat en Sciences politiques de l’Université de Manchester (Royaume-Uni) Martín Arboleda est professeur de sociologie à l’Université Diego Portales (Santiago du Chili). Auteur de Planetary Mine: Territories of Extraction Under Late Capitalism (Verso Books, 2020) et de Gobernar la utopía: sobre la planificación y el poder popular (Caja Negra Editora, 2021).
Cet article a d’abord été publié par Jacobin América Latina. Traduit par Robert March pour Contretemps.









