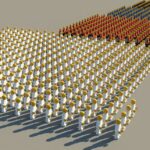À lire : un extrait de La démocratie des conseils, de Yohan Dubigeon
Yohan Dubigeon, La démocratie des conseils. Aux origines modernes de l’autogouvernement, Paris, Klincksieck, 2017
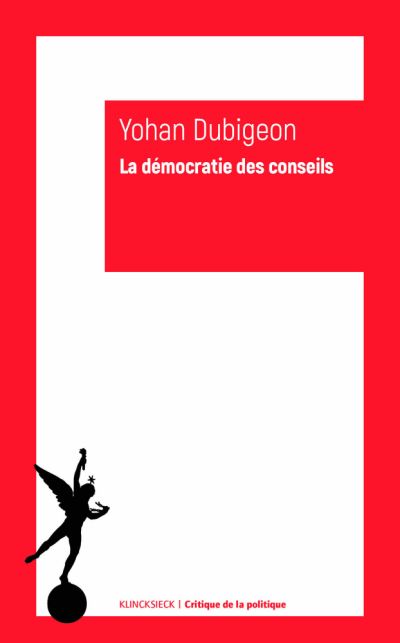
Le conseillisme, paradigme refoulé de la galaxie socialiste
Situer le « paradigme » des conseils à l’égard des courants de pensée qui occupent l’essentiel des réflexions de la science politique laisse le tableau incomplet. S’arrêter ici équivaudrait à passer à côté du terreau historique à partir duquel sont nés autant les conseils ouvriers que les courants de pensée s’en réclamant. Comprendre le sens politique de cette forme historique ne peut donc se faire qu’en partant des conseils eux-mêmes – ce qui est justement le point de départ de cette étude – et des courants d’idées desquels ils vont émerger avant d’être promus. Ce berceau théorique, c’est évidemment la pensée socialiste, au sens le plus large, dont la pensée des conseils fait partie.
Ce travail exige d’abord une précision sémantique. On parle ici de courant conseilliste en son sens le plus large, c’est à dire comme tradition de pensée qui s’est constituée au sein des courants révolutionnaires comme critique « de gauche » du léninisme, et ayant construit l’essentiel de son analyse à partir de l’expérience des conseils ouvriers, conçus comme contenu politique du socialisme. Mais les contours de ce courant de pensée, nous aurons l’occasion d’y revenir, restent larges et partiellement flous. Nous nous trouvons en effet face à une tradition qui, dès ses origines, est traversée par diverses querelles et contradictions compliquant singulièrement l’homogénéisation de ce courant politique. Cette diversité intrinsèque explique la faiblesse numérique et politique du conseillisme autant qu’il témoigne de sa fertilité théorique : c’est bien souvent dans les querelles qui structurent l’analyse de ce courant que se niche une épaisseur d’analyse sur laquelle nous tâcherons, au moins par bribes, de revenir. Ainsi, l’évolution historique et les divergences politiques propres à la pensée conseilliste nous amènent, en toute rigueur, à distinguer au moins deux grands pôles, dont nous reprenons l’identification à la très fine analyse de Philippe Bourrinet[1] : un pôle « communiste de gauche », et un pôle « communiste des conseils ». Sans entrer ici dans les détails, le second pôle ne se distingue historiquement au sein du premier qu’à partir des années 1930[2], au moment où un certain nombre d’analyses conseillistes convergent vers une radicalisation de ce qu’était le communisme de gauche depuis ses origines : le GIC[3] et ses théoriciens rejettent désormais toute organisation politique permanente, analysent le bolchevisme et la révolution russe comme bourgeois dès l’origine, et font de l’anti-substitutisme et de l’anti-léninisme la base de toute analyse politique ; caractéristiques qui rapprocheront très fortement ce conseillisme « strict » des courants anarchistes[4]. Critique à l’endroit de cette évolution historique, et marquant une différence très nette entre ces deux pôles, Philippe Bourrinet considère le pôle conseilliste – au sens strict – comme une dégénérescence du courant communiste de gauche. Il ne s’agit pas ici de commenter ces ramifications, ni de privilégier l’étude d’un des pôles sur l’autre. Comme Bourrinet le soulève lui-même, ces distinctions ne se font pas sans tâtonnements et allers-retours ; ce sont en partie les mêmes acteurs qui évoluent au cours de leur parcours militant ou intellectuel, parfois même plusieurs fois – comme ce sera le cas pour Pannekoek. Aussi, on parlera de courant conseilliste ou de conseillisme pour désigner ce courant au sens le plus large, en regroupant en son sein l’ensemble de ces divergences et contradictions sur lesquelles nous reviendrons.
Partant de là le conseillisme, en tant que courant de pensée fédéré derrière l’expérience des conseils, constitue bel et bien un paradigme ; avec ses dissensions internes, ses évolutions, ses contradictions parfois, mais un paradigme tout de même. Il y a une consistance propre au conseillisme, des éléments de définition et de cohérence suffisamment forts pour l’opposer, en tant que paradigme, à d’autres courants du socialisme. En outre, ce courant est d’autant plus essentiel à étudier qu’il apparaît comme largement sous-évalué dans l’histoire des pensées socialistes et marxistes, pour ne pas dire totalement refoulé. S’il y a évidemment des raisons historiques à cela – défaites successives des conseils ouvriers, disparition progressive du rôle des soviets en Russie, émiettement des groupes politiques conseillistes, poids de l’URSS dans la condamnation et la répression des courants révolutionnaires non léninistes – il n’en demeure pas moins essentiel à plusieurs titres de comprendre l’histoire et le positionnement de ce courant de pensée. D’abord parce qu’il reste justement une « zone d’ombre », mal connue et souvent maltraitée, et qu’il mérite donc en tant que tel d’être mieux interprété. Ensuite parce qu’autour de figures telles qu’Anton Pannekoek, Rosa Luxemburg pour partie, Herman Gorter, Karl Korsch, Paul Mattick, mais aussi plus récemment Castoriadis, le jeune Lefort ou Abensour, il compte des penseurs extrêmement profonds et fertiles, à la lisière du « courant chaud » du marxisme[5], du marxisme hétérodoxe ou critique[6], de la phénoménologie[7] ou encore de la philosophie politique critique[8] ; tous étant des démocrates convaincus – au sens le plus large – et centrés autour des thématiques de l’auto-émancipation politique. Enfin et peut-être surtout parce que le renouveau de mouvements sociaux contestataires centrés autour de thématiques proches de celles des conseils, nous amène à nous replonger dans le corpus qui a entouré son émergence, afin de mieux saisir ce qu’il peut apporter en retour pour nous aider à penser l’émancipation politique aujourd’hui.
Précisons enfin qu’il s’agit ici de comprendre les traits principaux par lesquels le geste conseilliste se distingue des autres courants de la pensée socialiste, et non de reconstituer en tant que telle l’histoire du courant conseilliste – travail déjà effectué de manière extrêmement précise et rigoureuse par ailleurs[9].
Face à la social-démocratie : contre le socialisme d’État
Le courant socialiste contre lequel se constitue la « gauche »[10] est évidemment la social-démocratie, entendu dans son sens postérieur à 1914. Les penseurs et militants se réclamant par la suite des conseils, s’inscrivent au début du siècle précédent dans les courants de gauche[11] de la social-démocratie, qui formeront à partir de la Première guerre mondiale le sillage communiste. La teneur des débats entre ces tendances de la jeune social-démocratie est évidemment immense ; nous n’en rappellerons ici que les grandes lignes.
La gauche social-démocrate apparaît dès les premières années du XXe siècle, autour des polémiques entre Pannekoek, Luxemburg et Lénine d’une part, Kautsky d’autre part[12]. Contre la primauté de la tactique parlementaire sur les actions de masse prônées par la majorité de la IIe Internationale – c’est à dire tant par la droite que par le centre de la social-démocratie représentés respectivement par Bernstein et Kautsky – la gauche fonde son schéma tactique sur la grève de masse et la valorisation de l’action spontanée extra-institutionnelle. Si l’on constate déjà des choix stratégiques différents selon les courants portés par cette gauche – rupture des bolcheviks russes, des radicaux allemands et des tribunistes hollandais avec les partis sociaux-démocrates contre le refus de scission des spartakistes allemands – c’est surtout l’attitude de la social-démocratie face à la première guerre mondiale qui achève d’unifier sa frange gauche. Alors que dans toute l’Europe, l’écrasante majorité des forces sociales-démocrates vote les crédits et appuie l’effort de guerre, la gauche s’unifie à partir de 1915[13] autour de son internationalisme, du rejet de la guerre, et de son soutien aux actions de masse contre les forces bourgeoises nationales. C’est tout naturellement que ce courant de gauche s’unifie à partir de 1917 derrière l’étendard de la révolution bolchévique, autour de la IIIe Internationale et de l’étiquette communiste, marquant ainsi la rupture définitive avec la social-démocratie. Au-delà des querelles théoriques qui continueront de structurer le rapport des deux noyaux majoritaires du courant socialiste, il importe de retenir ici que le courant de gauche se constitue avant tout comme opposition au socialisme d’État et à la centralité des méthodes parlementaires prônées par la social-démocratie. Face à cette orientation politique, les différentes franges de gauche ne cessent de rappeler leur soutien aux luttes de masse contre le système capitaliste et sa forme politique parlementaire.
Face au léninisme : contre le substitutisme
Aujourd’hui, la majeure partie des histoires du socialisme ne s’intéresse plus guère qu’à cette scission – ainsi qu’à celle entre trotskisme et stalinisme, à laquelle on ajoute parfois la prise en compte de courants « gauchistes » aussi vagues qu’élastiques[14]. La scission majeure entre communisme et social-démocratie en occulte bien souvent une autre, pourtant déterminante à l’époque des conseils, entre léninisme et communisme « de gauche ». Déterminante non pas pour entrer dans une distinction sans fin des diverses chapelles et groupuscules « gauchistes », mais parce qu’à l’origine, elle regroupe une très grande partie de la gauche social-démocrate, si ce n’est sa majorité[15].
Bien avant la figure dissidente de Trotsky à l’égard de l’orientation stalinienne, une démarcation s’opère progressivement entre un courant léniniste et un courant de gauche communiste que l’on peut commencer à rapprocher du courant de pensée conseilliste[16]. C’est surtout en Allemagne et en Hollande, mais aussi en Russie avec diverses organisations de l’opposition de « gauche »[17], que l’on trouve contre l’orientation léniniste les prémices d’une tradition conseilliste dont les principaux traits sont les suivants : défense de la centralité des conseils et de leur auto-organisation dans la réorganisation politique, rejet clair de la dictature de parti et du substitutisme, critique d’une forme d’autoritarisme léniniste et du rejet du pluralisme tant interne qu’externe aux partis communistes, critique de la bureaucratisation. La plupart des thèmes du courant conseilliste durant le XXe siècle sont déjà présents dès ces premières années de critiques adressées à la politique bolchévique ; critiques que l’on peut regrouper sous deux axes généraux : les relations conseils/parti/État et la conception de l’organisation – au sens d’organisation politique de type parti. Pour ces deux axes, on identifie bien une analyse conseilliste par opposition à l’analyse léniniste, analyse qui oppose socialisme par en bas et substitutisme. La pensée conseilliste, sensible donc à la question démocratique et à l’articulation entre finalité et modalités de la lutte de transformation sociale, se montrera critique envers certains écueils de la stratégie léniniste : survalorisation du rôle de l’organisation par rapport à la spontanéité révolutionnaire, poussant à privilégier la question des moyens de lutte et de la stratégie à celle de la finalité politique ; le tout menant in fine à une fétichisation du pouvoir étatique. Contre ce léninisme omniprésent, les conseillistes ne cesseront de répéter leur attachement à l’auto-organisation démocratique depuis la base de la société, à partir des organes de type conseil ; et donc la transformation radicale du rapport entretenu par le parti et la bureaucratie d’État à ces organes. On retrouve bien ici la thématique de la démocratie contre l’État.
On dit que les vainqueurs écrivent l’histoire ; cette formule pourrait illustrer celle du conseillisme face au communisme officiel. La victoire du capitalisme et de la démocratie parlementaire sur le « communisme » soviétique cache une autre victoire, celle de ce « communisme » bolchevik sur l’autogouvernement de la démocratie des conseils. C’est bien en ce sens qu’on peut parler du conseillisme comme d’un paradigme occulté – ou défait, c’est selon – de la galaxie socialiste.
Face au spontanéisme : contre l’oubli du politique
Le positionnement du paradigme conseilliste au sein de la galaxie socialiste constitue, d’une certaine manière, une forme de juste milieu. On pourrait croire à l’ironie, pour un courant régulièrement qualifié de gauchiste. Néanmoins, et nous tâcherons de le démontrer, la pensée conseilliste se trouve justement dans une position intermédiaire entre la tradition léniniste et les courants spontanéistes. Derrière cette désignation assez large se regroupent en réalité diverses traditions politiques autour de deux axes relativement précis : le rejet des organisations politiques permanentes, et/ou le refus de toute relation de représentation[18]. Cette tradition désigne donc aussi bien les courants anarchistes, que divers courants d’ultra-gauche ou certains courants influencés par le post-modernisme et un certain foucaldisme, et que l’on retrouve chez des penseurs comme Negri, Hardt[19] ou Holloway[20], très en vogue depuis les années 1980. C’est donc autant par antagonisme envers ces courants spontanéistes qu’envers certaines positions léninistes que le conseillisme nous semble avoir construit progressivement son existence comme paradigme. Plus qu’une ligne politique et stratégique précise et rigide, il constitue un courant dynamique, évolutif, tiraillé et menacé par des dérives contraires ; et c’est sans doute ce qui constitue l’intérêt politique et théorique de son étude.
À l’inverse de la critique d’un certain léninisme, c’est cette fois contre l’écueil d’une pensée privilégiant le projet d’émancipation « ici et maintenant » aux modalités de la transformation sociale que se positionne la pensée conseilliste. L’immédiatisme, la concentration sur les luttes sociales locales et partielles, le rejet des organisations politiques et de la représentation, le refus des questions stratégiques, l’obsession de la fétichisation étatique menant au refus du politique et finalement à la fétichisation du social, sont autant de caractéristiques spontanéistes identifiées et critiquées par la pensée conseilliste. Ces critiques ont d’autant plus d’intérêt qu’elles traversent et divisent le courant conseilliste lui-même, selon les périodes. Si cet aspect prouve à certains égards la fragilité théorique de ce courant, il est également une preuve de sa richesse et de sa capacité réflexive, ce qui confère un relief très riche à son étude.
Irène Pereira reprend et analyse certains traits du courant spontanéiste derrière ce qu’elle appelle la grammaire nietzschéenne[21], témoignant d’une orientation dont Antonio Negri est sans doute le représentant le plus emblématique. Forts des apports des pensées foucaldiennes et deleuziennes, nous trouvons chez ses défenseurs une grande acuité à penser l’articulation des formes de domination, d’oppression et d’exploitation, au sein desquelles se trouvent enchevêtrés des êtres sociaux qui ne sont plus définis unilatéralement par leur rapport au travail. À cela s’ajoute une évolution du capitalisme vers un capitalisme « cognitif »[22] où la production tendrait à devenir de plus en plus immatérielle. C’est à partir de cette analyse que se développe une organisation souvent regroupée sous la forme de réseaux ou de groupes affinitaires, orientés vers des modalités d’action assez diversifiées et souvent innovantes : performances, occupations, TAZ, etc. L’écueil ici pointé par la pratique conseilliste est une concentration excessive sur la question de la finalité démocratique, et l’illusion d’une capacité à dépasser les contradictions propres aux rapports sociaux existants dans la société telle qu’elle est. Cela se matérialise par un « oubli » de la question stratégique qui est celle du rapport aux asymétries structurantes de pouvoir, à l’État, au problème de la représentation, etc. Daniel Bensaïd[23] perçoit cette « faiblesse » chez des penseurs comme John Holloway[24] et Richard Dray[25] et l’identifie comme une caractéristique de ce qu’il nomme le « moment utopique » : ce sont ces moments consécutifs aux grandes défaites des mouvements sociaux, où la contestation renaît mais dans une direction floue et dans l’objectif explicite de tourner une page dans l’histoire des mouvements d’émancipation. Tout l’intérêt de cette analyse est le parallèle que Bensaïd dresse entre la période post-1989 – qui est celle de l’émergence de la mouvance altermondialiste et du renouveau des théories spontanéistes –, et la période du socialisme utopique, autour des années 1830-1848, postérieure à une grande période de restauration politique. Chez quelqu’un comme Holloway, les caricatures sur l’étatisme de toute pensée révolutionnaire et le développement d’une pensée de « l’anti-pouvoir » trahissent un fétichisme du social qui ne serait finalement que l’exact opposé du fétichisme étatique. La volonté d’abolir toute organisation – et donc toute représentation – comme le rejet de toute question stratégique liée au pouvoir aboutit finalement à une forme de négation du politique. C’est ce qui fera dire à Bensaïd, à propos de l’antiétatisme libertaire : « Il opposait au fétichisme d’État le fétichisme du social indifférent aux médiations politiques. L’abolition de tout principe de représentation ramène alors le rapport social au jeu des subjectivités désirantes. »[26]
Malgré les accusations récurrentes d’un spontanéisme de la pensée des conseils – accusations parfois légitimes tant il s’agit d’une question qui a divisé le mouvement – toute une partie de sa réflexion sur la question de l’organisation et du rapport aux mouvements sociaux vise justement à l’articulation entre finalité et modalité du projet d’émancipation politique. En ce sens, il semble possible de considérer la pensée conseilliste comme une tentative – imparfaite et inachevée – de dépassement des antinomies entre un pôle léniniste et un pôle spontanéiste. À l’écart du paradigme social-démocrate, le paradigme conseilliste pourrait bien être envisagé comme le troisième pôle oublié de la pensée révolutionnaire, entre bolchevisme et anarchisme, entre trotskisme et gauchisme, entre substitutisme et spontanéisme. Pôle sans cesse mouvant, souvent instable et parfois éclaté, mais pôle structuré par une histoire – celle des conseils ouvriers – et quelques grands enjeux théoriques – autour de la démocratie comme auto-institution.
Le problème de l’émancipation politique, au prisme de la question démocratique, nous mène donc vers la démocratie des conseils. Cette expérience moderne d’auto-institution démocratique répond ainsi à la préoccupation d’une démocratie agonistique dont l’objectif serait l’autonomie individuelle et collective[27] des sujets politiques via l’extension, et non le recouvrement, de la conflictualité politique. En ce sens, ce travail se situe dans la perspective d’un projet démocratique par en bas et contre l’État. Ce projet se positionne d’emblée en extériorité du libéralisme politique et du paradigme du gouvernement représentatif moderne. On lui trouve des préoccupations communes avec un certain républicanisme « aristotélicien » autour d’une sensibilité à la participation politique pensée selon la problématique de l’autogouvernement ; préoccupations qui limitent le rapprochement avec une partie de la pensée républicaine, autant qu’elles situent la démocratie des conseils au-delà des paradigmes participatifs et délibératifs de la démocratie. Enfin, en tant que projet démocratique issu de la galaxie socialiste, cette démocratie des conseils se déploie à rebours de certains écueils du léninisme et du spontanéisme, raison pour laquelle il devient possible d’identifier un pôle théorique conseilliste en tant que tel.
Photo : D. Chernov, 1939.
Notes
[1] Philippe Bourrinet, La gauche germano-hollandaise des origines à 1968
[2] Les piliers théoriques du conseillisme se retrouvent selon Philippe Bourrinet dans quatre textes essentiels : les Thèses sur le bolchevisme d’Helmut Wagner (1934) ; Vers un nouveau mouvement ouvrier d’Henk Canne-Meijer et constituant les thèses du GIC (1935) ; les Fondements de la production et de la distribution communiste du GIC (1930) ; et enfin le plus théorique Lénine philosophe de Pannekoek (1938).
[3] Le GIC, Groep van Internationale Communisten, est un groupe politique hollandais qui apparait en 1927 avant de devenir dans les années 1930 une référence internationale (si ce n’est la référence) du mouvement conseilliste.
[4] « Glissant de « l’antiléninisme » à « l’antibolchevisme », contrairement au KAPD, le GIC reprenait à son compte les thèses de Otto Rühle. Seule la référence constante au mouvement des conseils allemand empêchait le GIC de glisser vers une conception de type anarchiste. » cf. Philippe Bourrinet, La gauche germano-hollandaise des origines à 1968, opus cité, chapitre 7
[5] Ernst Bloch distingue dans Le principe d’espérance le courant « froid » du marxisme, caractérisé par une tendance à l’économisme, au scientisme voire à l’étatisme, de son courant « chaud » valorisant au contraire la subjectivité, l’art, la création et l’ensemble des formes de luttes contre l’oppression capitalistes qui ne se résument pas uniquement à l’antagonisme économique.
[6] On pense par exemple à Karl Korsch, Maximilien Rubel ou encore Cornelius Castoriadis.
[7] Castoriadis et Lefort seront notamment très influencés par la pensée de Merleau-Ponty.
[8] Voir Miguel Abensour, Pour une philosophie politique critique, opus cité.
[9] On pense notamment aux travaux de Philippe Bourrinet et de Denis Authier et Jean Barrot : Philippe Bourrinet, La gauche germano-hollandaise des origines à 1968, opus cité ; Denis Authier, Jean Barrot, La gauche communiste en Allemagne : 1918-1921, Paris : Payot, 1976, 388 p.
[10] On parle à l’époque de la « gauche » de la social-démocratie, pour désigner les courants qui deviendront par la suite les courants communistes et conseillistes.
[11] Contre la « droite » représentée par Bernstein et le « centre » représenté par Kautsky
[12] On pense notamment au célèbre texte de Rosa Luxemburg, Réforme sociale ou révolution, Paris : Les Amis de Spartacus, 1997, 192 p.
[13] La conférence de Zimmerwald réunira en 1915 la majorité des courants de la gauche, bien que le SDP hollandais en soit absent. Ce sera l’occasion pour la gauche d’unifier son programme politique, notamment autour du mot d’ordre de transformation de la guerre impérialiste en guerre révolutionnaire. On parlera ensuite de la « gauche de Zimmerwald ».
[14] En témoigne aujourd’hui l’étiquette « ultragauche », qui revient régulièrement sur le devant de la scène médiatique pour désigner des courants aussi différents que l’action directe, l’anarchisme, le mouvement autonome, etc.
[15] Rappelons qu’en Allemagne, c’est bien la majorité des effectifs du parti communiste, le KPD, qui est exclue en 1920 par la minorité suite à une manœuvre d’appareil coordonnée par les bolcheviks dans une volonté d’isoler la gauche.
[16] La gauche communiste d’après 1917 ne correspond pas encore tout à fait au courant conseilliste au sens large. Pour être rigoureux, il faudrait identifier trois foyers principaux de l’opposition de gauche : le foyer russe, le foyer italien, et le foyer germano-hollandais. Si l’on peut rapprocher le premier et le dernier du conseillisme dans l’importance qu’ils accordent au rapport parti/État/conseils et dans leur critique de la bureaucratisation et du substitutisme des bolcheviks, le foyer italien se rapproche lui du foyer germano-hollandais sur l’attitude à l’égard de la participation aux élections mais s’en éloigne quant à la conception du parti qui reste léniniste au sens le plus rigide. De manière un peu différente, certains auteurs comme Christophe Bourseiller distingueront quatre familles aux origines de la gauche communiste : les germano-hollandais, les italiens, mais aussi les situationnistes et les communistes libertaires. cf. Christophe Bourseiller, Histoire générale de l’ultra-gauche, Paris : Denoël, 2003, pp. 10-11
[17] On pense notamment aux communistes de gauche réunis autour de Radek, Bakounine et Ossinski au sein de la revue Kommunist en 1918, à l’Opposition ouvrière de Kollontaï et Chliapnikov, ou encore au Groupe Ouvrier de Miasnikov.
[18] Refus caractérisé notamment par la mise en place systématique du mandat impératif.
[19] Antonio Negri, Michaël Hardt, Empire, Paris : 10-18, DL 2004, 571 p.
[20] John Holloway, Changer le monde sans prendre le pouvoir : le sens de la révolution aujourd’hui, Paris : Syllepse, 2007, 317 p.
[21] Irène Pereira, Les grammaires de la contestation : un guide de la gauche radicale, Paris : La Découverte, 2010, 225 p.
[22] Cette analyse est celle développée notamment par Antonio Negri et Michael Hardt. Voir notamment Michael Hardt et Antonio Negri, Multitude : guerre et démocratie à l’âge de l’Empire, Paris : La Découverte, 2004, 407 p.
[23] Daniel Bensaïd, « Et si on arrêtait tout ? « L’illusion sociale » de John Holloway et Richard Day » in Revue internationale des livres et des idées, janvier-février 2008, n°3
[24] John Holloway, Changer le monde sans prendre le pouvoir, opus cité
[25] Richard Day, Gramsci is dead, London : Pluto Press, 2005, 254 p.
[26] Daniel Bensaïd, La politique comme art stratégique, opus cité, p. 30
[27] Gérard David, Cornelius Castoriadis : le projet d’autonomie, Paris : Éd. Michalon, 2001, pp. 43-60