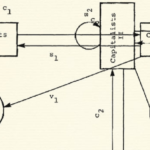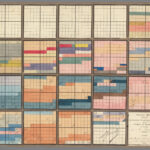A lire : un extrait de « Néolibéralisme. Un autre grande récit », de Jacques Bidet

Jacques Bidet, Le néolibéralisme. Un autre grand récit, éd. Les prairies ordinaires, p. 196, 16 €.
Ce texte est tiré du Chapitre 3, intitulé « En quoi le néolibéralisme se distingue du libéralisme ». La première partie a pour titre: « Le libéralisme comme logique limitée par des forces adverses ». Cette seconde partie argumente l’idée que le néolibéralisme est le régime qui apparaît quand celles-ci en viennent à être défaites. En ce sens, le néolibéralisme est au libéralisme ce que le « socialisme réel » est au socialisme : un « libéralisme réel ».
3.2. Le néolibéralisme : un libéralisme affranchi sous État-monde
Si cette analyse est exacte, on est conduit à prendre avec prudence la thèse avancée par Foucault, selon laquelle la nouveauté radicale du néolibéralisme tient à ce qu’il ne s’affirme pas comme un ordre naturel, qui naît du laisser-faire, mais comme un ordre rationnel, à promouvoir. Telle est certes l’auto-interprétation du néolibéralisme, sa conviction identitaire. Il reste cependant à savoir ce qui fait surgir une telle prétention. En réalité, quand le libéralisme, aux XVIIIe et XIXe siècles, se déclare comme « l’ordre naturel », il avance déjà cette « nature » comme la « raison » à faire advenir. Au temps des Lumières déjà, la raison est un combat. Le laisser-faire est une politique qui doit s’imposer contre la force adverse, et qui s’y emploie. La véritable nouveauté du néolibéralisme tient, me semble-t-il, à ce qu’il doit assumer explicitement ce défi libéral face à des forces sociales qui ont manifesté les potentialités d’une économie politique nationalement organisée. Ce « nouveau » libéralisme se trouve donc engagé dans un combat nouveau, qui vise proprement à détruire l’État social national. Mais il s’agit bien du même libéralisme (§321). Cette entreprise nouvelle n’est cependant pas réductible à une simple radicalisation du principe de marché : elle implique un nouveau principe d’organisation, mis en œuvre à travers un dispositif de « normation », au sens de Foucault, – qui implique le pouvoir-savoir dans un rapport de classe à l’échelle de l’État-monde (§322).
§321. Comment le libéralisme devient néolibéralisme
Les théoriciens classiques du libéralisme ne luttaient pas contre « l’État », mais pour un État dont la loi serait celle du marché capitaliste : les physiocrates réclamaient même un « État Despote ». Ils luttaient contre un « ancien régime », dans lequel la dynamique du capital se trouvait comprimée par une logique d’organisation dont la fin, par contraste avec celle des capitalistes, était l’accumulation d’un certain nombre de valeurs d’usage : la monnaie n’était que la ressource pour l’accumulation d’un potentiel militaire entre les mains du pouvoir royal, dans l’arène « systémique » internationale – de la prééminence au Centre à la conquête des colonies. La logique du capital est au contraire de n’envisager les valeurs d’usage que dans l’horizon du profit. Tout cela serait une simple affaire de synthèse intelligente entre les deux termes, si ces deux logiques n’étaient portées par deux forces sociales distinctes, qui les nourrissent et s’en nourrissent. Les libéraux devaient – notamment dans la France du second XVIIIe siècle – contrer l’autre pôle privilégié, qui prédominait depuis des siècles, et cela dans le contexte du système-monde moderne, lequel exigeait de chaque État-nation qu’il monte continuellement en puissance face à tous les autres. Ils affrontaient une force sociale ancienne, toujours en charge de ce que Foucault appelle « l’État administratif » post-westphalien. Le bloc social ascendant rassemblait, avec les capitalistes, de nouvelles générations de compétents (avocats…), qui, dans le processus politique, se portaient à la pointe du combat. Dans les conditions de la révolution économique qui déjà travaillait la société, les tenants du capitalisme se trouvaient, par rapport aux tenants de l’ancien régime, dans une situation de supério¬rité à leurs yeux tellement évidente qu’elle pouvait passer pour naturelle, s’exprimant dans le langage juridique censément universel du contrat social conjugué avec celui de l’homo economicus. Ils représentaient la raison en marche. Mais quand, au XXe siècle, la modernité « socialiste » – au sens ici donné à ce terme, attaché au pôle de la « compétence » versus « finance » – a commencé, tant dans la révolution soviétique que dans le new deal occidental, et aussi dans diverses formes de populisme, à manifester une ambi¬tion historique d’hégémonie de pôle contraire, jusqu’à sembler envoyer le libéralisme aux poubelles de l’histoire, celui-ci s’est trouvé contraint à passer à l’offensive et à s’affirmer, à se revendiquer comme l’alternative proprement rationnelle. Non plus comme un ordre naturel à confirmer, mais comme un ordre rationnel à promouvoir: quand le Labour d’Attlee et de Bevan a nationalisé les hôpitaux, les mines de charbon, la sidérurgie, le gaz et l’électricité, la Banque d’Angleterre, etc., il faut à Thatcher un langage de reconquête.
Bref, le libéralisme devient néolibéralisme quand il en vient à se dresser contre les obstacles nouveaux qui le limitent, issus de l’alliance entre le « peuple » et « l’élite ». Mais cette ambition n’a pu s’affirmer qu’à un moment déterminé, qui est à situer tout à la fois dans la tendance historique et dans la conjoncture, l’une et l’autre à la fois structurelles et systémiques. Il reste donc à considérer les tendances et circonstances qui ont « libéré » le libéralisme et l’ont conduit à s’imposer effectivement dans sa forme radicale, celle que désigne le concept de « néolibéralisme ».
Le néolibéralisme comme pensée stratégique mûrit en discours théorique dans l’épreuve des années 20 et 30, où s’affirment à son encontre d’une part l’offensive du « socialisme réel » et d’autre part les expériences du New Deal et les poussées socialistes à l’Ouest (qui se concrétiseront dans l’après-guerre). Mais pour qu’il puisse s’affirmer pratiquement, il faudra que le pouvoir du pôle organisationnel, et avec lui aussi celui de la puissance populaire – alliés dans cette révolution de compromis qui va des années 30 à 70 –, en viennent à se trouver remis en cause. Ce fut d’abord le cas dans l’Allemagne année zéro, où les « régimes » du national-socialisme et du stalinisme se trouvent également disqualifiés, et où pré¬vaut par ailleurs l’influence « systémique » américaine. Le néolibéra¬lisme, qui est le rêve du libéralisme, demeurait jusqu’alors un projet empêché. Il s’exprimait déjà chez Hayek et dans la société du Mont Pèlerin. Il débarque en force avec l’ordo-libéralisme, dans une conjoncture apocalyptique où l’on pouvait envisager de faire du passé table rase. Les axiomes néolibéraux qui président à la renaissance de cette puissance centrale – dans la forme de la RFA – marqueront le destin de l’Europe ultérieure, tout en demeurant localement contrebalancés par les puissances sociales adverses, notamment celle du syndicalisme, effet des influences socialistes et communistes antérieures. Mais les conditions de possibilité d’un libéralisme universel – le seul qui soit à la hauteur de son projet, car on n’abolit pas le socialisme dans un seul pays, ni sur un seul continent – ne sont données que dans les années 70-80, avec l’abaissement de l’État social national dans un procès de mondiali¬sation capitaliste. La révolution informatique, qui unifie virtuellement tous les procès de production à l’échelle mondiale, va alors en effet permettre au grand capital de reprendre l’initiative politique. Dans un contexte mondial systémique inégal, il s’avère alors possible de délocaliser la production là où le salaire est proche de zéro. C’est dans cette conjoncture technologique et géopolitique que peut s’imposer la stratégie de dérégulation universelle dont Thatcher et Reagan ont pris l’initiative – on y reviendra au chapitre V ci-dessous. Á travers eux et leurs semblables, le capital financier prend le contrôle des États, qui vont privatiser et dérégula¬riser, ouvrir aux investissements et à la spéculation l’espace mondial : ils se donnent les moyens de se porter là où le profit immédiat est à son maximum.
L’ordre juridico-économique commence à se définir par-dessus les nations. L’Etat social national, qui était le lieu de l’arrangement entre la classe populaire et le pôle des compétents-dirigeants, le lieu de leurs projets, se trouve ébranlé. Soumis à une constitution néolibérale, il tend à devenir une simple succursale, en même temps qu’un agent actif, d’un État-monde néolibéral, coiffé par une constitution néolibérale universelle. En tant qu’appareil, sa fonction est dès lors d’aligner la partie nationale sur le tout mondial, dans les conditions inégales du Système-monde. A ce moment, se produit un retournement épochal de la relation entre structure et système. Une Structure-monde de classe commence à s’affirmer sous la forme d’un État-monde entremêlé et articulé au Système-monde.
Au total, le néolibéralisme n’est rien d’autre qu’un libéralisme libéré dans l’espace global: un libéralisme qui se donne libre cours en s’affranchissant de l’État-nation où s’organisaient les forces sociales adverses. Si, pourtant, il n’en est pas tout à fait ainsi, si le néolibéralisme ne se trouve pas adéquatement réalisé dans ce que l’on appelle la « mondialisation néolibérale », c’est pour deux raisons sur lesquelles on reviendra au chapitre V, et qui se comprennent mieux si l’on se reporte aux principes de l’analyse métastructurelle. La première est que le pouvoir propriétaire comme tel ne suffit jamais à lui seul pour diriger une société: l’État est en lui-même un dispositif organisationnel. La « forme moderne de société » se définit comme l’articulation des deux médiations rationnelles que sont le marché et l’organisation sous l’égide d’un État territorial. En tant qu’instrumentalisation de la raison, elle se réclame de la règle du discours également partagé (une voix = une voix), immédiation discursive supposée arbitrer entre ces deux médiations – lesquelles cependant se trouvent toujours déjà, du fait des deux sortes de « privilèges », de propriété et de compétence, auxquels elles donnent respectivement lieu, instrumentalisées en facteurs de classe qui se combinent dans le rapport moderne de classe. Les deux médiations s’englobent l’une l’autre: l’entreprise est une organisation englobée par le marché, lequel l’est à son tour sous une organisation étatique qui comme telle exclut, censément du moins, tout privilège marchand. C’est donc l’organisation qui prévaut donc au sommet de l’État national, lequel pourtant se trouve englobé dans un espace mondial, qui est à la fois celui du Système-monde et celui du marché mondial, jusqu’au point où celui-ci s’englobe dans l’État-monde. La relation est d’englobance mutuelle1. La prévalence du marché, au sens de la logique capitaliste, au sein de l’État-nation néolibéral ne fait donc pas disparaître sa logique organisationnelle, qui ne cesse de se déployer dans son rapport à un extérieur où s’articulent l’affrontement concurentiel et la menace guerrière toujours latente. On ne s’étonnera donc pas que les hégémons du Système-monde (et ceux des sous-systèmes, tels que l’Europe), grands défenseurs de la libre concurrence, soient toujours prêts, comme ce fut naguère le cas au temps du libéralisme, à s’en affranchir chaque fois que leur intérêt le réclame. Bref, la relation du Système-monde à l’État-monde n’est pas celle de l’englobance, mais à proprement parler de l’imbroglio. L’autre limite à l’ordre néolibéral tient à ce que la classe populaire à l’échelle mondiale n’a pas définitivement perdu la partie.
§322. Le néolibéralisme organisé par la normation
Le néolibéralisme, en même qu’il marque le triomphe du marché, implique un développement corrélatif inédit de l’organisation, notamment sous la forme d’un processus de « normation », qui tout à la fois appelle une extension des pouvoirs-savoirs et accentue leur inféodation au pouvoir-capital du capital global.
Une sociologie de la norme, qui se réfère à Weber et à Foucault pour l’étude de la nouvelle « bureaucratisation » mondiale2, montre en effet que l’ancienne organisation pyramidale trouve un relai dans une forme de coordination fondée sur un travail d’abstraction qui élabore des repères – de critères abstraitement définis – de qualité, de performance, de sécurité, etc.3. Il s’agit bien là d’un processus organisationnel, qui s’impose à mesure que les produits se multiplient et que de nouvelles activités se trouvent introduites dans la sphère marchande. La production de normes gouverne ainsi de plus en plus la production et les produits, les conduites des producteurs et celles des consommateurs – et tout autant les transactions marchandes. Ce dispositif de normation que Foucault avait identifié comme le vecteur du « pouvoir-savoir » dans l’ordre du carcéral, du médical, du scolaire etc., et finalement étendu à la gestion des populations, s’est en quelque sorte recyclé dans l’entreprise capitaliste, pour revenir en force dans l’espace public de l’hôpital et de l’université, de l’administration et de la culture, et envahir toute la vie privée à l’ère néolibérale.
Le pôle des « compétents » se trouve significativement impliqué dans ce nouveau processus. Il tend pour une part à s’y reconvertir. Des bataillons d’experts et de consultants sont requis pour le fonctionnement de cet univers de normes et son renouvellement incessant : agents au service de puissances particulières (firmes ou États), mais s’inscrivant dans une logique de rationalité universelle censément partagée. En réalité, celle-ci entre en tension avec les logiques de métier, orientées vers les valeurs d’usage et liées à un contenu pourvu de sens aux yeux de l’ensemble des acteurs. Á mesure que s’impose cette normation généralisée, toutes les particularités liées à l’histoire (de classe de lutte de classe) nationale doivent s’effacer devant une configuration nouvelle, celle d’un État de classe à l’échelle monde, en cela d’autant plus aliénant4. On ne s’étonnera pas qu’elle rencontre des résistances chez les acteurs concernés, enseignants, médecins, hospitaliers, etc., à divers degrés dans l’ensemble des corps professionnels. Comme le soulignait Foucault, les « intellectuels spécifiques » se trouvent appelés à choisir entre des options de classe contradictoires.
Si l’on veut cependant prendre ce problème de la normation dans son ensemble, il faut le référer à toute la complexité métastructurelle. La nouvelle culture bureaucratique permet au pouvoir-capital de s’affirmer dans des sphères d’activité jusqu’alors gouvernées par le pouvoir-savoir et demeurées sous quelque influence de la classe populaire. Cette extension au public de procédures empruntées au monde de l’entreprise capitaliste – typiquement celles de l’audit basé sur des normes inspirées par les intérêts qu’elle sert – ne signifie cependant pas que « la normation » appartienne par essence au privé ou à l’entreprise, ni qu’elle ne puisse venir que d’en haut : elle est le fait de toute organisation. C’est bien certes dans l’entreprise que se sont d’abord développées ses nouvelles figures, particulièrement expéditives. Mais la « norme », comme fait d’organisation, est transversale à toute la société moderne. Et l’abstraction organisationnelle qui se vérifie dans la normation est en elle-même significative de rationalité commune au sein du « carré métastructurel », tout comme l’est l’abstraction marchande5. L’une des découvertes majeures de Foucault est précisément d’avoir montré son existence transversale dans toutes les sphères de la société moderne et son lien à l’émergence d’un pouvoir-savoir qui fait pendant au pouvoir-capital, avec ou contre lui. Mais de ces deux pouvoirs, liés à la raison commune, la puissance d’en bas ne se laisse pas si facilement déposséder. D’autant que la normation est censément le fait d’un discours supposé public, même lorsqu’elle s’élabore dans les arcanes des pratiques « professionnelles ». C’est une organisation à partir du discours : à la jointure de la « médiation » et de « l’immédiation ».
Et comme le rationnel ne vient jamais seul, la normation s’entend aussi – et c’est ainsi que l’entendent les acteurs sociaux en présence – au regard du raisonnable qu’elle revendique. Ainsi en va-t-il, comme y insiste B. Hibou, lorsqu’on prétend à travers elle mettre à plat les injustices et privilèges, instaurer une société transparente, vieux rêve rousseauiste et marxien. La norme, quoiqu’elle s’impose comme fait de pouvoir, s’entend comme ce qui requiert justification. Tous peuvent donc se sentir concernés. Par la normation s’exerce un mode de pouvoir, comme le montre Foucault. Qui ajoute : un « pouvoir productif ». Mais comment le pouvoir pourrait-il par lui-même produire ? Cette expression reste en effet paradoxale, voire douteuse, aussi longtemps que l’on n’a pas compris en quel sens elle est à prendre. Non pas en allant du pouvoir à la production : d’un pouvoir qui serait de surcroît, mystérieusement, productif. Mais de la raison productive au pouvoir de domination sur autrui qui découle de sa relative monopolisation. C’est le savoir qui donne du pouvoir, et non le pouvoir qui engendre du savoir. Et, s’il en est ainsi, dans le processus d’instrumentalisation de la raison, la raison demeure toujours présente, comme un enjeu. On ne s’étonnera pas que la normation soit au cœur de la lutte moderne de classe : normes de sécurité, de salubrité, de scolarité, d’employabilité, etc. Ni que le savoir populaire la dispute au savoir-pouvoir, vu qu’il y a continuité de l’un à l’autre.
L’irrationalité instrumentale qui est celle de l’organisation dès lors que le pouvoir-savoir tend à devenir un privilège monopolisé se redouble quand celui-ci se trouve hégémonisé par le pouvoir propriété du capital financier. Et la folie génératrice de normes, aimantée par les appétits « abstraits » de plus-value, devient plus difficile à maîtriser à mesure que se délitent les alliances constituées dans l’État-nation en vue de valeurs d’usage communément partagées. Il reste que cette folie « interpelle », advenant dans le discours. Elle s’adresse à des sujets de raison, relevant d’une ontologie sociale définie : à des « sujets à l’ère du néolibéralisme ».
à voir aussi
références
| ⇧1 | Ce concept d’ “englobance”, naguère avancé dans Théorie générale, permet de comprendre qu’entre marché et organisation, à quelque niveau que ce soit, il n’y a jamais à proprement parler de “mélanges” ni de “mixtes” (comme on le prétend souvent), mais seulement des rapports entremêlés d’alternatives toujours potentiellement conflictuelles, mises en oeuvre par des forces sociales opposées dans la relation structurelle-systémique. |
|---|---|
| ⇧2 | Le livre de Béatrice Hibou, La Bureaucratisation du Monde, loc. cit., en fournit une belle synthèse. Notons que ce concept de norme n’est pas en lui-même une nouveauté. Marx lui-même s’y réfère dans les premières pages du Capital, rappelant que les marchandises relèvent d’une Disziplin particulière, celle de la « connaissance des marchandises », die Warenkunde, qui relie données techniques et exigences juridiques (MEW 23/50, CAP 1/52). Mais sa réflexion s’arrête là : le processus bureaucratique n’est encore que faiblement engagé sur ce terrain. |
| ⇧3 | Foucault avait déjà clairement identifié ce concept d’abstraction. « En liaison avec cette instauration du savoir à l’origine du pouvoir, on a la mise en place de toute une série d’instruments spécifiques, instruments d’abstraction (je souligne) de généralisation d’estimation quantitative » (La Société Punitive, op. cit., p. 238). Cela à propos du développement de la police, fin XVIIIe siècle. |
| ⇧4 | Notons, par avance, que cette bureaucratisation universelle ne signifie pourtant pas tout uniment construction de l’État-monde. Car elle se trouve, en sens inverse, immédiatement instrumentalisée par les grandes puissances du Système-monde, en concurrence pour l’imposition de standards qui privilégient leurs industries et leurs compétences. Le Système monde instrumentalise l’État-monde en même temps qu’il s’y englobe. |
| ⇧5 | Celle-ci, on l’a vu (§313), constitue la contrepartie de la valeur d’usage, à la différence de l’abstraction de plus-value, qui entre en contradiction avec elle. |




![Une organisation non capitaliste de la vie : discussion avec Jérôme Baschet – partie 1 [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Chiapas_school_in_zapatistaland-150x150.jpg)