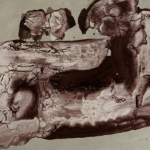Alaa Abd el-Fattah, l’inépuisable voix de la révolution égyptienne
Le 11 février 2011, le regard rivé sur la place Tahrir du Caire, le monde assistait, médusé, à ce qui paraissait encore à peine croyable : Moubarak rendait les clés sous la pression du collectif-en-acte. Éruptif et foudroyant, l’élan révolutionnaire venu de Tunisie avait ouvert la brèche de tous les possibles. Le jour suivant, j’atterrissais à Tahrir, et j’y trouvais un pays comme miraculeusement délivré. Est-ce donc cela les lendemains qui chantent ? Depuis des haut-parleurs suspendus ici et là, entre la place Talaat Harb et ses rues adjacentes, la voix de Shadia tonnait, celle de Abdel Halim Hafez la suivait, les chants patriotiques et révolutionnaires se succédaient, derrière un brouhaha joyeux d’intarissables bavardages. Un balai à la main, j’imitais le mouvement général : il fallait restaurer un pays tombé en ruine après quatre décennies de criminelle négligence.
C’est sur la place Tahrir qu’au mois de décembre 2011, je rencontrais Alaa Abd el-Fattah pour la première fois. Vêtu d’une longue galabeyya blanche, Alaa menait le débat au milieu d’une vingtaine de personnes regroupées autour de lui. Né en 1981, soit un an après l’accession de Moubarak au pouvoir, Alaa est l’une des nombreuses figures qui ont contribué à façonner une culture contestatrice en Égypte, à partir du début des années 2000. Membre du mouvement Kefaya (Assez) fondé en 2004 contre un nouveau mandat présidentiel de Moubarak et contre le principe d’hérédité du pouvoir, ce jeune informaticien et bloggeur était déjà un militant chevronné, formé dans le creuset de l’environnement familial. En effet, son père, Ahmad Seif al-Islam, militant communiste et avocat, était à la tête du Centre Hicham Moubarak pour les droits humains, dont les locaux servaient de QG pour une partie de la gauche au Caire ; sa mère, Laila Soueif, universitaire, est une militante féministe, co-fondatrice du Mouvement du 09 Mars pour l’indépendance des universités.
Doté d’une solide culture politique, Alaa est surtout un homme de son temps. À la pointe de la technologie, il contribue à remodeler non seulement les pratiques militantes, notamment à travers un usage novateur des réseaux sociaux, mais également le langage politique. Intellectuel public ancré dans les collectifs militants, sa voix n’a eu de cesse de « dire la vérité au pouvoir[1] ». Pour cela, Alaa a passé l’essentiel des 10 dernières années en prison. Condamné en 2021 pour « diffusion de fausses informations », il a entamé une grève de la faim le 2 avril 2022, puis une grève de la soif le 6 novembre dernier, pour protester contre les conditions de détention des prisonniers. Car comme lui, près de 60 000 opposants – islamistes, socialistes et libéraux – croupissent derrière les barreaux des prisons égyptiennes. Et il faut le préciser : ces dernières renferment l’horreur plein les yeux.
Icône de la révolution égyptienne de 2011, Alaa est à présent davantage que cela encore. Il incarne à l’échelle du monde arabe une lutte collective contre l’autoritarisme et la terreur de l’État. Alors que se déroule la COP27 à Sharm al-Sheikh, sous l’égide des Nations unies, s’impose à la face du monde, la voix de Alaa, depuis son corps brisé. Ainsi que sa mère l’a formulé il y a quelques jours : quelle que soit l’issue de son agonie, qu’il trouve la mort ou la sortie de prison, Alaa a choisi la liberté. C’est-à-dire cette douce brise qui avait empli les rues cairotes au lendemain du 11 février 2011 et qui soufflait l’espoir d’un monde un peu plus léger.
À notre lectorat, nous mettons à disposition deux textes de Alaa Abd el-Fattah, « Les seuls mots que je puisse écrire » (2016) et « Cinq métaphores sur la guérison » (2019), tirés de son livre You have not yet been defeated (Fitzcarraldo Editions, 2021), avec l’aimable autorisation de la maison d’édition.
Aya Khalil
***
Les seuls mots que je puisse écrire
Écrit dans la prison de Torah. Publié le 24 janvier 2016, dans le Guardian & Mada Masr.
Il y a cinq ans, lors de ce qui allait s’avérer être le dernier jour normal de ma vie, je me suis assis à mon bureau dans une petite entreprise informatique de Pretoria et j’ai fait semblant de travailler alors qu’en réalité j’étais en train d’écrire un court article pour le Guardian. Il s’agissait d’expliquer pourquoi la révolution égyptienne devait être prise au sérieux. Ou du moins, c’est ainsi que je m’en souviens. Je ne peux pas retrouver cet article maintenant ; cela fait plus d’un an que je n’ai plus accès à internet. En Égypte, les prisonniers n’ont même pas droit à un coup de téléphone. Mais je ne devrais pas me plaindre : au moins, je peux voir ma famille deux ou trois fois par mois. D’autres prisonniers politiques (des islamistes pour la plupart) n’ont le droit de recevoir aucune visite.
Ce jour-là, il y a cinq ans, je me suis engagé pour la première fois dans la bataille pour le récit de la révolution, une bataille qui allait me consumer complètement pendant quatre ans. Mais ce jour-là, je n’étais même pas sûr qu’une révolution était en train de se produire en Égypte – au moment même où j’écrivais sur cette nouvelle forme de panarabisme au sein de la jeunesse, je craignais qu’elle ne s’éteigne.
Il m’a fallu un jour de plus pour accepter que la révolution était bien réelle, et trois autres jours avant de pouvoir m’envoler pour Le Caire et rejoindre Tahrir. Je suis passé de mon doute sur la profondeur du soulèvement à une inquiétude d’arriver après la bataille.
Après la chute de Moubarak, la bataille sur le récit historique a pris de l’importance. L’État a été contraint de faire des compromis avec la révolution tout en tentant de la contenir en s’appropriant son histoire. Nous avons expliqué pourquoi nous continuions à manifester, et pourquoi nous avions commencé. Les jeunes qui ont jeté des pierres sur la police sont-ils des révolutionnaires ou des saboteurs ? Les prisonniers qui sont morts lors des émeutes dans les prisons doivent-ils être comptés parmi les martyrs de la révolution ou non ? Quel est le rôle de l’armée dans le régime de Moubarak ? L’enseignement doit-il continuer à être gratuit dans les universités publiques ? Avons-nous besoin d’une nouvelle constitution ? Si oui, qui doit l’écrire ? Et ainsi de suite. J’écrivais, j’écrivais encore, surtout en arabe, surtout sur les médias des réseaux sociaux mais parfois pour un quotidien national. Je m’adressais surtout à d’autres révolutionnaires et de plus en plus sur le mode de l’avertissement : la fragilité du moment révolutionnaire et la précarité de notre situation étaient mes thèmes principaux. Et pourtant, je ne pouvais pas me débarrasser d’un franc sentiment d’espoir et d’ouverture des possibles – malgré les revers, nos rêves poursuivaient leur essor.
Les gens parlent d’une barrière de peur, mais quant à moi je l’avais toujours perçue comme une barrière de désespoir, et une fois retirée, la peur, les massacres et les prisons n’étaient plus en mesure de la réimplanter. J’ai fait toutes les erreurs bêtes des révolutionnaires trop optimistes : je suis retourné en Égypte de façon permanente, j’ai eu un enfant, j’ai fondé une start-up, je me suis engagé dans une série d’initiatives progressistes pour une démocratie plus populaire, décentralisée et participative, j’ai enfreint toutes les lois draconiennes et tous les tabous dépassés, je suis entré en prison en souriant et j’en suis sorti triomphant.
En 2013, nous avons commencé à perdre la bataille du récit au profit d’une polarisation toxique entre un étatisme pseudo-séculaire farouchement militarisé et une forme d’islamisme dangereusement sectaire et paranoïaque. Tout ce dont je me souviens de 2013, c’est l’impression de casser les oreilles de tout le monde en criant « Un fléau sur vos deux maisons », entre pleurnicherie et mélodrame, en me plaignant de la malédiction de Cassandre qui prévient d’un feu dévorant quand personne ne veut écouter. Alors que les rues étaient gagnées par des rassemblements qui brandissaient les photos de policiers au lieu de celles de leurs victimes, que les sit-ins étaient remplis de chants contre les Chiites et que les complots contre les Coptes fleurissaient, mes mots perdaient tout pouvoir et pourtant ils continuaient de sortir de moi. J’avais encore une voix, même si une poignée seulement m’écoutait.
Mais l’État a alors décidé de mettre fin au conflit en commettant le premier crime contre l’humanité de la République égyptienne. Les barrières de la peur et du désespoir sont réapparues après le massacre de Rabia al-Adaouïa. Une autre bataille narrative s’est engagée : faire accepter aux non-islamistes qu’un massacre a eu lieu, faire rejeter la violence commise en leur nom.
Trois mois après le massacre, j’étais de retour en prison, et ma prose a étrangement pris un nouveau rôle : appeler les révolutionnaires à admettre leur défaite. Abandonner l’optimisme qui était devenu dangereux dans son encouragement à choisir un camp : un triomphalisme militaire ou le maintien d’une volonté de changement complet de régime, impopulaire et peu pragmatique. Ce qu’il fallait, c’était rassembler toute la force possible pour maintenir une défense élémentaire des droits humains.
Je produisais un récit de défaite parce que le langage même de la révolution nous était perdu, remplacé par un dangereux cocktail de langage nationaliste, nativiste, collectiviste et post-colonialiste, employé par les deux parties du conflit et utilisé pour répandre les théories du complot les plus alambiquées et la paranoïa.
Début 2014, il n’était toujours pas consensuel pour les révolutionnaires de s’engager dans une campagne de défense des droits humains limitée à la révocation de la loi sur les manifestations et à la libération des prisonniers politiques. La plupart croyaient encore que la révolution était en train de gagner (définissant la victoire comme étant soit la disparition, soit le triomphe des Frères musulmans). L’idée que l’état d’urgence était la nouvelle norme était généralement rejetée.
Aujourd’hui, il semble que nous ayons gagné cette ultime bataille narrative. Si l’État a toujours ses partisans, leur nombre diminue à grande vitesse, en particulier chez les jeunes. La plupart des gens ne débattent plus de la nature des événements de l’été 2013. Le débat « coup d’État ou révolution » est dépassé. Même les partisans de Sissi ne croient plus vraiment que la prospérité soit pour bientôt. Il est plus difficile d’évaluer l’état d’esprit des partisans des islamistes : ceux-ci rencontrent bien un soutien croissant dans leur détresse, mais n’ont presque aucune crédibilité pour organiser un front uni efficace contre le régime. Le désespoir prévaut.
J’ai passé la majeure partie de l’année 2014 en prison et pourtant j’avais encore beaucoup de mots. Mon audience était très réduite, mon message n’était pas porteur d’espoir, et pourtant il me semblait important de rappeler que même après avoir admis la défaite, nous pouvons encore résister ; que nous pouvions accepter de revenir aux marges d’où nous nous étions battu·es à l’époque de Moubarak tant que nous poursuivions le combat pour les droits humains fondamentaux. Mais début 2015, lorsque ma sentence a été prononcée, je n’avais plus rien à dire à aucun public. Je ne pouvais qu’écrire des lettres personnelles. La révolution, et en fait l’Égypte elle-même, s’effaçaient lentement, même dans ces lettres, et à l’automne 2015, même mes mots les plus personnels se sont taris. Cela fait des mois que je n’ai pas écrit de lettre, et plus d’un an que je n’ai pas écrit d’article. Je n’ai rien à dire : pas d’espoir, pas de rêve, pas de crainte, pas d’avertissement, pas d’idée, rien, absolument rien. Comme un enfant présentant des signes d’autisme, je régresse et je perds mes mots, ma capacité à imaginer un public et à anticiper mentalement l’impact de mes mots sur lui.
J’essaie de me souvenir de ce que j’ai écrit pour le Guardian il y a cinq ans, le dernier jour normal de ma vie. J’essaie d’imaginer les personnes qui ont lu cet article et l’impact qu’il a eu sur elles, j’essaie de me souvenir de ce que cela faisait, quand demain semblait si plein de possibilités et que mes mots semblaient avoir le pouvoir d’influencer (ne serait-ce que légèrement) ce à quoi ce demain ressemblerait.
Je ne peux pas vraiment m’en souvenir. Demain sera exactement comme aujourd’hui, et hier, et tous les jours précédents, et tous les jours suivants. Je n’ai aucune influence sur rien.
Mais il y a une chose dont je me souviens, une chose que je sais, c’est que le sentiment de possibilité était réel. Il était peut-être naïf de croire que notre rêve pouvait se réaliser, mais il n’était pas insensé de croire qu’un autre monde était possible. Il l’était vraiment. Ou du moins, c’est ainsi que je m’en souviens.
Cinq métaphores sur la guérison
Écrit dans le Kiosque de la Solitude, Commissariat de police de Doqqi. Publié le 26 septembre 2019, dans Mada Masr.
I. Renaître
« Chaque séparation donne un avant-goût de la mort, chaque réunion un soupçon de la résurrection. »
– Arthur Schopenhauer
« Tu dois être prêt à te brûler dans ta propre flamme ; comment pourrais-tu renaître si tu n’es pas d’abord devenu cendre ? »
– Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra
Pendant la majeure partie de son histoire, l’humanité a été aux prises avec deux certitudes : la vie est souffrance, et l’innocence, une fois perdue, ne peut jamais être retrouvée. Pourtant, les écritures et les mythes résonnent d’alternatives alléchantes de mort et de renaissance, de sacrifice et de résurrection : des variations sur le phénix dans lesquelles la combustion de l’ancien et l’émergence du nouveau de ses cendres nous donnent une chance de briser le cycle du destin, soit par la table rase, soit par un retour aux sources – une continuité du soi une fois celui-ci débarrassé des blessures, des impuretés et des péchés. La douleur est le prix à payer pour la rédemption.
II. Amputer et cautériser
« On est toujours dans la position de devoir décider entre l’amputation et la gangrène. L’amputation est rapide, mais le temps peut prouver que l’amputation n’était pas nécessaire – on peut aussi pourtant retarder l’amputation trop longtemps. La gangrène est lente, mais il est impossible d’être sûr que l’on lit correctement ses propres symptômes. L’idée de traverser la vie comme un infirme est insupportable, et tout aussi insupportable est le risque de se gonfler lentement, dans l’agonie, de poison. »
– James Baldwin, Chroniques d’un enfant du pays
Le corps, et non l’âme, est le lieu de la douleur. L’homo sapiens n’est qu’un animal rationnel. La médecine moderne, avec son rationalisme, sa terminologie, ses méthodes et ses machines, est capable de guérir toutes les douleurs. La médecine est née de la chirurgie. D’actes de violence précis. Une précision qui peut dicter l’ablation d’un organe entier malade, non pas parce que l’organe est jetable mais parce qu’il n’est pas essentiel. Tant que vous êtes en vie et en possession de vos facultés mentales, vous êtes en forme. Qui d’entre nous n’a pas rêvé d’une délivrance décisive de la douleur ? Et si la douleur persiste après l’opération, n’ayez crainte car ce sont des douleurs fantômes, de simples illusions provoquées par votre système nerveux. Il suffit d’être rationnel. Si vous vous inquiétez que votre imagination et votre esprit ne fassent qu’un, la psychiatrie est là pour cela. Faites confiance aux experts et détendez-vous. Amputez, puis cautérisez, et avant cela, anesthésiez. Et une fois l’acte accompli, les analgésiques, la thérapie de rééducation et la patience vous permettront de vous en sortir. La vie continuera.
III. Recycler
« Nous construisons l’ordre nouveau avec les briques que l’ordre ancien nous a laissées. »
– Vladimir Lénine
« Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C’est à cela que doit ressembler l’Ange de l’Histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d’événements, il ne voit, lui, qu’une seule catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruines sur ruines et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s’attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais du Paradis souffle une tempête qui s’est prise dans ses ailes, si violemment que l’ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l’avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s’élève jusqu’au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. »
– Walter Benjamin, « Thèses sur la philosophie de l’histoire »
La souffrance n’est pas un sacrifice et le corps n’est pas une machine. La douleur n’est pas seulement la vôtre ; chaque individu appartient à une classe sociale et ces classes émergent au fur et à mesure que l’histoire avance. Vous pouvez devenir un agent de l’histoire, au lieu d’en être la victime. Faites de votre douleur une révolution, votre souffrance est résistance. Détruisez les sources de douleur, et avec les ruines de l’ancien, nous construirons le nouveau, mettant en pratique notre capacité d’agir collective. C’est inévitable, car l’histoire suit une logique aussi déterministe que les lois de l’univers matériel. Il suffit de reconnaître le bon moment quand il arrive, et de choisir la bonne faction.
IV. Hanter
« Les sociétés capitalistes peuvent toujours pousser un soupir de soulagement et se dire : le communisme est fini depuis l’effondrement des totalitarismes du XXe siècle, et non seulement il est fini mais il n’a pas eu lieu, ce ne fut qu’un fantôme. Elles ne peuvent que dénier ceci, l’indéniable même. Un fantôme ne meurt jamais, il reste toujours à venir et à revenir. »
– Jacques Derrida, Spectres de Marx[2]
On ne vous éjecte pas de l’histoire tant que vous pouvez encore parler ; on ne vous bannit pas dans le passé tant que vous pouvez encore écouter. Mais quel présent habitez-vous ? Hantez les rêves de vos camarades, et les cauchemars de vos ennemis ; vivez dans un futur qui n’est jamais venu – soyez un spectre, un souvenir, et un signe annonciateur. Rappelez-leur que l’état actuel n’était pas inévitable jusqu’à ce qu’il advienne. Ne vous occupez pas de la question de savoir pourquoi ce futur tout à fait possible a échoué, laissez les vainqueurs chercher tant bien que mal des réponses. Soyez la question, et ne vous souciez pas de votre impuissance. Un fantôme n’a pas besoin de présence matérielle ni d’action, il suffit de briller.
V. Régénérer
« Chez les salamandres, la régénération après une blessure, telle que la perte d’un membre, implique la repousse de la structure et la restauration de la fonction, avec la possibilité constante d’un dédoublement ou d’autres phénomènes topographiques bizarres à l’endroit de l’ancienne blessure. Le membre qui repousse peut être monstrueux, dupliqué, puissant. Nous avons tou·tes été blessé·es, profondément. Nous avons besoin d’une régénération, pas d’une renaissance, et les possibilités de notre reconstitution incluent ce rêve utopique, l’espoir d’un monde monstrueux sans genre. »
– Donna Haraway, Manifeste cyborg
Il ne peut y avoir de retour au paradis perdu, car nous ne sommes pas né·es innocent·es ; il ne peut y avoir de résurrection, car nous ne sommes pas saint·es, et nos sacrifices n’ont pas été faits consciemment. Aucune chirurgie ne peut nous guérir ni aucun médicament, car la décision d’amputation ne nous appartient pas, et aucune recherche clinique n’a été menée pour évacuer nos maux en les expliquant. Il n’y aura pas de reconstruction, car la terre elle-même ne peut plus supporter de nouveaux défrichements. Remettons après la mort le vagabondage de nos âmes, car chacun·e d’entre nous est hanté·e par des camarades disparu·es, et il ne faudrait pas les abandonner avant leur heure.
Si nous devons être traités comme des animaux sans pouvoir, qu’il en soit ainsi. Mais nous devons écarter le bétail, ignorer animaux de compagnie et autres domestiques. Nous nous tournerons vers les lézards, les étoiles de mer et les vers de terre, ces êtres qui peuvent se régénérer après une blessure, aussi grave soit-elle. Nous accepterons que les organes régénérés ne soient pas nécessairement identiques à ceux qui ont été perdus. Ils peuvent sembler mutilés, mais regardez de plus près et vous verrez la beauté dans la monstruosité, car seul le monstrueux peut tenir ensemble l’histoire des rêves et des espoirs, et la réalité de la défaite et de la douleur. Le monstrueux n’a pas besoin d’oublier ses anciennes blessures pour perdre sa peur d’en acquérir de nouvelles.
*
Copyright © Alaa Abd el-Fattah, 2021. Publié avec l’accord de Fitzcarraldo Editions et la famille d’Alaa Abd el-Fattah.
Traduction de l’anglais de Mathieu Bonzom.
Note
[1] Said Edward, Des intellectuels et du pouvoir, Seuil, Paris, 1998