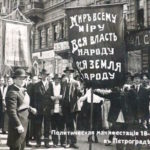L’alternative de Lénine : le double pouvoir et une politique d’un autre type
Selon Peter Thomas, Vladimir Ilitch Lénine n’est pas seulement le constructeur obstiné du parti bolchevik et le stratège brillant de la Révolution d’Octobre. Il est aussi, en tant que théoricien de la notion nouvelle de « double pouvoir », formulée en 1917, celui qui a esquissé une conception alternative du pouvoir politique, se distinguant des principaux courants de la pensée politique moderne.
L’article suivant est une version revue et augmentée d’une intervention de Peter Thomas qui a eu lieu le 25 mai 2024, comme discours de clôture de la série internationale d’événements Leninist Days/Jornadas leninistas (27 janvier au 25 mai 2024), organisée en commémoration du centenaire de la mort de Lénine. Il a été initialement publié le 28 janvier dernier sur le site de la revue Communis, l’un des organisateurs, avec la revue Historical Materialism, des Journées léninistes.
Peter D. Thomas est philosophe et enseigne à l’Université Brunel de Londres. Spécialiste de Gramsci et du marxisme occidental, il est l’auteur de The Gramscian Moment : Philosophy, Hegemony and Marxism (Brill, 2009). Il a également codirigé Encountering Althusser : Politics and Materialism in Contemporary Radical Thought (Bloomsbury, 2013) et fait partie du comité éditorial de Historical Materialism.
***
Il existe de nombreux Lénine, comme en témoigne amplement l’étonnante galerie d’images discordantes présentée tout au long de ces remarquables quarante et une « Journées léninistes ». C’est là, en effet, l’un des signes les plus sûrs du statut désormais « classique » de Lénine : tant de lecteurs différents ont pu trouver dans sa pensée et son action autant de manières d’aborder les questions historiques et contemporaines, et surtout une manière de saisir l’imbrication constante de l’historique et du contemporain.
Lénine est un « classique » en ce sens précis : non pas un monument figé issu du passé, mais un prisme réfractant à travers lequel le présent peut chercher à acquérir de nouvelles perspectives sur sa relation à lui-même[1].
Compris ainsi, il ne peut jamais être question de choisir entre l’un ou l’autre de ces Lénine : Lénine l’organisateur du parti et le théoricien austère de la discipline organisationnelle, par opposition à Lénine le tacticien presque anarchiste de la spécificité temporelle de l’intervention politique dans les rapports de force existants, par exemple, ou Lénine le praticien poétique (dadaïste ?) du slogan opportun, par opposition au défenseur pragmatique de la Nouvelle Politique Économique et de la Révolution culturelle[2].
Nous avons besoin de tous ces Lénine, de tous ces angles de vue différents sur le passé, le présent et l’avenir de la politique révolutionnaire au sens authentique, en tant que tradition vivante. La capacité à les hériter tous, dans leur conflictualité et leur créativité, au cours des vingt dernières années et tout au long de cette série de séminaires véritablement mondiale, peut, en ce sens, être considérée comme un indice de la maturation croissante d’une nouvelle culture socialiste générationnelle[3].
Dans ce texte, je propose de me concentrer sur un seul de ces Lénine, et plus précisément sur un moment très bref, presque éphémère — peut-être même marginal dans l’ensemble de son parcours —, bien que son influence ultérieure et sa réception par divers courants marxistes conflictuels l’aient rendu beaucoup plus central qu’il ne l’était historiquement ou textuellement. Il s’agit de Lénine en tant que théoricien de la notion nouvelle de « double pouvoir », formulée au milieu de l’année 1917.
Ma thèse est que ce Lénine esquisse une conception alternative du pouvoir politique, et plus précisément, une forme de politique qui se distingue radicalement des principaux courants de la pensée et de la pratique politiques modernes.
Quelles sont les caractéristiques centrales des grands courants de la pensée politique moderne, et en quoi Lénine s’en distingue-t-il ? De manière forcément schématique, ces courants peuvent être décrits comme une lignée qui va de Jean Bodin (1530–1596), Thomas Hobbes (1588–1679) et Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) à Max Weber (1864–1920), Carl Schmitt (1888–1985), John Rawls (1921–2002), et au-delà. Tous, à des degrés divers, conçoivent la politique — en tant que politique — comme le processus de production de l’unité par le biais d’une relation d’autorité et de commandement.
Pour cette tradition (elle-même conflictuelle et traversée de tensions), la politique est l’instance qui, dans les formations sociales modernes, agit comme une contrainte au sens littéral : une instance de régulation, de décision, et donc d’imposition d’un ordre — quel qu’il soit — sur ce qui est supposé être le désordre originel du pré-politique ou du non-politique, qu’il soit compris comme social, économique, éthique, moral ou autre[4].
La politique est ainsi conçue comme un mécanisme d’affirmation de ce que cette tradition désigne comme la « souveraineté » : l’instance ultime du pouvoir politique, au-dessus ou au-delà de laquelle il ne peut y avoir d’appel effectif, ni sur le plan structurel ni sur le plan temporel. Dans les termes fondateurs de Jean Bodin (1530–1596), pour être véritablement souveraine, la souveraineté doit être absolue, perpétuelle et, surtout, indivisible — autrement dit, un pouvoir qui ne saurait être partagé ou réparti entre le souverain et ses sujets.[5]
La souveraineté postule ainsi une séparation permanente et structurelle entre les gouvernants et les gouvernés, ou, en d’autres termes, entre la force organisationnelle et la pratique associative. C’est sur cette base qu’une relation circulaire peut s’établir entre les moyens (la politique) et la fin (la souveraineté), dans laquelle cette dernière rétroagit sur les premiers, rendant contradictoire toute conception de la politique qui ne soit pas souveraine.
Cette insistance sur une unité politique incontestable, indivisible et durable conduit nécessairement au principe – et à la pratique – de la politique comme « représentation », au sens très spécifique de « re-présentation » de ce qui a été rendu absent (sur les plans logique et temporel), une absence produite précisément pour permettre cette re-présentation[6]. La représentation, dans ce sens précis, ne doit pas être comprise uniquement au sens institutionnel restreint de la tradition parlementaire, où elle valorise la conscience responsable et pondérée du représentant face au caprice du délégué.
Elle doit plutôt être envisagée comme la formalisation de pratiques plus générales d’absence : l’absence des énergies et perspectives de la grande majorité des membres d’une formation sociale (en particulier les classes ouvrières au sens large, ou, selon les termes de Gramsci, les groupes sociaux subalternes), remplacées – ou re-présentées – par des élites de divers types dans des processus politiques définis de manière strictement institutionnelle.[7]
Ce n’est pas seulement la célèbre gravure du Léviathan de Hobbes – ce corps unifié contenant et ordonnant des multitudes autrefois chaotiques – qu’il faut considérer dans cette perspective élargie. Même un critique explicite du principe de représentation comme Rousseau reproduit la logique d’une « représentation absente » au cœur de sa notion de volonté générale[8]. En effet, la rapidité de la transition que Rousseau préconise entre la volonté de tous (divisée) et la volonté générale(unifiée) pourrait être considérée comme un exemple encore plus paradigmatique de ce processus d’absence-représentation que chez son prédécesseur hobbesien.
La volonté générale fonctionne en effet comme une instance d’imposition transcendantale de l’ordre, précisément par le biais d’une logique soustractive : elle constitue ce qui subsiste, comme instance universelle formelle, une fois que toutes les revendications particulières empiriquement existantes ont été disqualifiées en tant que contingentes.
Comme l’a formulé Rousseau dans un passage célèbre :
« Il y a donc bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale : celle-ci ne regarde qu’à l’intérêt commun, l’autre à l’intérêt privé, et n’est qu’une somme de volontés particulières ; mais ôtez de ces volontés les plus et les moins qui s’entre-détruisent, reste pour somme des différences la volonté générale. »[9]
L’argument de Rousseau a joué un rôle central dans l’émergence de la notion de souveraineté populaire, souvent présentée comme une alternative démocratiquement plus acceptable aux revendications absolutistes — fréquemment, et à tort, considérées comme le fondement de la théorie de la souveraineté chez Bodin.
Dans cette perspective, l’adjectif « populaire », valorisé positivement, est non seulement censé qualifier ou modérer un substantif devenu suspect (« souveraineté »), mais tend même, en un sens, à le nier.
Pourtant, l’impulsion qui sous-tend la théorisation bodinienne — à savoir la tentative de dériver un principe de pouvoir politique suprême à partir de la nature hiérarchique de la constitution de la communauté politique (entre gouvernants et gouvernés) — ne trouve peut-être son aboutissement logique que dans la notion même de souveraineté populaire. Autrement dit, dans une souveraineté du peuple où l’abstraction d’une singularité-multiplicité est affirmée comme source ultime de la décision politique — sans oppositions internes ni contestations (telles que les factions séditieuses d’intérêts privés, selon Rousseau), et surtout, sans extérieur.
En tant qu’unité politique complète et totalisante, le peuple est, à proprement parler, indénombrable, et c’est précisément pour cette raison qu’il peut occuper la place du souverain singulier[10]. En tant qu’abstraction produite par la représentation, le peuple en vient ainsi à fonctionner à la fois comme sujet — détenteur du pouvoir souverain — et comme objet — gouverné par « lui-même ». Le rêve de Bodin — celui d’une souveraineté fondée sur une fusion stable entre gouvernants et gouvernés, au sein d’une communauté politique close, sans extériorité — ne trouve, pourrait-on dire, sa réalisation la plus aboutie que dans cette déclinaison populaire.
La politique bourgeoise et capitaliste est, en ce sens, constitutivement représentative et souveraine, constituant un moment clé de condensation de ce que j’ai ailleurs qualifié de processus plus généraux de subalternisation qui ont caractérisé la modernité politique[11]. Ce substitutionnisme ne se limite évidemment pas aux formes particulières de subalternisation caractéristiques de la démocratie représentative bourgeoise ; il a constitué une dynamique active, y compris – et surtout – dans l’histoire des forces d’opposition politique.
La constante de ces processus, historiquement variables, réside dans la primauté accordée à l’organisation sur l’association, ce qui engendre une distance formelle infranchissable entre le pouvoir politique et les savoirs politiques, dans leur pluralité.
Même dans les régimes dits « populaires », le maintien d’une séparation entre la capacité décisionnelle d’un organe centralisé et les pratiques d’association multiples et superposées garantit l’existence d’un fossé structurel entre gouvernants et gouvernés.
En ce sens, la souveraineté subalterne nécessairement, puisqu’elle assigne structurellement une position subordonnée permanente à toute instance non souveraine.
En réalité, la souveraineté ne peut se soutenir sans cette subalternisation, dans la mesure où elle dépend d’une soumission généralisée— autrement dit, d’une reconnaissance de soi comme instance ultime — pour affirmer, avec succès, sa propre prétention à la souveraineté.
Dans ce contexte, en quel sens puis-je soutenir que Lénine doit être distingué des théoriciens de la politique conçue comme souveraineté, et que la notion de double pouvoir constitue, en particulier, une alternative théorique au courant dominant représentatif du parti de l’ordre bourgeois souverain ?
Après tout, le double pouvoir a été plus souvent compris comme un exemple de l’analyse concrète d’une conjoncture concrète (selon la célèbre formule d’Althusser), c’est-à-dire comme une catégorie à dominante empirique ou historique : une description de conditions spécifiques et transitoires dans l’évolution de la révolution russe de 1917, plutôt que comme une élaboration théorique à part entière.
Pour saisir la portée théorique de la notion de double pouvoir, il convient donc, en premier lieu, de suspendre certaines des lectures influentes qui lui ont été traditionnellement attribuées.
Premièrement, pour Lénine, une situation de double pouvoir ne résultait pas de l’application d’une volonté politique (du moins si l’on entend par « volonté » une orientation subjective, au sens de Willkür plutôt que de Wille, pour reprendre la distinction kantienne).
Comme il l’a initialement élaboré dans l’espace entre les deux révolutions de 1917, le double pouvoir n’était pas une question de choix : le choix plus ou moins subjectif d’un acteur politique donné entre une proposition stratégique et une autre à un moment indéterminé.
Il s’agissait plutôt d’une situation objectivement donnée ou, plus précisément, d’un rapport de force inscrit dans la structure d’une conjoncture de crise spécifique.
Il s’agissait d’un moment d’intensification d’une contradiction structurelle sous-jacente, configurée et exprimée d’une manière singulière et donc non répétable.
En ce sens, la crise conjoncturelle révolutionnaire de 1917 n’était pas arbitraire, le résultat de machinations machiavéliques de Lénine en particulier ou des bolcheviks en général, comme le suppose une certaine lecture « diabolique » généralisée[12]. Au contraire, même et surtout dans sa singularité, elle était symptomatique et expressive de la crise structurelle de la modernité politique elle-même.
Deuxièmement, précisément parce qu’il s’agissait d’un rapport de forces inscrit dans la structure d’une conjoncture de crise spécifique, l’existence d’une situation de double pouvoir ne signifiait pas un “retrait”, ni un “exode” subjectivement décidé, hors de la politique existante[13]. Lénine ne soutenait pas qu’une situation de double pouvoir pouvait être produite par un simple rejet de l’engagement avec l’appareil d’État existant, au profit d’un pouvoir “plus pur” situé ailleurs — que ce soit dans la société civile ou dans quelque autre espace prétendument libéré.
Lénine affirmait en réalité que l’engagement avec l’État existant, y compris avec les mécanismes de la démocratie parlementaire, pouvait être tactiquement utile au mouvement révolutionnaire, dans des conjonctures précises et sous certaines conditions politiques bien définies[14]. Une part de la nouveauté de la notion de double pouvoir réside précisément dans l’intégration de cette perspective réaliste au cœur même d’une crise révolutionnaire. La situation de double pouvoir en Russie, en 1917, s’est produite, pour Lénine, à la fois “dans et contre” l’État existant— pour reprendre la formulation quasi augustinienne que Mario Tronti adoptera fréquemment par la suite pour caractériser les sources des rébellions ouvrières.
Troisièmement, le double pouvoir, chez Lénine, relève moins d’une théorie pleinement développée que d’un moment explosif de clarté et d’intensité conceptuelles. Avec tout le respect dû à Poulantzas, « toutes les analyses et actions de Lénine ne sont pas traversées par le leitmotiv du double pouvoir »[15]. En réalité, le terme même de double pouvoir (dvoïévlastie) n’apparaît pas du tout dans les nombreux écrits de Lénine avant et après la révolution russe de 1917[16].
Si une telle absence textuelle peut sembler déroutante au vu de l’influence ultérieure de la notion dans la constitution de tant d’« images de Lénine », il existe une raison simple à cette lacune terminologique : la réalité à laquelle elle se rapportait n’existait pas avant 1917. La thèse de l’existence d’une situation de double pouvoir n’apparaît explicitement dans le vocabulaire politique de Lénine qu’au moment très spécifique de l’“interrègne”, entre les deux révolutions de février et d’octobre 1917. Il nous faut donc revenir à la singularité de ce moment pour clarifier la spécificité — voire la singularité absolue — de la proposition conceptuelle de Lénine.
Si une certaine approche de l’histoire des idées pourrait soutenir que le concept (par opposition au mot) de double pouvoir était déjà présent « à l’état pratique » dans les Thèses d’avril, rédigées par Lénine durant son trajet vers la gare de Finlande, il n’a en réalité été formulé explicitement qu’un peu plus tard — dans un article publié dans la Pravda le 9 avril 1917, puis exposé de manière plus célèbre dans La tâche du prolétariat dans notre révolution (rédigé le 10 avril, mais publié seulement en septembre).
Par ailleurs, le terme même de « double pouvoir » n’était pas une invention de Lénine : des auteurs de diverses orientations politiques l’avaient déjà employé pour désigner la situation anormale créée par le refus des soviets d’assumer pleinement le pouvoir après Février, laissant émerger un gouvernement provisoire aussi inefficace que fragile. [17]
Dans ces cas, la notion de double pouvoir visait à penser une configuration totalement inédite, une « imbrication de deux dictatures » — celle des soviets et celle du gouvernement provisoire. Dans son article du 9 avril, Lénine reconnaît explicitement que « personne auparavant n’avait pensé, ni n’aurait pu penser, à un double pouvoir »][18].
Le type de pouvoir politique incarné par les soviets apparaissait alors comme un pouvoir parallèle, né en dehors mais à côté de l’appareil d’État existant — un appareil profondément affaibli, tant du point de vue de sa légitimité que de son fonctionnement, par une crise politique et sociale majeure.
C’est précisément cet affaiblissement qui a ouvert une brèche « machiavélienne » permettant aux soviets d’émerger comme institution politique dotée d’une certaine durabilité. Cependant, Lénine ne concevait pas ici le double pouvoir en termes manichéens, comme un affrontement entre un pouvoir pur et un pouvoir impur. Il y voyait plutôt une forme instable de « gouvernement mixte », associant des revendications concurrentes issues, pour reprendre les termes de Gramsci, de la « société politique » (formes organisationnelles) et de la « société civile » (formes associatives), dans un moment de perturbation de leurs hiérarchies établies[19].
Les fondements sociaux et les effets politiques de ces deux « gouvernements » ou « dictatures » étaient cependant radicalement distincts. Le gouvernement provisoire, aussi éphémère et fragile fût-il, prétendait incarner un « État au sens propre », c’est-à-dire un appareil d’État reposant sur le droit (administré par les élites politiques) et, en dernière instance, sur les « droits » de la propriété privée. Par son inscription dans les paradigmes de la souveraineté et de la représentation, il constituait nécessairement une forme de gouvernement répressif et subalternisant.
Son objectif était de réaffirmer et de reproduire ce que Bodin — et avant lui Machiavel — identifiaient comme le fait politique primordial : l’existence empirique de dirigeants et de dirigés — autrement dit, la configuration des rapports de force à l’origine même de la crise révolutionnaire. En ce sens, le gouvernement provisoire ne résolvait pas la crise : il la perpétuait, en l’institutionnalisant[20]. En ce sens, le gouvernement provisoire ne résolvait pas la crise : il la perpétuait, sous une forme institutionnalisée.
Les Soviets, en revanche, représentaient un « type particulier d’État » qui, aux yeux de Lénine, rappelait les caractéristiques essentielles de la Commune de Paris. La Commune et les Soviets étaient tous deux fondés sur l’initiative populaire et fonctionnaient comme tels — en particulier par le remplacement de la police et de l’armée par l’armement du peuple, ainsi que par le contrôle direct du pouvoir étatique et de l’appareil bureaucratique à travers des mécanismes de délégation et de révocation. Pour reprendre les termes de l’analyse de Marx sur la signification politique de la Commune, il s’agissait d’une forme de gouvernement expansive, à travers laquelle s’ouvrait la possibilité de commencer à élaborer l’émancipation du travail[21].
Ces deux formes de pouvoir politique étaient, au sens strict, mutuellement incompatibles, fondées sur des présupposés radicalement opposés quant à la nature et au fonctionnement des institutions politiques, et de la politique elle-même. Leur antagonisme ne pouvait qu’aboutir à la disparition de l’un des deux. Lénine soulignait le caractère exceptionnel et nécessairement transitoire d’une telle conjoncture : « Il ne fait aucun doute qu’un tel ‘enchevêtrement’ ne saurait durer. Deux pouvoirs ne peuvent coexister dans un même État », écrivait-il. « Le double pouvoir n’est que l’expression d’une phase de transition dans le développement de la révolution ». [22]
La notion de double pouvoir représente également une phase transitoire dans la pensée de Lénine, alors qu’il tentait de comprendre les configurations sans précédent apparues en 1917. Elle traverse les hauts et les bas de l’été 1917 et aboutit à une conclusion programmatique dans les réflexions renouvelées de Lénine sur les écrits de Marx sur la Commune de Paris dans L’État et la révolution. En effet, l’éruption de la situation de double pouvoir en 1917 a incité Lénine à revisiter des thèmes auxquels il méditait depuis longtemps, tout comme le déclenchement de la guerre l’avait conduit à revenir à Hegel en 1914[23].
L’État et la révolution est un ouvrage qui peut légitimement être inscrit parmi les grandes « œuvres inachevées » de la tradition matérialiste, dans la mesure où cette tradition nous permet de comprendre l’inachèvement non pas comme un manque, mais comme le produit d’une conjoncture historique déterminée par et dans la conjoncture[24].
Commencé pendant la solitude presque machiavélique de Lénine, alors hors-la-loi caché dans une meule de foin, c’est un ouvrage qu’il « abandonna » volontiers (au sens de Valéry) lorsque la vague révolutionnaire reprit au début de l’automne. Tout comme le Tractatus politicus de Spinoza (Traité politique, Paris, Garnier-Flammarion, 1966) s’interrompt de manière symptomatique au moment où commence la discussion sur la nature de la démocratie, le traité de Lénine sur la révolution s’« interrompt » précisément au moment où il s’apprête à raconter l’histoire des révolutions russes de 1905 et 1917 dans une perspective comparative. « Il est plus agréable et plus utile de vivre l’expérience de la révolution que d’écrire à son sujet », a déclaré Lénine avec son habituelle ironie après l’insurrection d’octobre.
La théorisation de la double puissance a également été interrompue par les événements de la fin de l’année 1917. Le terme a largement disparu des écrits de Lénine lorsque l’état d’exception de 1917 a pris fin avec la prise du Palais d’Hiver et tandis que le nouveau gouvernement révolutionnaire a été confronté à des contextes politiques très différents. Après la guerre civile et le reflux apparent de la vague contre-révolutionnaire, la construction hésitante d’un ordre socialiste sous la NEP a vu les bolcheviks aux prises avec les défis liés à l’occupation des « sommets » de l’autorité administrative, sans pouvoir s’appuyer sur un mouvement social puissant issu de la base, et finalement vaincus par ces défis eux-mêmes.
L’évocation des potentialités et des écueils du double pouvoir dans les écrits de Lénine est ainsi devenue, en quelque sorte, une anomalie sans précédent ni successeur. En ce sens, il s’agissait moins d’un concept achevé que d’une intuition géniale encore marquée par des ambiguïtés potentiellement productives. Il s’agissait d’une intuition qui n’avait pas été pleinement développée au moment de son émergence et qui est donc restée particulièrement ouverte à des réinterprétations et des réévaluations sans fin par les traditions marxistes ultérieures[25].
Reconstruire et actualiser une telle perspective aujourd’hui, à un moment où les luttes sociales se multiplient et s’entrelacent, exige de comprendre avec précision en quoi la notion de double pouvoir élaborée par Lénine esquisse une alternative radicale aux grands courants de la théorie politique moderne — ou, comme il le formule de manière suggestive, un « pouvoir d’un type complètement différent ». Un des courants les plus novateurs de la pensée radicale contemporaine — et sans doute l’un des lecteurs les plus inventifs de Lénine — a cependant eu tendance à interpréter cette notion d’une manière qui reste, en fin de compte, compatible (quoique de manière antagonique) avec le paradigme de la souveraineté.
Antonio Negri conçoit le double pouvoir comme le moment de réémergence d’un pouvoir constituant originel, surgissant hors des formes constitutionnelles contraignantes que l’histoire, dans sa brutalité, avait imposées à cette puissance en fusion. Cette approche, exposée dans son ouvrage majeur Insurrections (1992), s’inspire directement de sa lecture précédente de Lénine, développée dans une étude importante publiée en 1977[26].
Les « leçons » de Lénine que Negri propose dans le contexte incandescent des anni di piombo italiens ont en effet marqué un tournant dans son itinéraire intellectuel, depuis ses premières recherches sur les formes du pouvoir bourgeois — comme dans Descartes politico (1970) — jusqu’à ses tentatives ultérieures de penser des alternatives concrètes à celui-ci. Rétrospectivement, on peut voir dans la distinction que Negri établit, à partir des années 1980, entre potentia et potestas— dans ses lectures influentes et controversées de Spinoza — une transposition métaphysique des thématiques initialement explorées à travers Lénine dans un registre politique[27].
Dans cette perspective, une situation de double pouvoir correspond à la réaffirmation d’un type de pouvoir créateur qualitativement distinct, à la base de tout ordre constitutionnel. Ce pouvoir peut être réprimé ou déformé, mais jamais totalement épuisé ni éradiqué. En tant que force primordiale d’innovation, le pouvoir constituant fonctionne ici comme une cause qui, bien qu’ayant agi, s’est ensuite retirée – à l’image d’un « Dieu qui disparaît » après avoir engendré sa création. Pourtant, en tant que principe ontologique premier, il continue de subsister dans la forme qu’il a engendrée, comme « permanence de l’innovation » ou menace latente d’un retour vital au moment où l’ordre institué sombre dans la corruption ou le déclin.[28]
Ainsi comprise, la double puissance semble fusionner une théorie marxiste de la singularité de la crise révolutionnaire — toujours une surdétermination spécifique de surdéterminations multiples — avec le présupposé fondamental de la tradition du droit naturel : l’idée d’un fondement ontologique générique et ultime de l’action et du pouvoir politiques. Ce n’est qu’à partir de ce présupposé qu’une véritable « histoire naturelle » du pouvoir constituant devient concevable[29].
Cependant, concevoir une situation de double pouvoir en termes de pouvoir constituant originaire peut bien en garantir la primauté temporelle et ontologique, mais c’est aussi l’exposer à une disparition rapide, presque dès son apparition. Comme le rappelait Lénine, « un tel “entrelacement” des pouvoirs ne peut durer longtemps ». Par définition, une situation de double pouvoir constitue une exception au fonctionnement « normal » de la souveraineté — entendue, selon Bodin, comme une autorité prétendant être absolue, indivisible et perpétuelle.
Aussi séduisante que puisse paraître l’idée d’un « double pouvoir permanent » — c’est-à-dire d’un contexte où des institutions d’auto-organisation populaire, relativement autonomes, coexisteraient durablement avec des formes établies de pouvoir étatique, les harcelant de manière intermittente à travers une série d’escarmouches de type guérilla pendant une crise structurelle prolongée — cette idée ne permet pas de résoudre l’un des paradoxes fondamentaux au cœur même de la notion de pouvoir constituant[30].
Ce paradoxe réside dans le fait que le pouvoir constituant ne peut être défini en tant que tel — et surtout distingué comme pouvoir constituant — qu’à travers sa différence temporelle ou formelle avec le pouvoir constitué dont il est censé être l’origine. Si cette différence est pensée dans des termes temporels, le pouvoir constituant apparaît à la fois comme antérieur et comme interne à l’État souverain moderne : il représente le fondement historique et structurel que la consolidation de l’État tend à subalterniser — au sens hégélien double d’annulation et de conservation simultanées.
Si, à l’inverse, cette différence est conçue de manière formelle, le pouvoir constituant ne précède pas l’ordre constitutionnel, mais il en est la condition transcendante de possibilité, une « cause absente » reconstruite a posteriori. »[31] Dans les deux cas, le pouvoir constituant en vient à fonctionner comme une alternative au moment originel abstrait du contrat social – mais qui n’est finalement pas moins abstraitement mythique.
Dans une situation de double pouvoir durable ou permanent, un pouvoir constituant faiblement émergent resterait structurellement subalterne à l’ordre établi, revendiquant performativement une autonomie que cette même performance contredit, puisqu’elle ne peut avoir lieu qu’en reconnaissant la présence continue de son antagoniste. Plus une telle situation de « double pouvoir de faible intensité » dure, plus le pouvoir constitué a l’occasion de se réaffirmer comme la seule instance politique organisatrice.
La montée et le déclin des mouvements radicaux au cours des trente dernières années ont largement illustré cette dialectique tragique : depuis le confinement progressif et l’épuisement du soulèvement zapatiste initial jusqu’à la dissolution des mouvements radicaux dans les places publiques qui avaient nourri le « printemps arabe » et ses répercussions, une fois la « normalité » — autoritaire en Égypte, parlementaire en Turquie — (ré)imposée.
Une telle conception ontologique du double pouvoir tend également à occulter non seulement l’accent mis par Lénine sur le caractère temporairement exceptionnel du double pouvoir en tant qu’interrègne, mais aussi le sens précis dans lequel les Soviets représentaient effectivement pour lui un pouvoir (vlast’) analogue à l’autorité souveraine — mais un « pouvoir d’un type tout à fait différent ».
Quelle était la nature de cette différence ? Le pouvoir soviétique ne se distinguait pas par une incommensurabilité avec le pouvoir revendiqué par le gouvernement provisoire : une mesure commune leur avait déjà été imposée par la conjoncture, les deux formes de gouvernement revendiquant la suprématie dans une même formation sociale. Ni les Soviets ni le gouvernement provisoire ne se présentaient simplement comme des formes génériques de pouvoir (au sens wébérien de Macht, simple capacité d’agir).
Tous deux prétendaient incarner une autorité suprême concrète dans la conjoncture bien particulière de 1917 — en termes wébériens, comme Herrschaft (domination), c’est-à-dire une autorité capable de contraindre les actions ou de les imposer même contre la volonté des intéressés[32]. Si les décrets du gouvernement provisoire avaient pu obtenir un consentement au moins passif ou tacite (dans la mesure où ils n’étaient pas activement contestés par des secteurs stratégiques de la population), les prétentions des Soviets à représenter un pouvoir gouvernemental alternatif n’auraient sans doute pas été prises au sérieux bien longtemps.
Cette insistance sur la revendication d’une autorité suprême par les Soviets implique-t-elle dès lors que la notion léninienne de double pouvoir soit, au fond, compatible avec la « conception univoque du pouvoir » défendue par ses contemporains Max Weber et Carl Schmitt, comme l’a soutenu Antonio Negri ?[33] Le double pouvoir participe-t-il, peut-être à son insu, au paradigme de la souveraineté — sinon dans sa forme hobbesienne la plus austère (ainsi que l’a suggéré de manière provocatrice Lars Lih )[34], du moins dans sa variante de « souveraineté populaire », qui, depuis le XIXe siècle — et de manière encore plus affirmée après la guerre froide —, s’est imposée comme le fondement historiquement dominant de tout régime gouvernemental souverain durable ?[35]
C’est l’argument de Lénine, selon lequel les soviets incarnaient un « pouvoir d’un type tout à fait différent », qui empêche leur récupération dans le cadre du modèle souverain de l’autorité politique, qu’il soit absolutiste ou populaire. Il s’agissait d’un pouvoir d’un type radicalement autre, à la fois par la manière dont il était produit et par celle dont il fonctionnait : non pas comme une autorité souveraine, mais à sa place. La logique d’absence propre à la représentation — centrale dans la structuration souveraine de l’ordre social — se retournait contre elle-même : le contrôle par les soviets des points névralgiques de la société « re-présentait » l’autorité souveraine rendue absente par l’initiative des forces populaires.
Production : D’un côté, les prétentions du gouvernement provisoire s’inscrivaient dans le paradigme établi de la production de la souveraineté moderne : légalité garantie par la forme constitutionnelle, légitimité produite par des mécanismes de représentation (fussent-ils limités), primauté du commandement, continuité dans le temps consolidée par le droit, etc. De l’autre, les soviets héritaient d’une vieille tradition révolutionnaire qui insistait sur le caractère toujours révocable de toute délégation politique. Le contrôle permanent de l’application des décisions des soviets — c’est-à-dire l’articulation des fonctions exécutive, législative et administrative dans un rapport organique de correction mutuelle — constituait la base d’un ordre politique sans cesse révisable, autrement dit, d’un réagencement politique permanent. Pour reprendre les réflexions de Marx sur la Commune de Paris, il s’agissait d’une forme politique « expansive » plutôt que répressive[36].
Fonction : La fragile prétention du gouvernement provisoire à représenter une autorité souveraine visait avant tout à affirmer la primauté du commandement politique sur le social, et la permanence de l’ordre comme finalité de l’exercice du pouvoir. Autrement dit, la vlast’ du gouvernement provisoire tendait à préserver l’ordre établi, fondé sur le « droit » à la propriété privée comme principe structurant du domaine public. À l’inverse, les soviets étaient conçus, dans l’argument de Lénine, non comme une variante de l’« État au sens propre » moderne et représentatif, mais comme une rupture naissante avec sa logique fondamentale. Leur revendication du pouvoir décisionnel suprême surgissait négativement, comme négation spéculaire de la revendication concurrente de leurs adversaires. La prise dramatique du Palais d’Hiver n’était donc pas tant une occupation du lieu de la souveraineté qu’un encerclement visant à empêcher sa capture par l’ennemi, et à le vider de l’intérieur. C’était un refus de reconnaître l’existence de tout pouvoir supérieur susceptible de faire obstacle à l’institutionnalisation du réagencement permanent que les soviets mettaient eux-mêmes en œuvre — y compris leur propre pouvoir, qui n’était pas auto-affirmatif, mais un moyen en vue d’un objectif : l’émancipation populaire.
La différence entre les types de pouvoir représentés par le gouvernement provisoire et les soviets ne relevait donc ni d’une incommensurabilité de deux pouvoirs qualitativement distincts, ni d’une simple opposition symétrique entre deux forces antagonistes, tranchée par un excès de puissance. Elle résidait dans la nature même et la fonction du type de pouvoir que leur occupation du lieu de la souveraineté exprimait et produisait. En adaptant une formule de René Zavaleta Mercado (1937-1984), on pourrait qualifier cette différence de « dualité du double pouvoir »[37].
Zavaleta préférait parler de « dualité des pouvoirs » (dualidad de poderes), plutôt que de « double pouvoir » (doble poder) ou de « pouvoir dual » (poder dual), pour souligner que la situation révolutionnaire théorisée par Lénine (et après lui, Trotsky) ne relevait pas de la bifurcation d’un « pouvoir unique classique », mais de l’émergence de « deux pouvoirs, deux types d’État » fondamentalement incompatibles[38].
Cette théorisation fut notamment influencée par les débats et expériences des années 1970 autour de situations de double pouvoir, en particulier l’Assemblée populaire en Bolivie et la brève séquence de l’Unité populaire au Chili — réflexions marquées tragiquement par la postface que Zavaleta ajouta à l’édition originale après les événements du « premier 11 septembre ». Cependant, cette théorisation de la dualité des pouvoirs me semble ambiguë, partagée entre une lecture quantitative (pouvoir majoritaire contre pouvoir minoritaire, populaire contre élitaire) et une distinction qualitative entre des pouvoirs structurés et fonctionnant selon des logiques différentes — des « types d’État » opposés —, mais agissant tous deux sur un même objet : la société, enjeu commun de leur lutte.
En réactivant la notion de « dualité du double pouvoir », je cherche plutôt à souligner le déséquilibre entre les deux pouvoirs en concurrence pour occuper le lieu de l’autorité souveraine. Un pouvoir — celui du gouvernement provisoire — cherchait à conquérir la souveraineté pour la conserver : il s’agissait, selon la terminologie de Poulantzas, d’un « pouvoir unitaire » visant à condenser en lui-même tous les conflits sociaux pour les réguler. La souveraineté fonctionnait ici comme une fin en soi, et comme une représentation d’elle-même ; dans les termes hobbesiens repris par Lih, elle cherchait effectivement à « submerger » et « intimider tous les autres » pour imposer l’ordre et l’obéissance (passive) des sujets.
Le pouvoir incarné par les soviets, en revanche, visait bien à occuper le lieu « normal » de la souveraineté lors de la prise du Palais d’Hiver — mais ce n’était pas pour maintenir le système souverain existant. Il s’agissait au contraire de désactiver le fonctionnement normal non seulement du gouvernement provisoire, mais de la souveraineté elle-même, afin de permettre au pouvoir déjà en action dans les soviets de se déployer davantage, dissolvant le « lieu » de la souveraineté dans le non-lieu d’une relation politique de réorganisation continue du social et du politique.
Malgré l’opinion de Lih, c’est en ce sens précis que le mot d’ordre de Lénine — « Tout le pouvoir aux soviets ! » — revêtait une signification historiquement concrète et explosive : non pas comme l’affirmation d’un Léviathan communiste, mais comme le remplacement de la permanence de la souveraineté, conçue comme unité hiérarchique des instances d’organisation et d’association, par la permanence du mouvement révolutionnaire lui-même[39].
À double face, les soviets participaient — et en même temps ne participaient pas — au paradigme de la souveraineté moderne. Mais c’est là que résidait le pari audacieux des bolcheviks. En affirmant qu’il était temps d’assumer la responsabilité gouvernementale par l’insurrection d’octobre et la dissolution du gouvernement provisoire, même sous sa forme formelle, ils pariaient sur le fait que la relation politique immédiate et populaire incarnée par les soviets — comme « gouvernement fonctionnel » de type Commune de Paris — pourrait soutenir la révolution dans sa permanence, en décomposant la souveraineté.
À travers les reculs et renversements qui suivirent rapidement Octobre — la guerre civile, la NEP, la politique du front unique comme tentative de « révolution culturelle » —, le processus révolutionnaire russe fut marqué par des tentatives frénétiques de retrouver cette fragile utopie, avant qu’elle ne soit définitivement balayée par la restauration d’une souveraineté nue et absolutiste dans la contre-révolution stalinienne.
Isolée dans les « sommets décisifs » du pouvoir d’État souverain, l’expérience originelle de la dualité du double pouvoir dans la révolution russe fut incapable d’empêcher le retour d’un système de souveraineté classiquement austère — ou, pour reprendre la terminologie de Gramsci, la réaffirmation de la primauté de l’organisation sur l’association, et la subalternisation de toutes les instances sociales à la rationalité de la société politique.
Cette expérience fut répétée, encore et encore, à l’issue des grandes insurrections populaires du XXe et du XXIe siècle, au point qu’aujourd’hui rares sont celles et ceux qui considèrent la dissolution de la société politique autrement que comme une utopie au sens péjoratif. Est-il encore possible de résister au retour, apparemment inévitable, de la politique du parti de l’ordre ? Une situation de double pouvoir, en tant qu’ouverture objective — opportunité — pour faire émerger une politique d’un autre type, est-elle encore possible aujourd’hui ?
Des réponses concrètes à cette question ne peuvent être formulées que par et dans les mouvements de lutte actuels — des mouvements qui, comme je l’ai soutenu ailleurs, sont sans doute bien plus vivants et créatifs qu’on ne le croit souvent[40]. Il n’est guère besoin d’insister sur la distance qui nous sépare des énergies révolutionnaires cristallisées dans les soviets de 1917 ; un récit ressassé de défaites (souvent imaginaires) au cours des cinquante dernières années nous rappelle sans cesse notre condition post-lapsaire[41]… Pourtant, il est frappant que les mouvements récents aient redécouvert des dynamiques comparables de participation populaire et d’autonomisation dans des dispositifs institutionnels collectifs et délibératifs, malgré leurs limites et contradictions.
La proposition de Lénine d’une « politique d’un autre type » offre à ces mouvements un rappel critique structurant autour de quatre principes fondamentaux :
1/ La politique telle qu’elle est actuellement constituée, dans ses formes souveraines et représentatives officielles, n’est pas un antidote à la subalternisation ; elle en est même l’un des instruments les plus puissants de généralisation et de normalisation à l’échelle du champ social tout entier. Aucun pouvoir souverain ne viendra nous sauver…
2/ Faire de la politique radicale aujourd’hui, c’est le faire en étant pleinement conscient non seulement des limites de la politique institutionnelle, mais aussi du fait que la politique telle que nous la connaissons — y compris, et parfois surtout, la politique dite radicale — est souvent l’expression des problèmes mêmes que nos mouvements cherchent à résoudre. Hiérarchies de commandement, prétentions à la prééminence de groupes restreints, pratiques de pacification ou blocages structurels des énergies : rien de tout cela n’est étranger aux cultures politiques oppositionnelles, surtout dans des mouvements fondés sur l’intersection de trajectoires, de revendications et d’objectifs divers. Ce n’est pas la prise du pouvoir souverain, mais sa déconstruction qui reste l’objectif final de la politique révolutionnaire.
3/ La politique ne suffit pas. Le type de politique qui ne reproduit pas la subordination de l’association à l’organisation propre à la modernité politique reste un projet à venir, et non un héritage disponible. Être simplement « plus politique » à l’intérieur des cadres actuels ne suffit pas. Ce qui est décisif, c’est le type de politique dans lequel s’engagent les mouvements émancipateurs — à la fois dans leur rapport aux structures politiques existantes, et surtout dans l’innovation de formes politiques nouvelles au sein même de ces mouvements. La permanence du mouvement révolutionnaire implique la nécessité de révolutions dans la révolution.
4/ Enfin, pas de politisation sans désubalternisation : en tant que critique concrète de la représentation et de la souveraineté, non seulement comme institutions, mais comme orientations fondamentales visant à restaurer l’ordre établi dans les moments de crise. Le défi central des mouvements radicaux d’aujourd’hui n’est pas de politiser des revendications prétendument « sociales », ni de les faire représenter au niveau politique ; nos mouvements intersectionnels ont déjà prouvé que les rapports de force politiques traversent tous les espaces sociaux. C’est la forme même de la politisation dans les mouvements qui déterminera leur capacité à se développer. La critique concrète de la souveraineté et de la représentation comme logiques gouvernantes de l’action politique, par l’expérimentation de pratiques alternatives de délégation et d’émancipation populaire, constitue aujourd’hui le premier pas de notre génération vers l’invention d’une « politique d’un autre type », capable d’hériter de la proposition radicale de Lénine.
*
Traduit de l’anglais pour Contretemps par Christian Dubucq.
Notes
[1] Sur une telle conception dialogique plutôt qu’antiquaire du classicisme, voir Niccolò Machiavel (1469-1527), Lettre à Francesco Vettori, 10 décembre 1513, dans Correspondance, éd. et trad. Jean-Jacques Marchand, Paris : Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2000.
[2] Sur ces différents visages de Lénine, voir Lars Lih, Lenin Rediscovered : “What is to be Done” in Context (Leiden : Brill, 2006) [non traduit en français] ; Alan Shandro, Lenin and the Logic of Hegemony. Political Practice and Theory in the Class Struggle (Leiden : Brill, 2014) [non traduit en français] ; Jean-Jacques Lecercle, Lénine et l’arme du langage (Paris : La Fabrique, 2024) ; Moshe Lewin (1921-2010), Lenin’s Last Struggle (Londres : Pluto, 1994), trad. fr. La dernière bataille de Lénine (Paris : Éditions de Minuit, 1979) ; Craig Brandist, The Dimensions of Hegemony: Language, Culture and Politics in Revolutionary Russia (Leiden : Brill, 2015) [non traduit en français] ; Paul Le Blanc, Lenin: Responding to Catastrophe, Forging Revolution (Londres : Pluto, 2023) [non traduit en français].
La « capacité négative » à tenir ensemble toutes ces dimensions diverses de la pratique de Lénine est l’un des nombreux éléments qui distinguent les travaux biographiques récents – comme ceux de Lih, Le Blanc ou encore Reconstructing Lenin : An Intellectual Biography de Tamás Krausz (New York : Monthly Review Press, 2015), trad. fr. Repenser Lénine. Une biographie intellectuelle (Paris : Éditions Les Prairies ordinaires, 2017) de la lecture réductrice, téléologique et désormais clairement datée proposée dans la biographie influente de Lénine par Robert Service ((1947), Lenin: A Biography, Londres : Macmillan, 2000 ; trad. fr. Lénine. Une biographie, trad. Martine Devillers-Argouarc’h, Paris : Perrin, 2003.
[3] L’extraordinaire floraison de nouvelles lectures de la signification historique et contemporaine de Lénine au cours des vingt dernières années a commencé avec la conférence importante de 2001, dont les actes ont été publiés par la suite dans Lenin Reloaded : Towards a Politics of Truth, édité par Sebastian Budgen, Stathis Kouvelakis et Slavoj Žižek (Durham : Duke University Press, 2007).
[4] Dans ce sens, la distinction qu’un représentant du néo-républicanisme contemporain comme Maurizio Viroli tente d’établir au sein de cette tradition — entre Hobbes (théoricien de l’ordre formel, ou de l’ordre sans qualification) et Rousseau (axé sur les conditions spécifiques d’un ordre juste, ou d’une « société bien ordonnée ») — masque le trait décisif qu’ils ont en commun : à savoir, la présupposition selon laquelle la politique consiste en une tentative d’imposition de l’ordre sur un désordre préexistant. Chez Hobbes comme chez Rousseau, ce désordre — qu’il soit naturel pour le premier ou artificiel pour le second — est consciemment présenté comme un fondement mythique du politique. Voir Maurizio Viroli, Jean-Jacques Rousseau and the « Well-Ordered Society », Cambridge : Cambridge University Press, 1988, p. 46 et suivantes. La nécessité d’un ordre transcendantal pour produire l’unité interne d’une communauté politique dans la modernité est théorisée de manière particulièrement conséquente par Carl Schmitt — bien que, là encore, au prix du recours à une forme mythique qui l’obscurcit (chez Schmitt, l’inimitié extérieure), laquelle fonctionne comme un « ciment politique » fusionnant en un tout formaliste des éléments qui, rétrospectivement seulement, peuvent être considérés comme conflictuels en interne. Voir Carl Schmitt, La Notion de politique (Paris : Flammarion, 1992), notamment pp. 23-29 (The Concept of the Political, Chicago : University of Chicago Press, 1996).
[5] Jean Bodin, Les Six livres de la République, éd. Gérard Mairet (Paris : Librairie Générale Française, 1993). Voir en particulier le Livre I, chapitre 8 (« De la souveraineté »), pp. 111 et suiv., ainsi que le chapitre 10 (« Des véritables marques de la souveraineté »), pp. 151 et suiv., où Bodin déduit logiquement la fonction structurelle et nécessaire du pouvoir souverain à partir de la nature même de la constitution de la communauté politique comme telle — à savoir, une unité hiérarchique fondée sur le commandement et sur l’obéissance (qu’elle soit volontaire ou contrainte). Hobbes et Rousseau prolongeront et radicaliseront ensuite cette intuition, chacun à leur manière, mais sans en modifier fondamentalement la topographie ni la primauté.
[6] Sur la logique d’absentation propre à l’ordre souverain moderne, voir l’ouvrage classique d’Augusto Illuminati, J.J. Rousseau e la fondazione dei valori borghesi (Milan : Il Saggiatore, 1977).
[7] J’ai exploré la nouveauté de la conception gramscienne du subalterne dans : Peter D. Thomas, « Refiguring the Subaltern », Political Theory, vol. 46, n°6, 2018, pp. 861–884.
[8] Pour une analyse encore utile du rôle ambigu de la représentation dans l’analyse institutionnelle de Rousseau, voir Richard Fralin, Rousseau and Representation (New York : Columbia University Press, 1978) [non traduit en français]. Pour une analyse plus récente et importante, selon laquelle la notion de « volonté générale » réintroduit subrepticement une logique de la représentation derrière le célèbre rejet de la représentation par Rousseau, au nom de l’immédiateté et de la capacité d’auto-représentation de la volonté générale, voir Michael Hardt et Antonio Negri, Assemblée (Paris : Les Prairies ordinaires, 2019, trad. de Jérôme Vidal ; titre original : Assembly, New York : Oxford University Press, 2017), pp. 41 et suivantes.
[9] Jean-Jacques Rousseau, Of the Social Contract, in The Social Contract and Other Later Political Writings (Cambridge : Cambridge University Press, 1997), p. 60 de l’édition anglaise. En version française, on se réfèrera à : Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Livre II, chapitre 3.
[10] Comme l’a observé Jacques Derrida (1930-2004) : « Le Souverain Un est un Un qu’on ne peut plus compter ; il est plus d’un — au sens de plus qu’en —, au‑delà du plus d’un d’une multiplicité calculable. » — Jacques Derrida, Voyous. Deux essais sur la raison, Paris : Galilée, 2003, p. 248.
[11] Voir Peter D. Thomas, Radical Politics : On the Causes of Contemporary Emancipation (New York : Oxford University Press, 2023), en particulier pp. 117 et suivantes.
[12] Robert Service n’est que l’un des représentants récents les plus influents à avoir promu une telle lecture, dont on peut néanmoins retrouver des traces dans de nombreuses interprétations, y compris parmi des courants politiques très divers. Son ouvrage Lenin: A Biography (Macmillan, 2000) a été traduit en français sous le titre Lénine, dans une édition Perrin de 2012 (traduit par Martine Devillers‑Argouarc’h).
[13] Je fais ici référence à des notions proposées par Badiou et Negri, fondées sur des présupposés théoriques très différents, mais produisant, on peut le soutenir, des conséquences politiques similaires.
[14] Voir August H. Nimtz, Lenin’s Electoral Strategy from Marx and Engels Through the Revolution of 1905 (New York : Palgrave Macmillan, 2014) ; ainsi que, du même auteur, Lenin’s Electoral Strategy from 1907 to the October Revolution of 1917 (New York : Palgrave Macmillan, 2014).
[15] Nicos Poulantzas, L’État, le pouvoir, le socialisme (Paris : Presses Universitaires de France, 1978), p. 310
[16] Le large éventail de significations associées à la notion de vlast’ prolétarienne dans l’expérience révolutionnaire russe a été longuement exploré par Lars T. Lih (1972) au fil des années. Les premiers travaux de Lih mettaient notamment l’accent sur la difficulté de traduire le terme russe vlast’ en anglais, même si ses écrits plus récents tendent à lui associer un équivalent général possible dans la notion d’« autorité souveraine ». (Une suggestion avec laquelle je suis en désaccord dans le cas précis de l’usage que Lénine fait de dvoïévlastie en 1917, pour des raisons que j’exposerai bientôt.) Voir en particulier : « ‘Vlast’ From the Past : Stories Told by Bolsheviks », Left History, vol. 6, n° 2, automne 1999, p. 29-52 ; – « All Power to the Soviets : Marx meets Hobbes », Radical Philosophy, n° 201, février 2018, p. 64–78.
[17] Voir Tsuyoshi Hasegawa, The February Revolution, Petrograd, 1917 (Leiden : Brill, 2018).
[18] Lénine, « Sur le double pouvoir », dans Œuvres complètes, tome 24 (Moscou : Éditions du Progrès, 1964), p. 38.
[19] J’ai exploré, sous différents angles, la relation dialectique entre société politique et société civile chez Gramsci dans Peter D. Thomas, The Gramscian Moment : Philosophy, Hegemony and Marxism (Leiden : Brill, 2009), en particulier aux pages 186 et suivantes ; ainsi que dans Radical Politics: On the Causes of Contemporary Emancipation (New York : Oxford University Press, 2023), notamment aux pages 117 et suivantes.
[20] L’essentiel de la critique que Lénine adresse à la conception de l’État chez Kautsky dans L’État et la révolution tient précisément au fait que Kautsky refuse de voir que l’État moderne est nécessairement et toujours une institution du pouvoir de classe, qui perpétue une séparation entre dirigeants et dirigés, gouvernants et gouvernés — et que, dans la mesure où il est un État « au sens propre du terme », il est structurellement et constitutivement incapable de faire autrement. Sur ce point, voir les contributions, toujours précieuses, de Lucio Colletti et Lucio Magri dans Dibattito su Stato e rivoluzione (Rome : La nuova sinistra, 1970).
[21] Les notes et extraits de Lénine sur le “marxisme et l’État”, compilés à Zurich en janvier et début février 1917, ont ainsi fonctionné comme des hypothèses exploratoires initiales qui ont nourri ses observations sur la situation inédite de double pouvoir à partir de février. C’est au cours de cette période qu’il en est venu à comprendre ce que sa compilation de citations issues des classiques marxistes pouvait signifier concrètement dans les actions des Soviets — un processus d’apprentissage qui a culminé avec la réélaboration de ces citations dans la rédaction de L’État et la révolution durant l’été et le début de l’automne.
[22] Lénine, Les tâches du prolétariat dans notre révolution, in Œuvres complètes, tome 24, Éditions du Progrès, Moscou, 1964, p. 61. En juin, Lénine réaffirme l’instabilité et le caractère transitoire du double pouvoir dans Le double pouvoir a-t-il disparu ? in Œuvres complètes, tome 24, pp. 445–448. Version française disponible en ligne : https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/04/vil19170400.htm.
[23] Sur les stratégies de lecture « conjoncturelles » de Lénine, voir Stathis Kouvelakis, Lenin as Reader of Hegel : Hypotheses for a Reading of Lenin’s Notebooks on Hegel’s The Science of Logic, dans Lenin Reloaded, sous la direction de Sebastian Budgen, Stathis Kouvelakis et Slavoj Žižek, Durham & London, Duke University Press, 2007, p. 164–204.
[24] Sur le thème de « l’inachèvement » dans la tradition matérialiste, voir Slavoj Žižek, The Indivisible Remainder: On Schelling and Related Matters (Londres : Verso, 1996), p. 6.
[25] Pour des tentatives récentes, et très différentes les unes des autres, de réfléchir à la signification du double pouvoir dans la politique contemporaine, voir George Ciccariello-Maher, We Created Chávez: A People’s History of the Venezuelan Revolution (Durham : Duke University Press, 2013 ; trad. fr. Nous avons créé Chávez. Une histoire populaire de la révolution vénézuélienne, Raisons d’agir, 2014), pp. 234-256 ; Fredric Jameson, An American Utopia : Dual Power and the Universal Army (Londres : Verso, 2016 ; trad. fr. Une utopie américaine. Double pouvoir et armée universelle, Lux, 2019) ; et, à l’échelle mondiale dans les longues années 1970, Michael Hardt, The Subversive Seventies (New York : Oxford University Press, 2023).
[26] Voir Antonio Negri Insurgencies: Constituent Power and the Modern State, traduit par Maurizia Boscagli (Minneapolis : University of Minnesota Press, 1999 [1992] ; trad. fr. Insurrections. Le pouvoir constituant et l’État moderne, Paris : Éditions Amsterdam, 2023), pp. 286 et suivantes. Comparer avec La fabbrica della strategia. 33 lezioni su Lenin (Padoue : librirossi, 1977), réédité par Manifestolibri en 2004, sous son sous-titre original ; voir pp. 130 et suivantes.
[27] Voir Antonio Negri, Political Descartes : Reason, Ideology and the Bourgeois Project, traduit par Matteo Mandarini et Alberto Toscano (Londres : Verso, 2007 [1970]). (Descartes politico. La costituzione del soggetto moderno, Feltrinelli, 1970) ; The Savage Anomaly: Power of Spinoza’s Metaphysics and Politics, traduit par Michael Hardt (Minneapolis : University of Minnesota Press, 1991 [1981]) ; trad. fr. L’anomalie sauvage. Puissance et pouvoir chez Spinoza, Paris : PUF, 2007.
[28] L’argument de Negri (1933-2023), dans Insurrections, selon lequel la construction du politique doit être comprise comme le produit de « l’innovation permanente » du pouvoir constituant, s’est développé en dialogue critique avec la célèbre — et en apparence très différente — conception de l’innovation chez Pocock. Voir Antonio Negri, Insurrections. Le pouvoir constituant et l’État moderne (Paris : Éditions Amsterdam, 2023), p. 29. Dans l’interprétation que J. G. A. Pocock propose du Prince, l’innovation est conçue comme une réponse d’ordre secondaire face au flux primaire de la fortuna, pensée comme une « contingence pure, incontrôlée et non légitimée ». Voir J. G. A. Pocock, The Machiavellian Moment : Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition (Princeton : Princeton University Press, 1975), pp. 156 et suivantes. En d’autres termes, l’innovation est perçue, de manière compatible avec la tradition souverainiste, comme une tentative rétrospective d’imposer un ordre au désordre. L’inversion ontologique opérée par Negri — selon laquelle l’innovation du pouvoir constituant est toujours fondatrice, même lorsqu’elle est réprimée, de l’ordre constitutionnel qui cherche à la contenir — ne fait qu’en apparence échapper aux présupposés fondamentaux de cette logique. Car, dans la mesure où cette inversion conserve l’opposition des termes tout en en valorisant l’un au détriment de l’autre, elle perpétue, voire renforce, la logique souverainiste : l’innovation continue d’être pensée comme une instance fondatrice de l’unité politique. Ainsi, plutôt qu’un rejet du paradigme de la souveraineté en tant que tel, la conception de l’innovation chez Negri pourrait être qualifiée de « post-souverainiste » — ou, pour reprendre les termes de Walter Benjamin, comme une recherche d’une « véritable » souveraineté située avant, sous ou au-delà de la souveraineté.
[29] Pour une mise en question de cette notion, voir Antonio Negri, Insurrections. Le pouvoir constituant et l’État moderne, Paris : Éditions Amsterdam, 2023, p. 7.
[30] Cette thèse d’une situation de « double pouvoir permanent » a été explorée de manière originale dans des travaux récents de Panagiotis Sotiris. Voir Rethinking Dual Power, communication présentée lors de la conférence Historical Materialism de Londres en 2017, disponible à l’adresse suivante : https://www.academia.edu/35145688/Rethinking_Dual_Power.Voir également Michael Bray, States of Excess : Passive Revolution, Dual Power and New Strategic Impasses, communication présentée à la conférence Historical Materialism de Londres en 2022, disponible à l’adresse suivante/ https://www.academia.edu/90641614/States_of_Excess_Passive_Revolution_Dual_Power_and_New_Strategic_Impasses_HM22_.
[31] Pour des analyses de la nature paradoxale du pouvoir constituant dans une perspective constitutionnelle, voir Martin Loughlin et Neil Walker (dir.), The Paradox of Constitutionalism: Constituent Power and Constitutional Form (Oxford : Oxford University Press, 2007).
[32] Max Weber, Gesamtausgabe, volume 23 (Tübingen : Mohr Siebeck, 2013), p. 210.
[33] Antonio Negri, Fabbrica di porcellana. Per una nuova grammatica politica (Milan : Feltrinelli, 2008), p. 15. Cette œuvre a été traduit en français sous le titre : Fabrique de porcelaine, publié par Stock en 2006
[34] L’article de Lars T. Lih, All Power to the Soviets : Marx Meets Hobbes, publié dans Radical Philosophy n°201 (février 2018), pp. 64–78, constitue une contribution fondamentale au débat sur la signification théorique du mot d’ordre léniniste et sur la réalité du pouvoir soviétique. Toutefois, à mon sens, Lih identifie un peu trop rapidement l’autorité opérationnelle effective à la souveraineté en tant que telle. Or, la caractéristique déterminante de la souveraineté — de Bodin à Hobbes, en passant par Rousseau et au-delà — ne réside pas seulement dans le fait qu’elle incarne une instance de commandement suprême, d’autorité absolue, ou, pour reprendre les termes que Lih emprunte à Hobbes, dans la capacité à « intimider » toutes les autres instances sociales et ainsi garantir leur obéissance à un pouvoir établi (voir pp. 65–66). Comme le souligne Bodin lorsqu’il distingue la souveraineté d’autres formes de pouvoir suprême ou décisionnel (la tyrannie, la dictature, la magistrature, ou encore la fonction de l’archonte dans l’Athènes antique), la nouveauté de la souveraineté moderne réside dans la manière dont elle dérive une conception du pouvoir d’ordre fondamental à partir de la nature de la communauté politique — conçue comme une unité hiérarchique d’instances dirigeantes et de moments structurellement subalternes (l’indivisibilité de la souveraineté) — et fixe ces rapports comme une caractéristique permanente et nécessaire (la souveraineté comme perpétuelle). Voir en particulier la méthode définitionnelle soustractive-comparative utilisée par Bodin dans le Livre I, chapitre 8, « De la souveraineté ». Plutôt que de considérer les soviets comme une expression de la souveraineté, je proposerais donc d’adopter la formulation comparative de Tamás Krausz, selon laquelle, en octobre 1917, les autres instances sociales furent (temporairement, de manière contingente) placées « sous le contrôle des soviets » — et non, en l’occurrence, sous celui d’autres institutions ou de celles du gouvernement provisoire. Cette formulation rend plus justement compte, à mon avis, de la nature antagonique et conjoncturelle du pouvoir soviétique. Voir Tamás Krausz, Reconstructing Lenin: An Intellectual Biography (New York : Monthly Review Press, 2015), p. 201.
[35] Pour des relectures historiques de la souveraineté populaire, voir les essais réunis dans l’ouvrage dirigé par Richard Bourke et Quentin Skinner, Popular Sovereignty in Historical Perspective (Cambridge : Cambridge University Press, 2016). Malheureusement, aucune étude portant sur la pertinence des notions de souveraineté populaire chez Lénine ou dans l’expérience révolutionnaire russe au sens large n’est incluse dans ce volume.
[36] Sur la notion de forme politique expansive, voir Stathis Kouvelakis, « Marx’s Critique of the Political: From the 1848 Revolutions to the Paris Commune », Situations. Project of the Radical Imagination, vol. 2, n° 2 (2007), pp. 81-93 ; ainsi que, plus récemment, Stathis Kouvelakis, « Événement et stratégie révolutionnaire », dans Karl Marx et Friedrich Engels, Sur la Commune de Paris. Textes et controverses (Paris : Éditions sociales, 2021). Verso Books blog.
[37] René Zavaleta Mercado, El poder dual en América Latina, dans Obra completa I : Ensayos 1957-1974, éd. Mauricio Souza Crespo (La Paz : Plural editores, 2011 [1973]). Pour une discussion contemporaine importante sur la portée de ce texte, voir Susana Draper, « Hegemonía, poder dual, poshegemonía : las derivas del concepto », dans Poshegemonía : El final de un paradigma de la filosofía política en América Latina, éd. Rodrigo Castro Orellana (Madrid : Biblioteca Nueva, 2015).
[38] Zavaleta Mercado, El poder dual en América Latina, p. 378.
[39] J’ai exploré certains aspects de l’histoire de la notion de permanence de la révolution dans Peter D. Thomas, « Gramsci’s Revolutions: Passive and Permanent », Modern Intellectual History, vol. 17, n° 1 (2020), pp. 117-146. Pour les textes sources qui ont influencé la réinvention créative de cette notion par Gramsci, voir Frederick C. Corney (éd.), Trotsky’s Challenge : The ‘Literary Discussion’ of 1924 and the Fight for the Bolshevik Revolution (Leiden : Brill, 2016).
[40] Voir Peter D. Thomas, Radical Politics : On the Causes of Contemporary Emancipation (New York : Oxford University Press, 2023).
[41] Lapsaire : relatif au déclin, à la chute.