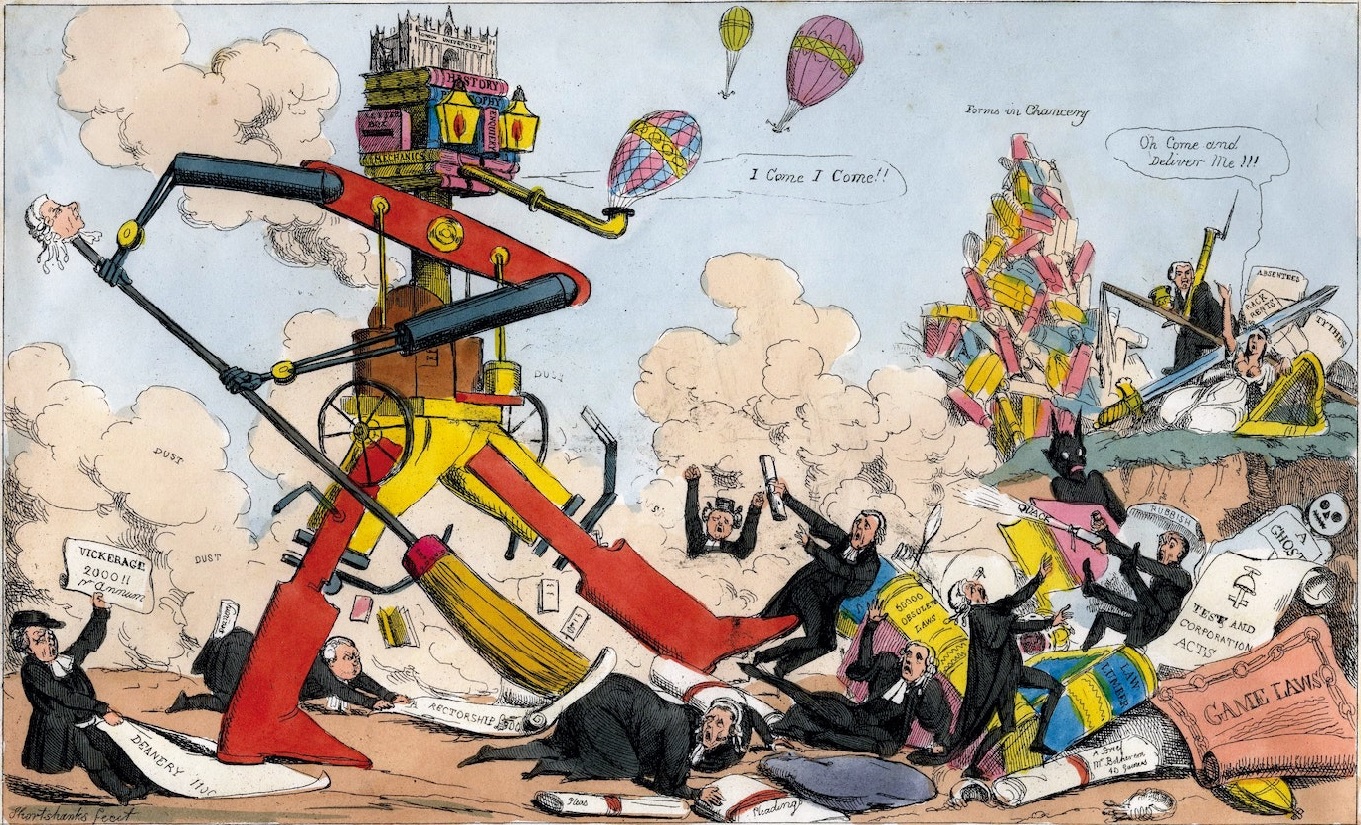
Bernard Friot, prophète du communisme advenu
Bernard Friot a beaucoup contribué ces dernières années à remettre au centre la question du travail, du contrôle de l’économie par les producteurs/rices et – dans la dernière période – du communisme. Il est donc important de discuter les thèses qu’il a développées et défendues infatigablement depuis plus de deux décennies, qui mettent l’accent sur un « communisme déjà-là » inscrit dans la Sécurité sociale et dans ce qu’il a nommé de longue date les « institutions du salariat ». C’est une telle discussion, indissociablement théorique et stratégique, que propose ici la philosophe Isabelle Garo.
***
« Secrétaire des actes inouïs », c’est un titre que je revendique[1].
Critiquer Friot ?
La contre-réforme des retraites a provoqué une déflagration sociale mais aussi politique : c’est ce que montre l’exceptionnelle mobilisation de 2023 face à des mesures aussi injustes qu’inutiles, rejetées par l’écrasante majorité de la population et qui ne sont soutenues que par un argumentaire mensonger, par le contournement des procédures démocratiques et par le déchaînement de la répression policière. Un tel degré de brutalité assumée est inédit, mais la volonté d’imposer l’allongement de la durée de cotisation et le recul de l’âge de départ s’inscrit dans un agenda néolibéral déjà ancien : libéraliser le système social français, conformément aux injonctions européennes de réduction des dépenses sociales, mais aussi poursuivre son étatisation[2] en dépossédant les syndicats et les citoyens de sa gestion autonome.
A travers cette réforme, c’est une logique globale, économique, sociale et politique qui est massivement rejetée. Mais mettre en échec la domination néolibérale implique de parvenir à réarticuler des luttes, des formes d’organisation rénovées, des perspectives politiques au sein d’une alternative potentiellement hégémonique. Cette urgence, dans une situation de défaite de longue durée du mouvement ouvrier, explique le succès foudroyant d’auteurs et d’essayistes qui théorisent des bifurcations franches mais qui se détournent cependant de la réflexion sur les conditions et les voies concrètes de leur réalisation. Bernard Friot s’inscrit dans ce paysage, tout en faisant partie du petit nombre de ceux qui s’efforcent de relier une théorisation originale à des propositions bien définies. Elles s’enracinent sur le terrain du salariat et de la protection sociale qu’il s’efforce de relier à la perspective d’un communisme qu’il qualifie de « pragmatique ». Il faut s’arrêter sur cette option théorique et politique qui reçoit un large écho et entre plus que jamais en résonance avec les mobilisations présentes.
Pourtant, entreprendre de discuter les thèses de Bernard Friot ne va pas de soi, même si nombre d’objections lui ont déjà été adressées (par Jean-Marie Harribey, Michel Husson, Jacques Bidet, Jérôme Maucourant, Frédéric Lordon, Pierre Khalfa, Guillaume Etiévant, etc.). Chercheur d’une indiscutable compétence dans son domaine, la protection sociale, Friot est aussi le défenseur infatigable du salaire à vie, en lien avec une redéfinition inédite du communisme, le dénonciateur acerbe de la gauche politique et syndicale, et l’initiateur d’un réseau militant qui diffuse et développe ses thèses. Il les expose brillamment dans des livres et des interventions orales nombreuses qui lui valent une large audience. Il semble donc peu opportun de critiquer des thèses qui visent à orienter les luttes en cours. Mais sont-elles vraiment en mesure de le faire ? A distance de tout engouement excessif comme de tout rejet hâtif, c’est cette question qu’il s’agit d’aborder.
Il faut commencer par le souligner, Bernard Friot ne fait pas partie de ceux qui se détournent de la question du travail ou annoncent sa disparition en faveur d’une société post-industrielle. Ses propositions, à la fois techniques et radicales, ont le mérite de permettre une large popularisation de questions complexes. Convaincu de la centralité du salariat, il s’efforce d’y repérer les prémices d’une sortie du capitalisme mais c’est aussi un lieu d’intervention longtemps déserté, celui de la critique de l’économie politique, que Friot s’efforce de réoccuper, en reliant une définition de la valeur à une refonte de la notion de communisme. C’est donc sous cet angle programmatique et plus largement stratégique qu’il s’agit de discuter ses propositions. On prêtera ici particulièrement attention à ses derniers travaux, puisque Friot remanie parfois certaines de ses thèses, en lien avec le contexte social et politique dans lequel il intervient, tout en esquivant généralement les objections[3].
Classiquement synonyme d’exploitation et de subordination, du moins dans la tradition marxiste dont il se réclame, le salaire tel que Friot le redéfinit acquiert un caractère avant tout émancipateur et anticapitaliste, qu’il deviendrait aujourd’hui possible et nécessaire de généraliser. Les moyens de cette généralisation sont la déconnexion poursuivie entre rémunération et activité professionnelle ainsi que la transformation de la rémunération en attribut de la personne, ouvrant la voie à un salaire à vie inconditionnel. Pour Friot, ces avancées, de nature fondamentalement institutionnelle, s’inscrivent dans l’histoire de la protection sociale, que ses acteurs aient ou non mesuré la portée radicale de leur intervention. Mais ces avancées impliquent désormais la prise de conscience claire de leur visée intrinsèquement communiste, impliquant d’adopter des mots d’ordre bien différents de ceux que proposent les syndicats et la gauche en général. Ainsi, il s’agit d’abandonner au plus vite la revendication d’une autre répartition des richesses, de rejeter l’idée de solidarité intergénérationnelle, jugée libérale et bourgeoise[4], et même de renoncer à la grève, estimée obsolète[5].
Marxisme et postmarxisme
Le succès de Bernard Friot tient ainsi à sa capacité à articuler un projet de rupture, tenant en quelques propositions phares, à un rejet sans nuance des formes d’organisation et de lutte existantes, qu’il juge responsables de la longue défaite du mouvement ouvrier depuis des décennies. La perspective optimiste qu’il esquisse vient ainsi impeccablement s’emboîter dans un constat d’échec lui aussi sans nuance, celui des luttes de ces dernières années. Il confère au passage à la théorie le rôle éminent de redessiner des perspectives porteuses d’avenir. Cette alchimie, qui s’efforce de métamorphoser le plomb de la défaite en or de l’espérance, n’acquiert sa force de conviction que dans un contexte bien déterminé qu’elle n’analyse cependant jamais : celui d’une crise généralisée des formes politiques (étatiques, institutionnelles, partidaires), combinée au maintien d’une hégémonie néolibérale inentamée.
Dans ces conditions, le délitement déjà ancien de l’alternative en mille voies concurrentes se traduit par l’émergence de travaux théoriques s’efforçant d’associer innovation conceptuelle et radicalité politique : le communisme nomme paradoxalement, depuis quelques années, ces élaborations singulières et rivales, qui se tiennent à distance des reconfigurations politiques en cours tout en étant portées par leur urgence. Pour sa part, présentant la protection sociale comme un miracle communiste enchâssé dans une institution, porteuse de l’élan de son propre dépassement, Friot promeut la cotisation au rang de levier de la transformation radicale.
Ce faisant, sa démarche s’inscrit bien dans le contexte d’une critique du marxisme de longue durée, même s’il ne l’évoque pas. En effet, en dépit de la singularité revendiquée de son propos, ses thèses s’éclairent à la lumière de certaines critiques antérieures du capitalisme et du marxisme qui en constituent de fait l’arrière-plan. Ces critiques ont été élaborées au cours du 20ème siècle par les courants du marxisme et du post-marxisme qui, convaincus de la disparition sans retour de toute perspective révolutionnaire, ont cherché à définir une nouvelle alternative au capitalisme. Elle s’est accompagnée d’une critique des organisations du mouvement ouvrier, en particulier des partis communistes, alors qu’ils affrontaient l’érosion croissante de leur base et la montée de contestations vives sur leur gauche, dans le contexte du tournant idéologique de la fin des années 1970.
Dès la fin des années 1960, le post-structuralisme dont Foucault est le plus brillant représentant s’est orienté vers l’analyse des normes et du pouvoir. Sur ce flanc de la pensée critique, l’analyse de la domination politique va tendre à l’emporter sur celle de l’exploitation, les travailleuses et travailleurs perdant leur rôle historique au profit d’autres catégories sociales, « plèbe », « exclus », intellectuels précaires, etc. Mais certains théoriciens, restés plus proches du marxisme et de son enracinement dans une critique de l’économie politique, vont s’employer à repenser le travail et ses transformations et à remettre en cause la conception marxienne de la valeur. Les uns comme les autres s’affrontent à ce qui constitue le cœur du marxisme, la centralité de la contradiction entre travail et capital, en tant qu’elle se présente comme la racine du conflit de classe et de toutes les dominations qui désormais s’y combinent. Mais c’est en partant de la recherche d’une stratégie neuve, en période de reflux de la combativité ouvrière, qu’ils mènent cette discussion, stratégie alternative à la fois à la ligne du Parti communiste italien et au modèle révolutionnaire issu de la révolution d’Octobre.
Si Friot ne mentionne jamais ces débats, pas plus qu’aucune autre référence, il semble néanmoins emprunter à la tradition opéraïste la notion de « salaire politique », dans un contexte tout différent mais non sans lien avec cette histoire théorique. En effet, cette notion va se trouver développée tout particulièrement du côté du féminisme opéraïste pour étayer la revendication d’une rémunération en échange du travail domestique féminin, ce dernier étant affirmé comme travail productif à l’encontre la définition qu’en donne Marx. Or ces thèses connaissent aujourd’hui une forte diffusion, au sein du courant écoféministe et au-delà de lui, qui contribue à populariser la thèse du salaire domestique et du salaire à vie. Dans le contexte italien d’alors, qui associait à la modernisation industrielle les intenses mobilisations ouvrières du « mai rampant » se prolongeant jusqu’en 1969 sans trouver d’issue politique, cette proposition résumait une intervention de nature stratégico-théorique, valorisant dans un premier temps l’autonomie ouvrière et l’insubordination.
Parler de « salaire politique » visait alors à dépasser la revendication d’une simple amélioration des conditions de vie et du pouvoir d’achat, revendication syndicale et politique jugée non seulement impuissante mais complice de la domination capitaliste. Il s’agissait aussi, dans la foulée, de repenser de fond en comble la nature du capitalisme contemporain, en affirmant la montée irrésistible de nouvelles modalités de la production des richesses, l’essor du travail immatériel et du capitalisme cognitif. Une fois retombée l’intense mobilisation des années 1970, Antonio Negri va réorienter l’option initiale, affirmant que la logique capitaliste est par elle-même irrésistiblement porteuse d’une productivité de la subjectivité et du vivant. Fondamentalement émancipatrice, elle doit avant tout se libérer des entraves de l’autoritarisme étatique autant que de l’autoritarisme patronal. La revendication du salaire à vie, de même que la revendication du salaire domestique, visent à pousser à son terme la logique de la marchandisation de la force de travail pour mieux la subvertir de l’intérieur. Pour cette tradition, le communisme est une tendance à l’autonomie par avance inscrite dans les mutations technologiques et sociales en cours.
Cette approche a eu pour conséquence d’éclipser la complexité de la catégorie marxienne de force de travail, rejetant l’analyse de ses contradictions propres au profit de l’opposition simple entre travail vivant et travail mort. Friot appelle pour sa part à mettre « l’affirmation du travail vivant au service de l’affirmation de la vie »[6], promouvant lui aussi une alternative immanente qui cherche ses fondements philosophiques du côté d’une ontologie, et non plus du côté d’une politisation de la contradiction entre la marchandisation capitaliste de la force de travail d’un côté, et la résistance à la fois individuelle et collective à cette marchandisation de l’autre. Cette immanence de l’alternative est une thèse avant tout retournée contre toute dialectique, autrement dit contre une stratégie qui s’affronte aux contradictions réelles.
Dès lors, si le communisme est une tendance émancipatrice souterraine, inaccessible aux profanes, sa résurgence exige avant tout que des théoriciens se donnent pour mission d’en révéler la présence. Ce communisme idéalisé peut alors être arraché à son passé réel autant que découplé de la question classique des transitions et des médiations nécessaires à la sortie lente et difficile hors de la cage d’acier capitaliste. On comprend que ses partisans retrouvent tous des accents théologiques : Antonio Negri invoque Saint François d’Assise tandis qu’Alain Badiou cherche chez Saint Paul le modèle de la conviction universaliste, Bernard Friot soulignant pour sa part l’importance de sa foi chrétienne. Mais loin que sa conception du « déjà-là » soit réductible à une théologie latente, c’est bien plutôt sa foi qui, retraduite en une mystique politique, vient soutenir sa conception d’une alternative vivante : « c’est l’aujourd’hui de Dieu qui se construit dans le tragique du présent » [7] écrit-il. A ses yeux, la possibilité du communisme repose sur un surgissement premier qu’il s’agit de réactualiser, 1946 étant la date inattendue de cette rupture des temps.
La Sécurité sociale, une légende rouge
Dès lors que le système social français se trouve promu au rang de creuset du communisme, le récit de sa genèse importe au plus haut point. De façon au premier abord surprenante, Bernard Friot dénonce de façon répétée la légende qui fait de 1945 l’origine de la Sécurité sociale : « 1945 est une date totalement fantasmée »[8]. Mais fût-elle jamais synonyme d’unanimité ? Les historiens l’ont souligné, outre que la Libération a été un moment de vives tensions sociales et politiques, 1945 est aussi l’année des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata. Pour ces raisons, aucun courant politique n’en fera par la suite son étendard, même si la défaite du nazisme est saluée par tous. C’est contre ce « 1945 » fantasmé, mais surtout par Friot lui-même, que ce dernier suggère un autre moment fondateur : celui de l’instauration en 1946 d’un « statut communiste du producteur »[9]. Cette contre-légende qui glorifie l’initiative des communistes et des « communistes de la CGT » n’est pourtant pas une thèse neuve, un tel récit ayant été forgé dès cette époque par les directions du PCF et de la CGT.
Il n’en demeure pas moins que la fondation de la Sécurité sociale s’inscrit dans une histoire longue et complexe[10]. Il faut rappeler que dès 1941, Roosevelt et Churchill avaient fait du « progrès économique et de la Sécurité sociale » des buts de guerre, affirmation reprise par de Gaulle dans son discours d’Oxford de novembre 1941[11]. Nicolas Da Silva montre qu’en France la montée des préoccupations de santé publique date du début du 20e siècle[12], en lien direct avec la préparation de la guerre. On peut y ajouter la délégation à l’État par la classe capitaliste d’une partie des tâches de reproduction de la force de travail. Ce « populationnisme » français, qu’on peut même faire remonter à Colbert[13], va se traduire par une orientation nataliste et familialiste durable de la protection sociale française :
« contrairement aux apparences, cependant, la nouvelle législation sociale se coule dans un moule institutionnel ancien, qu’elle ne remet nullement en cause »[14].
Inscrite dans le programme du CNR du 15 mars 1944, la Sécurité sociale est créée par ordonnance le 4 octobre 1945, et modifiée par une série de lois et de décrets adoptés en 1946. Loin de tout irénisme, le CNR avait insisté sur les luttes sociales nécessaires à « l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale ». Dès l’été 1944, des comités de gestion se sont imposés dans certaines entreprises[15] : si le PCF les soutient, c’est en tant que moyens d’une relance de l’activité économique et non comme un levier en vue d’une réappropriation généralisée des moyens de production. En novembre 1944, Maurice Thorez insiste sur la priorité de la reconstruction nationale puis, dans son entretien au Times de novembre 1946, définit une « voie française au socialisme » qui reste conforme aux préconisations de l’URSS[16], dans une situation où la perspective d’une révolution semble peu envisageable. C’est dans ce contexte et à l’occasion de sa participation au gouvernement provisoire d’octobre 1945, en collaboration avec la SFIO et le MRP, alors que les exigences d’unité nationale et de progrès social sont au plus haut, que le PCF œuvre effectivement, dans des conditions très difficiles, à la réalisation du programme du CNR : nationalisations et politique sociale sont les principaux résultats de cette participation, qui vont conduire à accroître considérablement les droits des salarié-es.
Pourtant, l’instauration d’un système de protection sociale sans précédent ne provoque pas un enthousiasme unanime. Depuis longtemps, une partie du mouvement ouvrier, héritière du syndicalisme révolutionnaire, y est hostile, voyant « dans les lois de protection sociale un moyen de détourner la classe ouvrière de la révolution »[17]. Mais au Parti communiste aussi, la contestation monte concernant une participation au gouvernement qui implique des concessions au patronat. Dans le même temps, l’anticommunisme est en plein essor, les classes dominantes compromises dans la collaboration se réorganisent et la situation internationale se tend : dès mars 1946, la guerre froide commence. C’est dans ce contexte instable, en cours de retournement accéléré, que le ministre communiste du travail Ambroise Croizat et son équipe mettent sur pied une Sécurité sociale qui porte la marque de ces conditions difficiles. Michel Pigenet souligne qu’elle n’a pas suscité de
« mobilisation à la hauteur d’une réforme dont les enjeux sont pourtant considérables. La presse syndicale de l’époque n’accorde guère d’importance à sa préparation, tandis que les militants l’évoquent à peine dans leurs réunions internes »[18].
Et en 1947, lors du premier scrutin en vue d’élire les administrateurs syndicaux et patronaux, la CGT obtient un score décevant.
Si Friot admet que cette construction s’effectue dans un contexte conflictuel, il réduit celui-ci à un affrontement strictement institutionnel, combinant une offensive patronale aidée par FO, et un « sabotage étatique de l’institution »[19], en vue de barrer la voie à une invention dont la portée serait fondamentalement révolutionnaire. Pourtant, c’est en raison de sa dimension fondamentalement protectrice et redistributive, que la Sécurité sociale va finalement devenir l’« emblème de la solidarité nationale »[20] et non le symbole de la rupture. Institution assurément émancipatrice, elle est défendue, y compris dans les rangs communistes, au nom d’un souci partagé de cohésion sociale et dans une perspective de reconstruction nationale.
Concernant l’organisation spécifiquement française, il est classique de rappeler que le débat d’alors met face à face la solution anglaise, énoncée dans le rapport de Beveridge de 1942, qui propose un revenu de citoyenneté accordé à tous, mais minimal et fondé sur l’impôt, et le système allemand, qui date de Bismarck, liant les prestations au revenu mais instaurant une gestion corporatiste des prestations. Ambroise Croizat, mais également Alexandre Parodi et Pierre Laroque[21], dont Friot tient à effacer les rôles, vont contribuer à bâtir un système français original, qui établit une corrélation entre cotisations et prestations, tout en l’articulant à une gestion non étatique[22]. Bruno Valat écrit : « si l’unité et l’universalité sont clairement mises en échec, le troisième principe beveridgien, celui de l’uniformité de prestations est, quant à lui, clairement rejeté dès l’origine »[23] et la proportionnalité au revenu s’impose.
Friot conteste ce point : afin de mieux défendre sa proposition contemporaine d’un salaire à vie détaché de l’emploi, il affirme pour sa part que les pensions ne sont pas indexées sur le montant des cotisations, même si il reconnaît qu’elles sont liées au dernier salaire et à la durée de cotisation[24]. Cette dénégation lui permet de corroborer sa conception d’un salaire politique qu’il s’agit de généraliser. Pourtant, cette dissociation caractérise en réalité la voie anglaise, d’inspiration fondamentalement libérale, qui propose un « filet de sécurité » destiné à éviter aux plus pauvres de tomber dans la misère, limitant à cette seule mesure la protection sociale. En ce sens, le principe beveridgien d’une rémunération non conditionnée à l’emploi reste apparenté à l’assistanat et n’a rien d’émancipateur, on va y revenir.
C’est donc, en dépit de cette histoire complexe et réformiste dont il ne dit mot, que Friot entreprend de révéler, à plus de cinquante ans de distance, l’ampleur de ce qui aurait été une révolution, étrangement restée inaperçue, y compris aux yeux de ses fondateurs comme à ceux de ses bénéficiaires, et cela à l’heure de sa destruction néolibérale en cours. Pourquoi Friot tient-il tant à ce récit étrange, qu’il répète de livre en livre ? S’il y va de sa fidélité à son propre engagement communiste, il y va surtout de sa conception de l’intervention sociale et politique, qui fait d’une construction institutionnelle l’incarnation d’un « déjà-là communiste » toujours vivant, porteur de sa propre force expansive. Cette conviction lui permet d’énoncer pour aujourd’hui des propositions qui, coupées de leur histoire heurtée, semblent ainsi être protégées de leurs défaites. C’est bien une philosophie de l’histoire qui se dessine là, métamorphosant un processus long en un fiat lux :
« Je pratique l’annonciation, en tout cas j’essaie »[25].
Dès lors, le communisme n’est plus un processus, une confrontation de classe menée à son terme à travers le temps long, non linéaire et conflictuel, de la construction collective d’une autre formation économique et sociale, il est « le mouvement par lequel la classe révolutionnaire met en place des institutions alternatives à celles du capitalisme »[26], élaborant un statut individuel de citoyenneté. Dès lors, la « socialisation intégrale des valeurs ajoutées »[27], le crédit planifié organisant l’allocation des ressources, le salaire à vie, etc. semblent à portée de main, ne rencontrant en face d’elles que d’autres institutions qu’il s’agit de transformer ou de contourner : la « propriété lucrative », le « salaire différé », la « convention capitaliste du travail ». Enoncées une à une, elles semblent en effet bien plus faciles à affronter que ce mode de production puissant et solidement charpenté qu’est le capitalisme. Elles ne sont pourtant que ses formes d’existence, ses dynamiques essentielles rebaptisées en anodines conventions.
Les institutions sociales, tabernacle de la lutte de classe
En vertu de cette légende de la naissance du communisme en tant qu’institution sociale, son redéploiement contemporain n’a plus à s’affronter ni aux capitalistes ni à l’État néolibéral autoritaire, mais en premier lieu à cette fragile et arbitraire « convention capitaliste du travail »[28]. Sans rien dire des rapports d’exploitation et d’appropriation qui conditionnent un régime contemporain d’accumulation capitaliste, traversé de contradictions croissantes mais qui demeure d’une puissance sans rivale, c’est un statut juridique, celui de la « propriété lucrative » que dénonce Friot, qu’il oppose à la « propriété d’usage »[29]. Ces catégories sans âge, plus aristotéliciennes ou chrétiennes que marxistes, semblent surtout relever de la dénonciation morale de l’usure et du profit commercial. En outre, elles décrivent un face-à-face entre des logiques supposées équivalentes, reposant sur des décisions qui n’ont d’autre fondement qu’elles-mêmes, étrangères à toute réflexion sur une réappropriation sociale qui irait bien au-delà d’une autre répartition des richesses et viserait les rapports sociaux ainsi que le rapport à la nature. C’est seulement au prix de cette volatilisation sémantique des rapports de force réels qu’on peut envisager que la citadelle assiégée des services publics puisse dès à présent redevenir la base arrière d’un nouvel assaut victorieux, d’une révolution qui n’attend que d’être ressuscitée par décret.
Mais comment comprendre que les bénéficiaires de cette révolution l’aient ignorée, tandis que le patronat, qui aurait immédiatement compris l’ampleur de la menace, n’a su lui opposer qu’une institution adverse, avant que l’Union européenne ne s’emploie « à restaurer le mode de production capitaliste »[30], disparition qui était jusque-là passée inaperçue ? Selon Friot, c’est en effet la caisse des cadres du privé, l’Agirc-Arrco, fondée sur le principe du salaire différé, qui aurait fait office d’unique contre-feu face à ce communisme invasif : cette caisse et son principe sont selon lui plus dangereux qu’ « un ennemi existant mais tout à fait secondaire, la capitalisation »[31]. Ces affirmations n’aident pas à saisir de façon précise et articulée les évolutions du capitalisme contemporain : la place prépondérante prise par la capitalisation dans de nombreux pays occidentaux et sa montée constante en France[32], plus largement la financiarisation en cours au cœur d’une vaste offensive néolibérale, guerre de classe de plus de cinquante ans. Or, si protéger et élargir des statuts acquis de haute lutte est en effet une question politique essentielle, ceux-ci ne constituent ni un but ultime ni un levier efficace, tout simplement parce qu’ils résultent d’un rapport de force qu’ils ne créent pas.
Néanmoins, il faut le souligner, la thèse d’une alternative immanente au capitalisme, autrement dit y trouvant ses conditions, était bien celle de Marx. Mais il concevait cette immanence comme étant celle des contradictions vives du capitalisme, comme autant de brèches à élargir par la lutte sociale et politique, et non pas en tant que projet en gésine, préformé dans des conventions protectrices ou, à son époque, dans un système coopératif (dont il dénonçait la dimension politique illusoire tout en vantant ses mérites relatifs). Cette croyance en la dimension foncièrement institutionnelle et par suite experte de la politique, délégués à des spécialistes fussent-ils militants, est plus proche de certaines des thèses d’Émile Durkheim en son temps. Outre qu’elle propage une conception profondément délégataire de la transformation sociale, elle délaisse la critique générale d’une logique capitaliste d’appropriation du travail et de la nature qui s’est installée dans toute l’épaisseur des rapports sociaux et notamment à travers la subordination salariale.
Car le salaire n’est pas par définition émancipateur, loin de là. En tant que rapport social, il est synonyme d’exploitation. En tant que statut juridique, il est inséparable des variations d’un contrat de travail plus ou moins protecteur, en permanence remodelé par des politiques publiques néolibérales, aujourd’hui d’autant plus hégémoniques que le camp salarial est largement désarmé. Karel Yon et Guillaume Gourgues insistent sur
« le développement de la sous-traitance et du capitalisme en réseau, l’effondrement des cadres institutionnels de la ‘démocratie industrielle’ liés à la grande entreprise intégrée et à la norme fordiste du travail, masculin, stable et à temps complet »[33].
En revanche, affirmer qu’on assiste à « l’abolition en cours du salariat »[34], que les capitalistes ont pour objectif principal le retour du salaire à la tâche et l’uberisation généralisée sont des thèses qui empêchent de prendre en compte le maintien du salariat stable « qui reste la norme dans la plupart des pays riches »[35] et dont les évolutions sont aussi à analyser, indépendamment d’une montée par ailleurs bien réelle de la précarité.
Qualifier le salaire de « politique » est donc exact si l’on désigne ainsi le rapport de force social qui préside toujours à sa fixation, mais l’expression devient paradoxalement dépolitisante, dès lors qu’il s’agit de définir comme simple convention, découplée de l’analyse de la causalité spécifiquement économique qui commande l’achat capitaliste de la force de travail et l’effort pour en abaisser le « coût ». Outre qu’une telle approche tend à minorer la violence de la guerre sociale en cours, dans un contexte de crise approfondie du capitalisme, elle abandonne la critique ciblée et concrète des politiques néolibérales, qui passe par la revendication première d’une autre répartition des richesses et d’une réforme de la fiscalité. Prétendre régler par en haut et en une fois cet affrontement de classe est un projet en réalité aussi irréaliste qu’impuissant à mobiliser. Les reformulations proposées par Friot, qui visent à présenter comme accessibles des réformes de fond, contournent la logique capitaliste qui en réalité les interdit. Ainsi, la construction d’un « patrimoine social commun »[36] opposé à la peccamineuse « propriété lucrative » et à une « convention du travail » aux effets déplorables, visant la redistribution de la plus-value (que Friot rebaptise « valeur ajoutée »), au lieu d’être son moyen, présuppose une révolution d’ores et déjà réalisée.
Faute de s’arrêter sur leurs conditions concrètes de réalisation, et sur leur capacité à fédérer un camp social large, Friot propose donc un tableau presque réjouissant de notre présent, regorgeant de potentialités à portée de main : le capitalisme ne ferait que survivre sous la menace d’institutions sociales qui ont installé en son cœur une logique révolutionnaire puissante. Cette portée subversive a été neutralisée par des revendications absurdes et inefficaces. Les critiques qu’il adresse aux syndicats et à la gauche en général sont virulentes et systématiques[37] : le montant des retraites importe moins que leur nature, la question du partage des richesses est donc une impasse[38] ; la « hausse du pouvoir d’achat » est un leurre qui enferme dans « la plainte et la dénonciation » »[39] ; invoquer la solidarité intergénérationnelle relève d’un pur et simple ralliement au patronat ; la réduction du temps de travail n’est pas une revendication pertinente, pas plus que la taxation du capital ; revendiquer un nouveau partage de la valeur est une ineptie, dénoncer la capitalisation n’a pas de sens, proposer un pôle public du crédit est irresponsable, etc. Quant à la grève, il la juge dépassée en vertu d’un argument étrange qui consiste à la définir non comme confrontation avec le patronat mais comme modalité obsolète d’un dialogue social désormais impossible[40]…
Cette virulence critique n’est pas une dimension secondaire de la réflexion de Bernard Friot ni de son succès : après des décennies de défaite, dénoncer en priorité les défauts des organisations syndicales et politiques existantes et leurs « mots d’ordre nécessairement voués à mener la mobilisation d’échec en échec »[41] est un cliché largement diffusé, qui fait obstacle à une véritable réflexion critique. Que proposer d’autre ? Selon Friot, c’est « l’auto-organisation des travailleurs » qu’il faut instituer dès à présent. Une telle proposition, qui consiste à inverser les conditions et les buts, fait là encore du communisme réalisé le moyen de son instauration, « non pas l’arrêt de travail, mais le travail comme on l’entend »[42]; non pas taxer le capital, mais instaurer un « salaire à vie pour tous » doublé d’un « droit à la propriété d’usage »[43] appliqué aux entreprises. Loin d’offrir une alternative claire, la voie du « travail comme on l’entend », incluant des formes de contrôle sur la production que Friot n’évoque qu’en passant, ignorant des décennies de débats et d’expérience sur ce plan, entraîne une avalanche de questions. Elles portent sur l’articulation entre l’émancipation du producteur individuel et les contraintes sociales d’un travail productif à réarrimer aux besoins sociaux, ainsi que sur les conditions d’une véritable planification démocratique et écologique.
Friot ne s’embarrasse pas de ces problèmes :
« Que faut-il pour qu’il y ait des travailleurs qui décident démocratiquement de ce qui va être produit (…) ? Il faut et il ne faut qu’une avance des salaires »[44].
Le crédit, solution proudhonienne, et l’institution, option durkheimienne, constituent les deux piliers de ce communisme à portée de main. Une fois de plus, seule une mystique de l’avènement permet de congédier la construction de longue haleine de voies de passage stratégiques, articulant conflit social de haute intensité et reconstruction d’une dynamique politique capable d’expansion. Pour Friot, aux antipodes d’un tel labeur militant, l’immanence est l’autre nom de l’immédiateté, au sens strict d’absence des médiations politiques et stratégiques indispensables (médiations qu’il ne s’agit pas, bien entendu, de penser comme des étapes figées[45]) :
« l’alternative communiste ne viendra que par l’alternative communiste, et l’affermissement des prémices de cette alternative est l’unique chemin »[46].
Certes, la foi « est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu’on espère, c’est une manière de le posséder déjà par avance » (Hébreux, 11-1)[47]. Mais est-ce bien là une base suffisante ?
Une alternative au capitalisme ou à l’économie politique ?
Comme la foi ne soulève que rarement les montagnes, Friot prend soin de construire sur la base de sa ferveur communiste une critique de l’économie politique censée en réalité la fonder. Celle-ci déjà a reçu nombre d’objections qu’on ne reprendra pas ici, afin d’examiner en priorité la façon dont Friot modifie l’un par l’autre le projet communiste et l’argumentation théorique qui le porte. En effet, tout en se réclamant de Marx et en lui empruntant une partie de son vocabulaire, Friot opère une profonde torsion de ses concepts centraux, délaissant les autres et disloquant littéralement l’analyse marxiste du capitalisme sans jamais se référer ni aux débats nombreux en la matière ni à aucun élément empirique précis. C’est en particulier le cas du concept de valeur : alors que Marx étudie la valeur capitaliste et ses métamorphoses en lien avec l’exploitation de travailleurs contraints de vendre leur force de travail « comme si » elle était une marchandise (car elle n’en est, selon lui, jamais une, les capacités humaines n’étant pas produites en tant que marchandises), Friot élargit la notion de valeur pour en faire le critère du travail en général, les concepts de « travail » et « valeur » se trouvant aussitôt détachés du mode de production capitaliste où ils acquièrent leur sens propre[48].
A l’image exacte de sa stratégie, la méthode de Friot est dualiste, proposant de basculer sans médiation entre des définitions qui s’opposent terme à terme, et par là entre des logiques sociales adverses, congédiant les processus autant que l’analyse dialectique des contradictions internes qui les travaillent : en s’autorisant à subdiviser la valeur en « valeur capitaliste » et en « valeur communiste », sans aucune argumentation, Friot rend incompréhensible le processus capitaliste de valorisation. Les dégâts non seulement théoriques mais stratégiques sont immédiats : parler de « valeur communiste » interdit de comprendre le communisme comme visant l’abolition de la mesure de la richesse par le temps de travail, autrement dit comme perspective d’abolition pure et simple de la valeur. C’est pourquoi viser à terme cette abolition est la condition pour repenser la richesse sociale à partir des besoins sociaux et dans le cadre d’une réappropriation des rapports de production. C’est cette démarche politique complexe et de longue haleine que Marx nommait une révolution.
Le coup de force théorique décrété par Friot vient ébranler tout l’édifice, à commencer par l’analyse du travail, dont toutes les formes sont à leur tour confondues : il ne craint pas d’écrire que
« la pratique communiste de la valeur repose sur l’immanence du travail (abstrait) aux personnes et l’exprime dans la qualification -et donc le salaire- comme attribut de la personne »[49].
C’est à nouveau au prix d’un démembrement de la notion qu’il oppose un travail abstrait capitaliste à un autre, qualifié de « communiste ». Car, pour Marx, le travail abstrait résulte de sa dimension sociale et de la péréquation réelle qui, dans le capitalisme et lui seul, permet à chaque instant de définir le temps de travail moyen socialement nécessaire à la production d’une marchandise. C’est ce travail humain indifférencié, cette « gelée de travail », qui constitue la substance de la valeur. C’est ce que la notion inintelligible de « travail abstrait endogène » proposé par Friot interdit de comprendre, faisant disparaître dans la foulée la plus-value (ou survaleur) qui constitue le cœur du capitalisme, remplacée par la très libérale notion de « valeur ajoutée », ne renvoyant plus qu’à un régime juridique de propriété et à une approche comptable néoclassique. Mais reprendre la notion de plus-value contraindrait Bernard Friot à reconnaître que la domination salariale est la condition de l’extorsion et de son accumulation de cette plus-value…
Souligner ces confusions ne consiste donc pas à ergoter sur des points de vocabulaire : les enjeux de ces concepts sont immédiatement politiques. Le sort réservé à la notion de force de travail est lui aussi exemplaire. Chez Marx, la force de travail est une réalité objective qui inclut les individualités vivantes elles-mêmes, les capacités humaines, et n’est en rien propre au capitalisme. Dans le capitalisme, elle désigne les êtres humains eux-mêmes, dès lors traversés par la contradiction qui fait se heurter les capacités inédites qu’ils acquièrent dans le travail et leur exploitation salariée aliénante. Parce que les êtres humains sont éduqués et formés dans le cadre majoritairement non-marchand de la reproduction sociale, la force de travail est le lieu même de la révolte et de sa politisation, le lieu de la reconquête de soi et du temps libre qui caractérisent selon Marx le communisme, et non celui du travail généralisé.
Réduite au statut de pure marchandise par Friot, là encore sans explication, elle n’est alors plus que le résultat foncièrement passif de la convention juridique capitaliste. Dépourvue de puissance émancipatrice propre, elle n’exprimerait que le « point de vue » capitaliste sur le travail « qui réduit les personnes à de la force de travail mesurée par le temps de sa production »[50]. Outre que le prix de la force de travail est fonction du prix des biens marchands nécessaires à sa reproduction, ce qui est tout différent, vider cette notion de sa charge dialectique fait disparaître la complexité d’un travail capitaliste à la fois exploité et formateur de l’individualité humaine : cette opération va de pair, chez Friot, avec le rejet de la revendication de diminution du temps de travail et avec le dénigrement des besoins humains, ravalés au rang d’exigences élémentaires[51], alors que Marx concevait au contraire les besoins humains et leur développement comme la vraie richesse, aux antipodes de ses formes réifiées et monétaires, fussent-elles salariales.
Cette dislocation systématique de la critique marxiste de l’économie politique, accompagnée de la reprise, non pas de certains de ses concepts mais de leur seule dénomination, est une opération qui épargne à Friot de proposer une véritable élaboration théorique alternative. Tablant sur une faible diffusion de cette culture économique, prenant le relais de critiques antérieures du marxisme qu’il ne cite cependant pas, il peut, par simple décret et à l’aide de figures de style, s’autoriser à redéfinir le salariat comme forme émancipatrice et le communisme comme sa généralisation, alors même que Marx y voyait la forme capitaliste de la dépossession et de la subordination, et par suite la condition même de sa perpétuation. N’analysant jamais la séparation des producteurs et des moyens de production qui définit en propre la condition salariale, Friot ramène toute analyse dialectique des contradictions de l’économie politique capitaliste à une opposition frontale entre le travail concret, confondu avec le travail vivant et le travail productif, d’un côté, et un travail abstrait, mort, confondu avec la force de travail, de l’autre. Au vu de ces facilités argumentatives, c’est surtout grâce au panache littéraire de son auteur qu’un tel édifice théorique tient debout.
En effet, si Bernard Friot ne répond jamais aux critiques formulées sur le terrain économique, il module parfois certaines de ses thèses, oscillant entre radicalité revendiquée et extrême modération. Ainsi, pour ne mentionner que cet exemple, le dépassement du travail abstrait-mort et sans valeur d’usage par le travail concret-productif-utile qui semblait structurer son argumentaire laisse-t-il soudain place à un constat désabusé :
« je crois à la nécessité du travail abstrait, et je ne vois pas comment on peut échapper à la valorisation (monétaire) de l’activité »[52].
Pareillement, en dépit de la promesse d’échapper au monde capitaliste, on pourra être surpris et déçu d’apprendre que nous avons néanmoins besoin des « nécessaires fonctions d’entrepreneur, d’innovateur, de supérieur hiérarchique »[53]. Ces énoncés voisinent avec d’autres auxquels ils ne sont reliés par un pur volontarisme :
« Il est temps de prendre le pouvoir sur la valeur économique, et d’en changer le sens en passant de la valeur-travail à la qualification. Nous le pouvons puisque nous avons déjà des institutions salariales en mesure de se substituer à celles du capital »[54].
Mais en quoi consiste au juste l’alternative globale proposée par Bernard Friot ?
Le salaire à vie, une fausse fenêtre sur l’horizon communiste
Le centre névralgique de sa construction réside dans la proposition d’un salaire à vie, pièce maîtresse d’une citoyenneté centrée sur la personne comme entité juridique. Le salaire à vie, sous des dénominations diverses, est une proposition aujourd’hui montante, au point que ses nombreuses variantes se répartissent sur un arc qui va de l’anticapitalisme au libéralisme. La version présentée par Friot est celle d’une rémunération déconnectée de l’emploi, qui s’oppose selon lui à la proposition libérale de « revenu universel », le terme de revenu renvoyant, dit-il, à l’existence préalable d’un patrimoine[55]. Pour les gouvernements néolibéraux, la mise en place d’un filet de sécurité en faveur des plus précaires autorise la destruction des services publics et la montée des inégalités. Comme le montre Daniel Zamora,
« l’allocation universelle se présente ainsi comme la technique sociale par excellence d’une société postindustrielle, où l’emploi a en apparence cessé d’être le socle de l’édifice social »[56].
En quoi la proposition de Friot diffère-t-elle fondamentalement de cette mesure d’accompagnement de la montée des inégalités et de déconnexion du revenu et de l’emploi, terme honni, que la notion fourre-tout de « travail » permet de noyer ? Pour sa part, Friot relie le salaire à vie à sa redéfinition du travail productif. En insistant sur la définition de la retraite comme « salaire continué » pour définir la retraite, et en dépit d’objections qui en contestent vigoureusement la pertinence (elles ont été notamment formulées par Jean-Marie Harribey et Jérôme Maucourant[57]), il affirme le caractère productif de toute activité, indépendamment de l’emploi. Mais si la transformation de la compétence en qualification a en effet été au centre des luttes salariales, déconnecter cette transformation de l’emploi lui fait perdre ses enjeux concrets immédiats, support et motif des mobilisations.
L’expression de « salaire continué » tente de surmonter ces difficultés : si Friot l’objecte au « salaire différé », elle lui permet surtout, plus discrètement, de rejeter le principe du « salaire indirect ». Ce dernier, résultat d’un long processus historique, est « composé d’un ensemble de prestations en espèces ou en nature, notamment sous la forme de l’accès gratuit à un ensemble de biens ou de services collectifs »[58]. Ce caractère socialisé permet seul de comprendre que la cotisation sociale s’oppose en effet à la marchandisation intégrale de la force de travail, précisément parce qu’elle relève d’un autre partage de la valeur imposé par les luttes de classe et incarné dans des institutions qui ne sont, par définition, jamais pérennes. Ce partage, déjugé par Friot comme non révolutionnaire, relève d’une opposition là encore schématique entre des conquêtes partielles et l’élan qu’elles impulsent en vue d’une remise en cause de la logique capitaliste tout entière[59]. Faute de quoi, en effet, elles risquent fort de se voir substituer des allocations, combinées à des formes de travail obligatoire et gratuit, d’inspiration profondément libérale.
Dès lors, dire que toute activité est productive et mérite salaire, ou bien que l’existence d’une rémunération prouve qu’il existe un travail productif correspondant c’est, non seulement jouer sur les mots, mais ouvrir la voie à une régression qui généralise le principe de l’allocation en échange d’un travail hors emploi, détruisant la convention salariale au lieu de l’étendre. Parallèlement, c’est le temps libre, c’est-à-dire libéré de toute rentabilité mais aussi de toute exigence d’utilité sociale, qui disparaît. En effet, ou bien la pension n’est pas un salaire et le retraité, pas plus que le jeune ou le chômeur ne sont productifs, ce qui n’est un défaut que du point de vue du productivisme capitaliste, ou bien la retraite est en effet un salaire qui rémunère un travail socialement utile, et qui donc, contrepartie logique, reste requis.
Sur ce plan, les thèses de Friot sont franchement ambiguës : dans ses derniers textes, il envisage que les entreprises et les services publics puissent recourir aux retraité-es comme c’est déjà par endroits le cas :
« la recherche scientifique publique bénéficie de l’apport non négligeable des retraités dont je précise qu’ils n’ont pas de rémunération supplémentaire »[60].
Dans son dernier livre, il envisage que « les retraités puissent travailler dans toutes les entreprises et les services publics », tout en s’offrant de temps en temps « un tour du monde »[61](sic). Mais de façon contradictoire, il ajoute : « je pense que des retraités qui ont un salaire à vie doivent justement s’impliquer dans le marchand. Moi, par exemple, je vais me faire violence et je vais rendre marchandes une partie de mes prestations »[62], afin de garantir une redistribution aux non-retraités via les associations. Un tel modèle, si peu cohérent, est-il vraiment porteur de progrès social ?
Du moins Friot est-il pleinement en accord avec lui-même lorsqu’il reprend sans le mentionner la revendication de salaire domestique, dans la filiation du féminisme opéraïste. Il soutient, sur le modèle du travail des retraités, la thèse d’un travail domestique créateur de valeur au même titre que le travail salarié, comme si cette différence n’était au fond qu’une distinction arbitraire, un « point de vue » là encore, ou une « idée reçue » :
« les femmes sont particulièrement exposées à la différence entre valeur d’usage et valeur économique. Elles font, à leurs dépens, l’expérience du pouvoir qui est en jeu dans la valeur économique (…). La domination masculine repose sur l’idée reçue qui veut que ce que font les femmes est très utile, mais ne produit pas de valeur économique »[63].
D’une part, la valeur économique, ailleurs nommée capitaliste, devient ici émancipatrice. D’autre part, si la domination est une « idée reçue », il est nécessaire et suffisant de modifier les représentations pour que la domination disparaisse. Dans le même temps, le modèle patriarcal de la famille qui imprègne la Sécurité sociale[64] n’est jamais abordé.
Marx s’était en son temps moqué des Jeunes Hégéliens qui accordaient un semblable crédit aux idées, en leur objectant que se débarrasser de l’idée de pesanteur n’aide en rien un homme qui se noie. Prêter un caractère déterminant aux représentations, thèse qu’on trouve également dans la sociologie durkheimienne, n’est nullement secondaire chez Friot. C’est elle qui confère son efficacité supposée à une intervention à la fois experte et militante, prêtant à la croyance un rôle déterminant :
« une classe est dirigeante pour autant que la représentation des choses qu’elle met en scène est partagée par une majorité »[65].
Et c’est très logiquement que Friot décrit le capitalisme plus comme un culte que comme un mode de production :
« battons-nous pour que le culte capitaliste ne soit plus reconnu et salarié par la République, pour qu’enfin la loi de 1905 s’applique à la religion dominante »[66].
Abolir le capitalisme par décret, donc.
Ainsi, l’insistance sur la dimension anthropologique du travail, abstraction géante, fait-elle disparaître les questions concrètes de la diminution du temps de travail, des hausses de salaire, de la division genrée et racialisée des tâches, de la santé au travail, de la socialisation du travail domestique, du contrôle de la production et de la planification écologique et démocratique. S’effacent également des perspectives la contestation de la propriété des moyens de production et de l’appropriation inégalitaire des richesses, remplacée par une ode à la généralisation de la cotisation, réintroduisant au passage la notion d’ « épargne préalable » d’origine néoclassique, comme le souligne Jean-Marie Harribey[67]. On voit mal en quoi un tel modèle qui hybride les logiques les plus incompatibles pourrait être l’antichambre d’un communisme conçu comme gestion enfin rationnelle de l’activité humaine.
Face à ces vastes et optimistes perspectives, il peut sembler décevant d’objecter que la Sécurité sociale et le salariat, loin d’être les bastions du communisme réalisé, sont avant tout le curseur des victoires et des défaites du mouvement ouvrier. Mais il faut ajouter que c’est précisément à ce titre qu’ils sont aussi de possibles points d’appui dont la défense et le redéploiement sont à intégrer à un projet alternatif offensif et rassembleur. Il faut reconnaître que le talent de Bernard Friot confère un souffle sans pareil à une vision historique tout autre, argumentée avec conviction et qui le situe sans conteste dans le camp de la transformation sociale. Ses options s’inscrivent pourtant dans une histoire qu’il nous faut parvenir à dépasser, celle de la recherche d’une alternative au capitalisme autant que d’une alternative au projet de son abolition. Pour que l’immanence du déjà-là ne soit pas, derrière son optimisme de façade, la simple expression d’une défaite en réalité profondément intériorisée, c’est ce débat qu’il faut relancer, qui ne trouvera de solutions que collectives et inscrites dans les mobilisations telles qu’elles sont pour mieux en déborder les limites.
Notes
[1] Bernard Friot, Frédéric Lordon, En travail – Conversations sur le communisme, Paris, La Dispute, 2021,p. 135.
[2] Jean-Claude Barbier, Michaël Zemmour, Bruno Théret, Le système français de protection sociale, Paris, La Découverte, 2021, p. 71.
[3] C’est le cas, par exemple, de sa thèse affirmant que les retraités produisent leur pension. Dans ses derniers textes, Friot affirme que si la pension est un salaire et que le salaire rémunère un travail, alors les retraités travaillent. Cette affirmation ne s’accompagne d’aucune argumentation factuelle. Pierre Khalfa souligne que, dans Puissances du salariat, publié en 1998 (La Dispute, Paris), Friot définit le salaire non comme la valeur de la force de travail mais comme produit d’un rapport de forces, qui fait de la cotisation sociale la part socialisée de ce salaire. Dans L’enjeu des retraites, paru en 2010 (La Dispute, Paris), la pension des retraités ne résulte plus d’une redistribution mais elle consiste dans la richesse créée par les retraités eux-mêmes. (Pierre Khalfa, « La retraite, le salaire du retraité » ? », Mouvements n° 63, juillet-septembre 2010, pp. 168-169). Si Friot est revenu sur cette affirmation dans ses derniers livres, il continue de rejeter l’idée de solidarité intergénérationnelle qui accompagne le principe du financement des retraites par les actifs.
[4] Bernard Friot, Judith Bernard, Un désir de communisme, Paris, Textuel, 2020, p. 14
[5] Bernard Friot, Prenons le pouvoir sur nos retraites, Paris, La Dispute, 2023, p. 64.
[6] Bernard Friot, Frédéric Lordon, En travail, op. cit., p. 30.
[7] Ibid., p. 242.
[8] Ibid., p. 120.
[9] Bernard Friot, Vaincre Macron, Paris, La Dispute, 2017, p. 12.
[10] Henri Hatzfeld, Du paupérisme à la Sécurité sociale, 1850-1940 – Essai sur les origines de la Sécurité sociale en France, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1989.
[11] Michel Dreyfus, Michèle Ruffat, Vincent Viet, Danièle Voldman, Bruno Valat, Se protéger, être protégé – Une histoire des assurances sociales en France, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, ch. XI.
[12] Nicolas Da Silva, La bataille de la Sécu – une histoire du système de santé, Paris, La Fabrique, 2022, chapitre III.
[13] Jean-Claude Barbier, Michaël Zemmour, Bruno Théret, Le système français de protection sociale, op. cit., p. 107.
[14] Michel Dreyfus, Michèle Ruffat, Vincent Viet, Danièle Voldman, Bruno Valat, Se protéger, être protégé, op. cit., chapitre. 11.
[15] Julian Mischi, Le parti des communistes – Histoire du Parti communiste français de 1920 à nos jours, Paris, éd. Hors-d’Atteinte, 2020, p. 361.
[16] Serge Wolikow et Antony Todorov écrivent que « l’acceptation de la démocratie parlementaire par les différents partis « communistes occidentaux » procèdent d’indications explicites de Staline et de Georges Dimitrov » données en 1944 (« L’expansion européenne d’après-guerre », in : Le siècle des communismes, (dir. Michel Dreyfus, Bruno Groppo, Claudio Ingerflom, Roland Lew, Claude Pennetier, Bernard Pudal, Serge Wolikow), Paris, L’Atelier, 2000, p. 223). Ces questions sont complexes, mais Friot se contente d’affirmer qu’il y existe un anticommunisme à gauche « qui gobe voire qui construit le discours sur les staliniens qui auraient empêché la révolution possible en 1945 en France » (Bernard Friot, Judith Bernard, Désir de communisme, op. cit., p. 71).
[17] Nicolas Da Silva, La bataille de la Sécu, éd. cit., p. 104. Voir aussi, Henri Hatzfeld, Du paupérisme à la Sécurité sociale, op. cit., pp. 250 et suivantes.
[18] Michel Pigenet, « La Libération, les mobilisations sociales à l’heure de la Reconstruction », in : Michel Pigenet et Danielle Tartakowski, Histoire des mouvements sociaux en France, Paris, La Découverte, 2014, p. 430.
[19] Bernard Friot, Vaincre Macron, op. cit., p. 30.
[20] Michelle Zancarini-Fournel, Les luttes et les rêves – une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, Paris, Zones, ch. 15.
[21] Si le rôle d’Ambroise Croizat a été déterminant, il n’est pas le seul fondateur de la Sécurité sociale. Pierre Laroque, haut fonctionnaire, passé par le premier gouvernement de Vichy avant de devenir résistant et gaulliste, élabore la réforme de la Sécurité sociale à partir d’octobre 1944, sous la tutelle d’Alexandre Parodi, lui aussi haut fonctionnaire gaulliste, nommé « Ministre du Travail et de la Sécurité sociale » en septembre 1944. C’est dans un second temps qu’Ambroise Croizat, membre du Parti communiste et de la CGT et devenu Ministre du Travail en novembre 1945, complète et met en œuvre cette réforme, en étroite collaboration avec Pierre Laroque et François Billoux, ministre communiste de la Santé. Tous œuvrent ainsi à la réalisation du projet porté par le CNR dès mars 1944.
[22] Jean-Claude Barbier, Michaël Zemmour, Bruno Théret, Le système français de protection sociale, op. cit., pp. 16-17.
[23] Michel Dreyfus, Michèle Ruffat, Vincent Viet, Danièle Voldman, Bruno Valat, Se protéger, être protégé, op. cit., ch. 11.
[24] Bernard Friot, Prenons le pouvoir sur nos retraites, op. cit., p. 24.
[25] Bernard Friot, Frédéric Lordon, En travail, op. cit., p. 105.
[26] Bernard Friot, Prenons le pouvoir sur nos retraites, op. cit., p. 51.
[27] Bernard Friot, Frédéric Lordon, En travail, op. cit., p. 53.
[28] Bernard Friot, L’enjeu du salaire, Paris, La Dispute, 2012, p. 41.
[29] Ibid., p. 33.
[30] Bernard Friot, Vaincre Macron, op. cit., p. 10.
[31] Bernard Friot, Frédéric Lordon, En travail, op. cit., p. 119.
[32] Jean-Marie Harribey, « Dupont et Dupond : vive la capitalisation ! Je dirais même mieux : vive la capitalisation ! », Attac, 24 février 2023.
[33] Guillaume Gourgues, Karel Yon, « Rapport salarial », in : Colin Hay, Andy Smith (dir.), Dictionnaire d’économie politique, Paris, Presses de Sciences Po, 2018, pp. 391-402.
[34] Bernard Friot, Frédéric Lordon, En travail, op. cit., p. 39.
[35] Juan Sebastian Carbonell, Le futur du travail, Paris, Amsterdam, 2022, p. 60.
[36] Bernard Friot, Le travail, enjeu des retraites, op. cit, p. 204.
[37] Voir, par exemple, Désir de communisme, op. cit., p. 16 : Friot reproche aux syndicats de « pleurnicher », alors qu’« il ne tient qu’aux fonctionnaires d’État (…) de s’opposer à l’invasion de la logique managériale », à condition de s’auto-organiser, conformément à leur statut et à l’idée que s’en faisait Maurice Thorez en 1946…
[38] Bernard Friot, Prenons le pouvoir sur nos retraites, op. cit., p. 14.
[39] Bernard Friot, Judith Bernard, Désir de communisme, op. cit., p. 66.
[40] Bernard Friot, Frédéric Lordon, En travail, op. cit., p. 213.
[41] Ibid., p. 119.
[42] Bernard Friot, Judith Bernard, Désir de communisme, op. cit., p. 213.
[43] Ibid., p. 66 et p. 67.
[44] Bernard Friot, Prenons le pouvoir sur nos retraites, op. cit., p. 64.
[45] C’est cette vieille conception étapiste du socialisme comme stade inférieur du communisme que certains membres du PCF ont objecté à Friot, ce dernier étant l’un des signataires du texte d’orientation « Urgence de communisme » qui fut opposé à celui de la direction actuelle, en vue du Congrès de Marseille de mars 2023.
[46] Bernard Friot, Vaincre Macron, op. cit., p. 125.
[47] Dans la traduction d’Alfred Kuen, Parole vivante, traduction dynamique du Nouveau Testament, Marpent, BLF Europe Editions, 2011.
[48] « Le travail semble être une catégorie toute simple. L’idée du travail dans cette universalité – comme travail en général – est, elle aussi, des plus anciennes. Cependant, conçu du point de vue économique sous cette forme simple, le ‘travail’ est une catégorie tout aussi moderne que les rapports qui engendrent cette abstraction simple » écrit Marx dans l’Introduction à la critique de l’économie politique, reliant l’émergence des catégories générales à l’histoire d’une homogénéisation réelle de l’activité productive par le capitalisme.
[49] Ibid., p. 67.
[50] Bernard Friot, L’enjeu du salaire, éd. cit., p. 16.
[51] Bernard Friot, Frédéric Lordon, En travail, éd. cit., p. 25.
[52] Bernard Friot, L’enjeu du salaire, éd. cit., p. 175.
[53] Ibid., p. 186.
[54] Ibid., p. 124.
[55] Ibid., p. 168.
[56] Mateo Alaluf, Daniel Zamora, Contre l’allocation universelle, Montréal, Lux, Montréal, 2017, p. 7.
[57] Jean-Marie Harribey, « Derrière les retraites, le travail. À propos du livre de Bernard Friot, Le travail, enjeu des retraites »,Les Possibles, n°20, printemps 2019 ; « Aux salariés mal nés, la valeur n’attend que 18 années. Lire Vaincre Macron de B. Friot », Contretemps, janvier 2018 ; « Les retraités au pouvoir selon Bernard Friot ? », Contretemps, mars 2023 ; Jérôme Maucourant et Véronique Taquin, « Les fondements du système français de retraites en question, A propos de L’enjeu des retraites », de Bernard Friot », Le journal du MAUSS, 2010.
[58] Alain Bihr, La novlangue néolibérale, Lausanne, Page Deux, 2007, p. 33.
[59] « Il n’y a pas de réforme progressive ! » s’exclame Friot (Désir de communisme, p. 15).
[60] Bernard Friot, Prenons le pouvoir sur nos retraites, éd. cit., p. 90.
[61] Ibid., p. 98 et p. 100.
[62] Bernard Friot, Judith Bernard, Désir de communisme, éd. cit., p. 34.
[63] Bernard Friot, L’enjeu du salaire, op. cit., p. 28.
[64] Christiane Marty, L’enjeu féministe des retraites, Paris, La Dispute, 2023, p. 27.
[65] Bernard Friot, Prenons le pouvoir sur nos retraites, op. cit., p. 22.
[66] Ibid., p. 78.
[67] Jean-Marie Harribey, « Repenser le travail, la valeur et les revenus », in : Matéo Alaluf et Daniel Zamora, Contre l’allocation universelle, op. cit., p. 69.









