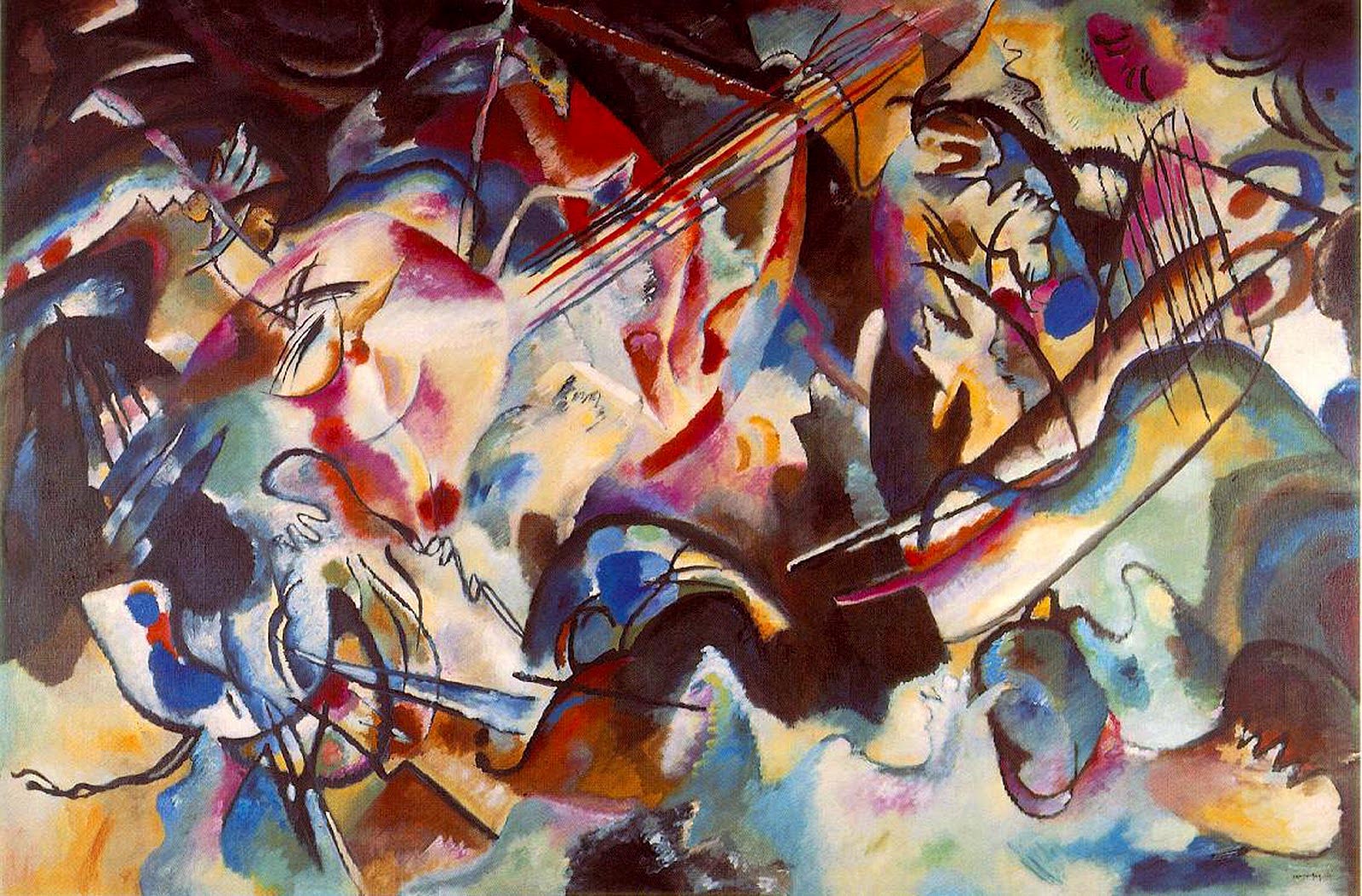
Une recension de Puissances du salariat par Frédéric Lordon
Alors que En travail. Conversations sur le communisme (La Dispute, 2021) ouvre un dialogue inédit et passionnant entre Bernard Friot et Frédéric Lordon, dont on recommande vivement la lecture, il n’aura pas échappé à celleux qui suivent leurs travaux que les prémices de leur rencontre intellectuelle remontent déjà à quelques années.
Dans leurs entretiens conduits par Amélie Jeammet, il est plus d’une fois fait allusion à une recension[1] de Puissances du salariat[2] de B. Friot par F. Lordon, parue en 1998. Si le premier sait gré à son camarade d’avoir donné une visibilité inespérée à son ouvrage, le second confie en avoir été « emporté comme dans un tourbillon, littéralement vampé »[3] à sa lecture. Il nous a dès lors semblé opportun de partager avec le plus grand nombre le compte-rendu pour le moins rocambolesque (et ô combien jouissif !) de F. Lordon.

Puissances du salariat
Bernard Friot, édition La Dispute, Paris (1998)
Par DJ-FRED[1]
Ce matin-là, Bernard Friot se lève et décide : 1) je me laisse pousser la barbe ; je serai Karl Marx ou rien. Ecsta coupé au spécial K – comme Kapital ? Fix au Pétrole Hahn ? En tout cas c’est parti pour un vieux trip avec salariés en lutte à la place des éléphants roses, et révélation du sens de l’histoire au moment du flash.
On va le dire tout de suite pour ne pas laisser inutilement s’installer des malentendus : ce bouquin est super ! D’une radicalité à réveiller un mort, il nous montre que l’intransigeance peut se décliner simultanément dans l’ordre de la pensée et dans celui du projet militant – soulagement tout de même en une époque où la norme révolutionnaire était en train de s’aligner sur les vaticinations de Viviane, qui croit faire un voyage quand elle fait des bulles après deux verres de champagne. Radical aussi par l’ambition, qui nous sauve enfin des émiettements anomiques de la division du travail scientifique, non sans parfois confiner à la folie des grandeurs – mais des deux excès on préférera avec plaisir le second. J’entends bien qu’il y a quelque chose de nécessaire – et d’admirable – dans les grignotages de trotte-menu et les ergotages millimétriques de la science ordinaire, mais de temps en temps courir tout nu à travers champs est un truc qui fait énormément de bien. Bref, on ne sait pas ce que Friot a pris ce jour-là. On se doute que ça n’est pas dans la licence IV, mais on s’en fout, on veut essayer aussi.
Évidemment la dose est massive et on n’est pas sûr de tout bien digérer. Mais ça, il fallait s’y attendre : même dans les meilleurs trips on a toujours un peu mal aux cheveux. Là, pareil : il y a deux ou trois fois où le cachet a du mal à descendre. Sur le modèle de Médecins du monde qui s’incruste dans les raves pour éviter aux gamins d’avaler de la crotte, bilan chimique d’un produit qui change agréablement du lait grenadine mais qui laisse un instant neuneu, juste sur le coup.
Trois thèses sur le salariat, un café, l’addition et de la décoiffure
Ce qu’il y a de bien dans ce livre, c’est qu’il y a de tout : de l’histoire avec un petit h – celle des avancées sociales chèrement gagnées et des coups fourrés de la négociation collective -, de l’histoire avec un grand H – avec livraison de sens en palettes pour au moins un siècle -, des concepts, et surtout une réforme radicale des catégories de l’entendement, c’est-à-dire, comme à l’époque de Pif-gadget, une paire de lunettes à monter toi-même et qui font voir le monde avec des couleurs bizarres, en tout cas pas les mêmes que d’habitude. (Hihihi, bien sûr pour que les lunettes fassent de l’effet il faut d’abord avoir bouffé les cachetons – sacré Bernard.)
Thèse 1 : « Je ne suis pas celle que vous croyez » – nous dit la rémunération salariale
Si la terre ne ment pas, l’idéologie du salaire-valeur, elle, nous embobine depuis un bail. Voilà la première idée que Friot nous administre. Le salaire n’est pas de l’ordre de la valeur. Il n’est pas un prix de marché, ni la contrepartie d’une contribution productive mesurable, encore moins les dividendes d’un capital humain. Le salaire ne ressortit pas aux mécanismes de l’économie, il est l’expression d’une distribution politique de la richesse. Du coup, c’est la prestation sociale qui en constitue la forme accomplie et les institutions de la protection sociale à la française qui en sont l’instance majeure. Soustrayant au marché la formation d’une bonne moitié du revenu disponible des ménages, la Sécu est le lieu par excellence de la distribution politique, la terre d’élection du salaire comme politique faite grandeur.
Premier hoquet : on en a presque l’impression que si la prestation sociale constitue la vérité dernière du salaire politique, le salaire direct (qui continue tout de même d’exister !) est une espèce de reliquat aberrant, une scorie de l’histoire. Non non non, nous dit Friot : le salaire direct est lui aussi politique à partir du moment où sa fixation est rendue totalement conventionnelle et participe d’une logique du barème, neutralisation de la logique du marché. C’est d’ailleurs tout l’avantage de la manœuvre : au moins les conflits de répartition, entre prestations et barèmes, sont-ils exposés au grand jour, appelant la passation de compromis explicites et expressément politiques – résolution transparente qui tranche singulièrement avec l’opacité que fait tomber d’ordinaire sur la formation des revenus les abstractions dissimulatrices de la macroéconomie. Tout cela est vrai et on l’entend bien, mais jusqu’à un certain point seulement. Car le salaire (direct) barème est surtout le propre de la fonction publique – dont Friot veut certes faire un modèle, mais qui n’a pas encore entièrement conquis la société française ! Et s’il est vrai que des entreprises pratiquent le salaire-grille, on ne saurait pour autant considérer que tout le secteur privé s’est doté de marchés internes suffisamment structurés pour soustraire entotalité la fixation des salaires à quelque chose qui est de l’ordre des « ajustements de marché ». Début de confusion du positif et du normatif et commencement d’hallucination en forme de wishful thinking. On aura l’occasion d’en reparler.
En attendant, voilà tout de même de quoi mettre les choses au clair à propos de la vraie place qui revient à notre Sécu dans le tableau des espèces. Il faut vraiment carburer au gros-qui-tache, nous dit en substance Friot, pour qualifier de beveridgienne la protection sociale à la française. Soulagement de Bruno Théret, revenu avant les autres du 12°5, et qui disait la même chose depuis des lustres, mais dans des articles où l’hyperthermie arrive dès la lecture du titre de trois lignes et où on risque le décollement de rétine à regarder trop longtemps des tableaux qui font croire que les SNPS[2] sont des molécules de chimie organique.[3]
Bref, contrairement à tout ce qu’on raconte, la protection sociale à la Beveridge, comme combinaison de l’épargne-retraite financière individuelle et d’un filet de sécurité assistancielle à financement fiscalisé, réalise à peu près l’antithèse parfaite du modèle français de protection sociale ! En tout cas la Sécu est un truc précieux car, insiste Friot, le génie de cette invention institutionnelle c’est de contourner l’impératif de la constitution d’épargne préalable pour financer les retraites – propriété sacrément agréable quand on racle les tiroirs à la recherche de tout ce qui pourrait résister au fléau de la financiarisation. En effet, les cotisations sociales versées par le salarié ne financent pas la pension qu’il touchera dans trente ans, elles la légitiment. Sans requérir d’accumulation préalable, les retraites ne sont pas directement financées par les intéressés mais par les cotisants courants, et c’est bien cette disposition qui est productrice de lien social. Avec le camp d’en face, c’est le choc des civilisations : Beveridge est grand et Bébéar est son prophète. Ceux-là voudraient substituer à la solidarité horizontale la « solidarité » longitudinale, à la solidarité instantanée de la collectivité la solidarité intertemporelle de l’individu avec lui-même. Inversion radicale et régression manifeste, puisqu’il s’agit de démanteler l’une des dernières résistances à l’envahissement complet de la société par la finance, et dans la foulée de faire sauter un lien en l’absence duquel la cohésion sociale fera bien comme elle pourra – c’est vrai, elle nous fatigue celle-là, quoi.
Thèse 2 : L’emploi et le salariat sont les deux mamelles du politique
Récuser l’impératif de l’épargne préalable et de la financiarisation de la protection sociale, nous dit Friot, n’est rien d’autre que renouer avec l’intuition fondatrice d’Hatzfeld pour qui le modèle français réalise le passage d’une sécurité par la propriété à une sécurité par le salaire. Encore faut-il bien s’entendre sur ce qu’il y a lieu de comprendre du terme « salaire » et de son corrélat « l’emploi ». Le monde du salariat n’est pas seulement la collectivité de ceux qui touchent un salaire. Il rassemble tous ceux qui vivent d’une ressource salariale, soit directement soit indirectement par les prestations sociales qu’ils reçoivent – extension impeccablement logique au regard des prémisses précédentes. Le salariat s’incarne alors dans la figure du « travailleur collectif » où le chômeur, le retraité, le malade et l’accidenté côtoient le salarié « ordinaire », celui qu’on connaît, qui travaille et qui touche à la fin du mois, mais qui fait désormais communauté avec tous ceux qui participent à la grande circulation de revenus mise en mouvement à partir de la ressource salariale. « L’emploi », c’est eux, entité co-extensive du salariat et qui ne se définit plus par la détention d’un contrat de travail en bonne et due forme. On sent qu’on arrive dans l’inhabituel, dans l’exotique, que nos catégories usuelles ont du shimmy et qu’on a la vision des couleurs qui commence à foirer. On n’a encore rien vu. Car Friot est un type logique, et qui connaît la force explosive de la conséquence. Puisque nous voilà partis dans une reconstruction politique du salariat et du monde de l’emploi, il faut aller jusqu’au bout.
Et comme les mots sont trompeurs et qu’ils n’en finissent pas de charrier souterrainement des images du monde bien faites pour reconduire le monde en son ordre établi, la première chose à faire est de procéder à leur rectification. Ainsi, dans la logique de Friot, est-il aberrant de parler de redistribution à propos de la protection sociale à la française. La Sécu ne redistribue pas. Partie de la circulation salariale, elle distribue tout court. La tuyauterie cotisations-prestations n’est pas qualitativement distincte du salaire direct-barème sous ce rapport : tous contribuent à la distribution politique du salaire généralisé, opération à un coup et qui n’appelle pas de réitération. Dans la foulée c’est la catégorie de solidarité qui fait naufrage à son tour. Avec ses relents assistanciels, tout en dépassant la charité, elle reste de l’ordre de l’emplâtre, du surplus ou du complément. Et même si elle s’inscrit dans des droits sociaux institutionnalisés, elle ne cesse de reconduire le clivage des inclus et des exclus du monde de l’emploi (au sens classique), ce clivage que veut précisément dépasser la figure du « travailleur collectif » pour affirmer la « solidarité » de tous ses membres à titre essentiel et non pas supplétif. Et voilà que ça se met à dégringoler : avec la solidarité, exit l’État-Providence dont l’intitulé même véhicule et incruste dans les esprits la logique solidariste et redistributive qu’il s’agit de dynamiter. Enfin, ni fleurs ni couronnes pour le « social », cette figure intermédiaire si nécessaire à la pensée libérale pour concevoir l’articulation de l’économique et du politique [Donzelot, 1983 ; Ewald, 1986], quand cette articulation est immédiate et consubstantielle au « salariat » et à « l’emploi» généralisés.
Là déjà ça commence à faire beaucoup, et sous ces engloutissements successifs d’objets familiers qu’on croyait assez bien installés, le lecteur de base se sent la vision du monde partir en sucette, et éprouve ce flottement pénible consécutif à ununivers cognitif foutu par terre. Évidemment Semtex-Friot jubile.
Heureusement, de temps à autre, le bougre nous fait une boulette qui nous permet de toucher terre à nouveau et de nous rebeller avec d’autant plus de véhémence qu’on ne veut pas louper cette occasion d’avoir retrouvé nos marques. Premier pétage de plombs, mais d’importance, sur la Régulation. La théorie de la Régulation, figurez-vous, « qui comme son nom l’indique récuse le caractère contradictoire du capitalisme » et dont le « fonctionnalisme » est notoire, « est l’instrument du travail de deuil » du salariat, présenté par elle comme « un moment dépassé […] un passé révolu »[4]. On va céder, mais juste un instant, à l’envie de se départir de la bienséance académique qui a fait jusqu’ici l’excellente tenue de ce compte rendu : tant de couillonnades dans un si petit espace, ça tient du prodige. Oh la la le mauvais trip, voilà ce qui arrive quand on se fait refiler des cachets à la sciure de bois ou qu’on roule ses pétards avec des couvertures de manuels scolaires : on voit la Régulation tout flou entre deux chauves-souris. À force d’avaler n’importe quoi, Bernard a fini par confondre CME et Régulation. On va donc servir le café salé au jerrycan, mais c’est tout de même un peu pénible à la fin : on accuse les régulationnistes de radoter, quand il leur faut sans cesse ripoliner les bases. « Régulation », cher Bernard Friot, c’est fait exprès pour sortir de la reproduction et faire sa part à l’histoire : il s’agit de désigner la façon dont un ensemble de formes institutionnelles à durée de vie finie accommodent, mais transitoirement, les contradictions principales du capitalisme dont les régulationnistes n’ont jamais cessé d’affirmer la permanence. Mais enfin, est-il si difficile de lire les textes en essayant d’enregistrer honnêtement ce qu’ils disent – « la régulation est le primat relatif et temporaire de l’unité sur la lutte » [Lipietz, 1979] -, et est-il venu à l’idée de Friot que si les régulationnistes utilisent le mot crise plus souvent qu’à leur tour, c’est précisément pour exprimer l’idée qu’il y a de temps en temps comme qui dirait des ratés dans la reproduction ? Du contresens sur la régulation-reproduction découle évidemment celui sur le fonctionnalisme – dont la Régulation s’est toujours soigneusement tenue à distance par un geste méthodologique aussi explicite que réfléchi. C’est parce qu’elle est un historicisme que la Régulation est plutôt bien placée pour s’apercevoir que les genèses institutionnelles et les créations historiques ne répondent presque jamais aux logiques d’optimisation fonctionnelle des reconstructeurs post festum. Quant à l’enterrement supposé du salariat, s’il y a une question sur laquelle les régulationnistes, en général plus divisés qu’un village gaulois, sont tous d’accord c’est bien celle de « la fin du travail », unanimement tenue pour une galéjade, et sur la permanence de la société salariale ! Au total, mettre davantage à côté de la plaque était possible, mais à condition de nous coller les anticipations rationnelles ou la courbe de Laffer.
On en était à la dimension politique du salariat et puis voilà on s’est un peu perdu en route. Mise au point faite et bile soulagée on peut peut-être s’y remettre, d’autant plus qu’en comparaison de ce qui doit venir, ce qui précède fait office d’aimable pétarade. Voici la vraie bombe : le salariat n’est pas seulement politique, il est le politique. Tout entier et sans résidu. « Penser qu’il est possible d’affirmer la citoyenneté contre ou sans l’inscription dans le salariat est absurde »[5]. Tel que. Ainsi, le politique est intégralement réductible au salariat – étendu bien sûr, mais tout de même ! -, et la seule vraie communauté politique, c’est celle du « travailleur collectif ». « Sa citoyenneté [celle du travailleur] est armée de son appartenance au salariat »[6]. Ah ça, pour détoner, ça détone. Mais sous la violence de la déflagration il n’est pas dit que Friot himself ne sorte pas un peu noirci et la liquette en guenilles. « C’est l’appartenance au salariat qui fonde la capacité politique »[7] : aïe aïe aïe Bernard, mais que fais-tu de nos amis les agriculteurs, les notaires et les petits commerçants ? Tu veux vraiment finir avec du pneu qui brûle autour de ta voiture ou de la betterave au quintal sur ta porte palière. Et bien oui, ne t’en déplaise, nos amis les fâcheux continuent malgré tout de faire partie de la communauté citoyenne, quoique non salariés, même lato sensu, c’est-à-dire ne vivant ni directement ni indirectement de la ressource salariale. Alors bon,qu’est-ce qu’on en fait ? Dans l’attente d’une colonie lunaire il faut bien continuer à se les tartiner, et en fait comme ça ne se passe pas toujours au pire, c’est peut-être qu’il y a du lien politique qui opère hors de la sphère salariale. La représentation, le suffrage universel, la souveraineté tout ça, c’est vraiment le salariat et lui seul ? Il me vient à l’esprit que si Bruno Théret, qui n’est pas seulement un chimiste de talent, passait par là il nous livrerait quelques arguments sur l’autonomie – relative bien sûr – du politique qui permettraient au moins de donner les premiers soins contre les effets du blast.
Thèse 3 : Prophetico ergo sum
Ça fait déjà un moment que la température monte et on sent venir le bouquet final. Le voici : contrairement à ce que beaucoup continuent de penser, le salariat n’est pas un rapport social du capitalisme mais un rapport social antagoniste au capitalisme.
Les travaux d’approche avaient été soigneusement conduits, et dès la redéfinition du salariat on se doutait que le « rapport salarial » marxien à la papa allait souffrir. D’abord, et curieusement, la question de la propriété n’est jamais reprise. De la séparation des travailleurs d’avec les moyens de production, pas un mot. Peut-être que pour Friot ça continue d’aller sans dire, mais dans le chamboulement général, où on ne sait plus trop ce qui reste debout et ce qui est parterre, on trouve que ça irait mieux en le disant. D’autant plus que se retrouve à coup sûr au tapis le rapport de subordination comme caractère décisif du salariat : « dans les problématiques dominantes […] les individus s’inscriraient dans le salariat […] par leur type de rapport au travail, dont celui qui repose sur « contrat et subordination » sera défini comme salarié. Il faut tenir la position inverse : ce sont les ressources qui définissent les salariés, et elles trouveront leur explicitation dans des rapports au travail, dont l’analyse est utile pour déƒinir la structure du salariat, mais qui ne sont pas décisifs pour inscrire les individus dans le salariat »[8]. Comme toujours rien que de très logique au regard du projet général de Friot. Il faut en effet rétrograder le rapport au travail dans la hiérarchie des prédicats du salariat dès lors qu’on entend faire figurer côte à côte au sein du « travailleur collectif » aussi bien « un médecin conventionné du secteur T, qui tire ses revenus de l’assurance-maladie, un pensionné, un chômeur indemnisé, les ayants droit d’un salarié actiƒ»[9]. Mais tout de même l’entendement ancien renâcle quand il lui est ainsi demandé de renoncer à accorder toute antériorité au salarié stricto sensu, le producteur de valeur ajoutée dont une partie va être mise en circulation dans la communauté de « l’emploi » – antériorité qui justifierait de conserver toute leur importance aux rapports de propriété et de subordination. Sainte patience, doit s’exclamer Friot, celui-là n’a vraiment rien compris…
On voit rapidement en tout cas que le rapport de subordination ne pouvait pas faire obstacle très longtemps face à ce qui se prépare. Car Friot le Titan entreprend de dresser le salariat contre le capitalisme. Non pas le salariat – collection des salariés – contre le capital – les capitalistes sur leur tas d’or – ; ça, on connaît. Mais le rapport social du salariat (étendu) contre le rapport social du capitalisme. Confrontation qui supposait d’abord d’extraire l’un de l’autre puisqu’on les pensait d’abord dans une relation d’englobement. Et c’est bien là le sens de l’histoire que Friot dévoile sous nos yeux ébahis : le salariat est « tout à la fois produit et négation de la logique capitaliste »[10]. Ce qui frappe d’abord dans cette proposition c’est l’indétermination de son statut. Lorsque Friot déclare que le salariat, tel qu’il s’est construit à l’ombre de la protection sociale à la française, est fondamentalement d’une logique anti-capitaliste, qu’il recèle en lui des Puissances capables de renverser l’ordre d’où il est issu et contre lequel il est en train de se retourner, c’est-à-dire qu’il est porteur d’un devenir révolutionnaire, que dit-il ou plutôt que fait-il exactement ? Extraction du sens ou prophétie créatrice ? « Un peu des deux » ânonne l’empastrouillé qui ne sait pas trop comment trancher. Et bien pour une fois la réponse la plus facile ne manque pas de pertinence. Friot n’a pas inventé le salariat à la française, c’est l’histoire qui lui en livre la trajectoire. Mais une trajectoire inachevée et en attente de son plein déploiement. Une trajectoire qui a maintenant besoin d’une parole consécratrice et de ses auxiliaires symboliques pour apparaître vraiment pour ce qu’elle est, et pour se prolonger « en toute connaissance de cause », ou « en toute conscience d’elle-même ». Bourdieu l’a montré, en reprenant les termes de Durkheim : la construction symbolique de la réalité sociale ne « prend » qu’à partir d’une « fiction bien ƒondée »[11]. Or c’est bien à un tel acte constructiviste que se livre Friot, à partir d’un substrat qui s’y prête objectivement : voir le salaire non plus comme valeur de l’économie, comme prix de marché, mais comme une distribution politique, voir l’emploi nonplus comme la détention d’un contrat de travail, mais comme l’appartenance à une communauté de la ressource salariale, c’est, à partir du même « matériel empirique », opérer une mise en forme symbolique de la réalité sociale absolument inédite – révolution dans les catégories qui anticipe sur la révolution tout court, en même temps qu’elle aide à l’accomplir. Parce que, en faisant l’économie de l’accumulation préalable il fait barrage à la financiarisation, parce qu’il crée la communauté du « travailleur collectif » au principe d’une citoyenneté politique, le salariat, engendré du capitalisme, finit par se dresser contre lui. Mais encore faut-il avoir pleinement conscience de toutes ces potentialités pour qu’elles puissent effectivement se réaliser. Friot a conscience de la nécessité de la prise de conscience, du surplus de dynamisme social qui peut naître de l’inscription dans les consciences d’une nouvelle image du monde social. C’est donc avec ses armes à lui, c’est-à-dire performativement, qu’il œuvre inséparablement à la construction et au déploiement des Puissances du salariat.
C’est bien sûr dans ces moments-là que l’entreprise de Friot révèle toute sa démesure. Pas étonnant donc que le lecteur soit tantôt emporté par le souffle révolutionnaire, tantôt estomaqué par l’ambition de l’auteur. Car, en gros, suggère Friot, le salariat est sympa mais il a la vue un peu basse. Bien sûr il enchaîne les conquêtes sociales avec ténacité, mais leur sens global continue de lui échapper. Il tient la perle entre ses mains mais il ne s’en est pas bien aperçu. En d’autres termes, le salariat a fait son histoire mais il ne sait pas l’histoire qu’il a faite – ça vous rappelle quelque chose ? En tout cas il faut bien que quelqu’un se dévoue pour la lui raconter, et opérer cette transition décisive de l’histoire magmatique à l’histoire mise enordre de marche. C’est trop bête d’enchaîner les grèves, les négociations à pas dormir, les accords matutinaux à l’haleine chargée, les luttes désespérées ou joyeuses, sans avoir idée de où tout ça nous mène, non ? On exige du sens, on veut de la lumière. Or vieux Karl n’est plus l’homme de la situation. D’abord l’État-Providence, tout ça, il a pas vu venir, et puis surtout il est resté collé avec le salariat dans le capitalisme. Du coup on réclame intérimaire barbu, à l’aise dans la prophétie, bon sens de l’histoire à cent ans, eschatologique lu, écrit, parlé, références sérieuses exigées. Pas de problème, BF se pointe au guichet, sort son curriculum et décroche le job : « Qu’est-ce que c’est comme boulot ? » – « C’est pour faire accoucheur de l’histoire » – « Impec, j’ai déjà fait un CDD de ça et puis j’ai plus trop envie de me raser ». Quelques mouvements d’échauffement pour démarrer le cerveau jupitérien à la manivelle, les forces de l’esprit s’ébrouent et se mettent au boulot pour tout à la fois extraire, révéler et accomplir la destinée révolutionnaire du salariat. Ah c’est sûr, Grand herméneute et Guide suprême, ça boxe pas dans la même catégorie que marabout à Paris-Boum Boum ou pythonisse à la Foire du Trône. Le geste est titanesque, mais tout dans le symbolique et le performatif. C’est pourquoi il rappelle irrésistiblement – et comme c’est fait pour ! – celui de Marx qui contribuait à la fois à dire et à faire être historiquement la lutte des classes. Comme jadis le vieux maître, tout l’art consiste à faire voir ce qui était déjà là mais imperçu, à porter au clair ce qui était encore dans le flou. D’une parole ample et messianique, on dissipe le brouillard et on guérit les cécités. Tout ça est donc une affaire de vision. Le salariat était à moitié en rade ? Actif mais miro ? Heureusement, dans ce monde de bigleux, Friot a le don de double vue pour les autres, celui qui fait voir le manitou direct en stéréoscopie ; et à côté de lui Castaneda est un grand amblyope qui peut pas sortir sans son labrador.
On chambre un peu l’auteur, mais c’est pour rire, car d’un certain côté son propos s’y prête et qu’il ne faut pas perdre une occasion de rigoler. Mais c’est peut-être aussi parce que, ne cessant in petto de le prendre au sérieux, on cherche, comme on peut, à retrouver son souffle et à réduire l’effet de la commotion. D’abord on friserait l’inconséquence en commençant par un panégyrique de la grande théorie et des visions en cinémascope pour finir par éreinter les rares candidats à oser se lancer. Mais il y a surtout dans le système de Friot et sa culmination prophétique une cohérence d’ensemble et une capacité d’agression de nos visions du monde qui impressionnent autant qu’elles donnent le sentiment d’être mis en danger. Car, si la vaticination en roue libre est à la portée du premier venu, la prophétie au bulldozer, celle qui découle inexorablement d’une analyse historique de longue haleine et d’un appareil conceptuel ferraillé à outrance, est un événement plus rare dont on se souvient du passage. Envoyé cul par-dessus tête sous l’impact, le lecteur à la ramasse se défend de la déstabilisation avec les moyens du bord ; ce peut être, pour tenter de minimiser, par la dérision. C’est pourquoi ces taquineries pas méchantes doivent être prises pour ce qu’elles sont véritablement : une forme d’hommage paradoxal.
Le salariat, chef-d’œuvre en péril ?
C’est sûrement parce que sa vision de l’histoire place dans le salariat des enjeux d’une tout autre importance que celle que nous avons l’habitude d’y voir, que Friot a la fulmination généreuse et l’éruption facile. C’est d’ailleurs tout l’avantage de remonter de quelques crans la barre des attentes investies dans le salariat et de le requalifier en dessein grandiose. On ygagne en sensibilité, là où quinze ans d’attaques récurrentes pourraient presque finir par endormir les plus vigilants et conduire, par la force de l’habitude, à trouver seulement « exagéré » ce qu’on aurait autrefois qualifié d’atteinte intolérable. Sans hésiter, et d’ailleurs en toute logique, Friot endosse le rôle du véhément de service. Du coup, le pauvre a l’ulcération permanente.
Le fait est que l’époque n’est guère aimable au « travailleur collectif », et que si le salariat a l’orientation incertaine, en face on sait parfaitement où on veut en venir. Ironie de l’histoire : par la force des démantèlements successifs, le contre-sens sur le beveridgisme est entrain de s’auto-dissoudre. Ce qui était une erreur de catégorie devient chaque jour davantage réalité. Étape par étape, le modèle beveridgien progresse inexorablement. Or il n’est pas de dispositif plus efficace que ce binôme de l’épargne financière personnelle et de l’assistance fiscalisée pour rompre l’unité du salariat. À chacun sa prévoyance d’un côté, et la voiture-balai de l’autre, histoire de bien signifier aux exclus leur statut d’exclus. Dans une veine qui n’est pas sans faire penser à Illich, Friot montre que, par un retournement pervers, la « solidarité » fait prospérer le clivage de l’exclusion qu’elle est censée résorber. Du coup, voilà le « travailleur collectif » menacé de se vider par les deux bouts : par le haut, en rentiers, et par le bas, en exclus. C’est pourquoi il y a une solidarité profonde entre les thématiques des fonds de pension et celles de l’Allocation Universelle d’Existence. L’une et l’autre œuvrent de concert à l’éclatement du salariat, à la polarisation de la société, et entretiennent entre elles cette cohérence qui est celle du modèle beveridgien.
Les attaques n’ont pas toujours ce côté aussi massif et spectaculairement visible que lorsqu’il est question des fonds de pension, où se joue le choc frontal de deux systèmes, logique contre logique. Le diable est dans les détails, et si le grand basculement finit par survenir, il le devra aussi à cette préparation méticuleuse et de longue haleine, faite de « petites » avancées, plus « techniques », moins fortes en charge symbolique et moins susceptibles de jeter les foules dans la rue, mais tout aussi corrosives d’un point de vue « conceptuel », c’est-à-dire dans les dommages faits aux principes du salariat à la française. Le vaste mouvement, mais dessiné à petites touches depuis bientôt dix ans, de fiscalisation de la protection sociale entre typiquement dans cette catégorie. La substitution de la CSG aux cotisations sociales, les exonérations et reprofilages en tous genres, la fiscalisation des prestations familiales, etc, sont pour Friot autant d’atteintes à l’unité de la circulation salariale. Toutes « s’emploient à détruire [le salariat] en réduisant le champ de la cotisation au bénéfice del’impôt et de l’épargne : il s’agit de déconnecter la protection sociale du salaire »[12]. Dans ce ripage progressif de la protection sociale vers l’épargne et l’État fiscal se joue donc la lente dépossession du salariat de ses conquêtes historiques, c’est-à-dire de tout ce qui, l’arrachant au salaire direct marchand, l’aura constitué en rapport social susceptible de s’opposer à l’emprise complète du capitalisme sur la société. Du coup la mise en forme grandiose qu’on charriait tout à l ‘heure fait mieux voir ses vertus : c’est par référence, mais en creux, à la logique historique qu’elle a dégagée, qu’on peut mieux percevoir la systématicité et la cohérence d’ensemble de ces mille « petites » agressions éparses, dont le cumul finit par faire un changement de société. On rêve alors d’un travail d’histoire des représentations qui reconstituerait le long massage des élites politico-administratives par les idées beveridgiennes, la lente imbibition des esprits d’État qui prépare les conversions inconscientes et qui, en dehors de tout projet machiavélique ex ante, finit par faire d’une myriade de décisions séparées, non plus une série d’aberrations incoordonnées, mais la trame d’une cohérence de longue période.
Ainsi, parce qu’il ratisse large, fait système de tout ce qu’il ramasse, et constitue l’ensemble en enjeu historique, le travail de Friot donne des armes à la résistance intellectuelle, c’est-à-dire de quoi ne pas céder immédiatement au terrorisme et à l’intoxication. Or c’est bien ce genre d’intimidation et d’effet d’autorité qu’on voit à l’œuvre à propos des retraites ou de la santé, supposées l’une et l’autre naufrager la Sécu à coup sûr. Postulat bien fait pour aller directement à la conclusion désirée – « bazardons, bazardons ! » – en s’évitant l’effort de se demander si le système n’aurait pas par hasard les moyens, à logique invariante, d’accommoder les tensions auxquelles il est objectivement confronté. Or Friot insiste pour dire que, à principes constants, les paramètres du compromis de la protection sociale sont, eux, évidemment révisables. Il n’y a que dans le discours de ses détracteurs que la Sécu a la souplesse d’un verre de lampe, quand les degrés de liberté existent pour amortir les chocs imprévus et qu’il entre dans le compromis l’acceptation de ce que ses termes puissent un jour devenir moins favorables qu’ils ne l’étaient par le passé. La baisse du point, l’augmentation des cotisations font partie de ces révisions, et au moins pourrait- on se donner là peine d’examiner ce qu’il est possible de faire avec ces instruments simples plutôt que de fracasser soi-même les étagères pour mettre plus vite la boutique en liquidation. C’était là d’ailleurs tout le sens d’un travail réalisé par Cornilleau, Echevin et Timbeau [1996], qui montraient que les inflexions à réaliser pour « passer » en moyenne période étaient somme toute assez modestes, conclusion aux vertus esthétiques très médiocres quand la dramaturgie du discours dominant réclame de la ruine, du sang et des larmes.
Tout ça fait beaucoup, mais comme la meilleure défense c’est l’attaque, Friot ne reste pas les deux pieds dans le même sabot et, rendant coup pour coup, propose autant d’avancées par lesquelles revitaliser le salariat. L’effort est admirable bien entendu, mais, comme souvent, le volet propositionnel ne vaut pas tout à fait l’analyse qui l’a précédé.
Partout où le modèle beveridgien menace d’imposer sa « solidarité » excluante, commence Friot, réaffirmons la logique du salariat et la solidarité essentielle du « travailleur collectif ». C’est la cotisation-prestation, et non l’impôt, qui doit circuler entre employés et chômeurs pour refuser la relégation assistancielle, la dégradation sociale de ces derniers, et proclamer publiquement qu’ils demeurent bien des membres à part entière du salariat. La cotisation doit donc monter jusqu’au niveau nécessaire pour garantir financièrement cette cohésion essentielle du salariat. Quitte à se faire un instant l’avocat du diable, on voudrait alors confronter Friot aux questions les plus usuelles de ses contradicteurs beveridgiens, qu’il n’affronte pas directement et que la seule réaffirmation des impératifs du salariat ne suffit pas à esquiver. L’assurance-chômage n’est-elle pas confrontée à un changement de régime, et peut-elle continuer de fonctionner à l’identique quand elle doit supporter un chômage massif et permanent en lieu et place du chômage frictionnel qui constituait son cahier des charges d’origine ? Certes l’histoire récente a montré que l’extension du prélèvement social était bien mieux tolérée que celle du prélèvement fiscal, mais peut-on pour autant considérer qu’il offre un instrument d’ajustement manipulable indéfiniment, sans risque de rencontrer un seuil de délégitimation ? C’est parce que ces questions font l’ordinaire du débat public, et le fer de lance des discours dominants, que le propos de Friot aurait gagné en force à les prendre bille en tête. Il y aurait gagné d’autant plus que l’extension du champ de la cotisation apparaît en définitive dans son discours comme une sorte de panacée, destinée à amortir tous les chocs et à accommoder toutes les tensions : chômage de masse, croissance des dépenses de santé, déséquilibres démographiques des régimes de retraite. La liste ne vise pas à faire pousser des cris d’orfraies ou à faire hurler immédiatement à la banqueroute – n’a-t-on pas vu que les possibilités de passer moyennant des ajustements raisonnables sont réelles ? -, elle demande simplement qu’on y aille voir calmement et de plus près, si possible avec des ordres de grandeur.
C’est aussi un tel travail qu’il serait utile de conduire quand Friot propose comme nouvelle frontière au salariat l’intégration pleine et entière de la population des étudiants, en usant d’ailleurs d’un parallèle à moitié spécieux. Comme les années soixante-quatre-vingt ont opéré avec succès la salarisation des femmes, nous dit-il, il appartient aux décennies qui viennent de réussir celle des étudiants. Irréprochable sur le plan de ses principes généraux, la proposition de Friot joue quelque peu sur les mots. C’est que la salarisation des femmes s’est effectuée conformément au modèle « standard » du salariat : par le contrat de travail, le salaire direct et la production effective. C’est d’une tout autre intégration salariale, au titre étendu de « l’emploi généralisé » et du travailleur collectif, qu’il est question pour les étudiants ; et tout l’art de jouer du double sens du terme « salarial » – à l’ancienne ou bien étendu façon Friot – ne parvient pas à dissiper l’intuition que le parallèle pertinent aurait été bien davantage celui des retraités que celui des femmes. Ça ne rend pas la démonstration impossible, simplement un peu plus exigeante.
L’un dans l’autre, Friot fait d’ailleurs un usage tellement intensif de la cotisation qu’il nous vient des envies de macroéconomie. Le meilleur moyen de défaire le discours anti-Sécu ne consisterait-il pas à montrer que la tuyauterie du salaire généralisé, même ramifiée aux étudiants et à tous les rmistes, « fait régime », qu’elle réalise un bouclage macro viable, que les cotisations prélevées ne sont pas mises en bouteilles et jetées à la mer mais qu’elles solvabilisent une demande adressée à de nouveaux secteurs porteurs de développement économique, qu’elles peuvent stimuler l’innovation sociale et, partant, orienter le progrès technique dans une direction susceptible de soutenir un sentier de croissanceoriginal – tous avantages à mettre en balance avec les effets supposés de profit squeeze ou de perte de compétitivité, etc. Certes la modélisation macro est un exercice rustique autant qu’incertain, mais elle a des propriétés d’exhaustivité et de cohérence logique hors desquelles le calcul des résultantes et les projets de bilan global peuvent rester tranquillement dans les cartons. On aura compris que c’était là moins un reproche s’adressant à Friot en personne – le malheureux n’est tout de même pas tenu de couvrir à lui seul toute la division du travail théorique – qu’une idée d’occupation pour qui l’aurait lu et se trouverait encore désœuvré. Et puis, voilà ce que c’est de nourrir trop généreusement le client : pris de boulimie et gosier en extension, il se met à réclamer sans fin.
Il y a enfin une question, et ce n’est pas la moindre, que ne peut manquer de faire surgir le règne annoncé de la cotisation et la condamnation du prélèvement fiscal : et les inégalités ? Pas besoin d’avoir le don de clairvoyance pour imaginer le coup de sang qu’a dû piquer Friot avec les mises sous conditions de ressources et autres fiscalisations des allocs. Autant on comprend parfaitement en quoi ces transformations du régime des prélèvements sont attentatoires à la logique du salariat généralisé, autant ce constat ne suffit pas à évacuer d’un revers de main le projet de réduction des inégalités qui leur a aussi donné naissance. Ah c’est compliqué l’histoire quand les bonnes raisons commencent à se mélanger inextricablement aux mauvaises. – Pause récréative : prends tes Puissances du salariat, et après avoir soigneusement tourné toutes les pages, compte sur tes doigts combien de fois le mot « inégalité » est apparu. Indication : une seule main suffira, l’autre peut continuer à tenir le livre ou aider à numéroter les doigts de la première -. On pourrait enchaîner sur une devinette : est-ce qu’une proposition vraie perd sa valeur de vérité de devenir une tarte à la crème ? Si la réponse est non, alors il y a lieu derevenir sur ce lieu commun que, sous l’importance des cotisations, le prélèvement global a perdu presque toute progressivité. Là, on sent déjà que ça se cabre, on est dans la matière fissile et les sujets qui fâchent. Le fait est que la question du lien entre inégalités et prélèvement social – tout comme celle de l’allocation universelle d’existence d’ailleurs – a le don de produire des convergences idéologiques aberrantes et de faire se retrouver ensemble des gens que tout devrait séparer. On sait bien qu’il n’est pas de projet libéral plus constant que celui de la concentration de la protection sociale sur les pauvres et de l’affranchissement des riches enfin rendus à leurs chères assurances privées. Et on sait bien jusqu’où ce projet, usant et abusant de la rhétorique des inégalités, aura poussé la jérémiade faussement scandalisée et le simulacre de l’altruisme social : « les prestations indispensables à ces pauvres pauvres paient la (notre) consommation superflue des (de) riches ». L’instrumentation idéologique passablement opportuniste du thème des inégalités ne doit pourtant pasconduire à conclure que le problème soit controuvé. La cotisation, c’est quand même de la flat tax. Et il faut résister à la logique de polarisation, productrice d’oppositions binaires en fer forgé, comme celle qui ne laisse pas d’autre choix que le maintien en l’état ou le démantèlement. C’est pourquoi il n’est pas forcément opportun de faire surgir comme alternative unique à l’état des choses « la concentration de la protection sociale sur les plus démunis », ainsi que le proposent Hugounenq et Sterdyniak [1997]. Bien sûr, il est utile d’évoquer cet idéal-type extrême, pour mieux faire apparaître toutes les arrière-pensées et les projets tordus qui traînent derrière le débat sur « la cotisation dégressive ». On entend bien que faire contribuer les classes sociales aisées à une protection sociale dont elles ne bénéficieraient en rien serait profondément délégitimateur de l’ensemble du système et porteur d’une logique de sécession sociale : les riches repliés dans le bunker des assurances privées « enfin » rendues « légitimes », puisque nécessaires, les pauvres abandonnés à uneprotection sociale stigmatisante et très probablement vouée à voir son niveau de prestation se dégrader. Mais rien n’oblige à en venir à cette extrémité, et il n’est pas vrai que l’universalité périsse à coup sûr d’un profilage différencié des cotisations- prestations – même si on veut bien admettre qu’il doit exister quelque part un seuil dont le franchissement doit faire changement de régime. On ne sache pas par exemple que la progressivité des contributions directes ait atteint lalégitimité de l’impôt. Certes, il y a derrière la progressivité de l’impôt l’idée que les classes sociales aisées profitent davantage que les autres des dépenses publiques – voir l’école par exemple. Mais l’argument de superfluité n’est-il pas le dual dans l’ordre des prestations sociales de la justification précédente dans l’ordre des dépenses publiques ? Ce que nous montre en tout cas le modèle étatique du prélèvement fiscal, c’est que l’universalité, productrice de légitimité et garante de cohésion sociale, n’est pas incompatible avec un certain degré de différenciation. Pourquoi cette combinaison descontraires, à doses raisonnables, ne serait-elle pas praticable en matière de finances sociales ?
Faute de position bien affirmée et de certitudes définitives sur ce sujet, autant reconnaître tout de suite qu’on a ouvert la boîte de Pandore beaucoup pour le plaisir de susciter quelques franches empoignades sur un sujet qui s’y prête de si boncœur. Fi reste tout de même, et c’est surtout là qu’on voulait en venir, que l’évitement méthodique de la question desinégalités par Friot est symptomatique d’un impensé radical : celui de l’hétérogénéité du salariat. De fait, si le salariat est omniprésent dans le livre de Friot, en revanche on ne voit pas la queue d’un salarié. Or l’hypostase n’est une puissance unificatrice qu’en imagination. Du coup on cherche en vain ce qu’on croit connaître de la société salariale : les stratifications, les luttes de classement, l’affrontement des statuts, les conflits de position. Mais rien de tout ça chez Friot : ni Quasimodo avec des bosses et des irrégularités de partout, ni Frankenstein ré-assemblé comme un tableau de boucherie ambulant, le « travailleur collectif » a un beau visage glabre et un grand corps musculeux, il est l’unité même. Il faudrait faire la généalogie d’une telle représentation du salariat-un-seul-corps, dont on pressent qu’elle n’est pas sans rapport avec une vision prophétique de l’histoire et de ses destins monumentaux à accomplir. Un peu comme si pour être à la hauteur d’une eschatologie impérative, il nous fallait des acteurs collectifs en ordre de marche et avançant comme un seul homme, pas des dyslexiques dont les membres se contredisent et qui s’emmêlent les crayons à la première motte de terre. Ah ah Bernard, si c’est vraiment ça, à fonctionnaliste, fonctionnaliste et demi !
On sent bien que pour le plaisir d’une vacherie de plus on a peut-être poussé un peu loin le procès d’intention. Il n’en demeure pas moins qu’il y a chez Friot une vision de la société en correspondance avec l’ampleur de ses vues historiques. On ne dit pas qu’on n’aimerait pas y croire, mais parfois on a un peu de mal. Comme il se doit, on a d’ailleurs gardé le meilleur pour la bonne bouche. Puisque la protection sociale à la française nous montre qu’il est possible d’éviter l’accumulation d’épargne préalable et, ce faisant, de résister à la financiarisation de l’économie, pourquoi ne pas en tirer plus largement les conséquences ? Ce qu’on a fait pour les retraites pourquoi ne le ferait-on pas pour l’investissement ? Tout à son élan, Friot suggère ni plus ni moins que de mutualiser l’investissement comme on a mutualisé le salaire généralisé. On sait maintenant véritablement ce que l’auteur avait en tête en commençant : pas seulement le projet d’éradiquer la logique rentière, mais une vision de la socialisation de l’économie si poussée qu’elle n’hésite pas, après le projet de neutralisation complète des mécanismes marchands de formation des salaires, à s’attaquer à l’un des actes les plus essentiels du capitalisme : l’engagement privé du capital. Évidemment, une fois de plus, Friot offre sa poitrine à la mitraille : rien de précis n’est dit sur la nature du dispositif concret de ce fonds collectif d’investissement ni sur les conditions socio-politiques de sa mise en place. Mais tout ça n’est pas très grave. On sait bien qu’on est là dans le rêve éveillé, probablement aussi indispensable à la société qu’à l’économie psychique individuelle. L’essentiel est plutôt que de nouveau se fasse entendre un discours capable de mettre en question quelque chose de plus fondamental dans la société quela réduction de la taxe professionnelle ou bien l’assujettissement des œuvres d’art à l’ISF. Il me revient à l’esprit que dans Accumulation, inflation, crises, Boyer et Wistral[13] concluaient en évoquant comme « une ambition toujours d’actualité… la recherche d’une solution non capitaliste » à la crise. C’était en 1978, c’était il y a une éternité… Et si Friot faisait à la Régulation le reproche d’avoir abandonné un peu trop vite ce type d’interrogation, pour le coup j’aurais tendance à être assez d’accord avec lui.
Faut-il vraiment redire encore une fois que si on s’est permis de charrier l’auteur une ou deux fois, c’est précisément parce que le bonheur de lecture qu’il nous a procuré rend impossible toute interprétation malveillante ou ronchonneuse ? Si oui, on y consent volontiers. Il reste que pour tous ceux qui revendiquent le paradigme des « Valseuses » et « se baladent dans la vie (intellectuelle) comme dans un self-service », le livre de Friot pose à coup sûr un problème. C’est qu’ici, on n’achète pas par appartements. C’est la totalité ou rien. L’immeuble en entier ou dormir sous les ponts. De là ce sentiment de fascination mêlée de méfiance qu’éprouve le lecteur face à l’engin blindé qui menace de lui coloniser intégralement la pensée. C’est dire tout de même que le truc à Friot fait de l’effet.
Rien que pour rire, on imagine la chose dans des mains néo-classiques ! Déjà que l’hétérodoxe de base s’en tire essoré à 1000 tours, c’est sûr que quand on a mâchonné des années durant les conditions du premier ordre ou insiders- outsiders, on doit sortir de là totalement stone. C’est comme le gars qui passerait sans transition de « 0ui-0ui à l’école » à du Bruno Théret : il est dépaysé à bloc, il a des problèmes à se remémorer son état-civil, et voilà qu’il sait plus trop où il a garé sa voiture. Pourtant on voit déjà opérer l’accoutumance vénéneuse au produit. La première prise laisse un peu chose, mais on sent déjà que le synapse va en redemander. Heureusement, mélange d’auteur à succès et de dealer qui n’a pas son pareil pour ferrer son clille, Friot, passé maître dans l’art du teasing, nous annonce déjà une suite. Gavé jusqu’aux yeux, la biochimie réjouie et le cervelet en roue libre, on anticipe en rêvant un peu : Puissances de la régulation… Ça y est, surdose, délire. Par ici le café salé.
*
Références bibliographiques
BOURDIEU P. (1987), « Espace social et pouvoir symbolique », in Choses dites, Minuit, Paris.
BOYEZ R., MISTRAL J. (1978), Accumulation, inflation, crises, PUF, Paris.
CORNILLEAU G., ECHEVIN D., TIMBEAUX. (1996), « Perspectives à moyen terme des finances sociales », Revue de l’OFCE, n°56, janvier.
DONZELOT J. (1983), L’invention du social, Le Seuil, Paris.
EWALS F. (1986), L’Etat-Providence, Grasset, Paris.
HUGOUNENQ R., STERDYNIAK H. (1997), « Le plafonnement des allocations familiales : questions de méthodes », Lettre de l’OFCE, n’°167.
LIPIETZ A. (1979), Crise et inflation : pourquoi?, La Découverte, Paris.
THERET B. (1997), « Méthodologie des comparaisons internationales, approches de l’effet sociétal et de la régulation : fondements pour une lecture structuraliste des systèmes nationaux de protection sociale », L’Année de la Régulation, vol.1, La Découverte, Paris, p.163-228
Notes
[1] CNRS-CEPREMAP, Médecins du Monde
[2] Systèmes Nationaux de Protection Sociale
[3] On a beau être top fan, le tableau 4 (in Théret 1997, p.216) fait à peu près l’équivalent pour les petites lettres de l’opticien de l’Acid-Garage pour la Lettre à Elise.
[4] P.51
[5] P.65
[6] Id.
[7] Ibid.
[8] P.53
[9] P.52
[10] P.297
[11] Bourdieu (1987)
[12] P.256
[13] Boyez, Mistral (1978)
*
Illustration : « Composition VI », 1913, Wassily Kandinsky, Musée de l’Ermitage, Saint-Petersbourg.
Notes (de Contretemps)
[1] LORDON Frédéric, « Note de lecture sur Puissances du salariat », L’Année de la régulation, vol.2, 1998
[2] FRIOT Bernard, Puissances du salariat. Emploi et protection sociale à la française, Seuil, Paris, 2021 (réédition avec une nouvelle préface).
[3] FRIOT Bernard, LORDON Frédéric, En travail. Conversations sur le communisme, La Dispute, Paris, 2021, p.249







