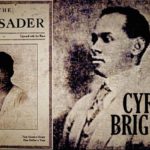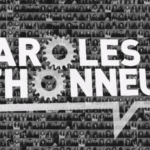La dignité ou la mort. Extrait du livre de Norman Ajari
Norman Ajari, La dignité ou la mort. Éthique et politique de la race, Paris, La Découverte, « Les empêcheurs de penser en rond », 2019, 324 pages, 17 €.

Présentation
Norman Ajari élabore une conception de la dignité dont la nécessité relève de l’urgence. Renouant avec l’histoire méconnue de la pensée radicale des mondes noirs, il déploie une philosophie décolonisée de l’histoire des êtres noirs. Une philosophie au sein de laquelle l’histoire coloniale, l’esclavage, la déshumanisation, les violences raciales et la mort sociale sont au cœur d’un parcours de libération.
Être Africain ou afro-descendant, c’est provenir d’un peuple dont l’humanité fut contestée sur les plans juridique, scientifique, philosophique, théologique, économique, psychiatrique. On n’en continue pas moins à exiger des afro-descendants qu’ils cessent de « ressasser », de « ruminer » l’histoire coloniale : n’est-ce pas ignorer que l’on répète ainsi une vieille injonction esclavagiste à l’oubli des ancêtres et à la méconnaissance de la communauté d’origine ?
Pourquoi prendre la question sous l’angle de la dignité ? La dignité est ce que le Blanc essaie d’abolir lorsqu’il exerce sa violence sur le Noir. Mais c’est aussi ce dont le Blanc se prive lui-même lorsqu’il exerce sa violence sur le Noir. Enfin, c’est ce que le Noir réaffirme collectivement lorsqu’il s’engage contre la domination blanche. Lorsque la dignité d’un jeune Noir est prise d’assaut, lorsqu’il est violé ou assassiné par les représentants de l’État, c’est une longue histoire de luttes, de conquêtes et d’affirmation d’une humanité africaine qui vacille et tremble sur ses bases.
La Dignité ou la mort propose une implacable analyse critique de la tradition philosophique européenne. Mais c’est pour mieux renouer avec l’histoire méconnue de la pensée radicale des mondes noirs. Les révoltes d’esclaves, la négritude, les usages révolutionnaires du christianisme en Amérique du Nord et en Afrique du Sud, l’ontologie politique, seront autant d’étapes d’un véritable parcours de libération.
La dignité est la capacité de l’opprimé à tenir debout entre la vie et la mort.
Introduction
Je me suis attaché dans cette étude à toucher la misère du Noir. Tactilement et affectivement. Je n’ai pas voulu être objectif. D’ailleurs, c’est faux : il ne m’a pas été possible d’être objectif.
Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs (1952).
Comme tout ce qui naît de la condition noire, ce livre est enfant de l’amour des miens et de la témérité du désespoir. Il porte témoignage de cette contradiction ; comme une oscillation, un clignotement, entre l’œil ubiquitaire de la négrophobie moderne et l’allégresse infinie de l’éclat de rire de ma fille. Jamais, sans doute, la philosophie n’agrippera par le concept l’intensité de cet écartèlement. Frantz Fanon, qui l’a remarquablement décrit dans Peaux noires, masques blancs, dut multiplier les métaphores :
« Le Martiniquais est un crucifié. Le milieu qui l’a fait (mais qu’il n’a pas fait) l’a épouvantablement écartelé ; et ce milieu de culture, il l’entretient de son sang et de ses humeurs. Or le sang du nègre est un engrais estimé des connaisseurs[1]. »
La Dignité ou la mort se propose comme un effort en direction d’une compréhension, peut-être impossible, de la dimension éthique de la mort et de la vie noires à l’époque moderne. Son projet est l’écho des débuts du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis ; du développement remarquable, en France, du militantisme contre les crimes policiers, en particulier, et la violence de l’État en général ; du bouillonnement d’un antiracisme politique décolonial radical ; du spectacle d’un traitement de plus en plus avilissant réservé par les États-nations européens aux exilés d’Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, contraints de fuir les conséquences de l’impérialisme ; de la détresse sociale à laquelle sont aujourd’hui abandonnés les prolétaires et sous-prolétaires noirs, asiatiques ou maghrébins du Nord global. S’il n’est pas une intervention directe dans la conjoncture dessinée par ces conflits, ce travail a été rendu nécessaire par son époque et par le diagnostic qu’elle impose : la condition noire actuelle est défi nie par l’indigne.
La leçon de ce temps, c’est que les politiques des identités et des représentations qui ont été en vogue ces dernières décennies sont vouées à demeurer impuissantes face à ces périls. Qu’elles promeuvent l’assimilation aux sociétés occidentales ou la revalorisation africaine, les approches identitaires ont prospéré sur une même méconnaissance des questions de vie ou de mort qui font aujourd’hui brutalement retour.
Ce livre fait l’hypothèse qu’il existe – transcendant le partage entre les Afriques et leurs diasporas – une condition noire et une histoire noire essentiellement modernes, définies par une surexposition structurelle à la violence sociale et politique, et par une constante invention contrainte de stratégies de survie. Sous la variété des cultures, les singularités nationales et l’illimitation des variations identitaires se dégage une relative unité, que je décrirai comme une sorte de contamination de la vie par la mort. Derrière ce retour à la si désuète « question noire » gît la conviction d’assister au crépuscule de la séquence théorique, caractérisée par un anti-essentialisme radical, ouverte par la philosophie française du second XXe siècle (cristallisée dans la trinité Derrida, Foucault, Deleuze) et approfondie, dans l’université globalisée, par une variété d’initiatives théoriques sous les labels de « poststructuralisme », « déconstruction » ou « postmodernité ». Ce livre naît de la certitude que ce moment intellectuel, auquel la pensée contemporaine doit tant, a rencontré sa limite dans l’urgence actuelle à repenser la finitude que la mort noire impose.
En octobre 2016, Sébastien Chauvin, professeur de sociologie dans une université suisse, m’adressait un message dans lequel il subsumait les premiers éléments de la recherche qui allait donner lieu à ce livre sous une catégorie de son cru : celle d’« ontologie postconstructiviste [2] ».
Peut-être ne reprendrais-je pas ce terme à mon compte, tant le recours même au préfixe « post- » me semble intimement corrélé à la séquence intellectuelle dont je tâche de faire le deuil. Pour autant, la sagacité de cette formulation frappe et n’a cessé de me hanter. L’idée d’ontologie postconstructiviste contient, in nuce, un diagnostic perspicace de l’état présent des sciences humaines. En Europe continentale en général et en France en particulier, les discours théoriques sur le racisme, les Noirs, la situation postcoloniale s’égarent inlassablement dans un dédale d’arguties redondantes, de surenchères quant au caractère socialement construit de la race, à sa qualité performative ou à son historicité révocable. Face au spectacle de corps mutilés, de cadavres flottants sur la Méditerranée comme des radeaux lugubres, de viols et d’humiliations innombrables, le constructivisme obsessionnel de ce type de discours relève, au mieux, de la pensée magique et, au pire, d’une fétichisation perverse de concepts manifestement inopérants. Au lieu de permettre une meilleure compréhension de la situation, la théorie s’interpose entre le monde et la pensée, vaporisant l’océan d’extrême violence dont nous sommes témoins, sous le prétexte fallacieux d’en dévoiler la genèse.
Comment ne pas être las des sempiternels rappels de l’inexistence des races biologiques auxquels se livrent rituellement sociologues et militants, convaincus de conjurer par là le démon de la xénophobie ?
Ce mantra paraît à la fois inconséquent et pervers. Inconséquent, d’abord, car ses promoteurs semblent faire reposer la totalité de leur conscience politique sur une science biologique dont ils ignorent tout, sinon qu’elle aurait prouvé l’inexistence des races. Or sont aujourd’hui conduites des recherches vouées à produire de nouvelles taxinomies des races humaines. Si d’aventure de telles théories parvenaient un jour à agréger autour d’elles un consensus scientifique, qu’adviendra-t-il d’un antiracisme dénué d’armature éthique et de perspective politique, car bâti sur l’aveugle confiance en une Science à demi fantasmée ? Loin d’être suspendu au fragile discours de l’inexistence des races et aux vérités falsifiables de telle ou telle science, une théorie critique de la race conséquente tient la découverte de quelques régularités statistiques quant aux groupes humains insuffisante à poser les bases d’un système politique.
Cette question n’est pas celle de l’anthropologie physique car elle n’est pas un problème de faits, mais d’abord une affaire de valeurs. Le mantra de l’inexistence des races est pervers, ensuite, car l’insistance exagérée des sciences sociales sur l’artificialité de la notion de race – qui culmine dans l’étrange fétichisme qui consiste à mettre le mot race, voire même le mot Noir, entre guillemets – ne témoigne en aucun cas de la hauteur de vue de chercheurs qui auraient su se prémunir contre les effets perfides d’un vocable trompeur. Bien au contraire : l’ostensible mise à distance de ces concepts témoigne du surinvestissement imaginaire qui leur est encore attaché, notamment dans des travaux qui se prétendent les plus neutres et les plus impartiaux. Des notions comme celles de genre, de classe ou même de sexe ne sont jamais objets de ces interminables précautions.
Cela montre que de nombreux chercheurs et activistes agissent comme si les mots race et Noir étaient alourdis d’une aura malveillante et presque irrésistible, que leurs précautions oratoires ou typographiques auraient pour fonction de désamorcer. Ainsi maquillent-ils en prudence méthodologique leur claustration dans une épistémologie négrophobe qui sature les noms de fantasmes obscènes. La mauvaise conscience qui guide ces stratégies d’évitement dénote une inavouable croyance en l’abjection nègre, qui se manifeste là même où l’on entend critiquer le racisme.
Ce sont la violence de l’État et l’inégalité internationale structurelle qui produisent la race ; non les articles de sociologie. Ce sont la mort et la déshumanisation qui produisent les Noirs ; non les discours « essentialisants ». La Dignité ou la mort ambitionne d’offrir une approche philosophique de l’existence noire en rupture avec ces affèteries contre-productives. J’ai rêvé d’une théorie dure et acérée, comme l’acier d’une machette. Ce livre s’inscrit dans un double horizon philosophique : celui de la pensée et de la politique décoloniales, d’une part, et celui de la philosophie africana (c’est-à-dire l’alliance des pensées africaines et afro-diasporiques), de l’autre. Ces deux perspectives procèdent de la même redécouverte contemporaine d’une fécondité oubliée des œuvres des colonisés, des esclaves, des opprimés. Je qualifie cette approche hybride d’afro-décoloniale.
Les deux sources de la pensée décoloniale
La compréhension de la notion de « décolonial » dans le contexte de l’espace public français implique de rompre avec certains réflexes de routine intellectuelle. Il est impossible ici, comme c’est le cas depuis environ une décennie autour des « études postcoloniales », de réduire l’émergence du décolonial à l’accueil fait dans le milieu académique à un ensemble de travaux universitaires, de méthodes et d’hypothèses théoriques en provenance du continent américain [3]. L’histoire récente rompt à deux titres avec ce précédent. Tout d’abord parce que ce mot circule moins dans les cercles universitaires que dans la société civile, et plus précisément dans des organisations et groupes militants liés à l’antiracisme politique et à la défense des intérêts des descendants et descendantes de l’immigration postcoloniale. Ensuite, parce que tout porte à croire qu’il s’agit moins, dans le cas présent, d’un emprunt que d’une rencontre : il n’y a pas qu’un seul et unique concept du décolonial qui aurait voyagé depuis son lieu de naissance (un groupe de recherches théoriques latino-américain) et se serait disséminé jusqu’aux activistes français. La genèse du décolonial en France est distincte de celle du décolonial latino-américain ; ce qui ne signifie pas que les deux seraient hétérogènes et étanches.
Bien que je défende l’hypothèse qu’il y a (au moins) deux genèses distinctes du décolonial, il est incontestable que l’usage latino-américain du terme est plus ancien que son usage français. En effet, la paternité en revient à un groupe interdisciplinaire de théorie critique baptisé « Modernité/Colonialité/Décolonialité » (MCD) qui naît en 1998[4]. Ce groupe rassemble des universitaires latino-américains et caribéens autour d’une idée centrale, que résument Claude Bourguignon et Philippe Colin, ses principaux spécialistes français : « La violence coloniale sous toutes ses formes n’est pas simplement l’inévitable dommage collatéral ou la manifestation pathologique d’une modernité par ailleurs émancipatrice – et dont le bilan serait dès lors “globalement positif ” – mais bien l’une de ses dimensions intrinsèques[5]. » L’apport principal du groupe MCD est d’avoir grandement contribué à l’élaboration d’une nouvelle philosophie de l’histoire.
En France, le terme décolonial tel qu’il apparaît dix ans plus tard ne répond pas aux mêmes enjeux, bien que tous deux présentent un « air de famille ».
Si, comme toute théorie critique depuis Max Horkheimer, l’approche du groupe MCD entend dépasser l’opposition entre engagement social et recherche universitaire, l’usage français du terme décolonial est d’emblée un usage proprement militant, forgé à l’écart des travaux académiques. L’adjectif décolonial apparaît dans le lexique politique français en 2008, avec l’organisation d’une « marche décoloniale pour un mouvement antiraciste et décolonial autonome[6] ». Et, en effet, l’appel de cette marche contient un grand nombre d’éléments caractéristiques de la décolonialité telle qu’elle s’est constituée en France.
Il s’ouvre sur ces mots :
Le 8 mai prochain, MARCHONS pour montrer que le chemin de la dignité passe par la convergence, au sein d’une même organisation politique autonome, antiracialiste et décoloniale, de tous ceux qui sont aujourd’hui traités comme des indigènes. En France, des nostalgiques semblent regretter le temps béni des colonies… Mais qu’on les rassure ! Ce temps-là est loin d’être mort ! L’État français s’en porte en effet garant : il entretient la continuité coloniale à la française : le racisme républicain.
En premier lieu, est caractéristique l’affirmation d’un continuum colonial, d’une ininterruption de la logique du colonialisme avec les indépendances, mais au contraire sa perpétuation par d’autres moyens. À l’époque, l’originalité de cette marche résidait, d’une part, dans la volonté affirmée de construire une organisation politique autonome, mais aussi et surtout dans la diversité des demandes sociales qu’elle se proposait de rassembler à cette fin. En effet, l’appel se poursuit en abordant des thématiques aussi diverses que les mémoires des massacres coloniaux (Thiaroye au Sénégal) et des victoires anti-impérialistes (Dien Bien Phu) ; le soutien au peuple palestinien ; le néocolonialisme et la Françafrique ; la condition des travailleurs immigrés ; la situation des Kanaks et autres colonisés des possessions françaises, etc. Les associations et organisations signataires reflètent également cette diversité. On y trouve, entre autres, le Mouvement des indigènes de la République, l’Association des étudiants de culture africaine de Lyon, l’Association des étudiants kanaks, le Comité des familles pour survivre au SIDA ou encore l’Union des travailleurs immigrés tunisiens, et j’en passe. La lecture de l’appel peut ainsi donner l’impression d’une étrange juxtaposition qui n’a pas manqué de susciter l’interrogation. Mais le caractère peut-être surprenant, ou du moins inhabituel, de cet agencement conduit au cœur de l’enjeu central du discours décolonial en France : celui de l’élaboration d’un sujet politique non blanc. C’est-à-dire celui de la coalition politique de toutes ces particularités, de toutes ces singularités.
À partir du constat que lesdits non-Blancs sont généralement les victimes collatérales des stratégies politiques de l’ensemble des tendances de la gauche où se réveille cycliquement une tentation sociale-chauvine [7], l’enjeu était de répondre à cette mise à l’écart systématique.
En 2006, Sadri Khiari écrivait de ce qu’il nomme le champ politique non blanc :
« Il n’est pas un espace homogène car il est troué par les enjeux propres au monde blanc, comme par les effets des autres modes d’oppression (de classe, de genre). Plus : il est un effet de l’espace blanc ; il participe de cet espace ; il est dedans et dehors. C’est un espace discordant, disjoint, non contemporain de l’espace blanc mais qui pourtant le recoupe en maints endroits [8]. »
Ce sont ces préoccupations qui animaient l’appel à la marche du 8 mai 2008 : il s’agissait d’inventer en sujet politique tous ces descendants du Sud global qui ne partagent pas les mêmes affects et les mêmes expériences que le reste de la population française. Il apparaissait comme nécessaire de bâtir un espace pour celles et ceux que d’autres formes d’organisation tiennent à l’écart, afin que s’expriment notamment les intérêts sociaux qui procèdent de cette mise à l’écart.
L’adjectif « décolonial », en France, désigne ainsi un segment des mouvements sociaux, incompatible avec le corps d’affects et l’imaginaire nationaliste hexagonal, et qui refuse de se rendre compatible avec lui. Si ce néologisme a été choisi pour qualifier la marche du 8 mai, ce n’est pas par référence au MCD, mais par souci de situer ce positionnement nouveau dans le paysage militant. Il fallait ainsi abandonner le vénérable adjectif « anticolonial » qui faisait par trop référence à une séquence historique achevée : celle des luttes africaines et asiatiques du milieu du XXe siècle pour l’indépendance. En 2008, privilégier une approche décoloniale à une approche anticoloniale avait pour but de rompre avec une attitude commémorative pour s’ajuster aux enjeux de l’époque actuelle, dont les éléments listés plus haut fournissent quelques exemples et dont, par ailleurs, la dimension mémorielle était loin d’être absente.
Si la question du sujet politique et de son organisation est centrale dans l’acception française de l’adjectif décolonial, ce n’est pas le cas dans les travaux du groupe MCD. On pourrait même dire que c’est un point que cette entreprise intellectuelle collective a négligé. En revanche, comme je l’ai déjà évoqué en passant, son principal apport consiste en la formulation d’une nouvelle philosophie de l’histoire – à une époque où l’effondrement du bloc socialiste constituait un terreau favorable aux discours de la fin de l’histoire, qu’ils soient néolibéraux ou « postmodernes ». Mais la philosophie latino-américaine rappelle qu’au moment où le premier monde et le ci-devant deuxième monde se plongeaient avec délectation dans les illusions d’un triomphe conjugué de la démocratie libérale et de l’économie de marché, le tiers monde n’avait pour sa part pas ce luxe. Pour le dire de façon trop schématique, de Hegel à Heidegger en passant par Marx (et tant d’autres), les philosophies de l’histoire sélectionnent, à partir d’un diagnostic de l’époque actuelle, les événements passés jugés qualitativement significatifs, mis En ordre selon un principe. Ce geste ouvre sur une anticipation de l’avenir. Selon le groupe MCD, la constante de toutes ces entreprises a, jusqu’à présent, résidé dans un certain européocentrisme. Il entreprendra donc de proposer une nouvelle philosophie de l’histoire, pertinente pour le Sud global.
L’objet principal de la philosophie décoloniale de l’histoire est la modernité et, plus précisément, l’envers obscur de la modernité. Selon le philosophe argentin Enrique Dussel, elle ne commence pas avec les Lumières, ni avec la révolution industrielle. Elle débute en 1492 avec la pseudo-découverte des Amériques. Pseudo-découverte à deux titres : premièrement parce que Christophe Colomb n’a jamais, à proprement parler, compris ce qu’était l’Amérique. Il s’est toujours maintenu dans l’illusion qu’il abordait une péninsule asiatique. Comme on le sait, le terme « Indiens » qui désigne aujourd’hui encore les autochtones du continent américain demeure comme le stigmate de cette méprise.
Au fond, ce sont eux qui ont découvert Colomb et les siens, alors qu’ils étaient égarés dans leur périple vers les Indes ! Mais pseudo-découverte également en un second sens, peut-être plus évident : il est impossible de « découvrir » une terre déjà habitée et occupée par des groupes humains, des civilisations. C’est, selon Dussel, ce moment de la « découverte » puis de la conquête qui va constituer la naissance commune de la conscience européenne et de la modernité. Et, en ce sens, la modernité désigne la manière dont l’Europe va s’auto-instituer comme centre et tenir le reste du monde pour sa périphérie.
« La première relation fut donc violente : une relation militaire de conquistadors à conquis, d’une technologie militaire développée à une technologie militaire sous-développée. La première expérience moderne fut celle de la supériorité quasi divine du “Moi” européen sur l’Autre primitif [9]. »
Cette inscription ontologique de la supériorité de l’Europe moderne allait se voir consolidée et concrétisée lors de la controverse de Valladolid en 1550, avec une délégitimation méthodique des modalités d’existence, des formes de vie et des tournures de pensée non européennes et non chrétiennes. C’est en effet au cours de cette année que le philosophe aristotélicien Juan Ginès de Sepúlveda a affronté l’évêque et théologien Bartolomé de Las Casas autour de la question des conditions de la colonisation du continent américain. Mais, sous-jacent à ce problème général, se posait surtout celui de la nature des Indiens d’Amérique [10]. Les positions respectives des deux opposants sont connues : le premier, partisan en toutes matières du maintien d’une stricte hiérarchie, tenait pour infranchissable la frontière séparant les habitants des deux continents. Las Casas, pour sa part, préfigurant le mythe du « bon sauvage » d’un Diderot, prônait l’évangélisation douce d’indigènes dont il louait la vie frugale et équilibrée. Dussel glorifie Las Casas comme l’apôtre d’une raison persuasive, compréhensive de la dignité des cultures indigènes, et fondée sur la conviction qu’une intégration non violente des Indiens est possible par le seul biais de l’argumentation rationnelle. Autre acteur du groupe MCD, le philosophe portoricain Nelson Maldonado-Torres infléchit toutefois cette perspective en qualifiant l’ensemble du dispositif de Valladolid d’organisation d’un « scepticisme misanthropique [11] ». En effet, il ne suffit pas de critiquer le délire hiérarchique de Sepúlveda, en saluant par contraste la générosité des raisonnements de Las Casas ; il importe avant tout de remettre en cause le dispositif de véridiction qui les met en scène. Ainsi, ce n’est pas une doctrine qui est en cause, mais la structuration même de la pensée moderne qui est en train de s’élaborer, fondée sur l’évaluation souveraine et prétendument neutre d’un tribunal de la rationalité. Elle se présente in fi ne comme un soliloque subjectif où le témoignage des « objets » – c’est-à-dire des Indiens – est réduit à la portion congrue et où le cri des victimes est ignoré tant qu’il n’est pas traduit dans les idiomes respectables de la théologie et de la philosophie blanches. Le concept de scepticisme misanthropique introduit ainsi l’hypothèse selon laquelle la mise entre parenthèses de l’humanité des Indiens n’est pas moins cruelle que les accusations explicites de bestialité proférées par Sepúlveda, mais en constitue au contraire l’indispensable corollaire.
Selon le groupe MCD, la rationalisation, la sécularisation et autres synonymes du progrès ne sont ainsi qu’une face de la modernité. L’autre face, son envers obscur, c’est que ces avancées sont inextricablement liées à la déshumanisation, à l’expropriation et à l’exploitation des Non-Européens. Mais l’image que les modernes se font d’eux-mêmes n’incorpore pas cette réalité. Les valeurs modernes se redoublent inextricablement d’une dénonciation de la barbarie, patente chez Voltaire, chez Kant, chez Hegel. Or cette notion de barbarie se présente toujours de façon ambivalente : elle peut recouvrir aussi bien la violence arbitraire d’un souverain inique que des modes de vie étrangers, tenus pour exotiques et, par là même, purement et simplement voués à un mépris bestialisant. Cette condamnation ambiguë de la barbarie n’est pas un excès regrettable ou contingent, mais la conséquence nécessaire des valeurs d’émancipation telles que les produit la modernité. Cette dernière est certes porteuse d’une part libératrice, et les notions mêmes de liberté ou d’individu ne méritent sans doute pas d’être abandonnées purement et simplement. Mais leur usage n’est en aucun cas facile et ne va pas de soi. Il n’est pas possible de séparer à sa guise, au sein de la pensée moderne, le bon grain émancipateur de l’ivraie colonialiste. C’est le travail des esclaves qui libère le temps que les maîtres ont le loisir de consacrer à la philosophie : celui-là est condition de possibilité de celle-ci. De même, l’idéal européen d’émancipation se découpe sur fond de dénonciation de la barbarie des Amérindiens et des Africains. Or c’est précisément au point de ce diagnostic critique que la rencontre de la politique décoloniale telle qu’elle s’est élaborée en France avec les réflexions du groupe MCD peut s’avérer fructueuse.
Si je souscris à la perspective politique de l’approche décoloniale française aussi bien qu’à la philosophie de l’histoire latino-américaine, il me faut également souligner, à la suite de Lewis Gordon, que si la vision décoloniale permet de concevoir la face obscure de la modernité, elle méconnaît globalement la position qu’y ont occupée et y occupent encore l’Afrique et les Africains. Significatif à cet égard est le panégyrique de Las Casas entonné par Dussel, oubliant de rappeler que c’est sous l’influence de son Histoire des Indes que, dès 1517, la couronne espagnole prend le parti de recourir à des forçats noirs pour travailler dans ses colonies américaines [12]. Là où l’appartenance à l’humanité des Indiens fit à Valladolid l’objet d’un débat voulu rationnel, la mise en esclavage des Noirs ne posa aucun cas de conscience aux intellectuels européens modernes avant le XVIIIe siècle. À leurs yeux, l’abjection nègre semblait, toutes choses égales par ailleurs, se présenter avec une certaine évidence[13]. La perspective afro-décoloniale que je proposerai prend acte de cette surexposition historique de l’humanité noire à la violence déshumanisante qui tisse l’ensemble de l’histoire moderne, afin d’en faire le point de départ d’une nouvelle approche éthique inspirée de la philosophie africana.
La philosophie africana en contexte afro-français
La formule « philosophie africana » a été introduite par le philosophe africain-américain contemporain Lucius Outlaw. Elle représente à ses yeux une manière d’assembler, de rassembler, d’apparenter les écrits et discours théoriques élaborés par des personnes africaines ou d’ascendance africaine (Africains-Américains, Afro-Brésiliens, Afro- Antillais, « Afropéens », etc.) à travers l’histoire. Une telle délimitation pose évidemment la question de la spécificité de la tradition philosophique que l’on choisit d’identifier de la sorte, c’est-à-dire de la particularité d’une pensée issue des mondes-de-la-vie africains, par contraste avec d’autres mondes-de-la-vie [14]. En d’autres termes, se pose ici la question de la pertinence d’une délimitation d’un périmètre philosophique sur la base du seul critère d’une appartenance à un héritage africain. Il ne s’agit pas de soutenir qu’il y aurait un fondement biologique à cette philosophie, voire un paradigme unique auquel tout Afrodescendant serait sommé de se rapporter. C’est la recherche empirique de points communs entre les œuvres qui permet de dégager des questions transversales ; elles concernent les efforts de survie, la nécessité d’inventer des formes d’existence aptes à faire face à l’oppression.
De tels points communs ne relèvent pas seulement d’un « air de famille » mais s’enracinent dans l’histoire de laquelle émerge la philosophie africana : toute personne noire est descendante d’esclaves ou de colonisés. Pas un seul Africain ou afrodescendant dont l’humanité des ancêtres n’ait été radicalement contestée sur les plans juridique, scientifique, philosophique, théologique, économique, psychiatrique.
C’est pourquoi la philosophie africana pose inlassablement la question de l’être noir[15]. Elle fait office de révélateur du fait qu’à l’époque moderne, comme le démontre aussi la philosophie décoloniale, la définition de l’être humain ne va pas de soi. C’est pourquoi, note Lewis Gordon, l’anthropologie philosophique, segment périphérique de la tradition philosophique européenne, est centrale dans la philosophie africana où elle répond aux enjeux de la déshumanisation et du racisme auxquels sont confrontés les Africains et leurs diasporas[16]. La philosophie africana est souvent accusée d’être particulariste, restrictive, voire obtuse. Cette critique est infondée pour deux raisons. Tout d’abord, son infériorisation dans le cadre de la modernité et du racisme lui rend indispensable la fréquentation de la pensée européenne, où fut rationalisée la subalternité des Noirs. La philosophie africana, a contrario de la pensée européenne qui les ignore le plus souvent, présuppose d’autres pensées que la sienne propre, ne serait-ce que par le truchement du dialogue critique[17]. Deuxièmement, et plus radicalement, penser philosophiquement à partir de la condition noire suppose de déplacer les frontières du philosophique et du non-philosophique, pour y faire entrer des discours où la spéculation s’entrelace avec l’autobiographie, la politique, la religion, les arts.
De tels partis pris théoriques sont assez nouveaux dans un contexte universitaire français dont les racines positivistes sont tenaces. Y plane notamment une injonction à dégager l’originalité de la condition des Noirs en France, en la séparant autant que faire se peut des histoires étatsunienne, caribéenne, etc. Cette exigence comporte une part de validité. Il importe toutefois d’éviter d’établir par ce biais un privilège de la France dans nos esprits, faisant de la « francité » un référentiel identitaire essentiel et central. Se concentrer de façon monomaniaque sur la vie des Noirs en France, comme si elle pouvait avoir une spécificité absolue, revient à nier un imaginaire diasporique, la possibilité d’une conscience panafricaine et d’une historicité noire. En d’autres termes, une pensée de la dignité noire depuis la France implique de résister à toute nationalisation de la théorie et son enjeu serait moins d’envisager les Noirs « en tant que » Français qu’à partir de leurs rapports conflictuels avec l’État français. Aux États-Unis d’Amérique, le risque constant de mise à mort par les forces de police ou les milices de sécurité demeure le problème le plus saillant à partir duquel se pose la question noire. De l’autre côté de l’Atlantique nord également, les Afrodescendants sont familiers de ces mises à mort. Toutefois, plus prégnant encore me semble l’enjeu de la privation structurelle de toute puissance de signifier, qui affecte les descendants et descendantes de l’immigration postesclavagiste et postcoloniale. Par « puissance de signifier », j’entends la possibilité de se présenter dans l’espace public en tant que Noir (ou Arabe, ou musulman) afin d’y faire valoir ses intérêts collectifs – politiquement, artistiquement, littérairement, théoriquement, etc. –, au premier rang desquels le droit à une vie digne d’être vécue. La question n’est donc pas celle, superficielle, de la « visibilité » médiatique, mais davantage celle de la possibilité de dis cours effectivement porteurs d’intérêts, c’est-à-dire de questions de vie ou de mort, dont la philosophie africana représente un exemple significatif, propre au champ académique.
En France, l’accusation de communautarisme est l’un des principaux outils en usage pour saper toute puissance de signifier des Afrodescendants. Cette notion floue désigne généralement un attachement à des valeurs archaïques, contraires à la modernité, et donc propres à freiner l’émancipation individuelle. Cette opposition entre individus et communautés laisse intacte la communauté nationale, axiomatiquement défi nie comme moderne et émancipatrice. Il est donc nécessaire aux Noirs qui souhaitent se rendre audibles de prêter allégeance à la France, à l’idéologie républicaine, à la laïcité, qui sont autant d’attributs d’un pouvoir d’État érigé en synonyme de progrès et de perfectionnement de l’humanité. Si ce chantage participe à saper toute puissance de signifier des Noirs, c’est qu’il leur impose une déportation hors de la situation d’énonciation noire : il est périlleux de s’exprimer en tant qu’Afrodescendant ; pour être audible, il est préférable le faire en tant que citoyen français. L’extériorité, l’altérité, la singularité ne sont pas permises. Toute critique, en somme, se doit d’être interne, c’est-à-dire émise au nom même des valeurs qu’elle remet en cause, renforçant la légitimité de l’identité nationale en s’en réclamant, au lieu de la prendre d’assaut depuis un point de vue hétérogène.
La dignité noire en France ne peut que communiquer intimement avec l’Afrique et les Amériques. Elle n’affirme pas sa francité, mais prend acte de l’adversité spécifique au contexte français. La dignité noire, son historicité profonde, sa conscience diasporique ne sauraient « être françaises ». Elles sont mondiales, comme le furent la traite transatlantique et le colonialisme moderne desquels naît la condition noire. Les intellectuels et les sciences sociales françaises, pour les délégitimer, taxent l’étude de la question raciale de mauvais produit d’importation étatsunien[18]. C’est oublier que certaines références centrales de la philosophie africana sont des auteurs d’expression française qui expérimentèrent la violence raciale dans les (post)colonies aussi bien que dans l’Hexagone : Anténor Firmin, Léopold Senghor, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Cheikh Anta Diop, etc. Le théoricien anglo-jamaïcain Stuart Hall évoquait la réappropriation du nom « noir » dans les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Caraïbe anglophone du second XXe siècle comme une révolution culturelle qui vit l’émergence d’un nouveau sujet culturel et politique[19]. Mais, à Paris, c’est dans les années 1930, et notamment dans les pages de la revue des fondateurs du mouvement de la négritude, L’Étudiant noir, que se produisit l’insurrection intellectuelle et poétique. Mais elle fut vite étouffée par la contre- révolution coloniale et la revanche cocardière de l’idéologie républicaine. Rompant résolument avec l’alliance du chauvinisme et du scientisme caractéristique des formes dominantes des sciences sociales françaises depuis Auguste Comte, la philosophie africana prend congé de la fausse évidence de l’échelle nationale pour lui opposer l’échelle diasporique. Les Noirs d’expression française furent les acteurs d’une longue histoire internationaliste d’inventions philosophiques et politiques ; il importe aujourd’hui de se remémorer et de prolonger cette tradition.
Une éthique de la dignité
La théorie et la politique décoloniales, d’une part, et la philosophie africana, de l’autre, ont en commun de placer à leur fondement l’expérience et la réalité de la déshumanisation. C’est à partir de cette origine commune que s’est construite l’interrogation éthique qui constitue la trame de La Dignité ou la mort. En recourant à la vénérable notion d’éthique, je ne réfère ni à quelque soumission à une règle morale, telle que l’avait définie la philosophie moderne[20], ni à une manière de construire sa propre subjectivité, selon une acception propre à la philosophie contemporaine[21]. L’obéissance à la loi aussi bien que l’esthétique de soi ne deviennent accessibles qu’à partir du moment où la constante menace d’une destruction de l’existence est contenue. Pour l’approche afro-décoloniale, familière d’une histoire moderne où les corps des esclaves et des colonisés furent soumis à une maltraitance constante, l’éthique est confrontation à l’administration de l’opposition entre l’humanité et son déchet. Comme l’écrivit le théologien de la libération noire James H. Cone, sur l’œuvre duquel on reviendra longuement dans le cinquième chapitre de ce livre,
la résistance était la capacité à créer beauté et valeur à partir de la hideur de l’existence de l’esclave. La résistance a fait de la dignité bien davantage qu’un simple terme à analyser philosophiquement. La dignité était une réalité qui ne pouvait qu’être déterrée hors de la merde de l’environnement blanc ; elle se fondait sur les rapports que les esclaves entretenaient avec leurs frères et sœurs noirs. Les Blancs accomplissaient ce qu’ils appelaient dignité dans la mise en esclavage des Africains noirs ; leur importance se mesurait au nombre d’Africains qu’ils asservissaient[22].
Dans la continuité de cette analyse, le terme de dignité – pierre angulaire de l’éthique – recouvrira dans ce livre deux acceptions distinctes mais indissociables. Premièrement : une notion primordiale d’ontologie politique, qui relève de la délimitation de l’humain et de l’inhumain. En ce sens, la question de savoir qui est digne équivaut à la question de savoir qui est tenu pour authentiquement humain. La seconde notion, qui découle de la première, porte sur les revendications militantes de la dignité, comprises comme des incarnations et des redéfinitions vécues et incorporées de sa propre humanité et de celle du groupe marginalisé auquel on est identifié. La politique, au sens de l’engagement militant, est un moment constitutif de l’éthique noire. En effet, la dignité fait partie de l’arsenal conceptuel de nombreux mouvements anti- impérialistes, traduisant la radicalité de revendications qui portent sur l’humaine condition elle-même. Ainsi la rencontre-t-on en conclusion d’un intense éditorial publié dans l’organe de presse du Black Panther Party : « Non ! Th e Black Panther n’est pas un journal comme les autres. C’est la chair et le sang, la sueur et les larmes de notre peuple. C’est l’histoire du Passage du Milieu, de Denmark Vesey, de Nat Turner, de Harriet Tubman , de Malcolm X et d’innombrables autres opprimés qui ont fait passer la liberté et la dignité avant l’intérêt personnel [23]. » Ici, la revendication de dignité s’appuie sur l’épaisseur d’un passé, que la souffrance dispute à la révolte, preuve de la possibilité de la liberté là même où rien ne semble pouvoir la soutenir.
Dans le contexte français, une même nécessité de se réapproprier le passé, sans succomber à l’hébétude d’une autocélébration folklorique, présida à la fondation du Mouvement des indigènes de la République. Sa proposition fondamentale était que, bien que le Code de l’Indigénat ait été formellement aboli, l’existence des descendantes et descendants de l’immigration postcoloniale demeurait emmurée dans une sous-citoyenneté. En 2006, Sadri Khiari, son principal théoricien, s’appuyait sur le concept de dignité pour en formuler le projet :
En vérité, l’autodéfinition comme « indigène » ne constitue pas vraiment un retournement de stigmate. Les idées d’orgueil ou de fierté d’être indigènes nous sont étrangères. […] Nous accepter nous-mêmes, retrouver notre dignité d’être humains, est notre programme. […] L’identité indigène, si elle existe, est une identité de mémoires broyées, déformées ; une mémoire de l’oppression subie par les ancêtres et qui se continue, renouvelée, dans le pays d’« accueil », ce même pays qui a colonisé la terre d’origine, massacré, mis en esclavage ou contraint à l’exil ses populations[24].
Ce n’est certainement pas un hasard si des manifestations notamment vouées à protester contre les crimes policiers comme la Marche pour la dignité et contre le racisme du 31 octobre 2015 et la Marche pour la justice et la dignité du 19 mars 2017 ont adopté de tels noms. La fréquence de l’usage d’un même concept face à des situations certes non similaires mais comparables m’a semblé représenter bien davantage qu’une simple coïncidence de vocabulaire : une tonalité existentielle commune, née de la nécessité de braver des circonstances forgées par la violence. Ce livre est né de l’intuition que lorsque le mot dignité résonne dans les rues, scandé par des manifestants révoltés par les crimes policiers, lorsqu’il est mobilisé par des activistes mus par une volonté de restituer une humanité niée, il revêt une signification hétérogène à celles qu’a pu recouvrir ce terme dans les traditions philosophiques et politiques européennes. Le point de vue afro-décolonial permet de poser dans toute sa radicalité la question de la signification de la notion d’être humain : depuis son bord. C’est pourquoi le sens de la dignité, considéré dans cette perspective, ne saurait être similaire à celui que lui confèrent des philosophes européens qui tiennent pour acquise leur propre appartenance à une humanité glorieuse. L’une des tâches de la pensée afro-décoloniale est de lire la pensée, l’éthique et la politique européennes dans leurs limites.
À l’échelle globale, de nombreux mouvements sociaux de ces dernières années se sont cristallisés autour du mot d’ordre de l’indignation. « L’indignation issue de l’expérience de ces frustrations, du manque de respect et du sentiment de ne pas être entendu s’est transformée en une affirmation de la dignité dans des révoltes et exigence d’être traité avec respect par les institutions et d’être entendu par les gouvernements[25]. » L’objet de La Dignité ou la mort est de montrer que la dignité présente un autre visage lorsqu’elle émerge d’une histoire de la déshumanisation dont les acteurs se heurtent à une impossibilité structurelle d’avoir une voix audible. Son enjeu est ainsi de compliquer, pour mieux les compléter, les généalogies européennes de la dignité qui l’inscrivent comme un élément constitutif, bien que plus ou moins oppositionnel ou paradoxal, de la démocratie libérale.
Pour cette raison, une part significative de ce livre est consacrée à la critique afro-décoloniale de certaines formes dominantes de philosophie sociale et de théorie politique contemporaines. Toutes les œuvres en question, je les abordai d’abord de bonne foi, en quête de réponses aux questions qui m’assaillaient du dedans de la condition noire : le racisme, l’histoire coloniale et esclavagiste, la mort sociale.
Je dus me rendre à l’évidence : ce n’était pas seulement que ces auteurs ne traitaient pas des problèmes qui me hantaient. Ils en parlaient comme malgré eux, en les défigurant. Les colonisés, et singulièrement les Noirs, ne sont que très rarement étudiés pour eux-mêmes dans la théorie critique contemporaine ; et jamais sans arrière-pensée. Ils sont les victimes collatérales de raisonnements qui les traitent, au mieux, en seconds rôles et, au pire, en éléments de décor jetés là pour parfaire une trame historique, apprêter un exemple, épicer une démonstration.
Je l’ai senti, d’abord ; je l’ai pensé, ensuite ; je l’ai théorisé, enfin. Fanon, comme d’autres auteurs de la tradition radicale noire, n’avait lui-même eu d’autre choix que la polémique pour entrer en philosophie. Les pages de Peau noire, masques blancs le voient aux prises avec Sartre et Hegel, en lutte contre Octave Mannoni, René Maran et Mayotte Capécia, se débattant avec Adler et Freud. C’est qu’il n’y a pas de place pour le Nègre dans la vie de l’esprit ; la seule option est celle du passage en force. Malgré la valeur que je reconnais aux recherches des théoriciens postcoloniaux ou poststructuralistes qui puisent aux sources des paradigmes de la philosophie post-lacanienne ou de la déconstruction, nonobstant l’inspiration que j’ai tirée de leurs travaux et ma dette à leur égard, je ne m’inscris pas dans leur lignée. Comme l’a souligné Lewis Gordon, pour faire preuve de leur pertinence dans l’étude de la condition noire, de telles théories doivent avant tout être interrogées quant à leur propre solidarité avec le racisme et la colonialité ; c’est à- dire être passées au crible de la théorie critique noire elle-même[26]. Il n’est pas question ici d’ostraciser ou de mettre à l’index la philosophie européenne, mais bien d’apprendre à la lire avec nos propres yeux, notre propre chair et notre propre intelligence. Comme l’écrivit Fanon, au détour des remerciements de sa thèse de médecine, « la philosophie est le risque que prend l’esprit d’assumer sa dignité[27] ».
***
Le premier chapitre, « Décoloniser la philosophie morale », cherche à identifier les principales caractéristiques de l’acception dominante du concept de dignité. À cette fin, elle offre une brève histoire critique, bornée à quelques jalons significatifs, de ses usages dans la pensée européenne : Pic de la Mirandole, Kant, Habermas. Je cherche à montrer comment se sont imposées des définitions de la dignité, non seulement porteuses d’une méconnaissance du problème de la déshumanisation raciale, mais construites de sorte à ne jamais pouvoir s’y confronter de façon directe, mais au contraire à la consolider. Ainsi, Pic introduit le couple de l’autonomie (c’est-à-dire la capacité à poser ses propres lois d’un homme décrit comme soustrait à toutes les dépendances) et de la puissance appropriatrice comme un double critère de la dignité humaine, dans un geste singulièrement compatible avec l’ego conquiro : la mentalité conquérante de l’Europe coloniale naissante [28]. L’éthique kantienne peut se lire comme un effort de domestication des excès de cette approche, qui astreint l’individu autonome et appropriateur aux règles rationnelles de la morale afin de borner l’emprise de son pouvoir. Mais, de l’examen des écrits de Kant sur la question raciale, ressortira l’idée que le Noir se tient en exception par rapport à ces règles. Il est l’être que la loi morale est incapable de protéger, celui qui la contraint à douter d’elle-même. Ce chapitre décrit finalement un processus de constitutionnalisation, c’est-à-dire d’inscription dans les lois fondamentales des États européens, de cette philosophie morale inconsciemment fondée sur une épistémologie coloniale. On a eu beau définir la dignité comme le propre de l’humain, demeure la question de savoir si ces institutions de la frontière et de la citoyenneté sélective que sont les États-nations peuvent être considérées comme les gardiens légitimes de son universalité supposée, et si souvent contredite dans les faits.
À partir de l’hypothèse selon laquelle les expériences sociales négatives, et notamment la violence, sont le révélateur de la dignité, le second chapitre, « L’indigne », entreprend une enquête sur l’expérience vécue de la race et les politiques qui la produisent. Arendt , Foucault et leurs continuateurs, issus de l’« Italian theory[29] », ont offert d’influentes interprétations historiques du rôle du racisme dans la construction de la modernité politique. Ils partagent une définition de la violence de race construite, plus ou moins explicitement, en adoptant le génocide nazi comme paradigme. Une double conséquence découle de ce choix : premièrement, la déshumanisation raciale extrême apparaît comme un phénomène tardif dans l’histoire européenne et, deuxièmement, l’extermination semble en constituer la forme la plus essentielle et la plus caractéristique. Ce chapitre vise à tirer les conséquences d’un changement de paradigme qui penserait la déshumanisation à partir de la traite transatlantique et de l’esclavage. Ce phénomène, en effet, participe au contraire des origines de la modernité et relève d’une forme de destruction de la vie qui ne passe pas directement par le génocide, mais par la privation systématique de ce qui fait qu’une vie humaine est digne d’être vécue. Je qualifie cette situation de « forme-de-mort », en déplaçant le concept de nécropolitique qu’a introduit Achille Mbembe pour désigner des politiques contemporaines de la mise à mort. L’acception de Mbembe, en effet, recouvre exactement ce que des théoriciens italiens comme Giorgio Agamben ou Roberto Esposito ont nommé « thanatopolitique ». Or j’estime plus productif de réserver le vocable « nécropolitique » à des politiques de l’indifférenciation ou du déplacement de la frontière entre la mort et la vie. La forme-de-mort, comme l’envers de la vie quotidienne blanche et capitaliste, se caractérise par une accumulation d’impossibilités, de frustrations et d’interdits qui nécrosent l’existence et cause un effondrement de toute confiance dans le monde.
Le troisième chapitre, « Notre dignité est plus vieille que nous », étudie la dignité en tant que réponse nécessaire à cette atteinte nécropolitique à l’existence noire. Toutefois, bien qu’elle soit un produit de la puissance du négatif, la dignité n’est pas pour autant sans contenu propre. Elle n’est pas ce que les théoriciens politiques post- lacaniens qualifient de « signifiant vide » : elle est le produit d’une histoire ou, plus exactement, de l’entrelacs consistant d’un ensemble d’histoires relatives à la condition afrodescendante. Pour les opprimés, la dignité est un concept synonyme d’entrée dans le domaine de la politique selon leurs propres termes, qui implique un questionnement sur la vivabilité même de la vie. La dignité apparaît alors comme un effort pour vivre une vie authentiquement humaine, consubstantiel d’une revendication de l’histoire de ces efforts. Une illustration frappante en sera proposée à travers le mouvement de la négritude et son projet de confluence des héritages intellectuels, politiques et artistiques de l’Afrique et de sa diaspora. Contre la thèse commune d’une négritude « dépassée » par Sartre et Fanon, on soulignera l’importance de son geste théorique, qui ne se borna pas à une banale revalorisation identitaire, mais consista à s’autoriser à critiquer l’Occident colonial depuis un point d’extériorité. Pour le prolonger, je proposerai, au moyen de la notion d’historicité profonde, une revalorisation de l’idée méprisée d’essentialisme. Pour ce faire, j’établirai la nécessité d’une distinction entre l’essence (comprise comme une mémoire et un faisceau d’attachements vécus) et les normes (comprises comme les modalités de la contrainte sociale et politique par laquelle elles peuvent être imposées). Cette analyse conduira à pointer les limites éthiques et politiques de l’anti-essentialisme obsessionnel des philosophies contemporaines de la déconstruction : la dignité des opprimés, en tant que phénomène historique, sera définie comme la part indéconstructible de leur existence.
Le quatrième chapitre, « L’universel par accident », introduit une critique des doctrines universalistes contemporaines, sous l’angle de leur rapport au théologico-politique. On verra ainsi, par-delà leurs divergences, les points communs qui unissent les discours philosophiques du sécularisme français (c’est-à-dire les apologies de la « laïcité ») et certaines velléités de restauration post-déconstructionnistes de l’universel chez des théoriciens tels que Slavoj Žižek , Alain Badiou ainsi que, de façon plus subtile et complexe, Étienne Balibar. Ces deux tendances se fondent sur des approches restrictives de l’articulation possible entre politique et théologie, résumée dans l’opposition commode entre d’un côté des particularismes identitaires nécessairement réactionnaires ou barbares et, de l’autre, l’universalité salvatrice d’un sujet politique. Pour les uns, il s’incarne dans la figure de l’État ; pour les autres, dans celle de la révolution. Mais tous s’accordent dans une même dépréciation du particulier. L’idée directrice de ce chapitre est que la théorie critique gagnerait à cesser d’accorder une valeur positive par défaut à l’universel et, à l’inverse, une valeur négative au particulier. Une longue histoire d’usages révolutionnaires du christianisme dans les mondes noirs off re des exemples convaincants de la possibilité d’une autre approche.
L’objet du cinquième chapitre, « Une théologie de la dignité noire en Amérique du Nord », est de présenter l’éthique de la dignité qui a infusé une certaine tradition religieuse engagée, à travers le prisme de l’œuvre du regretté James Cone . A contrario d’un préjugé répandu, la christianisation des Noirs ne fut pas un vulgaire lavage de cerveau, une pure et simple aliénation. On insistera sur le fait que leur adoption de cette religion ne fut pas passive, ni fondée sur un néant spirituel. L’Église noire devint un lieu privilégié de rassemblement, d’action et d’invention d’une pensée critique. Lorsqu’il concrétise, à la fin des années 1960, son ambition de fonder une nouvelle théologie révolutionnaire, Cone peut s’appuyer sur cet héritage qui remet en perspective les combats pour les droits civiques et ceux du Black Power movement. Ce chapitre s’attarde notamment sur la pratique et la pensée du prophétisme, entendu comme discours démocratique radical et vecteur privilégié de la dignité noire.
Les débats sur l’existence d’une « philosophie africaine » qui agitèrent l’agora noire globale du milieu du XXe siècle[30] constituent le point de départ du sixième chapitre, « Ubuntu : philosophie, religion et communauté en Afrique noire ». Plutôt que de rendre compte de l’aspect le plus saillant de cette controverse, à savoir l’opposition entre une ethnophilosophie qui prétendait déceler une ontologie dans les structures linguistiques africaines, et une école critique qui attaquera les illusions de cette démarche, on s’attardera sur les différends qui agitèrent les représentants de la tendance critique eux-mêmes. Ce chapitre opposera ainsi à un certain scientisme diagnostiqué dans l’œuvre du jeune Paulin Hountondji la démarche plus existentielle et herméneutique de Fabien Eboussi Boulaga. On montrera comment l’approche de ce dernier préfigure la théologie de la libération du Sud-Africain Desmond Tutu et sa réinterprétation du concept bantou d’ubuntu qui, entre autres choses, peut être entendu comme un synonyme de la dignité humaine. Cette traduction linguistique opère une torsion de la signification de la dignité : elle n’est plus seulement un attribut de la personne individuelle mais se déplace dans l’être collectif. On rappellera le rôle que joua l’ubuntu dans la commission Vérité et Réconciliation qui, à la fin des années 1990, accompagna la transition post-apartheid. Ce passage par l’Afrique du Sud devrait révéler une conception de la dignité soucieuse de la réparation éthique, attentive à la finitude et à la vulnérabilité humaines confrontées à des conditions extrêmes.
Le septième chapitre, « Reconnaissance et dignité à l’ère de l’apartheid global », commence par une réflexion sur la prétendue « crise migratoire » de l’Europe contemporaine. On proposera une évaluation sans concession du statu quo en s’attardant notamment sur la production de vies jetables consubstantielle des politiques migratoires européennes et sur l’instrumentalisation médiatique de la violence d’État à des fi ns dissuasives. Mais on cherchera aussi à dépasser ce simple constat. D’abord, en critiquant systématiquement les politiques multiculturelles de la reconnaissance, longtemps présentées par la gauche libérale comme un antidote légitime aux politiques racistes de l’asile. L’œuvre du philosophe allemand Axel Honneth sera tenue pour exemplaire de la colonialité latente de cet idéal de reconnaissance. Là où Honneth tend à considérer unilatéralement la reconnaissance comme un bienfait, Frantz Fanon avait grandement complexifié les termes du problème, en mettant en évidence une sorte de nuancier de la reconnaissance. Elle peut, certes, équivaloir à une valorisation de l’individu ; mais, le plus souvent, elle légitime son aliénation et son assujettissement en consacrant l’intégration à la société coloniale comme un accomplissement. Fanon fait de la notion de reconnaissance un corollaire de celle de dignité ; en d’autres termes, la reconnaissance authentique procède d’une auto-affirmation de la dignité des opprimés qui force la société dominante à rompre avec ses propres modalités traditionnelles de reconnaissance. Ensuite, on recherchera dans les effets de l’impérialisme et de la colonialité du pouvoir les causes réelles des déplacements de populations. Un tel questionnement met à bas l’opposition, largement idéologique, entre réfugiés « politiques » et migrants dits « économiques », actuellement tenue pour légitime par les élites politiques européennes. Fanon associe dignité et souveraineté, pointant le traçage d’une frontière entre humanité et inhumanité sous-jacent aux définitions normatives dominantes de la dignité humaine. Le problème contemporain des migrations n’est pas seulement celui d’un devenir nécropolitique de l’accueil ; il est d’abord celui d’une longue tradition de démolition des souverainetés africaines.
Il est peu surprenant que le courant actuel de la pensée noire qui suscite aujourd’hui, à l’échelle internationale, le plus de résistance et de controverses, mais aussi d’intérêt et de curiosité porte le nom d’ « afro-pessimisme ». En dépit des débats relatifs à la « mise en marche[31] » d’une école de pensée aux propositions parfois délibérément lapidaires et provocatrices, je suis convaincu que son succès procède de l’écho qu’il rencontre au plus profond du vécu de la jeunesse noire de ce début de XXIe siècle. Cet « afro pessimisme » offre des mots à notre absence de confiance dans le monde, notre impossibilité structurelle à nous projeter dans l’avenir, notre précarité endémique. Le philosophe Calvin Warren en résume clairement les thèses fondamentales : le Noir, créature ontologiquement raturée, niée, est ce qui advient de l’existence africaine lorsqu’elle se voit transformée par l’événement de la traite transatlantique, « le transport et les rituels d’humiliation et de terreur[32] » qui l’accompagnent. Dès lors, le Noir sera le pilier abject d’un ordre symbolique où toutes les identités pourront se définir par contraste et par opposition à son ignominie ontologique absolue. « Le monde avait besoin d’un être pour supporter l’insupportable et vivre l’invivable ; un être qui existerait dans un interstice entre la mort et la vie, à cheval entre le Néant et l’Infini. L’être inventé pour incarner le noir comme néant est le Nègre[33]. » L’enjeu du huitième et dernier chapitre, « Ontologie politique et dignité noires », qui peut aussi se lire comme une récapitulation des propositions centrales de ce livre, est double. D’une part, malgré les critiques pertinentes récemment adressées au paradigme afro-pessimiste, il s’agit d’en identifier le noyau dur, intouché par les attaques : l’idée d’une ontologie politique noire. Ensuite, en s’attachant plus particulièrement à la situation française contemporaine, on mettra à l’épreuve le caractère universalisable de leur théorie, revendiqué par les penseurs de l’afro-pessimisme, mais dont l’excessive centration sur les États-Unis a été souvent soulignée. Pour ce faire, on posera une question d’ontologie politique fondamentale : que signifie « naître » dans l’horizon de la déshumanisation noire ? Il faudra ici, à partir d’une relecture d’Orlando Patterson, mais surtout de son inspirateur Claude Meillassoux, mettre en question l’usage afropessimiste de la notion de « mort sociale ». Puis, on reviendra sur le rapport de la vie noire à l’État, sur les plans de la violence policière d’abord, puis sur celui d’un dispositif institutionnel qui vise à en saper radicalement la critique en privant d’être les activistes antiracistes. Le concept de dignité noire exprime un besoin éthique et politique de braver cette négation. Jusqu’ici, il a su trouver ses ressources dans la forme-de-mort elle-même, comme on tâchera de le montrer à partir d’une défense de la dimension raciale (embarrassante pour les discours ordinaires de la gauche et donc souvent euphémisée, voire étouffée) de l’expression politique la plus pure de la nécessité : l’émeute. Finalement, la dignité noire sera définie comme une capacité à tenir debout dans l’interstice entre la mort et la vie, c’est-à-dire à se laisser hanter par les spectres ambigus du passé. L’afro-pessimisme insiste sur la destruction esclavagiste et coloniale de l’être africain dont aurait surgi la figure funeste du Noir moderne. À ce diagnostic d’« usurpation de la subjectivité, de la vie, de l’être[34] », on oppose souvent l’idée d’une survivance de certaines originalités traditionnelles dans la diaspora et l’Afrique postcoloniale. L’interprétation que je propose s’écarte de ces deux options. La dignité noire indique l’africanité du rapport même à cette destruction. L’africanité de la diaspora noire n’est ni un trésor à jamais perdu, ni une survivance à rechercher dans ce qui aurait résisté à la démolition ontologique. Elle gît dans sa manière unique et singulière de vivre la catastrophe et d’avoir commerce avec elle.
Comme je l’exprime dans ce chapitre final, la thèse afro-pessimiste avec laquelle je suis le plus profondément en désaccord est celle de l’unicité absolue de la souffrance noire. Je ne crois pas que la position structurelle abjecte des Noirs dans l’ontologie et l’histoire modernes s’exprime adéquatement dans les termes d’une singularité intégrale ou d’une intensité hors du commun. Je tiens, tout au contraire, l’expérience noire de la violence pour absolument comparable. C’est-à-dire que la constance de l’exposition de la vie noire à des violences sociales et politiques de tous ordres est peut-être ce qui permet le plus rigoureusement de la penser dans leur généralité et, surtout, dans le rapport à une totalité. J’ai, à cet égard, été non seulement honoré mais surtout ému d’apprendre que mon ami le philosophe hongrois Gábor Tverdota avait mobilisé certaines des thèses de cet ouvrage (alors en cours de rédaction) dans une étude remarquable consacrée à l’oppression en quoi consistent la pauvreté ordinaire et la précarisation des pauvres par la doctrine de l’État social actif en Belgique[35]. L’une des thèses de La Dignité ou la mort est que seule une attention extrême au particulier rend possible un éventuel acheminement vers des actions ou des énoncés universalisables. Je souhaite que le présent travail sur la vie noire encourage de multiples rencontres et collisions entre les singularités. Elles sont le prélude à la libération éthique et à l’élaboration d’une nouvelle politique de la nécessité.
La Dignité ou la mort comprend de nombreuses citations d’ouvrages et d’articles en langue anglaise, non disponibles en français. Ces traductions sont de mon fait.
Notes
[1] Fanon Frantz, OEuvres, Paris, La Découverte, 2011, p. 237.
[2] Selon ses propres dires, ce terme désigne surtout des travaux issus des science studies et du « tournant ontologique » de l’anthropologie contemporaine comme ceux d’Amade M’Charek, d’Annemarie Mol ou d’Eduardo Viveiros de Castro .
[3] Bancel Nicolas et alii (dir.), Ruptures postcoloniales, Paris, La Découverte, 2010 ; Bayart Jean-François, Les Études postcoloniales. Un carnaval académique, Paris, Karthala, 2010.
[4] Mignolo Walter D., La Désobéissance épistémique. Rhétorique de la modernité, logique de la colonialité et grammaire de la décolonialité, trad. Yasmine Jouhari et Marc Maesschalck , Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2015, p. 27.
[5] Bourguignon-Rougier Claude et Colin Philippe « La théorie décoloniale en Amérique latine. Spécificités, enjeux et perspectives », in Bourguignon-Rougier Claude, Colin Philippe et Grosfoguel Ramon (dir.), Penser l’envers obscur de la modernité, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2014, p. 25.
[6] Pour les données qui suivent je remercie Mehdi Meftah qui, en tant qu’acteur privilégié de ce moment politique, a partagé ses souvenirs avec moi.
[7] Boggio Éwanjé-Épée Félix et Magliani-Belkacem Stella , « Social-chauvinisme. De l’injure au concept », Contretemps, 6 janvier 2014, <contretemps.eu/socialchauvinisme-injure-concept>.
[8] Khiari Sadri, Pour une politique de la racaille. Immigré-e-s, indigènes et jeunes de banlieues, Paris, Textuel, 2006, p. 58.
[9] Dussel Enrique, 1492. L’Occultation de l’autre, trad. Christian Rubel, Paris, Éditions ouvrières, 1992, p. 44.
[10] Todorov Tzvetan, La Conquête de l’Amérique. La question de l’autre, Paris, Seuil, 1982, p. 193.
[11] Maldonado-Torres Nelson , Against War: Views from the Underside of Modernity, Durham/Londres, Duke University Press, 2006.
[12] Gordon Lewis R., An Introduction to Africana Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, p. 29.
[13] Wilderson Frank B., Red, White & Black: Cinema and the Structure of U.S. Antagonisms, Durham/Londres, Duke University Press, 2010, pp. 17-18.
[14] Outlaw Lucius T., On Race and Philosophy, New York/Londres, Routledge, 1996, p. 77.
[15] Warren Calvin L., Ontological Terror: Blackness, Nihilism and Emancipation, Durham/Londres, Duke University Press, 2018, pp. 26-27.
[16] Gordon Lewis R., Disciplinary Decadence: Living Thought in Trying Times, Boulder, Paradigm, 2006, p. 69.
[17] Gordon Lewis R., An Introduction to Africana Philosophy, op. cit., pp. 31-32.
[18] Bourdieu Pierre et Wacquant Loïc, « Sur les ruses de la raison impérialiste », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 121-122, 1998, pp. 109-118.
[19] Hall Stuart, « Anciennes et nouvelles identités, anciennes et nouvelles ethnicités » (1991), trad. Aurélien Blanchard et Florian Vörös, Identités et cultures 2. Politiques des différences, Paris, Éditions Amsterdam, 2013, p. 68.
[20] Kant Emmanuel, Critique de la raison pratique (1788), trad. François Picavet, Paris, PUF, 2012.
[21] Foucault Michel, Histoire de la sexualité, t. 3, Le Souci de soi (1984), Paris, Gallimard, 2001 ; Butler Judith, Le Récit de soi (2005), trad. Bruno Ambroise et Valérie Aucouturier, Paris, PUF, 2007.
[22] Cone James H., The Spirituals and the Blues (1972), Maryknoll, Orbis Books, 1991, pp. 27-28. C’est Cone qui souligne.
[23] Williams Landon, « The Black Panther, miroir du peuple » (1970), in Foner Philip S. (dir.), All Power to the People. Textes et discours des Black Panthers (1970), trad. collectif Angles morts, Paris, Syllepse, 2016, pp. 47-48.
[24] Khiari Sadri, Pour une politique de la racaille, op. cit., p. 102.
[25] Pleyers Geoffrey et Glasius Marlies, « La résonance des “mouvements des places”. Connexions, émotions, valeurs », Socio, n° 2, 2013, p. 69.
[26] Gordon Lewis R., « La “philosophie africaine” doit se définir en termes de projet intellectuel », Critique, n° 771-772, 2011, p. 626.
[27] Fanon Frantz, Écrits sur l’aliénation et la liberté, Paris, La Découverte, 2015, p. 168.
[28] Martinez Andrade Luis, « L’ego conquiro comme fondement de la subjectivitémoderne », La Revue nouvelle, n° 1, 2018, pp. 30-35.
[29] Chiesa Lorenzo , « Biopolitics in early twenty-first-century Italian theory », Angelaki. Journal of the Theoretical Humanities, vol. 16, n° 3, 2011, pp. 1-5.
[30] Kisukidi Nadia Yala , « Le “missionnaire désespéré” ou de la différence africaine en philosophie », Rue Descartes, n° 83, 2014, pp. 77-96.
[31] Sexton Jared, « Afro-pessimism: the unclear word », Rhizomes, n° 26, 2016 [En ligne].
[32] Warren Calvin L., Ontological Terror, op. cit., p. 39.
[33] Ibid., p. 37. Dans ce passage, Calvin Warren emprunte certaines formulations au dernier paragraphe du chapitre de Peau noire, masques blancs consacré à l’expérience vécue du Nègre.
[34] Wilderson Frank B ., « Blacks and the master/slave relation » (2015), in Wilderson Frank B . et alii, Afro-Pessimism: An Introduction, Minneapolis, Racked & Dispatched, 2017, p. 25.
[35] Tverdota Gábor, « L’État social actif et ses pauvres. Réflexions sur la dimension culturelle des politiques d’activation », Action et Recherche Culturelles ASBL, 2017, <arc-culture.be/wp-content/uploads/2017/11/Etude_-arc-gabor.pdf>.