
À lire : un extrait de « Le néo-libéralisme à la française », de François Denord
François Denord, Le néo-libéralisme à la française. Histoire d’une idéologie politique, Marseille, Agone, 2016 (1ère éd. 2007), 15 €.
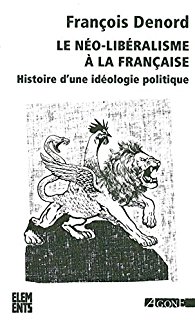
Un libéralisme réactionnel
La conversion au marché du parti le mieux structuré de la droite française permet de faire du libéralisme le lien entre les formations politiques qui, pour la première fois depuis la naissance de la Ve République, perdent le pouvoir. Face à la politique économique menée par la gauche entre 1981 et 1983, les formations de l’opposition enregistrent un afflux d’adhésions. Les nationalisations qui affectent les secteurs bancaire et industriel, la réduction du temps de travail, la création de l’impôt sur la fortune, la loi Quillot en faveur des locataires et les lois Auroux sur la représentation du personnel et son droit d’expression dans l’entreprise provoquent plus qu’un tollé à droite. C’est à l’ordre institué que semble vouloir s’en prendre le pouvoir. À l’UDF, l’augmentation des effectifs ne modifie pas profondément le recrutement : industriels, cadres supérieurs, professions libérales et indépendants demeurent sur-représentés au sein du Centre des démocrates sociaux et du Parti républicain[1]. Le RPR connaît une évolution plus marquée, qui le rapproche de l’UDF : ouvriers et employés qui représentaient 20 % de ses adhérents en 1977 passent à 16 % en 1984, dont seulement 3 % d’ouvriers, alors que le parti en revendique encore 11,3 % en 1979[2].
L’homogénéisation sociale de la droite et la place prépondérante en son sein de représentants des classes moyennes a une double conséquence : les prises de positions anti-étatistes prospèrent et la grande masse des militants, souvent peu diplômée, se laisse dessaisir de son rôle dans l’élaboration programmatique au profit de dirigeants qui tiennent un discours conforme à ses aspirations. La ligne est clairement fixée : deux France s’opposent et ce n’est pas du côté du service public que la droite ira chercher ses voix. « La France d’aujourd’hui, selon le programme du RPR, est atteinte d’hémiplégie, une moitié d’elle-même est soustraite à tout souci de productivité, à toute exigence de rentabilité. Quand les Français produisent deux francs, l’un de ces francs leur est aussitôt enlevé pour être affecté à la couverture des dépenses publiques et à la protection sociale. […] Les entreprises du secteur concurrentiel, les Français qui y travaillent ne doivent plus être considérés comme les vaches à lait d’un immense secteur protégé »[3].
Quelle que soit la formation considérée, les instances dirigeantes des partis de droite connaissent un important renouvellement au début des années 1980. Sur le plan des origines sociales, la stabilité l’emporte : les responsables locaux et les députés se recrutent principalement dans la bourgeoisie économique tandis que les directions parisiennes reviennent aux cadres ou anciens cadres de la haute fonction publique passés par les écoles du pouvoir. En revanche, sur le plan politique un glissement s’opère. Les nouveaux responsables des partis sont, soit par leur formation (le plus souvent Sciences-Po et l’ENA de la fin des années 1960), soit par leurs activités professionnelles, davantage enclins au libéralisme que leurs aînés. Leur socialisation politique s’est en outre effectuée de manière très différente. Quand ils sont « gaullistes » (cas d’Alain Juppé ou de Jacques Toubon), ils sont entrés dans la vie politique après la disparition du général de Gaulle et sont du même coup moins attachés à l’État et plus sensibles aux revendications des entrepreneurs du privé que leurs prédécesseurs. Quand ils sont libéraux, leur engagement à droite a souvent débuté à l’époque du « libéralisme avancé » et des premières avancées significatives de la gauche (Jean-Pierre Raffarin), à moins que, comme une minorité, ils n’aient fait leurs débuts à l’extrême droite (Alain Madelin et Gérard Longuet, anciens militants d’Occident). Ces nouveaux dirigeants politiques, qu’on appelle, dans les années 1980, les « cadets »[4], sont ainsi souvent en première ligne pour promouvoir le libéralisme, rejeter l’étatisme et louer les vertus de la « révolution conservatrice américaine » dont se délecte Guy Sorman[5], un essayiste membre du Parti radical valoisien. Même les plus anciens y vont de leur couplet reaganien ou thatchérien. Après avoir rencontré le président américain en janvier 1983[6], Jacques Chirac déclare devant la presse anglo-saxonne que la politique qu’il propose pour la France est « celle conduite actuellement en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en République Fédérale Allemande »[7]. En février 1984, face aux cadres supérieurs et aux chefs d’entreprises de l’Executive Club de France, il réaffirme que « le truc de Reagan, ça marche, et que le truc de Mitterrand, ça ne marche pas »[8] avant d’enfoncer le clou en septembre 1984 : « Regardez du côté des États-Unis… »[9]
La transformation des partis de droite s’accompagne du développement de clubs et d’associations. Tandis que les députés de l’opposition organisent une véritable guérilla parlementaire[10], les clubs ont pu passer pour l’un des moyens les plus sûrs de la reconquête du pouvoir, de la même manière qu’ils avaient joué un rôle central pour la gauche au début de la Ve République. La France compte rapidement plusieurs centaines d’organismes, plus ou moins institués, tentant de « former, maillon après maillon, la chaîne de la résistance à l’emprise idéologique de l’État socialiste »[11]. Toutes les familles politiques de la droite s’y investissent.
En 1982, les « nouveaux économistes » réactivent ainsi l’Institut économique de Paris, un think tank qu’ils avaient tenté de mettre sur pieds au début du septennat giscardien. Lié aux principaux organismes libéraux du même type en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, avec un comité de patronage prestigieux et Friedrich Hayek comme membre d’honneur, l’Institut économique de Paris abreuve hommes politiques et journalistes de notes et d’analyses. L’objectif poursuivi par son délégué général – Guy Plunier, un ancien cadre international de chez Michelin – est ambitieux : « Fournir les instruments intellectuels nécessaires à l’apparition [d’une] nouvelle culture après des décennies de domination presque absolue d’une pensée dirigiste surannée dont on s’aperçoit avec retard combien elle est dangereuse pour les libertés et inefficace pour la bonne marche des sociétés »[12]. Les nouveaux économistes publient également un bulletin, La Nouvelle Lettre, et créent un Groupe de recherche d’action et de liaison des libéraux (GRALL) en collaboration avec des parlementaires appartenant à l’UDF (François Léotard, Gérard Longuet, Alain Madelin). Dans les dîners qu’ils organisent, Jacques Chirac prend date : « Face à une machine d’État devenue folle, face une fonction publique à la croissance monstrueuse, face à une situation déjà difficile mais encore plus sombre pour les années à venir, que pourra faire, à l’heure de l’alternance, le responsable politique qui aura la charge des intérêts du pays ? Il n’aura guère d’autre choix que le libéralisme »[13]. Quant à Raymond Barre, redevenu le candidat préféré des intellectuels libéraux au début des années 1980, il y va de sa métaphore piscicole favorite : « Je cite toujours […] notre éminent prédécesseur, Bastiat, qui expliquait que la concurrence était nécessaire par l’apologue du bassin dans lequel se trouvaient des carpes : les carpes risquent de prendre un goût de vase si l’on n’y introduit pas un brochet… Je crois que, de temps à autre, il faut introduire le brochet de la concurrence internationale pour que nos carpes nationales perdent le goût de la vase »[14].
Le clubisme, comme mode de socialisation politique et comme accumulateur d’idées, fait partie intégrante de la stratégie de la droite pour conquérir le « pouvoir culturel » : les clubs permettent de faire participer au débat politique des individus rétifs à l’engagement partisan tout en les maintenant dans l’orbite des partis ; ils contribuent à la construction d’un sens commun libéral et tiennent souvent des discours radicaux propres à mobiliser ceux qui entrent dans la vie politique après 1981, sans que les partis aient à les assumer.
La division du travail entre clubs et partis peut prendre des formes très diverses. Certains clubs sont étroitement liés à un appareil partisan ou à une personnalité comme les giscardiens Clubs perspectives et réalités ou le chiraquien Club 89, fondé en 1981 par Michel Aurillac, Nicole Catala et Alain Juppé. D’autres sont inter-partis, à l’image du Club de l’Horloge. Son président Yvan Blot est le chef de cabinet de Bernard Pons, secrétaire général du RPR, et membre du comité central de ce parti ; Jean-Yves Le Gallou, le secrétaire général, appartient au conseil national du Parti républicain ; Henri de Lesquen et Michel Leroy, les vice-présidents, n’adhèrent officiellement à aucun parti[15]. Seule une minorité de clubs, tels les Comités d’action républicaine de Bruno Mégret, tente de s’affranchir des tutelles partisanes et de constituer une force politique autonome. Chaque club a son style propre. Si l’on s’en tient aux deux organisations qui ont sans doute marqué le plus nettement le discours libéral des années 1980, Club 89 et Club de l’Horloge, les différences sont nettes.
Le premier vise à recruter un maximum d’adhérents à Paris comme en province et a pour objectif de faire naître un projet politique d’ensemble « qui soit moins un instrument de conquête du pouvoir qu’un moyen de l’exercer dans la durée »[16]. Les ouvrages que diffuse le Club 89 déclinent les différentes facettes de la politique que le RPR et l’UDF pourraient mener une fois revenus au pouvoir. Ils nourrissent directement le programme du RPR ainsi que la plate-forme commune de 1986 (élaborée en collaboration avec les Clubs perspectives et réalités). À travers colloques, réunions publiques et publications, il s’agit, selon Alain Juppé, de « “vendre” ces notions de “liberté” et de “responsabilité” à nos concitoyens pour bien leur prouver qu’elles ne sont pas porteuses d’égoïsme, de repli sur soi, de dureté de la vie sociale mais, au contraire, d’épanouissement de l’individu »[17]. Sans être un mouvement de masse, le Club 89 connaît un développement et un succès rapides. Si seulement quarante-sept personnes étaient présentes lors de l’assemblée générale constitutive en septembre 1981, on en compte près de cinq cent à celle d’octobre de la même année et, huit mois plus tard, on fête l’adhésion du millième membre[18]. Son influence sur le discours de la droite se lit au travers de la reprise de certaines expressions, l’opposition entre « État gérant » et « État garant », par exemple[19].
Nettement plus élitiste, le Club de l’Horloge souhaite élaborer une nouvelle façon de faire de la politique. L’enjeu n’est ni d’attaquer de manière frontale les socialistes, ni de rechercher un compromis, mais de travailler progressivement au remplacement de la division gauche/droite par une opposition entre marxistes et républicains-nationaux-libéraux[20]. Tandis que le Club 89 s’essaye à renouveler le programme de la droite et à définir les mesures qu’elle pourrait prendre une fois revenue au pouvoir, le Club de l’Horloge s’inspire d’une stratégie supposément gramscienne visant à conquérir l’hégémonie en modifiant les structures du « champ de forces idéologiques ». La rhétorique du Club de l’Horloge fonctionne toujours selon le même principe. La devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité » est invoquée et, à partir de chacune de ses valeurs constitutives, on tente de montrer le fossé qui la sépare des idées et de la pratique socialistes. La force du Club est qu’au-delà de la production doctrinale, il permet aussi à toutes les sensibilités de droite de s’exprimer et de dialoguer. Les « nouveaux économistes » et leurs soutiens ne se privent d’ailleurs pas d’y intervenir.
Que les stratégies et les discours divergent ne doit pas masquer la grande complémentarité entre les clubs. Les multi-appartenances et les manifestations communes sont nombreuses, ce que les profils sociaux relativement similaires des clubs-men facilitent. Les clubs recrutent principalement des individus fortement diplômés, issus du privé, où ils occupent des positions dirigeantes. Quant aux animateurs de ces structures, il s’agit bien souvent d’anciens élèves de Sciences-Po et de l’ENA. La collaboration entre clubs et partis se traduit par une homogénéisation des discours tenus par les différentes formations politiques et en leur sein (les nuances s’estompent ainsi entre les composantes de l’UDF). Une fois la droite revenue au pouvoir, il lui faudra dénationaliser, déréglementer, désétatiser. Le libéralisme défendu par la droite française est très largement réactionnel. Popularisé par de très nombreux essais et pamphlets, il se définit avant tout dans l’opposition au socialisme de la période 1981-1982. Il emprunte dès lors à toutes les sources possibles, quelles que puissent être les contradictions doctrinales et les sensibilités apportées par chacun[21].
Anticipations rationnelles, main invisible, responsabilité des agents économiques se combinent de multiples façons pour faire du marché l’instance la plus efficace de régulation de la société. Le discours libéral de la droite ne puise pas aux sources françaises du néo-libéralisme. Il s’inspire très largement de son rameau américain. Rien de surprenant du côté de l’UDF : Pascal Salin et Georges Mesmin, l’animateur du GRALL, appartenaient tous deux à la « commission économique » du parti giscardien au début des années 1980[22]. Le GRALL a accueilli principalement des leaders de l’UDF et plusieurs des « nouveaux économistes », comme Jacques Garello ou Henri Lepage, comptent parmi les proches d’Alain Madelin, familier de l’ALEPS[23]. Le RPR n’est pourtant pas en reste. Public choice ? « La bureaucratie n’est pas seulement le produit de l’extension du secteur public, elle en est aussi en partie la cause. Son intérêt est de maximiser la taille de ses budgets », assène un député[24]. Anticipations rationnelles qui rendent inefficaces les politiques conjoncturelles ? « La confiance ne se décrète pas, énonce le programme du parti, mais se mérite : elle ne renaîtra dans le pays que le jour où nos concitoyens auront la certitude d’avoir à leur tête une équipe de gestionnaires responsables, décidés à refuser toute tentative démagogique et à rétablir, fut-ce au prix de douloureux sacrifices, un équilibre rigoureux de tous les comptes publics »[25]. Il n’y a guère que le monétarisme qui soit contesté parce que, « au lieu d’agir directement sur les facteurs structurels de l’inflation, écrit Alain Juppé, les politiques monétaires trop restrictives provoquent inéluctablement une récession »[26].
Si le discours de la droite est libéral sur le plan économique, il ne l’est presque jamais dans le domaine moral (cas de certains libertariens mis à part) : défense de la famille traditionnelle, dénonciation de l’insécurité, lutte contre l’immigration restent des thèmes récurrents, que la concurrence du Front national amène à marteler systématiquement. La reconstruction de la droite autour du libéralisme économique a également pour corollaire le déclin de la tradition qui contrebalançait le libéralisme, le gaullisme. Le nationalisme gaullien peut bien encore inspirer des prises de position en matière de politique étrangère, mais les volontés réformatrices (réelles ou supposées) du gaullisme social ne survivent qu’à l’état résiduel et le plus souvent en marge de la force politique se réclamant du gaullisme.
Au milieu des années 1980, la mode libérale atteint son paroxysme. La conjoncture nationale s’y prête : l’année 1984 est marquée par la formation du gouvernement Fabius, le départ du Parti communiste de la majorité ou encore la querelle dite de l’« école libre ». À droite, la mue idéologique paraît accomplie : Libres et Responsables du RPR, Réflexions pour demain[27] de Raymond Barre, La Liberté à refaire[28], dirigée par Michel Prigent, La Solution libérale[29] de Guy Sorman, sont autant de plaidoyers en faveur du libéralisme qui paraissent cette année-là. Une grande fête libérale est même organisée à Paris. À l’initiative des nouveaux économistes, la Société du Mont-Pèlerin tient en mars un meeting régional, financé entre autres par de grandes entreprises, comme Michelin – jamais en reste semble-t-il quand il s’agit de défendre la bonne cause[30] –, Nina Ricci ou Yves Rocher[31]. La réunion connaît une affluence record. Aux côtés des membres de la Société, des patrons (François Ceyrac, Michel Drancourt), des hommes politiques (Yvan Blot, Alain Juppé), des intellectuels anticommunistes et des essayistes (Alain Besançon, Guy Sorman) viennent écouter Friedrich Hayek proclamer que, « même en France, […] le libéralisme classique est devenu la nouvelle pensée »[32]. Sous le charme, Jacques Chirac remet au patriarche libéral la grande médaille de Vermeil de la ville de Paris. En 1976, le président du parti gaulliste déclarait à l’occasion d’un meeting que « la justice sociale est sans doute une des exigences les plus profondes de notre tempérament national »[33]. En 1984, il félicite Friedrich Hayek pour avoir montré que rien n’était plus arbitraire que cette notion : « Qui permettra de déterminer ce qu’il est équitable de distribuer, si ce n’est, en fin de compte, la décision arbitraire d’un seul ou d’un petit nombre, en fait, l’État omniprésent qui s’arroge le droit de décider pour tous ? », s’interroge-t-il. Avant de déclamer en hommage au récipiendaire quelques vers du poète allemand Friedrich Hölderlin : « Allons, viens ! Que nous voyions l’Orient. Que nous cherchions quelque chose de vivant, si loin soit-il »[34].
Si loin ou si proche ? Car quelques mois plus tôt, le 23 mars 1983, le Président François Mitterrand avait décidé de mettre fin à la politique de relance. Alors que le franc avait déjà été dévalué par deux fois depuis son élection, il s’expliqua lors d’une allocution télévisée : « Nous n’avons pas voulu et nous ne voulons pas isoler la France de la Communauté européenne dont nous sommes partie prenante. […] Ce que j’attends [du Premier ministre] n’est pas de mettre en œuvre je ne sais quelle forme d’austérité nouvelle mais de continuer l’œuvre entreprise adaptée à la rigueur des temps. » Ainsi fut annoncé ce qu’on a un peu abusivement appelé le « tournant de la rigueur »[35]. François Mitterrand prenait acte que le maintien de la France dans le système monétaire européen obligeait à faire de la lutte contre l’inflation une priorité. Au nom de l’Europe, la France s’arrima à l’Allemagne et renonça à sa souveraineté monétaire. Jacques Delors, le ministre de l’Économie et des Finances, qui réclamait depuis novembre 1981 une « pause » dans la mise en œuvre des réformes sociales, obtenait gain de cause. Porté à la tête de la Commission européenne en janvier 1985, il transforma la Communauté économique européenne en Union européenne, permit l’adoption de l’Acte unique (1986) puis du Traité de Maastricht (1992). La gauche française « a fait beaucoup plus que se laisser briser par les réalités de la mondialisation »[36]. Elle a participé à l’institutionnalisation du néo-libéralisme.
Notes
[1] Près de 34 000 amendements ont été déposés à l’Assemblée nationale entre 1981 et 1984.
[2] En réalité, Michel Leroy est permanent du PR et Henry de Lesquen militant RPR.
[3] Colette Ysmal, Demain la droite, Grasset, Paris, 1984.
[4] Patrick Guiol et Éric Neveu, « Sociologie des adhérents gaullistes », Pouvoirs, 1983, n° 28, p. 95 ; Pierre Bréchon, Jacques Derville et Patrick Lecomte, Les Cadres du RPR, Économica, Paris, 1987, p. 32.
[5] RPR, Libres et responsables. Projet pour la France, Flammarion, Paris, 1984, p. 14.
[6] Jacques Frémontier, Les Cadets de la droite…, op. cit.
[7] Le Figaro, 23 mars 1983.
[8] Le Monde, 11 février 1984.
[9] Libération, 14 septembre 1984.
[10] Andrew Knapp, Le Gaullisme après de Gaulle, op. cit., p. 129.
[11] Patrick Buisson (dir.), Le Guide de l’opposition, Intervalles, Paris, 1983.
[12] L’Institut économique de Paris, Paris, 1982.
[13] Jacques Chirac, « Le Libéralisme peut-il inspirer un projet politique ? », art. cité, p. 10.
[14] Raymond Barre, « Le Libéralisme peut-il inspirer un projet politique ? », Liberté économique et progrès social, octobre 1983, n° 46/47, p. 17.
[15] Catherine Rault, Le Club de l’Horloge (1981-1986)…, op. cit., p.165-166.
[16] Michel Aurillac, « L’Espérance est au rendez-vous », Les Cahiers de 89, juillet 1982, supplément au n° 3.
[17] Alain Juppé, intervention lors du Colloque Responsabilités et Libertés, Les Cahiers de 89, septembre 1982, supplément au n°4.
[18] Le Monde, 10 octobre 1981 ; Michel Aurillac, « L’Espérance est au rendez-vous », art. cité.
[19] « Texte du manifeste », Les Cahiers de 89, novembre 1983, n° 14.
[20] Club de l’Horloge, Échecs et injustices du socialisme, suivi d’un projet républicain pour l’opposition, Albin Michel, Paris, 1982.
[21] Bruno Théret, « Vices publics, bénéfices privés. Les propositions économiques électorales des néo-libéraux français », Critique de l’économie politique, avril-juin 1985, n° 31, p. 77-134.
[22] Georges Mesmin, « Théoriciens et politiques, les difficultés du dialogue », De l’ancienne à la nouvelle économie : essais à l’occasion de la 10e Université d’été de la nouvelle économie, Librairie de l’Université, Aix-en-Provence, 1987, p. 221.
[23] Frédéric Lebaron, « La Dénégation du pouvoir. Le champ des économistes français au milieu des années 1990 », Actes de la recherche en sciences sociales, septembre 1997, n° 119, p. 14.
[24] Jacques Godfrain, « Le vrai danger des nationalisations », Contre-Point, automne 1981, n° 39, p. 79.
[25] RPR, Libres et responsables…, op. cit., p. 26.
[26] Alain Juppé, La Double Rupture, préface de Jacques Chirac, Économica, Paris, 1983, p. 33.
[27] Raymond Barre, Réflexions pour demain, Hachette, Paris, 1984.
[28] Michel Prigent (dir.), La Liberté à refaire, Hachette, Paris, 1984.
[29] Guy Sorman, La Solution libérale, Fayard, Paris, 1984.
[30] Michel Dufourt, « François Michelin, libéral intégriste », Golias Magazine, janvier-février 2000, p. 39-50.
[31] « The Mont-Pèlerin Society 1984 regional meeting », Ronald Max Hartwell papers, Box n° 1, HIA.
[32] Le Figaro Magazine, 10 mars 1984.
[33] Jacques Chirac, Discours de Strasbourg, 17 décembre 1976.
[34] « Allocution prononcée par Monsieur Jacques Chirac, maire de Paris », 1er mars 1984, Mont-Pèlerin Society papers, Box n° 25/6, HIA.
[35] Matthieu Tracol, La Rigueur et les Réformes. Histoire des politiques du travail et de l’emploi du gouvernement Mauroy (1981-1984), Université Paris 1, Thèse pour le doctorat d’histoire, 2015, p. 528.
[36] Rawi Abdelal, « Le consensus de Paris : la France et les règles de la finance mondiale », Critique internationale, juillet-septembre 2005, n° 28, p. 90.

![Retraites : le FN/RN, l’autre parti du capital [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Lille_-_Meeting_de_Marine_Le_Pen_pour_lelection_presidentielle_le_26_mars_2017_a_Lille_Grand_Palais_136-150x150.jpg)







