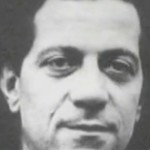L’État, la révolution et l’autogestion. La question autogestionnaire et la gauche en France depuis 1968
La question de l’autogestion a été au cœur des débats et des élaborations de la gauche radicale dans les années 1968. Théo Roumier donne à voir les lignes de force de ces discussions qui ne relevaient pas de simple polémiques entre courants politiques, mais s’inscrivaient dans un débat stratégique vivant, orienté vers la perspective, largement partagée alors, de la révolution socialiste.
Le texte ci-dessous est la retranscription, légèrement reprise, d’une communication prononcée lors de la conférence internationale Historical materialism Paris, « Conjurer la catastrophe », qui s’est tenue du 26 au 28 juin dernier. Elle s’inscrivait dans le panel « Transformations anticapitalistes de l’État ? ». Contretemps publiera d’autres communications tenues lors de cet événement important pour les pensées critiques et qui a attesté de leur vitalité.
***
État. Révolution. Autogestion.
Dans la décennie qui a suivi Mai 68 en France, c’est bien le dernier terme qui est venu interroger toute la gauche hexagonale, politique comme syndicale, ses pratiques, ses stratégies, ses projets.
Pour introduire cette communication qui va tenter de survoler cette période, en allant même un peu au-delà, je voudrais commencer par ces quelques mots de Daniel Guérin qui me semblent en poser les enjeux :
« L’autogestion ouvrière (…) est condamnée à osciller entre deux pôles : d’une part, l’autonomie des groupes de production, nécessaire pour que chacun d’eux se sente réellement libre et “désaliéné” ; d’autre part, la nécessité de la coordination en vue de faire prévaloir l’intérêt général sur les intérêts égoïstes. Qui diable pourrait assumer cette coordination ? Invoquer ici Satan n’est pas une outrance, car le problème est diaboliquement ardu. S’il ne se trouve pas un organisme de coordination qui soit autonome, c’est-à-dire émanant des travailleurs, et d’eux-seuls, c’est fatalement l’État autoritaire qui s’arrogera ce rôle. »[1]
Nous sommes fin novembre 1965 quand Guérin pose ainsi la question au colloque Proudhon de Bruxelles. La suite des événements va donner à ce dilemme une répercussion qui ira bien au-delà des cercles, informés mais encore étroits, qui s’en préoccupaient jusqu’ici (par exemple autour de la revue Autogestion, publiée à partir de 1966).
Mai-juin 68, ses 10 millions de grévistes, ses lycées et ses universités en totale ébullition, est en ce sens un détonateur.
Le 16 mai 1968, l’une des deux grandes confédérations syndicales françaises, la CFDT, publie un communiqué particulièrement marquant dans lequel on peut lire ceci :
« À la monarchie industrielle et administrative, il faut substituer des structures démocratiques à base d’autogestion »
Le mot n’est pas totalement nouveau, mais il est récent. Traduit du serbo-croate, il fait alors référence aux expériences menées dans la Yougoslavie titiste et dans les premières années de la jeune Algérie indépendante. Pour autant, il va vite les « déborder » et devenir en quelque sorte « l’autre nom du socialisme », en tout cas pour celles et ceux qui ne l’envisagent que « dans la liberté ».
Deux fédérations de la CFDT, la Chimie dirigée par Edmond Maire, et Hacuitex (pour Habillement, Cuir, Textile) dirigée par Frédo Krumnow, s’étaient déjà appropriée le mot en 1964, à l’occasion de leur déconfessionnalisation.
C’est au 35e congrès de la centrale syndicale, en 1970, que l’orientation du socialisme autogestionnaire est adoptée largement. De simple mot dans un communiqué, l’autogestion est devenue à la fois l’axe et la perspective centrale du syndicat. Stratégie pour l’action et projet de société.
Le socialisme autogestionnaire de la CFDT repose sur trois piliers :
1/ la propriété sociale des moyens de production (ni privée, ni d’État donc, les mots sont importants) ;
2/ la planification démocratique ;
3/ l’autogestion, de l’entreprise mais aussi de l’ensemble de la société.
Tous les trois supposent une rupture anticapitaliste. Et tous les trois percutent le rapport à l’État.
Disons-le d’emblée, la CFDT peinera à aller, collectivement en tout cas, au-delà de ce socle minimal dans les années qui suivent. Mais un espace a été ouvert, appelons-le de l’autogestion socialiste. Un espace qui a pour base sociale les grèves nombreuses et dures de la période et une classe ouvrière majoritaire dans la population active. Un espace dans lequel s’engouffre toute une frange du « peuple de mai » et de ses organisations.
C’est le cas d’un petit parti de la gauche radicale, le Parti socialiste unifié (PSU), fondé en 1960. Le PSU, où la gauche chrétienne est importante, cherchait à dessiner une alternative, tant à la social-démocratie incarnée par la SFIO qu’à la déformation stalinienne du socialisme incarnée par le PCF.
Il est un temps l’auberge espagnole en quelque sorte des différentes gauches hétérodoxes. C’est pour partie ce qui lui vaut d’être affublé de l’étiquette « centriste » par les trotskystes.
C’est enfin un parti qui a été considérablement remodelé par Mai 68 : en 1972, un peu plus de la moitié de ses 10 000 membres (revendiqués) a moins de 30 ans et seulement un quart a sa carte depuis 1960.
La même année, deux ans après le congrès de la CFDT, le 8e congrès du PSU adopte un manifeste, « Contrôler aujourd’hui pour décider demain »[2], qui valide là aussi l’option autogestionnaire. Le PSU se revendique même être « le parti de l’autogestion ».
Alors que dit-il de l’État et de la révolution ?
D’abord qu’il y aura bien une phase de transition consistant à mettre sur pieds un « État des travailleurs », je cite :
« Il ne leur suffira pas [aux travailleurs et aux travailleuses donc] d’occuper l’État modelé par la bourgeoisie en fonction de ses intérêts pour changer la société : il faut le briser. »
D’accord, mais comment le « briser » ? Et surtout par quoi le remplacer ? Là le manifeste oscille entre deux options :
« La forme de cet État dépendra du caractère des luttes qui auront mené à la prise du pouvoir = émanation des conseils de travailleurs dans les entreprises et les régions – expression directe du suffrage universel… »
Entre les deux, il y a tout l’espace donné à la stratégie du contrôle ouvrier (« contrôler aujourd’hui pour décider demain » dit le PSU, « vivre demain dans nos luttes d’aujourd’hui » dit la CFDT), trait d’union entre l’action immédiate et l’autogestion socialiste. La grève de Lip en 1973, animée notamment par des syndicalistes CFDT et membres du PSU, en sera une illustration majeure.
Le syndicaliste Frédo Krumnow, représentant de la gauche de la CFDT et n°2 de la centrale, qui n’hésite pas à se dire « révolutionnaire » (par ailleurs membre du PSU), exprime sensiblement la même chose dans un entretien donné à Tribune socialiste en mai 1971 :
« Nous avons […] à mener la lutte pour mettre en question le pouvoir capitaliste et favoriser au maximum la prise du pouvoir par des forces politiques socialistes [le pluriel est important]. Maintenant, quant à la façon dont cela se passera, nous n’avons pas dit que ce serait par la voie des élections. Il est possible que, dans notre pays, un renversement puisse se faire comme cela s’est passé au Chili.
Mais il est aussi possible que cela se passe autrement. Par exemple au moment d’une crise, au moment de l’immobilisation par la grève généralisée de l’appareil économique etpolitique [j’insiste sur le « et »]. Cela créerait une vacance du pouvoir et il faudrait alors le prendre. De toute façon, le choix populaire par voie d’élection s’opérera ! »[3]
Cette ouverture à deux voies possibles pour la rupture – pour simplifier, par les élections ou par la grève générale – répond :
– À la fois à l’observation attentive, entre inquiétude et espoir, de l’expérience de la révolution chilienne et de la tentative de transition pacifique et légale au socialisme qu’elle représente – expérience alors en cours au travers du gouvernement d’unité populaire et de son rapport aux diverses formes de « pouvoirs populaires » notamment animés par la gauche révolutionnaire.
– Mais c’est aussi une réponse au Programme commun signé en 1972 par le Parti socialiste et le Parti communiste français qui n’envisage le « changement » que par en haut et par la voie consacrée du seul suffrage universel, trop loin des aspirations autogestionnaires que le PSU comme la CFDT décèlent dans les luttes réelles menées dans ces années-là.
Il faut rappeler ici le sentiment d’imminence du passage au socialisme, dans ses différentes acceptations, qui habitait non seulement la totalité des organisations de gauche et d’extrême gauche, de l’Organisation révolutionnaire anarchiste (ORA) au Parti socialiste (PS), mais aussi de très larges pans des classes populaires.
Dans ce contexte, la question de la rupture porte en elle la question du socialisme.
Si le PSU par exemple oscille entre ces deux possibilités de rupture, légale et/ou extra-parlementaire, c’est qu’en réalité le débat est vif en son sein sur la source du pouvoir autogestionnaire à construire : les seuls conseils ouvriers ou des unités territoriales et collectives redessinées qui seraient la base d’un suffrage universel refondé et donc d’une autre forme d’État ?
Où et comment se feront les arbitrages nécessaires à une planification dès lors qu’elle se veut autogestionnaire ? Est-ce que la centralité d’un appareil d’État – même des travailleuses et des travailleurs – est la seule garantie de l’intérêt collectif, au risque de l’émergence d’une bureaucratie ? Quelle capacité de contrôle de la base de société peut permettre d’assumer une forme de coercition démocratiquement acceptable par toutes et tous ?
La Ligue communiste ferraille alors avec les « autogestionnaires purs », d’autant que le Parti socialiste envisage alors une pincée d’autogestion dans son projet, quand, de leur côté, le PCF comme la CGT n’y voient alors qu’un « mot creux »[4].
« le socialisme, ça n’est pas le parlement bourgeois plus l’autogestion des entreprises nationalisées. »[5]
Cette organisation n’envisage pas autre chose derrière le mot d’autogestion que l’autogestion ouvrière.
Jeannette Habel, membre du Bureau politique de la Ligue communiste, exprime ça assez bien dans une tribune donnée au Monde en juin 1973 :
« Dans une société socialiste, l’autogestion des entreprises collectivisées représente la base économique du pouvoir des travailleurs. Mais surtout, l’autogestion sous la forme d’un collectif de travailleurs élus et révocables est la grande école de la démocratie politique qui permettra aux travailleurs de gérer l’État eux-mêmes. »[6]
Le pouvoir des conseils ouvriers, centralisé, est le nouvel État où s’élabore la planification socialiste. Il doit se débarrasser, y compris à l’épreuve de la force, des formes de la société ancienne.
Le « vrai » clivage n’est pas pour la Ligue, entre autogestionnaires et étatistes, mais reste celui qui oppose révolutionnaires et réformistes. L’équilibre, qui est envisagé par le PSU, d’un pouvoir d’État, gagné à gauche électoralement, qui se ferait le soutien de l’auto-organisation populaire et de l’inévitable mobilisation des masses en vue de construire le pouvoir autogestionnaire qui le remplacerait ne convainc évidemment pas la Ligue communiste.
Ces critiques, la gauche du PSU peut les entendre si ce n’est les partager. Ainsi Victor Fay, communiste internationaliste et vétéran du luxemburgisme, défend-il dans la revue du PSU « l’unicité du pouvoir des conseils », dénonçant « le suffrage universel direct et indifférencié [qui] isole l’électeur de son milieu ». Il voit une filiation entre la démocratie des conseils et la Commune de Paris, rappelant que cette dernière « n’a privé personne de ses droits civiques »[7].
L’enjeu de ce débat est finalement résumé dans un langage franc et direct – ce qui fait parfois du bien – par le syndicaliste autogestionnaire de Lip, Charles Piaget, en 1974 :
« Notre objectif n’est pas de remplacer des patrons et des préfets de droite par des directeurs et des préfets de gauche. »[8]
C’est en définitive du fameux dépérissement de l’État dont il est question. C’est un sujet de discorde entre anarchistes et marxistes depuis au moins 1879. Les libertaires prônent la destruction immédiate de tout appareil étatique lors du processus révolutionnaire, les marxistes considèrent nécessaire de passer par une phase de transition (l’État ouvrier/la dictature du prolétariat) en vue du dépérissement, donc, de l’État.
Mais il y a une palette de réflexions possibles entre ces deux positions.
De ce point de vue, un des débats intéressants est notamment celui impulsé par Nicos Poulantzas. D’autant plus qu’il est posé après l’écrasement de la révolution chilienne le 11 septembre 1973 – et ce qui apparaît comme une impasse de la voie légale au socialisme – et après l’échec de la révolution portugaise de 1974-1975 où les commissions de travailleurs et de quartiers n’ont pas réussi, même avec l’appui des soldats radicalisés, à subvertir et supplanter le processus de rétablissement étatique et bourgeois.
Je m’attacherai rapidement à quelques points de la critique de Poulantzas :
– D’abord la nécessité, dans une perspective de transition socialiste, de « dépasser la stratégie classique du double-pouvoir », de constitution d’un pouvoir autonome remplaçant l’État (stratégie partagée par les libertaires, rappelons au passage que c’est le marin anarchiste Anatoli Jelezniakov qui dispersa l’Assemblée constituante en janvier 1918).
– Poulantzas dénonce « la conception instrumentaliste de l’État, (…) comme bloc monolithique sans fissures (…) et qu’on ne peut attaquer que globalement et frontalement ».
– Pourquoi ? Répondant en 1977 dans Critique communiste à Henri Weber (alors dirigeant de la LCR) il s’exclame :
« Tu ne penses tout de même pas, dans la situation actuelle, qu’ils vont laisser centraliser des pouvoirs parallèles à l’État pour créer un contre-pouvoir ! Les choses seront réglées avant même le début de l’ombre d’un soupçon d’une telle organisation. »
– Mais aussi parce que pour éviter toute instrumentalisation de la démocratie directe de type conseilliste, ou autogestionnaire, il faut absolument garantir des « libertés politiques formelles [qui exigent] le maintien des formes institutionnelles de pouvoir de la démocratie représentative »[9].
Ce que propose alors Poulantzas est assez proche des théorisations du PSU :
« les masses populaires doivent, parallèlement à leur présence éventuelle dans l’espace physique des appareils d’État, maintenir et déployer en permanence des foyers et des réseaux à distance de ces appareils : mouvements de démocratie directe à la base et réseaux autogestionnaires »[10]
Mais cette recherche d’articulation entre État, révolution et autogestion – encore une fois qui n’est pas une recherche en chambre mais rencontre l’action de dizaines de milliers de travailleurs et de travailleuses –, cette recherche va se heurter au désarroi stratégique progressif qu’engendre la stratégie d’Union de la gauche et du Programme commun de gouvernement.
Que ce soit au travers des échecs électoraux successifs de mars 1973, mai 1974 et mars 1978 (même si les deux premières échéances ont pu apparaître comme des « marches » vers le pouvoir, la troisième, après la rupture de l’Union de la gauche l’année précédente, est une véritable douche froide). Ou de sa « victoire » en 1981, alors que les réserves d’énergie et de combativité du cycle ouvert par 1968 se sont effondrées.
L’espace politique de l’autogestion socialiste, un temps ouvert à une échelle de masse, s’est estompé en même temps que sa base sociale s’est affaiblie.
Il reste investi, théoriquement et stratégiquement par des minorités révolutionnaires. Si dans les années 1980 le PSU disparaît et la CFDT abandonne toute référence à l’autogestion et plus encore au socialisme, des militantes et militants, autour de l’Union des travailleurs communistes libertaires (UTCL) ou de la LCR entre autres, continuent de défendre la perspective socialiste autogestionnaire.
Une perspective qui rencontre le réveil des luttes auto-organisées dans la seconde moitié des années 1980 – inauguré par la Marche pour l’égalité de 1983, suivie de la grève étudiante et lycéenne contre la Loi Devaquet en 1986 et des grèves avec coordinations des cheminots, des infirmières ou à Air France dans la foulée.
Cela donnera lieu à des élaborations originales. Celle du « pouvoir fédéral autogéré » du Projet communiste libertaire en 1986 qui cherche à répondre au dilemme de Guérin d’un point de vue libertaire.
Mais aussi celle défendue dans les années 1990 par Daniel Bensaïd et la LCR avec
« la possibilité d’un système à deux chambres, l’une élue directement au suffrage universel, l’autre représentant directement (…) les différentes formes associatives du pouvoir populaire. Cette solution (…) [permettant] de ne pas confondre par décret la réalité de la société et la sphère de l’État, appelé à dépérir au fur et à mesure que s’épanouit, s’étend et se généralise l’autogestion. »[11]
Le référent autogestionnaire sera aussi présent dans la renaissance d’un syndicalisme de lutte et de transformation sociale dans la seconde moitié des années 1990, autour des syndicats SUD ou de la CNT.
Je veux préciser ici, et pour conclure, que le champ des possibles s’ouvre parfois aux idées des minorités politiques, précisément parce qu’elles continuent de penser et d’être actives dans un contexte où elles savent se mouvoir et influer malgré tout. C’est ici que réside l’enjeu de continuer à articuler les moyens et les fins de notre politique, de continuer donc à promouvoir l’auto-organisation.
À ce titre, et même si le mot « autogestion » n’a plus la surface qu’il a pu avoir, l’aspiration qu’il recouvre, celle d’un pouvoir qui n’échappe pas au contrôle populaire, celle d’un socialisme étroitement lié à la démocratie, cette aspiration-là peut et doit rester la nôtre.
Notes
[1] Daniel Guérin, « Proudhon, père de l’autogestion », reproduit dans Proudhon, oui et non, Gallimard, 1978.
[2] PSU, Contrôler aujourd’hui pour décider demain, Téma, 1972.
[3] Repris dans Frédo Krumnow, CFDT au cœur, Syros, 1977
[4] Le PCF n’adoptera le terme d’autogestion (accompagnée du qualificatif de « nationale ») qu’en toute fin de période, entre 1977 et 1979. Le format de cette communication ne permettait pas de détailler cet aspect, mais je renvoie vers le livre de Laurent Lévy, Histoire d’un échec. La stratégie « eurocommuniste » du PCF (1968-1978), à paraître chez Arcane 17, plus particulièrement aux passages sur « Les communistes et l’État », pages 168-176 et « Un tournant autogestionnaire ? », pages 208-212.
[5] Ligue communiste, Autogestion et dictature du prolétariat, brochure « Taupe Rouge », fin 1972
[6] Jeannette Habel, « L’autogestion, école de la démocratie politique », Le Monde du 13 juin 1973.
[7] Victor Fay, « L’unicité du pouvoir des conseils », Critique socialiste n°12, mars 1973.
[8] Charles Piaget, « Le pouvoir peut basculer », interview dans 20 mai du 1er mai 1974
[9] Nicos Poulantzas, « L’État et la transition au socialisme », Critique communiste n°16, juin 1977
[10] Nicos Poulantzas, L’État, le pouvoir, le socialisme, éditions Amsterdam, 2024 [1978]
[11] Daniel Bensaïd, Communisme contre stalinisme, brochure éditée par la LCR, 1997.