
Poulantzas retrouvé
À propos de : Jean-Numa Ducange et Razmig Keucheyan (dir.), La fin de l’État démocratique. Nicos Poulantzas, un marxisme pour le XXIe siècle, Paris, PUF, « Actuel Marx », 2016, 167 p.
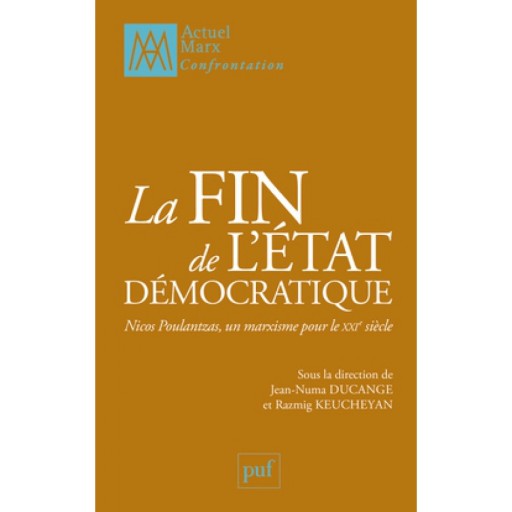
Théoricien marxiste de premier plan, dont l’œuvre relève à la fois de la philosophie et de la sociologie politique, Nicos Poulantzas (1936-1979) est à peu près absent de l’Université française. Bien que son nom soit fréquemment associé à celui d’Althusser, il n’a pas véritablement profité du regain d’intérêt académique et éditorial pour ce dernier, qui était notamment liée au cinquantenaire de Lire le Capital[1] et à la publication de nombreux inédits[2]. La plupart de ses ouvrages n’ont pas connu de nouvelle édition depuis les années 1970, et sont presque introuvables. La réédition de L’État, le pouvoir et le socialisme[3] par Razmig Keucheyan faisait figure d’exception. La publication d’un ouvrage de qualité consacré à Poulantzas, La fin de l’État démocratique. Nicos Poulantzas, un marxisme pour le XXIème siècle[4], sous sa direction et celle de Jean-Numa Ducange, est donc à saluer.
Il s’agit des actes d’un colloque[5] qui s’est tenu en janvier 2015, quelques jours avant les élections générales grecques[6], et la victoire attendue de Syriza et d’Alexis Tsipras, qui furent au centre des discussions. L’unité de la théorie et de la pratique semblait – enfin ! – se concrétiser. La pensée de Poulantzas reste en effet vivante en Grèce, son pays d’origine. Le nom de l’institut de recherche de Syriza – « Institut Poulantzas » – en est un indice. Mais il est également un auteur influent en Amérique latine (l’un des textes du recueil a été écrit par le vice-président bolivien, Alvaro Garcia Linera, théoricien critique de premier plan), en Grande-Bretagne[7] (où la New Left Review de Perry Anderson fit connaître son œuvre), en l’Allemagne, etc. Le livre reflète cette réception bien plus favorable à l’international qu’en France en accordant une part importante – la moitié des textes – à des auteurs étrangers.
Il est composé de trois parties. La première s’intitule « État et stratégie » et regroupe différentes réflexions sur l’État et la transition au socialisme. Garcia Linera utilise Poulantzas comme point de départ de développements plus personnels, liés aux transformations socio-politiques qu’il contribue à mettre en œuvre en Bolivie. Isabelle Garo souligne la nécessité de penser l’économie et la politique dans leur unité dialectique afin d’élaborer une conception adéquate du dépassement du capitalisme, qui serait partiellement négligée par Poulantzas. Alex Demirovic revient sur les fondements théoriques des propositions stratégiques de Poulantzas. Et Stathis Kouvélakis examine la question du fascisme et de l’État d’exception dans l’ensemble de son œuvre. Dans tous ces textes, la question de la voie démocratique au socialisme est centrale.
La deuxième partie « Histoires et communismes » rassemble trois interventions. Serge Wolikow réévalue la lecture critique que Fascisme et dictature fait des analyses du fascisme dans le cadre de la IIIème internationale à l’aune de l’état actuel des recherches historiographiques[8]. Marco Di Maggio replace la pensée de Poulantzas dans le contexte des eurocommunismes français et italien. Ludivine Bantigny expose et analyse les lectures que les théoriciens de la LCR ont fait de Poulantzas (Artous, Bensaïd, Löwy, Vincent, Weber[9]).
Enfin, la troisième partie, « Théories », esquisse des liens entre la pensée de Poulantzas et différentes disciplines. James Martin se penche sur le droit, qui fut la première discipline étudiée par notre théoricien[10] ; Costis Hadjimichalis sur la géographie ; Tristan Auvray et Cédric Durand sur l’économie. Cette dernière intervention fait à nouveau resurgir la question stratégique : les auteurs cherchent à évaluer la pertinence de la conception poulantzassienne du capitalisme et du proto-État européens comme subalternes à l’impérialisme américains, alors qu’Ernest Mandel appréhendait les institutions européennes comme l’instrument utilisé par les capitaux européens « amalgamés », dans le cadre de leur rivalité avec le capitalisme américain.
L’ouvrage porte donc avant tout sur ce que Poulantzas nous apporte pour penser notre situation, et pour y intervenir stratégiquement dans le sens de la démocratie et du socialisme. Le titre choisi en témoigne.
I) Théorie de l’État et question stratégique
Au cours de son évolution théorique et politique, la pensée de Poulantzas est de plus en plus en prise sur la conjoncture. Si on laisse de côté sa thèse, son premier grand livre – Pouvoir politique et classes sociales (1968) – s’inscrivait dans le projet althussérien de science marxiste du « continent Histoire », et voulait le compléter en étudiant la « région politique », et plus spécifiquement l’État, du mode de production capitaliste, et plus spécifiquement de l’État capitaliste[11]. Les enjeux stratégiques n’étaient pas développés explicitement, et la « Théorie » semblait avant tout renforcer une perspective léniniste classique. Mai 1968 et ses suites, le coup d’État des « Colonels » en 1967 puis leur chute en 1973, l’instauration d’un régime démocratique en Espagne, la révolution des oeillets au Portugal[12] ou encore l’expérience chilienne eurent une profonde influence sur sa réflexion. Il s’engage d’ailleurs pour la première fois formellement en politique en 1968, en adhérant au Parti communiste grec dit « de l’intérieur » – né de la scission avec la branche stalinienne – dont la ligne eurocommuniste s’affirmera progressivement[13]. Au début des années 1970, en phase de ce point de vue avec de nombreux althussériens et avec Althusser lui-même, ses textes prennent une tonalité maoïste très marquée. C’est notamment le cas de Fascisme et dictature (1970). L’intérêt pour le maoïsme réside principalement dans l’accent mis sur le niveau idéologique, qui doit être considéré comme un espace à part entière de lutte des classes, à côté des niveaux économique et politique. C’est plus la révolution culturelle qui attire théoriquement Poulantzas que la guerre populaire prolongée. Les Classes sociales dans le capitalisme aujourd’hui (1973) n’est pas non plus le lieu d’une élaboration stratégique en propre. Pourtant, certaines des questions examinées dans ce recueil d’article ont des implications politiques incontestables. En continuité avec le rejet de toute réduction du politique à l’idéologique qui était défendu dans ses précédents ouvrages, il critique sévèrement la théorie du « capitalisme monopolistique d’État » élaborée par le PCF[14]. Cette dernière était liée à une conception de l’État comme instrument neutre, dont la croissance, jusque dans la sphère économique, était appelée par celle des forces productives, et par leur socialisation. Le peuple devait chercher à se réapproprier cet État actuellement aux mains de l’oligarchie monopoliste, plutôt qu’à le transformer qualitativement. Comme dans ses précédents ouvrages, Poulantzas rejette donc l’économisme et le populisme qui sous-tentent le tournant eurocommuniste du PCF et son « programme commun » avec le PS. Cependant, dans le même ouvrage, il offrait une théorie de la « nouvelle petite bourgeoisie » comme classe indépendante irréductible tant à la classe bourgeoise qu’à la classe ouvrière. Du fait de l’importance de cette nouvelle classe, le prolétariat, par le biais du parti qui le représente, doit nécessairement s’y allier. Se dessine ainsi une stratégie eurocommuniste qui passe certes par une alliance avec les classes moyennes, mais très particulière car en rupture avec la stratégie prônée par les instances dirigeantes du PCF.
C’est cette perspective que le dernier ouvrage de Poulantzas, L’État, le pouvoir, le socialisme (1978) va développer et fonder en construisant une théorie novatrice de l’État. Ce dernier est défini comme la « condensation matérielle d’un rapport de force entre les classes et fractions de classe tel qu’il s’exprime, de façon spécifique toujours, au sein de l’État »[15]. L’État n’est ni un instrument, ni un sujet, ni une chose ; c’est un rapport[16] – un ensemble de rapports multiples. Il est l’un des espaces où se déploie la lutte des classes, les luttes et stratégies des différentes classes s’inscrivant en lui. Il est multiple, traversé par des réseaux de pouvoir différents, des influences diverses. Il a une « matérialité institutionnelle complexe » : il est notamment constitué de différents appareils et branches, qui peuvent porter des politiques contradictoires entre elles. Les politiques suivies globalement reflètent donc un certain équilibre entre les classes et fractions de classe. Autrement dit, l’État est un « champ stratégique ». Cela ne signifie cependant pas qu’il soit neutre : il favorise structurellement les intérêts des classes dominantes. Seules les stratégies de ces dernières parviennent à s’inscrire directement en lui, car elles y possèdent des « centres de pouvoir », alors que les classes populaires n’y sont représentées que par des « centres de résistance ». C’est pour cette raison que Poulantzas a pu dire que le rapport de force entre les classes est représenté dans l’État « d’une manière spécifique », et « condensée » : chaque classe produit certes des effets dans l’appareil d’État, mais d’une manière inégale.
L’élaboration de cette problématique relationnelle et stratégique a été interrompue en 1979 par la mort prématurée du philosophe, son dernier grand texte restant une « œuvre de transition »[17]. Malgré cela, il en a tiré certaines des indications concernant la voie à adopter afin faire advenir le socialisme.
II) La voie démocratique au socialisme et ses zones d’ombre
D’après lui, dans la mesure où l’État n’est pas un bloc, on ne peut pas le prendre de l’assaut comme les bolcheviks agirent face à l’État bourgeois russe, afin de le briser et de résoudre la coexistence instable du double pouvoir par le triomphe des soviets et de l’État prolétarien. Et, puisque l’État de notre époque étend ses ramifications dans toute la société, jusque – en partie – dans l’économie[18], il convient d’abandonner toute idée de lutte des classes révolutionnaire située en position d’extériorité radicale à son égard. En toute logique, l’idée de rupture unique, irréversible, analogue à la prise du palais d’Hiver d’octobre 1917, est également à rejeter.
Concevoir l’État comme complexe et intrinsèquement hétérogène ouvre d’autres possibilités : y agir de l’intérieur, s’infiltrer dans ses brèches, jouer de ses contradictions internes, et des tensions entre classes et fractions de classe dominantes. La démocratie représentative et les libertés civiles et politiques sont à prendre éminemment au sérieux, et doivent être défendues et utilisées tant que possible. Elles sont un héritage des conquêtes populaires, et peuvent constituer des points d’appui pour des conquêtes ultérieures. Plus encore : elles devront être conservées sous le socialisme, en combinaison avec des formes de démocratie directe, afin d’éviter les dérives possibles de cette dernière, et notamment son instrumentalisation par un Parti autoritaire.
Poulantzas anticipe certaines critiques prévisibles : non, sa conception n’est pas gradualiste et réformiste. Il ne s’agit pas simplement de gagner les élections et de mettre en œuvre progressivement les transformations requises pour aboutir pacifiquement au socialisme. Le mouvement ouvrier ne doit pas se contenter d’investir l’appareil d’État. Cette lutte politique par en haut, doit s’accompagner d’une lutte par en bas : celle des mouvements sociaux, caractérisés par de multiples formes d’auto-organisation. Ce n’est qu’ainsi que les représentants populaires pourront ne pas se résigner devant leur impuissance à modifier les structures socio-politiques, ou tout simplement se laisser prendre au goût du pouvoir dans ses formes actuelles. Seule la mobilisation à la base peut constituer les impulsions et les leviers nécessaire pour surpasser les obstacles inhérents au champ stratégique piégé et inégal qu’est l’État capitaliste. Dès lors, le processus de longue durée conçu par Poulantzas ne sera pas de tout repos : il consistera en une lutte continuée, faite de multiples ruptures, ponctuée d’accélérations et de tensions. Ce sont ces éléments qui, aux yeux de Poulantzas différencient son « eurocommunisme de gauche », non seulement de la perspective sociale-démocrate classique, mais également de l’« eurocommunisme de droite ». Le premier « donne une grande importance à la démocratie directe et aux conseils ouvriers », « ce qui a toujours été un point capital du débat entre réformistes et révolutionnaires » ; et il « insiste sur le moment de la rupture dans l’État : il ne parle pas d’une transformation graduelle et progressive »[19]. Il reste alors à penser, et à créer, les modalités de l’articulation entre les luttes par en haut et par en bas. Or, même si l’on cherche à s’inscrire dans la continuité de Poulantzas, il faut admettre qu’il n’a fait que nommer ce problème, et qu’il n’y a apporté aucune réponse. Isabelle Garo souligne à juste titre une faiblesse dans la théorisation de notre auteur, qui est liée à son héritage althussérien : une trop grande dissociation entre le niveau politique et le niveau économique. Dès lors, il devient difficile de comprendre une transition qui implique, simultanément à de profonds bouleversements politiques, une réappropriation par les classes dominées de leur activité productive, dans la sphère économique elle-même. L’absence de théorisation des conseils ouvriers ou de l’autogestion par Poulantzas en témoigne.
Sa conception laisse en outre de nombreuses autres questions ouvertes. On peut ainsi s’interroger sur l’organisation politique qui aura l’initiative dans le processus de longue durée qu’il thématise. Le pluralisme de Poulantzas implique d’accepter que différents partis se revendiquent du mouvement ouvrier (communistes, sociaux-démocrates, marxistes révolutionnaires, etc.), et de faire droit à différentes formes d’organisation politiques (partis, syndicats, conseils, collectifs, associations, etc.). Pourtant, la stratégie qu’il prône semble devoir être mise en œuvre par un parti de masse communiste, eurocommuniste plus précisément. Tout le problème est alors de savoir comment faire adopter à un tel parti sa stratégie « de gauche », et le détourner d’une stratégie « de droite » alors même que cette dernière est généralement adoptée par les directions partidaires. Faut-il créer une tendance dans le parti et tâcher de l’emporter en interne ? Faut-il attiser la contestation populaire à la base – parmi les militant-e-s du parti ou les classes populaires en général – dans le but de radicaliser la direction du parti ? Faut-il faire peser sur le PC une menace extérieure, par exemple en participant à l’activité d’une organisation d’extrême-gauche, dont le rôle serait alors conçu « comme un rôle de critique plus que de débordement »[20] ? Poulantzas n’a malheureusement pas thématisé la question de l’organisation, c’est-à-dire la question des conditions organisationnelles à la mise en œuvre de sa stratégie[21]. Notons que les militants anticapitalistes grecs ont dû affronter ces questions lorsqu’il s’est agi d’adopter la ligne juste face à la direction de Syriza, avant même son arrivée au pouvoir. Ils ont également dû se demander si la stratégie de « critique » – consistant à faire changer de ligne le parti de masse – était plus pertinente qu’une stratégie de « débordement » – qui considère que le changement de ligne est impossible, et cherche à proposer une alternative organisationnelle plus radicale (Antarsya). Comme l’expose Ludivine Bantigny, de tels débats avaient déjà lieu entre Poulantzas et les théoriciens de la LCR. Le cas grec, donc, mais aussi celui des mouvements de gauche en Amérique latine ou en Espagne, montrent leur actualité.
On ne peut cependant qu’être frappé par le changement de situation entre janvier 2015 – date du colloque à l’origine du livre – et aujourd’hui, début de 2017. A cette date, de nombreux événements rendaient plausible l’hypothèse stratégique de Poulantzas : Syriza aux portes du pouvoir, Podemos en montée continue dans les sondages, la réélection triomphale de Morales en octobre 2014[22], etc. Aujourd’hui, cette hypothèse semble avoir souffert de nombreuses réfutations, la trajectoire de Tsipras après son arrivée au pouvoir – qu’on la qualifie de défaite, de démission ou de trahison – étant la plus choquante. Bien entendu, toutes les conditions énoncées par Poulantzas pour emprunter la voie démocratique au socialisme n’étaient pas présentes, et des expériences comme celle de la Grèce en 2015 ou de la France en 1981-1983 n’invalident pas nécessairement ses théories. En effet, dans ces deux cas la victoire électorale n’a pas été accompagnée et suivie de mouvements sociaux massifs, qui avaient au contraire connu leur apogée quelques années plus tôt. On peut donc envisager, conformément au cadre analytique de Poulantzas, que la désynchronisation entre les mobilisations populaires et le cycle électoral, entre la lutte par en bas et la lutte par en haut, constitue le principal facteur explicatif de ces défaites. Mais alors, l’impératif de penser leur articulation n’en est que plus pressant.
Quoi qu’il en soit, la situation française actuelle semble très défavorable à une mise en œuvre des propositions stratégiques de Poulantzas. Comme Di Maggio et Bantigny le soulignent, ces propositions ont été élaborées à une époque très particulière. Que ce soit en France ou en Italie, les luttes sociales étaient massives et intenses et le taux de syndicalisation était très élevé. Les résultats électoraux des PC étaient impressionnants : le PCI a connu son apogée électorale aux élections générales de 1976 et de 1979 (plus de 34 %) ; le PCF, allié au PS, semblait aux portes du pouvoir avant les élections législatives de 1978. Il est bien évident que le paysage politique actuel manifeste des caractéristiques opposées : en particulier, rien de comparable à un puissant parti euro-communiste, parti de masse ancré avec une base sociale mobilisée, n’existe dans ces deux pays. La social-démocratie classique elle-même semble avoir achevé sa mutation néo-libérale. Cette différence de contexte est sans doute l’une des raisons de l’oubli dans lequel Poulantzas est tombé dans notre pays.
Que l’on cherche à rendre possible et à faire triompher une stratégie « eurocommuniste de gauche » (ou ce que l’on pourrait considérer comme son équivalent aujourd’hui) ou que l’on s’efforce à l’inverse de développer une stratégie alternative, il est donc indispensable de se pencher sur les zones d’ombre laissées par Poulantzas, la question de l’organisation, en premier lieu. Et, plus spécifiquement, en se demandant quel type d’organisation aurait la « force expansive »[23] capable de massifier, d’intensifier et de coordonner les luttes populaires. Quelle organisation permettrait de reconstituer une conscience et une identité de classe, en rupture avec la société capitaliste ? Sur ce point les textes de Poulantzas ne nous apportent que peu de choses : s’ils mentionnent fréquemment les « masses populaires » ou le prolétariat, ils ne les prennent jamais directement pour objet d’étude.
III) L’actualité de l’étatisme autoritaire
Il reste à examiner la thèse qui donne son titre du livre, La fin de l’État démocratique, qui fait incontestablement écho à des enjeux immédiats. D’après Poulantzas, les sociétés contemporaines sont animées, du fait de la crise du capitalisme qui s’est manifestée intensément dans les années 1970, par une tendance à l’« étatisme autoritaire ». Il ne s’agit pas de dire que les sociétés capitalistes avancées sont en voie de « fascisation » : Poulantzas distingue soigneusement l’étatisme autoritaire des régimes d’exception. En effet, il n’implique pas une suppression des libertés formelles. Les libertés formelles, civiles et politiques, les élections et la démocratie représentative ne disparaîtront pas. Cependant, elles sont toujours plus vidées de leur contenu. Le parlement et les partis politiques ne sont plus le lieu central de négociation et de coordination des différentes fractions des classes dominantes. C’est une autre branche de l’appareil d’État, la haute administration, qui le devient. Elle est le centre de gravité de l’État, et détermine la ligne directrice de ses actions. Comme le dit Kouvélakis (p. 82) le « jeu partisan est dépourvu de véritable enjeu car de plus en plus soumis au « foyer informel de parti unique »[24] qui s’est constitué au sommet de l’État ». Les lois votées par les représentants élus deviennent relativement secondaires, et ce sont les décrets gouvernementaux, les circulaires et procédures administratives et, aujourd’hui d’autant plus, les réglementations européennes, qui sont dotés d’une véritable efficace.
Cette nouvelle logique d’exercice du pouvoir a pour corrélat une multiplicité de « mécanismes disciplinaires ». L’État capitaliste reste formellement un « État de droit »[25], mais il viole de plus en plus fréquemment ses propres principes, sans que des organismes d’auto-contrôle aient le pouvoir nécessaire pour le limiter. Ainsi, toujours d’après Kouvélakis,
« l’État parvient à se cuirasser de la pression populaire, au prix, certes, d’un nouveau type de dysfonctionnement et de contradictions internes. Ainsi, sans être une forme d’État d’exception, ni une transition irréversible vers celle-ci, l’étatisme autoritaire n’en atteste pas moins des « tendances totalitaires » présentes dans « toute forme démocratique d’État capitaliste »[26] ».
Depuis les années 1970, la situation a certes changé d’un point de vue économique : la crise du keynésianisme a impliqué une profonde refonte des appareils économiques d’État, et un recul de l’intervention directe de ceux-ci dans l’économie (dérégulation, privatisation, financiarisation, etc.). Mais la crise, si elle a pris de nouvelles formes et a connu des moments de stabilisation et d’autres d’intensification, n’a pas disparu. Et notre conjoncture semble plus que jamais caractérisée par l’étatisme autoritaire : l’état d’urgence perpétuellement prolongé en est l’indice ; et la « construction » européenne, loin de les contrecarrer, ne fait que développer ces tendances à un autre niveau, supra-étatique, en renforçant encore l’autonomie de la haute administration à l’égard des représentations nationales[27].
Conclusion
Au terme de la lecture de La fin de l’État démocratique, une conclusion s’impose : l’œuvre de Poulantzas, en particulier ses derniers travaux, présentent des réflexions indispensables pour penser et cartographier notre situation socio-politique. Elle nous offre des intuitions précieuses sur la nature de l’État capitaliste et sur ses transformations récentes, ainsi que les linéaments d’une théorie relationnelle apte à favoriser de nouvelles recherches. Mais si Poulantzas nous permet de penser l’ennemi, de théoriser ses contradictions et ses faiblesses, son œuvre nous apprend peu sur notre propre camp. Il faut donc prendre la juste mesure de ses propositions stratégiques. Leur statut reste hypothétique – elles demandent à être évaluées en étant mises en œuvre pratiquement – et problématique – elles posent plus de questions qu’elles n’en résolvent.
Notes
[1] Deux colloques ont été organisés à Paris pour cette date, dont « Althusser 1965 : la découverte du continent histoire », qui donnera bientôt lieu à une publication aux Éditions sociales.
[2] En particulier dans la collection « Perspectives critiques » aux PUF : Initiation à la philosophie pour non philosophes, Paris, PUF, 2014 ; Être marxiste en philosophie, Paris, PUF, 2015 ; Les vaches noires. Interview imaginaire, Paris, PUF, 2016.
[3] Paris, Les Prairies ordinaires, 2013.
[4] La fin de l’État démocratique. Nicos Poulantzas, un marxisme pour le XXIème siècle, Paris, PUF, 2016, 167 pages.
[5] « Nicos Poulantzas, un marxisme pour le XXIème siècle », à la Sorbonne les 16 et 17 janvier 2015.
[6] Le 25 janvier exactement.
[7] Son entreprise de théorisation marxiste de l’État y notamment a été poursuivie avec brio par Bob Jessop.
[8] Dans Fascisme et dictature. La troisième internationale face au fascisme, Paris, Maspéro, 1970.
[9] Voir à ce propos l’entretien entre Poulantzas et Henri Weber, « L’État et la transition au socialisme », paru en 1977 dans la revue théorique de la LCR, Critique communiste.
[10] Il fit une thèse en philosophie du droit : Nature des choses et droit, essai sur la dialectique du fait et de la valeur, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1964. Ce premier ouvrage était fortement influencé par les pensées de Sartre et de Godmann.
[11] Dans cette épistémologie althussérienne, Le Capital ne donnait pas une théorie générale de la société capitaliste mais uniquement de la région « économie ». Le projet de Poulantzas était donc de la compléter, en prenant en compte l’autonomie relative de la politique.
[12] Poulantzas a consacré une étude spécifique à ces trois derniers événements : La crise des dictatures. Portugal, Grèce, Espagne, Paris, Maspéro, 1975.
[13] Ce parti est d’ailleurs l’ancêtre de l’une des organisations qui fusionna dans Syriza.
[14] Notamment par Paul Boccara.
[15] L’État, le pouvoir, le socialisme, op.cit., p. 191.
[16] L’analogie avec le capital est évidente. Pour Marx il ne faut pas succomber au fétichisme du capital en le considérant comme une chose (qui serait en elle-même productive), mais plutôt le saisir scientifiquement comme un rapport (d’exploitation). De même, pour Poulantzas, l’État n’est pas une entité possédant d’elle-même un pouvoir, mais la cristallisation du pouvoir de classe.
[17] Bob Jessop, Nicos Poulantzas. Marxist Theory and Political Strategy, Londres, Macmillan, 1985, p. 6.
[18] Poulantzas forge dans L’État, le pouvoir et le socialisme le concept d’appareils économiques d’État, partie intégrante de ce dernier à côté des appareils politique et idéologique.
[19] « Vers un eurocommunisme problématique », in Poulantzas, Repères, Paris, Maspéro, 1980, p. 17. Ce texte est entretien donné en 1979 par Poulantzas à Stuart Hall et Alan Hunt, pour la revue Marxism Today.
[20] Dans l’entretien avec Weber, Poulantzas considère par exemple que si « l’extrême gauche est absolument essentielle », c’est notamment « comme rappel actif, et à tout moment, de la nécessité de la démocratie directe à la base, bref comme garde-fou, disons, des tentations autoritaristes éventuelles de la gauche gouvernementale. Rôle, si tu veux, plus de critique que de débordement ».
[21] Notons qu’il ne l’avait pas plus effet dans ses périodes léninistes et maoïsante.
[22] Il fut réélu au premier tour, avec 57, 5 % des voix, contre 23 % à son premier adversaire.
[23] Pour reprendre une expression de Gramsci.
[24] L’État, le pouvoir, le socialisme, op.cit., p. 82.
[25] Voire à ce propos le texte de James Martin.
[26] Idem., p. 232.
[27] Durand et Keucheyan forgent le concept, d’inspiration gramscienne, de « césarisme bureaucratique », pour appréhender ce phénomène. Voir https://www.monde-diplomatique.fr/2012/11/DURAND/48383.





![Marx face au problème de l’État [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Marx-graffiti-150x150.jpg)



