
À lire un extrait de Pourquoi ont-ils tué Lip ?, de G. Gourgues et C. Neuschwander
Guillaume Gourgues et Claude Neuschwander, Pourquoi ont-ils tué Lip ? De la victoire ouvrière au tournant néolibéral, Paris, Éditions Raisons d’Agir, 2018, 20€.
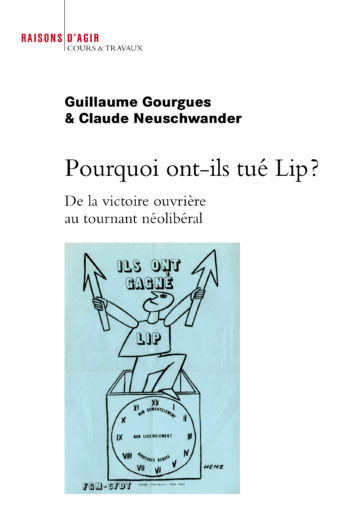
Le nom de Lip reste, dans la mémoire collective, le nom d’un conflit social inoubliable, marqué par l’imagination et l’audace des ouvriers et des ouvrières de l’usine horlogère de Palente, à Besançon, au cœur de l’été 1973. Pour s’opposer au démantèlement de leur entreprise et contester les licenciements qu’on leur promet, ils occupent leur usine, confisquent un important stock de montres, redémarrent partiellement la production et organisent des « payes ouvrières ». Leur slogan « on fabrique, on vend, on se paie » fait rapidement le tour du monde et la popularité de leur lutte est immense. La victoire est même au rendez-vous : en mars 1974, l’entreprise est redémarrée, conformément aux plans établis par la section syndicale CFDT de l’usine, par un pool d’actionnaires franco-suisse emmené par Antoine Riboud, alors patron de BSN et figure de l’aille « sociale » du patronat. Un an plus tard, les ouvriers restants sont tous réembauchés. Pourtant, après seulement 24 mois de fonctionnement, Lip est de nouveau liquidé en avril 1976. La lutte reprend mais aucune solution n’est trouvée, et les « Lips » choisissent la voie coopérative en 1978. Dans « Pourquoi ont-ils tué Lip ? », Guillaume Gourgues, politiste, et Claude Neuschwander, patron de l’éphémère relance de Lip, tentent de décrypter, 40 ans après les faits, les raisons à la fois politiques et économiques de cette seconde liquidation. Ils proposent, via un travail de recherche et d’écriture conjoint, d’expliquer pourquoi la relance de l’usine de Palente a été délibérément abandonnée par ceux qui l’avaient rendu possible. Ce qui se joue dans la seconde mort de Lip, en 1976, est bien un alignement du patronat et de l’État français autour de l’idée qu’il est désormais impossible, pour les salariés et les syndicats, de contester le bien-fondé économique des licenciements, ce que les auteurs qualifient de tournant néolibéral.
***
Dans ce premier extrait (p. 223-226), Claude Neuschwander, le narrateur, vit un moment important du revirement des actionnaires : le conseil d’administration du 16 janvier 1976 de la Société européenne d’horlogerie et de mécanique (SEHEM), holding de tutelle de la Compagnie européenne d’horlogerie (CEH), nouveau nom de la société Lip. Durant ce conseil, les actionnaires refusent, comme un mois auparavant, de réinjecter de l’argent dans la société, malgré les nouveaux plans établis par la direction et la conduite d’une mission externe sur l’état de l’entreprise, confiée à Jacques Bojin. Toutes les citations entre parenthèse proviennent du procès-verbal de ce conseil d’administration.
Le blocage est total. J’indique que la direction « n’a manifesté aucune mauvaise volonté à l’égard de la mission ». Antoine Riboud répond immédiatement qu’il a dû insister pour que « la moitié seulement des membres de la mission aient pu avoir accès sur place aux services comptables ». Je rétorque que mon « opposition était justifiée par le “risque social” que comportait, à [m]es yeux, le déplacement de la mission ».
Je comprends alors que le patron de BSN me lâche. Il indique au conseil comment, « à sa surprise, la direction a, dès le début de la mission, pris seule l’initiative de proposer un nouveau plan basé sur un chiffre d’affaires de 101 millions », avec un résultat bénéficiaire et des besoins de financement bien moindres que ce que présentait le plan du 12 décembre. Il n’était pas non plus au courant, affirme-t-il sans rire, qu’une « hypothèse plus basse et plus fiable » de 90 MF était étudiée « sans concertation avec la mission », ni qu’« un nouveau plan d’action supplémentaire a[vait] été établi par la direction la veille au soir », qui résorbe les pertes à 4,3 MF. Je suis présenté, en somme, comme un électron libre, hors de contrôle.
Le revirement qui s’opère sous mes yeux suit une logique simple, largement développée par la mission dans son rapport : le problème de la CEH tient essentiellement à sa direction. Toute la dernière partie dudit rapport est d’ailleurs consacrée à un démolissage en règle des principaux directeurs, sur la base de jugements de valeur douteux, ou pour le moins discutables (…) J’échappe miraculeusement à cette entreprise de décrédibilisation, mais je comprends que la discussion se déplace : au lieu de parler de la santé de l’entreprise et de son avenir, on cherche à distribuer les mauvais points et à désigner les coupables. J’aurais pu rappeler qu’un des directeurs incriminés (Alain Tyrode) avait été débauché d’Ébauches SA et qu’un rapport de juillet 1975 louait son mérite, mais à quoi bon ?
Les Suisses tranchent, en renvoyant tout le monde dos à dos. Peter Renggli indique que « les conclusions de la mission ne font que résumer des généralités que le conseil était en mesure d’établir lui-même à l’issue de sa séance de décembre 1975 ». Jacques Bojin fait le dos rond et « reconnaît les insuffisances du travail de la mission », qu’il explique « par le manque de temps et la faible fiabilité des outils de gestion et des documents disponibles ». Je prends ma part de responsabilité, sans endosser tout ce qu’on me reproche :
« M. Neuschwander souligne à nouveau que ce budget a été arrêté très récemment avec l’appui de M. Godard, mais ce dernier admet qu’il s’agit là d’un travail rapide et global, sans base de détail et dont il ne peut se porter garant. À son avis, il s’agit plus d’un plan que d’un budget. »
Mais le conseil refuse de se prononcer sur mon budget. Peter Renggli, toujours lui, demande à ce que la mission et la direction présente un « document complet et clair » de comptes d’exploitation prévisionnel sur la base de deux hypothèses de vente : 90 et 80 MF et ce « compte tenu du cadre financier de l’entreprise », ce qui est faisable en huit jours, comme le confirme immédiatement Jean-Michel Reffet.
Cette reculade est une catastrophe. J’ai pu constater que la précédente séance du CA et les rumeurs qui l’ont entourée avaient eu un impact direct sur les ventes. J’explique, le plus calmement possible, que le report du vote du budget 1976 me fait craindre de mauvaises réactions des fournisseurs, du personnel, des banquiers et des clients « connaissant la réunion d’aujourd’hui et attendant avec impatience les décisions du conseil ». Le CA ne bouge pas et m’invite dans la foulée à ne pas « différer certaines mesures à prendre d’urgence ». On me demande à présent de tailler immédiatement dans la masse salariale en procédant à « la suppression du personnel intérimaire et [aux] négociations sociales pour la suppression des heures supplémentaires, la réduction des horaires et la mise à la retraite anticipée de certains salariés ».
Je ne sais que penser, la situation s’embrouille et je demande une suspension de séance « pour réfléchir aux conséquences de cette décision du conseil ». Il est 15 heures. Mais juste avant de suspendre la séance, les actionnaires suisses clarifient leur lecture de la situation :
« À ce sujet, M. Renggli rappelle l’état d’esprit avec lequel Ébauches SA a apporté sa collaboration à la relance de Lip : en donnant son appui financier et technique à cette relance, Ébauches SA avait stipulé que la responsabilité de l’opération incombait aux partenaires français. Le groupe suisse était persuadé que l’entreprise Lip était viable. Mais, en présence de la situation actuelle qui peut évoluer vers un véritable échec, l’opinion publique suisse considérera que cet échec est celui de l’ensemble des parties prenantes françaises – du “management”, des syndicats, des actionnaires et même du gouvernement. Il conclut donc à la nécessité d’affronter avec détermination des négociations sociales difficiles pour réduire l’emploi et ainsi mettre fin à la détérioration de la situation de l’entreprise. À défaut d’agir ainsi, l’entreprise va à un échec et celui-ci aura une ampleur considérable. »
Nous y voilà. Les Suisses tiennent leur revanche. Deux ans à peine après la relance, ils réitèrent l’impérieuse nécessité de licencier, et de faire de Lip un établissage qui ne doit vivre qu’à partir des perspectives modestes qui lui octroient ses actionnaires. L’incurie française, déjà en cause de 1973, redevient la rhétorique de nos « partenaires ».
La pause est salutaire.
***
Dans ce second extrait (p. 313-315), Guillaume Gourgues livre sa lecture de ce que la reprise puis l’abandon de Lip, entre 1974 et 1976, permet de comprendre de l’ordre économique actuel, et explicite ainsi l’objectif majeur de l’ouvrage.
En 1973, le refus catégorique des licenciements, au nom de la viabilité structurelle de l’outil de travail, est un motif central de la lutte des travailleurs de Lip. Le combat qu’ils engagent appartient à une série de « réactions violentes contre des licenciements liés soit à des erreurs de gestion, soit à l’intervention de firmes étrangères, soit à la mise en place brutale de nouvelles politiques industrielles[1] ». Mais entendons-nous bien : le combat des Lips n’a pas été de refuser les licenciements « en général » mais de défendre la possibilité, pour les travailleurs, d’en contester le bien-fondé économique. Le monde dans lequel évolue Lip, entre 1945 et 1973, n’est pas un monde sans chômage : des entreprises font faillite, des emplois disparaissent et les licenciements sont déjà utilisés, partiellement, comme levier de gestion des entreprises. Depuis les années 1960, les licenciements économiques commencent d’ailleurs à se systématiser — nous y reviendrons. Dans ce contexte, ce que refusent les travailleurs de Lip, c’est qu’on leur présente ces solutions comme strictement inévitables, comme inscrites dans des règles économiques transcendantales. Rappelons ce qui a mis le feu aux poudres, le 12 juin 1973 : la découverte inopinée d’un plan de licenciements acté par les actionnaires, avant même l’ouverture des négociations. Les travailleurs refusent de se voir imposer des manœuvres sans avoir pu se défendre, sans avoir pu opposer leurs arguments aux diagnostics unilatéraux des actionnaires ; arguments qu’ils ne manqueront d’ailleurs pas de faire connaître.
Quarante ans après, le comportement de ces ouvriers et de leurs représentants syndicaux, refusant d’admettre la fatalité de leur licenciement et dénonçant leur prétendue nécessité, semble pour le moins radical, tant la « naturalisation » actuelle des licenciements économiques, devenus une sorte de loi incompressible de l’activité économique, a établi une frontière hermétique entre leur dimension sociale (gérer et atténuer les conséquences) et leur dimension économique (empêcher leur utilisation ou chercher à les éviter).
Nous ne vivons pas dans un monde sans protection individuelle contre le chômage. Mais les licenciements collectifs pour raisons économiques, même s’ils sont soumis à l’examen préalable des salariés et à l’opposition des syndicats qui peuvent mobiliser des recours juridiques[2], ne sont plus présentés comme des problèmes publics exigeant une action réglementaire et coercitive. Quand bien même ils sont liés à des erreurs de gestion ou interviennent dans des entreprises rentables, ils sont considérés une fatalité face à laquelle les victimes doivent être accompagnées et soutenues. C’est notamment l’orientation adoptée par l’action des pouvoirs publics qui « se traduit non [pas] par un interventionnisme d’État dans les affaires privées », mais bien par « de nouvelles mesures protectrices des salariés, inscrites dans des plans sociaux de plus en plus exigeants (périodes longues de formation, aide obligatoire à la réorientation professionnelle, versement prolongé du salaire, etc.)[3] ». Des hauts fourneaux de l’usine d’Arcelor-Mittal de Florange au parking de l’usine Whirlpool d’Amiens, le discours public entonne désormais une litanie bien connue : les licenciements doivent être évités le plus possible (et jamais empêchés), et l’État s’emploiera à convaincre un nouvel investisseur de maintenir autant d’emplois qu’il le pourra, tout en « accompagnant » celles et ceux qui ne pourront être repris.
Nous vivons une époque où l’idée même d’interdire les licenciements collectifs est considérée comme une proposition participant d’un « programme […] assez largement irréel[4] », incarnant la dérive d’une extrême gauche en voie de radicalisation, où des entreprises rentables sont parfaitement autorisées à licencier et où des économistes s’attristent, du haut de leurs modèles théoriques, de savoir qu’il existe encore tant d’entraves aux licenciements souhaités par les firmes pour améliorer leur compétitivité[5]. Les récentes réformes du droit du travail, notamment en France, accompagnent cette tendance : elles participent à une « managérialisation » du droit du travail, en permettant aux employeurs d’intégrer dans leurs calculs économiques le non-respect de la loi (notamment en matière de licenciements) et en appuyant la technicisation du travail syndical, désormais pensé comme un relais des directions et des DRH[6]. Les licenciements économiques sont, en quelque sorte, naturalisés : même si on regrette leur existence, ils sont inévitables, rien ni personne ne peut réellement les entraver, car ils incarnent la force de « destruction créatrice » du marché (les licenciements d’aujourd’hui feront les emplois de demain) et sont devenus des impératifs de compétitivité. Cette « naturalisation » des licenciements alimente un climat social dans lequel « les salariés peuvent avoir un contrat à durée indéterminée et vivre sous la menace d’un licenciement[7] ». Cette conviction, qui s’ajoute à la déstructuration des formes d’emploi[8] et à la présentation de l’entreprenariat individuel comme une inévitable solution face au chômage de masse[9], constitue un des faits incontournables de l’ordre économique actuel.
Ce qui se joue dans la reprise de Lip, c’est donc la consolidation d’une part de l’ordre économique : celle qui consiste à rendre quasi impossible une mise en débat des justifications proprement économiques des licenciements et à envisager sérieusement leur évitement. Lip représente, sous cet angle, ce qui est devenu impossible et impensable dans l’ordre économique actuel. Il nous faut donc remettre des mots sur ce « possible » perdu.
Notes
[1] Gérard Adam, Jean-Daniel Reynaud, Conflits du travail et changement social, Paris, Presses universitaires de France, 1978., p. 305-306.
[2] Voir Claude Didry, « Les comités d’entreprise face aux licenciements collectifs : trois registres d’argumentation », Revue française de sociologie, 39 (3), 1998, p. 495-534 ; Anne Bory et Sophie Pochic, « Contester et résister aux restructurations », Travail et Emploi, 137, 2014 [consultable en ligne].
[3] Sylvie Malsan, « Licenciements collectifs : le prix d’une dette symbolique », Revue du MAUSS, 29, 2007, p. 182.
[4] Philippe Raynaud, « 2002-2007 : déclin de la gauche radicale ? », Le Débat, 4 (146), 2007, p. 89.
[5] Voir Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo, « Que peut-on attendre de l’interdiction de licencier pour améliorer la compétitivité des entreprises ? », Revue économique, 58 (6), 2007, p. 1221-1245.
[6] Voir Guillaume Gourgues, Karel Yon, « Démocratie, le fond et la forme : une lecture “politique” des ordonnances Macron », Revue de droit du travail, 10, 2017, p. 625-632.
[7] Serge Paugam, « L’insécurité grandissante de l’emploi », in Serge Paugam, Le Salarié de la précarité, Paris, Presses universitaires de France, 2007, p. 84.
[8] Voir Robert Castel, La Montée des incertitudes : travail, protections, statut de l’individu, Paris, Seuil, 2009.
[9] Voir Sarah Abdelnour, Moi, petite entreprise. Les autoentrepreneurs, de l’utopie à la réalité, Paris, Presses universitaires de France, 2017.







