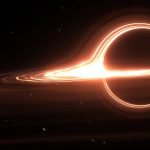Fatigue du capitalisme et résistances sociales
La crise qui a éclaté en 2007-2008 est l’élément central de la conjoncture actuelle[1]. La première étape en a été le krach financier et la crise bancaire.
La seconde fut la plus grave récession qu’ait connue le monde depuis les années 1930 ; elle a enclenché une hausse brutale du chômage ainsi que, dans de nombreux pays, une baisse des salaires réels. Nous sommes actuellement dans la troisième phase, centrée sur le financement de la dette publique. Celle-ci met à rude épreuve le carcan néolibéral de la zone euro. Il n’y a aucune perspective de reprise durable à l’horizon : les capacités de production excédentaires persistent dans les entreprises ; la demande agrégée reste étroitement dépendante des budgets publics ; le système financier n’a rebondi en 2009 que grâce aux politiques extrêmement accommodantes des autorités monétaires. Mais ce dernier menace de nouveau de s’affaisser, alors que la généralisation des politiques d’austérité en Europe contribue un peu plus à nous installer dans « la troisième dépression »[2] de l’histoire du capitalisme.
La période qui s’ouvre est celle des ajustements politiques et institutionnels. Elle est marquée par une grande indétermination, son issue dépendra des batailles sociales, idéologiques, politiques et géopolitiques qui s’engagent. Cette étape va conduire à la cristallisation de nouveaux rapports de force qui, pour certains, s’esquissent déjà, tandis que d’autres vont apparaître de manière retardée.
Sur le plan politique international, la constitution du G20 reflète ainsi l’accélération de la redéfinition des équilibres mondiaux, refermant une longue parenthèse de domination sans partage des puissances occidentales qui aura duré deux siècles. L’Union européenne, qui sert pour l’instant de paravent aux fragilités économiques étasuniennes, n’en sortira pas indemne. Les discussions sur de nouveaux modes de gouvernance de la zone euro battent leur plein, mais elles sont minées par des oppositions idéologiques et des intérêts nationaux rivaux. L’incapacité des gouvernements à opter pour des politiques coopératives, permettant de faire converger les performances économiques entre les pays de la zone, conduit à moyen terme à une probable dislocation partielle de l’Union monétaire.
La place de la finance devrait aussi être amenée à changer. Pour l’heure, domine l’intolérable impudence des grandes institutions financières, qui ont très vite retrouvé voire surpassé leurs profits exorbitants d’avant crise. Non seulement elles n’ont jamais cessé leurs activités spéculatives, mais elles ont utilisé à cette fin les dispositifs de soutien mis en place par les Etats, mordant la main qui les nourrit lors des attaques contre les dettes publiques. Pourtant des indices de changement de régime sont là. D’abord, les marchés de crédits titrisés, emblématiques de la bulle, ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes[3]. Certains segments ont quasiment disparu tel celui des CDOs (collaterized debt obligations), sorte de mille-feuilles financiers de titres sans aucun rapport entre eux : il ne pèse plus en 2009 que 4 milliards de dollars, contre 520 milliards en 2006. Plus généralement, les crédits titrisés n’existent que grâce aux Banques centrales : en Europe, seulement 5 % des montants écoulés le sont auprès d’acquéreurs privés (contre 95 % avant 2007), le reste étant acquis par la BCE ! Dès lors le dilemme pour les gouvernants est le suivant : soit assumer que les institutions publiques se substituent indéfiniment au marché des produits titrisés, afin d’assumer de manière continue le risque lié au crédit bancaire privé ; soit risquer d’enclencher une nouvelle phase récessive en déclenchant une nouvelle vague de rationnement et de renchérissement du crédit.
Par ailleurs, les pressions sur la finance s’accentuent, bien qu’elles tardent à se concrétiser tant sont puissants les intérêts qui s’y opposent. Pour la première fois depuis trois décennies, la taxation (des banques et des transactions) et la ré-réglementation sont inscrites à l’agenda politique et l’on ne peut exclure que les débats ne finissent par déboucher sur des mesures qui soient plus que symboliques. En revanche, après avoir fait une fulgurante apparition au plus fort de la tempête financière, la question de la nationalisation/socialisation intégrale du secteur bancaire a une nouvelle fois disparu du débat public. A coup sûr, cette option – qui est la seule cohérente compte tenu du caractère de bien public de l’activité de crédit et ce par le biais d’incitation découlant du too big too fail (« trop gros pour être mis en faillite ») – reviendra avec plus de vigueur lors de la prochaine tempête financière. Elle établit d’ores et déjà une claire ligne de démarcation à gauche, selon qu’on s’affirme, ou non, prêt à s’affronter aux intérêts capitalistes financiers.
Enfin, les politiques de rigueur en matière budgétaire et de protection sociale décidées en Europe vont affecter durablement les populations des pays concernés, à la fois directement – du fait des coupes claires décidées dans les dépenses publiques – et indirectement en raison de leur effet récessif sur l’activité économique. Ces mesures vont se traduire par une intensification des conflits sociaux, et leur synchronisation au niveau européen renforce la possibilité de crises politiques majeures. Cette éventualité s’inscrit dans un contexte de dégradation de la situation sociale, en raison notamment d’une forte augmentation du chômage, les entreprises ayant profité de la crise pour accroître leur productivité et intensifier leur recours à la sous-traitance internationale.
Construire une intervention politique efficace dans un tel contexte n’a rien d’aisé. D’abord, les forces anticapitalistes doivent trouver les moyens de peser sur ces batailles dont les conséquences sur les rapports de force entre les classes vont être considérables et durables. Mais il importe de le faire en articulant des positionnements immédiats et une vision globale du système, c’est-à-dire un diagnostic de l’état de ses contradictions et des éléments qui structurent les rapports de forces entre les classes. Ce sont ces deux derniers aspects que le présent texte vise à discuter en tant qu’ils constituent une conjoncture socioéconomique.
I – Un système à bout de souffle
La grande crise que traverse le capitalisme mondial n’est pas un orage dans un ciel d’azur. Elle est la manifestation de l’intensification depuis les années 1970 des contradictions du capitalisme. L’intégration aux circuits mondialisés du capital des pays d’Europe centrale et orientale et des grands pays asiatiques (Chine et Inde), d’une part, et, d’autre part, l’essor des technologies de l’information et des communications et des biotechnologies, ont offert de nouvelles possibilités à l’accumulation du capital. Pourtant, décennie après décennie, le rythme de la croissance s’est ralenti dans les pays du centre – et aussi, mais dans une moindre mesure grâce au dynamisme du rattrapage chinois, au niveau mondial.
Le rôle de la finance
Face aux difficultés de l’accumulation, la finance a joué un rôle de dérivatif. La libéralisation a conduit à la constitution de marchés financiers permanents et complètement mondialisés. C’est une arme majeure au service du capital qui permet une mise en concurrence des travailleurs et, plus largement, des systèmes socioproductifs en temps réel et à l’échelle mondiale. C’est aussi un des vecteurs essentiels de l’accroissement inouï des inégalités et d’une relocalisation d’une part importante de la classe capitaliste dans la finance au détriment de la production. Foster et Holleman[4], analysant le pouvoir de l’élite financière, montrent qu’aux Etats-Unis la part des profits financiers dans les profits totaux a explosé. De plus, la finance est devenue la principale source de richesse pour 27 % des plus grandes fortunes en 2007, contre 9 % en 1982 ; dans le même temps, les rémunérations des dirigeants des firmes financières se sont envolées par rapport à celles des autres secteurs.
Mais l’accumulation financière a un caractère très largement fictif, au sens où la valeur adossée aux titres financiers correspond à des reconnaissances de dettes qui ne pourront jamais être honorées[5]. C’est ce que révèle la déconnexion entre le rythme auquel la sphère financière a crû dans la période récente et celui auquel a progressé la production de richesses. Et là encore les salariés sont très durement affectés. L’effondrement de la valeur des fonds de pensions pendant la crise et l’annonce – par exemple en Irlande et dans divers Etats des Etats-Unis – de la réduction des montants des retraites qui en découle sont un avant-goût du douloureux effet de rappel de la production vis-à-vis de la finance.
La restauration des profits
En dépit d’une tendance de fond à l’essoufflement, plusieurs raisons permettent d’expliquer que la rentabilité des firmes des pays riches s? soit rétablie par rapport à la crise de profitabilité des années 1970, puis stabilisée à un niveau élevé. La détérioration de la position de la majorité des salariés – sur laquelle on va revenir – a eu pour conséquence une modération salariale et, dans un certain nombre de pays, tel l’Allemagne après la réunification, la complète atonie des salaires. L’emballement financier des dernières décennies a parfois été une source de revenus directs pour les firmes. La dimension productive de la mondialisation a permis aux firmes transnationales de concentrer les profits réalisés, tout au long des chaînes de valeur, du fait de l’activité de leurs filiales et de leurs sous-traitants. Enfin, le capital dans son ensemble a bénéficié d’une forme contemporaine d’accumulation primitive, appelée par David Harvey « l’accumulation par dépossession »[6], qui lui permet de valoriser des actifs obtenus à vil prix : il s’agit notamment de l’accès à de nouveaux marchés, de nouvelles réserves de main-d’œuvre et de matières premières ; mais aussi une nouvelle logique de l’Etat prédateur qui par son intervention subventionne de multiples manières le capital : diminution de la fiscalité sur les entreprises et les riches, accès aux paradis fiscaux, sauvetages financiers, aides multiples (comme en France le « crédit impôt recherche »), privatisations, libéralisation du marché du travail, érosion des prestations sociales …
Les entraves à l’accumulation
Si ces différents facteurs ont soutenu la rentabilité des firmes, cette dernière ne reflète pas une dynamique interne du système. Une situation de suraccumulation latente à l’échelle mondiale depuis la fin des années 1960 et l’intensification de la concurrence qui en découle n’ont fait que s’aggraver et constituent les tendances de fond à l’arrière plan de la crise actuelle. Il faut ajouter que, dans certains domaines liés à l’économie de la connaissance, la contradiction entre rapports de production et forces productives est criante : les barrières mises à la circulation des biens immatériels (brevets, lutte contre le piratage…) sont des facteurs qui entravent la circulation de l’information et donc constituent des freins à la création et à l’innovation 6. Enfin, la question de l’augmentation des coûts constitue un frein au dynamisme du système : on pense ici au vieillissement, à l’accroissement des dépenses de santé lié notamment aux progrès médicaux, aux tensions sur les matières premières, à l’extension des normes environnementales, aux coûts des sauvetages financiers à répétition ou, de manière plus prospective, à l’assèchement progressif des réservoirs de main-d’œuvre non-salariée dans le monde.
La déconnexion entre production capitaliste et besoins sociaux
Au-delà de ces contradictions, d’autres facteurs rendent manifeste l’épuisement de la dynamique du capitalisme. Un point crucial est le divorce de la production capitaliste par rapport aux besoins sociaux[7] : la sophistication des techniques marketing, visant à permettre l’écoulement de marchandises surabondantes, contraste vivement avec le fait que les besoins sociaux se concentrent de plus en plus dans des services tels que la santé, l’éducation/formation, les loisirs, la prise en charge du vieillissement, c’est-à-dire des secteurs assurant la reproduction de « l’être humain par lui-même » et qui ont pour point commun de générer peu de gains de productivité[8]. La prise de conscience de l’ampleur des destructions environnementales liées aux activités productives représente une autre manifestation de ce divorce. Sur le fond, le débat sur la mise en place de nouveaux indicateurs de richesse renvoie à une tentative de traiter cette déconnexion entre croissance – fruit de l’accumulation capitaliste – et satisfaction des besoins.
Les difficultés rencontrées par la poursuite du processus d’accumulation et le divorce entre production capitaliste et besoins sociaux – il faudrait ajouter d’autres éléments tels la crise du travail, la crise écologique… – s’additionnent pour saper la légitimité du système. L’idéologie contemporaine du capital – le néolibéralisme – est en miettes. Les réformes étaient censées apporter davantage de croissance, et donc des retombées positives pour tout un chacun. Il n’en a rien été. A ces promesses non tenues s’ajoute le fait que les soubresauts de plus en plus violents qu’a connus le système sont incompréhensibles dans le cadre conceptuel néolibéral. Les classes dominantes sont donc déboussolées.
Cette grande fatigue du capitalisme n’exclut cependant pas la possibilité d’un rebond systémique. Trois options principales, isolément ou de manière combinée, pourraient conduire à une nouvelle phase d’expansion. La première est l’émergence d’un nouveau centre d’accumulation à l’échelle mondiale. La Chine est candidate au poste, mais rien ne garantit qu’elle puisse jouer ce rôle : d’une part, son poids relatif dans l’économie mondiale reste encore limité par rapport à celui de l’Europe et des Etats-Unis ; de plus, extrapoler la trajectoire future du pays à partir des trois décennies de croissance extrêmement rapide qu’elle vient de connaître relève d’un raisonnement largement abusif. La seconde option est celle de l’émergence d’un nouveau paradigme socio-économique autour d’une vague d’innovation (les technologies de l’information ? les biotechnologies ? les technologies vertes ?) dont la diffusion soit compatible avec l’accumulation intensive du capital. Si des possibilités technologiques sont là, leur intégration à une nouvelle phase d’accumulation n’a absolument rien d’automatique. Troisième option : celle d’une destruction massive de capitaux, par exemple dans le cadre d’une guerre impliquant directement les grands pays. L’interpénétration des intérêts industriels, commerciaux et financiers des bourgeoisies nationales est un frein à tout affrontement direct. D’autant plus que les arsenaux nucléaires rivaux tendent à figer par la terreur les rapports de forces. Hors de ces options, et d’une rupture politique systémique, l’avenir est celui d’une poursuite ralentie d’une accumulation toujours plus prédatrice.
II – La puissance des faibles
Le désarroi idéologique des classes dominantes et l’affaiblissement de la légitimité substantielle du système – sa capacité à délivrer ce qui est promis – constituent des éléments favorables pour les gauches anticapitalistes. En revanche, la configuration des relations sociales de production dans lesquelles se déroule l’affrontement de classe sur le lieu de travail sont très défavorables. Les statistiques internationales du BIT sur le nombre de journées non travaillées pour cause de conflits sociaux indiquent une chute brutale, de l’ordre d’une division par un facteur dix entre les années 1970 et les années 2000 pour les pays du G7.
Cet indicateur est très imparfait du fait de problèmes de fiabilité des données recueillies, des difficultés des comparaisons internationales et de son caractère réducteur. Pour en rester seulement à la France, ces problèmes sont bien documentés et suggèrent de relativiser le recul enregistré[9]. Il y aurait même une amorce de retour de la conflictualité dans les années 2000 au sein du secteur privé, qui prendrait davantage la forme de grèves courtes (débrayages ou grèves limitées à une journée) ou de formes d’actions « sans arrêt de travail » (grève perlée, consistant à effectuer le travail au ralenti, manifestation, pétition, refus d’heures supplémentaires), tandis que les grèves renouvelables poursuivent leur recul. L’augmentation des sanctions et de l’absentéisme est un autre indicateur de l’absence de pacification des relations au travail. Enfin, les grands mouvements nationaux comme en 1995 (retraites et Sécurité sociale), 2003 (retraites), 2006 (CPE), ou 2010 (de nouveau sur les retraites) attestent également de capacités de résistance persistantes au sein du salariat. Nous sommes cependant très loin de la puissante vague internationale de grèves des années 1960 et 1970[10]. Après l’effondrement de l’activité contestataire au début des années 1980, la situation n’a pas été inversée, et ce en raison d’un affaiblissement structurel du pouvoir de négociation du travail par rapport au capital.
La dégradation du rapport de forces sur le lieu de travail
Le mécanisme de l’armée de réserve et la maîtrise de l’évolution technico-organisationnelle du travail constituent, avec le principe « diviser pour mieux régner », les trois piliers de la domination du capital[11]. La dégradation du rapport de forces au cours des dernières décennies résulte d’effets cumulatifs dans ces trois dimensions. Le chômage et la précarité disciplinent les travailleurs et modèrent les revendications salariales. Ils les conduisent à tolérer de nouveaux mécanismes de contrôle et de mesure de la performance, notamment par le biais de l’informatisation des processus de production. Enfin, la déconcentration productive, notamment avec le développement de la sous-traitance internationale, affaiblit l’unité des travailleurs et permet leur mise en concurrence, sans pour autant diluer les profits ou le pouvoir de décision. Par ailleurs, les transformations sectorielles des économies développées conduisent à un déclin de la part des emplois industriels et, en particulier, des emplois dans les industries mécaniques dans lesquelles le dispositif technique était très favorable aux salariés puisque, à l’instar de l’automobile, d’une part, l’outil de production est très coûteux – donc difficile à déplacer ou à abandonner – et, d’autre part, peut être totalement bloqué par une grève minoritaire.
Cette dégradation de la position des travailleurs n’est cependant pas unilatérale. D’abord, parce qu’au niveau international, au contraire, l’émergence de nouvelles grandes concentrations ouvrières, notamment en Inde et en Chine, crée les conditions d’un renouveau du mouvement ouvrier, dont la série de grèves observée au printemps 2010 est peut être un signe avant-coureur[12]. Si une telle évolution se confirmait elle ne manquerait pas d’améliorer le pouvoir de négociation global des salariés. Ensuite, parce que si les dispositifs de travail contemporains conduisent à un éclatement des collectifs de travail, ils créent également de nouvelles vulnérabilités des firmes à l’action collective, en particulier du fait de la généralisation du principe de « juste à temps ».
Le phénomène principal reste que la capacité des travailleurs des pays riches à mener des luttes de classe sur le lieu de travail est considérablement et structurellement diminuée. Cela n’implique pas une incapacité à mener des luttes victorieuses, mais en revanche suggère un déplacement du site central depuis les luttes au niveau de l’atelier (« à la Marx ») vers des luttes ayant d’emblée une dimension sociale plus diffuse (« à la Polanyi »)[13]. Ainsi, davantage que lors des décennies de l’après-guerre, les mobilisations se jouent aussi à l’extérieur des entreprises – importance des manifestations, des actions, des batailles médiatiques/idéologiques… – ou à travers des alliances de divers acteurs : collectifs d’habitants et soutien des élus pour défendre l’emploi ; campagnes coordonnées par des mouvements sociaux et des ONG, articulation « diagonale » entre mouvements et gouvernements lors du sommet de Cochabamba contre le changement climatique…. Ce déplacement du site central de l’affrontement social renvoie également à l’importance prise par la figure des luttes défensives contre le démantèlement des acquis sociaux (retraites, CPE, éducation..) ainsi qu’au développement proportionnellement important des mobilisations sur des questions non directement connectées au travail (contre le libre-échange, la finance, pour le logement, le climat, l’environnement..). En bref, si les luttes semblent moins à même de se résoudre dans le face-à-face local entre capital et travail, elles tendent à avoir d’emblée une portée politique générale.
Les luttes dans la respiration longue du capital
L’appréciation en dynamique de l’évolution du rapport de forces capital/travail est ainsi difficile à établir. Si, en statique, dans les pays riches la situation est mauvaise, une interprétation de la situation liant luttes de classes et ondes longues suggère une lecture plus contrastée.
Au cours des différentes phases de l’onde longue, la lutte des classes connaît des variations d’intensité qui contribuent à dessiner la trajectoire du système[14]. Les luttes de résistance sont particulièrement aiguës à la fin de la phase descendante, lorsque le processus de réorganisation bat son plein. Il y a alors une forte inadéquation entre les compétences des travailleurs et les besoins des industries en gestation : les travailleurs des anciennes industries sont en surnombre tandis que les nouvelles compétences ne sont le plus souvent acquises que par les nouveaux entrants, et le mécanisme de l’armée de réserve joue alors à plein. C’est par exemple le cas lors de la vague révolutionnaire de 1848 qui se déroule sur fond de chômage de masse et de misère ouvrière.
L’autre moment de forte conflictualité, offensif cette fois, correspond au sommet de l’onde, lorsque le paradigme techno-économique est hégémonique mais arrive à épuisement. Un quasi plein emploi et des modes d’organisation des luttes de travailleurs adaptés au paradigme permettent d’obtenir des concessions importantes de la part du capital, qui accélèrent la diminution du taux de profit. La vague de luttes autour de 1968 s’inscrit dans un tel cadre. Ces deux moments paroxystiques des luttes répondent à des logiques distinctes en terme de résistance ou d’offensive et l’on peut s’interroger sur leur potentiel transformateur respectif. En haut de l’onde longue, les mobilisations visent à prolonger le paradigme dominant dans une version émancipatrice à partir des positions conquises au cours de la phase ascendante. Tandis que la dimension la plus innovatrice des luttes va buter sur la résistance d’un paradigme dont le processus de dislocation s’amorce tout juste. Ce potentiel innovateur se diffuse alors de manière progressive tout au long de la phase descendante. En bas de l’onde longue, les confrontations se déroulent dans une situation a priori plus défavorable pour les mouvements sociaux. Cependant, leur potentiel innovateur peut davantage contribuer à la transformation sociale effective. En effet, en l’absence de paradigme stabilisé, la situation socio-institutionnelle est plus fluide et les innovations radicales ont davantage l’opportunité de s’imposer.
Le renouveau des mouvements sociaux depuis le milieu des années 1990, l’essor du mouvement altermondialiste et à présent du mouvement pour la justice climatique, ou encore la vague actuelle de mobilisations contre les mesures d’austérité qui touchent l’Europe, peuvent ainsi être interprétés autour du triptyque : délocalisation, durcissement et inventivité. D’abord, une tendance de la contestation à s’échapper du face-à-face localisé avec le capital duquel le travail sort le plus souvent défait. L’âpreté des luttes salariales pour l’obtention de primes de licenciements observée en France ces dernières années peut à cet égard être interprétée comme une expression de défiance radicale vis-à-vis du capital local auxquelles elles se confrontent. Tandis que l’attention portée aux questions systémiques (services publics, régulation internationale, environnement, droits sociaux…) renvoie à une confrontation à la fois globale et concrète avec le capitalisme en tant que logique sociale. En second lieu, cette confrontation tend à se durcir puisque le conflit distributif s’aiguise d’autant plus que la dynamique d’accumulation s’épuise. Enfin, la configuration originale du déploiement de répertoires d’action et de thèmes d’intervention, renvoie à la fois au peu d’emprise immédiate des mouvements sur la conjoncture, mais aussi à une mobilité et une vivacité qui constituent un avantage dynamique certain.
La conjoncture socio-économique se caractérise par un essoufflement de la dynamique d’accumulation capitaliste, un affaiblissement de la légitimité de ce système et un rapport de forces dégradé pour les salariés sur le lieu de travail. Cependant, la vivacité de luttes polymorphes, et qui tendent à s’attaquer à des objectifs surtout défensifs mais directement politiques, atteste d’une situation riche en potentialités. Pour libérer la puissance transformationnelle des mobilisations, la gauche radicale doit se mettre en position de défendre un scénario anticapitaliste qui dessine la possibilité d’une trajectoire alternative à l’avenir de régression sociale généralisée désormais explicitement assumé par la droite et les renoncements de la gauche de droite. Elle peut s’appuyer pour cela sur un renouveau des pensées critiques[15] qui participe d’un climat idéologique en partie favorable. En revanche, la faiblesse et l’éclatement organisationnels des forces anticapitalistes ainsi que la pauvreté de la réflexion stratégique plombent leur capacité à peser sur la situation. Les développements socio-économiques accélérés contemporains peuvent cependant faciliter un réagencement programmatique, une réflexion renouvelée sur le rapport aux institutions et, finalement, une recomposition politique et sociale. De telles avancées permettraient d’esquisser les contours d’une transition anticapitaliste, c’est-à-dire établir quelle forme pourrait prendre une crise de pouvoir et ce que pourrait être un gouvernement anticapitaliste.
Notes
[1] Article paru dans le n°7 (nouvelle série) de la revue ContreTemps, 3è trimestre 2010.
[2] Selon l’expression de Paul Krugman, en référence à la longue dépression du dernier quart du XIXe siècle et de la grande dépression des années 1930 : « The third depression », The New York Times, 27 juin 2010.
[3] Gillian Tellet, « Collapsed debt market poses dilemma for G20 leaders », Financial Times, 24 juin 2010.
[4] John Bellamy Foster, Hannah Holleman, « The financial power elite », Monthly Review, May 2010.
[5] François Chesnais, « Crise de suraccumulation mondiale ouvrant sur une crise de civilisation », Inprecor, n° 556-557, janvier 2010.
[6] David Harvey, The New Imperialism, Oxford University Press, 2005.
[7] Michel Husson souligne que ce divorce entre production et besoins s’accentue considérablement dans la période néolibérale par rapport aux décennies d’après-guerre. « Socialisation interrompue et résistance des besoins », communication au Congrès Marx international, septembre 2007.
[8] « Capitalisme(s) du XXIème siècle. Un entretien avec Robert Boyer », Contretemps, numéro 21, février 2008.
[9] Sophie Béroud, Jean-Michel Denis, Guillaume Desage, Baptiste Giraud, Jérome Pélisse, « Ce que révèlent les données officielles sur les conflits sociaux », Le Monde Diplomatique, octobre 2008. Baptiste Giraud, Jérôme Pélisse, « Le retour des conflits sociaux ? », La Vie des Idées, 6 janvier 2009.
[10] Il faut cependant se garder d’exagérer la rupture. Lilian Mathieu montre ainsi comment une série de mouvements sociaux contemporains s’inscrivent dans la continuité des luttes des années 1970 in Les années 1970, un âge d’or des luttes ?, Textuel, 2010.
[11] Pour une discussion de ces différentes dimensions de la dégradation de la position des travailleurs, voir Cédric Durand, Le capitalisme est-il indépassable ?, Textuel, 2010.
[12] « Signs of widespread worker action in China », Financial Times, 10 juin 2010.
[13] Sur la distinction « lutte à la Marx » , « lutte à la Polanyi », voir Beverly J. Silver, Forces of Labor, Cambridge University Press, 2003.
[14] Voir Ernest Mandel [1980] Long Waves of Capitalist Development: a Marxist Interpretation, London, Verso, 1995 ; Pierre Dockès, Bernard Rosier, Rythmes économiques, crise et changement social. Une perspective historique, Paris, La Découverte, 1983 ; Christopher Freeman, Francisco Louça, As Time Goes By: From the Industrial Revolutions to the Information Revolution, Oxford, Oxford University Press, 2001.
[15] Pour un panorama voir Razmig Keucheyan, Hémisphère gauche, Paris, Zones, 2010.