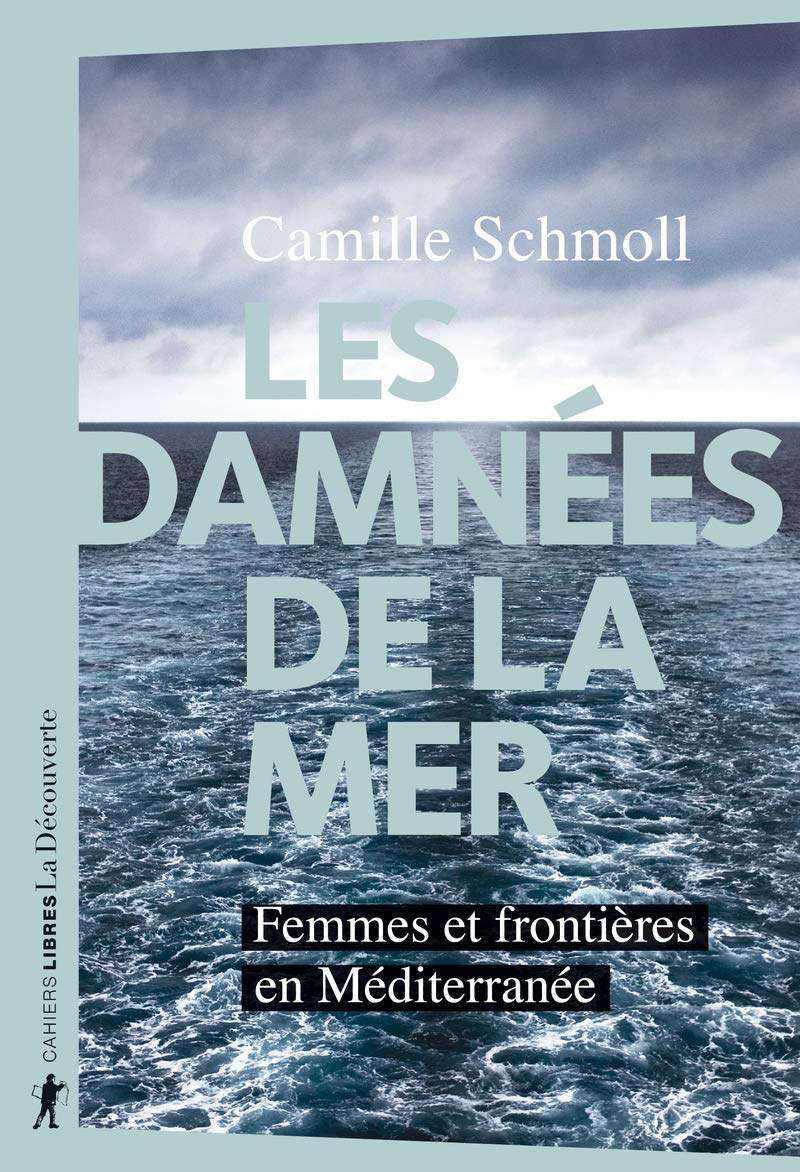Les damnées de la mer. Extrait du livre de Camille Schmoll
Camille Schmoll, Les Damnées de la mer. Femmes et frontières en Méditerranée, Paris, La Découverte, 2020.
Par son ouvrage, Les Damnées de la mer, Femmes et frontières en Méditerranée, paru aux Editions La Découverte en novembre 2020, qui est une enquête au long cours dans les « marges utiles » de l’Union Européenne, Malte et l’Italie, la géographe Camille Schmoll redonne aux femmes la place qui leur est souvent déniée dans les études sur les migrations.
Dans cet extrait de sa conclusion, elle revient sur les raisons de cette invisibilisation et sur les moyens de la combattre. Elle resitue sa démarche parmi les travaux menés depuis les années 1970 par les chercheuses féministes pour faire connaître la « part des femmes » dans les phénomènes migratoires. Elle plaide pour une pratique de « l’intersectionnalité située » et une repolitisation du genre, afin de déconstruire notamment les discours officiels présentant les politiques migratoires de l’Union Européenne comme une façon de sauver les femmes, ce qui contribue à masquer les violences spécifiques exercées sur ces dernières par les dispositifs institutionnels que l’ouvrage analyse dans le détail.
***
Faire la part des femmes : quarante ans de recherches sur les migrations féminines
Depuis les années 1970, des chercheuses féministes travaillent à faire reconnaître la « part des femmes » dans les flux migratoires. Ces recherches ont permis de montrer que le neutre générique, c’est‑à‑dire cette façon de se référer aux migrations comme un phénomène avant tout masculin, était une chausse‑trappe, le signe d’un masculin dominant qui a longtemps invisibilisé la présence des femmes. Ce mécanisme d’invisibilisation des femmes est bien connu des études sur le genre. Il a pu s’accompagner d’une minorisation de leurs propres mobilités par les femmes elles‑mêmes – une forme d’auto‑invisibilisation ; celles‑ci, pour différentes raisons, ne souhaitant pas nécessairement – ou ne pouvant pas – attirer l’attention sur leurs déplacements et leurs activités.
Trois moments se sont succédé dans la production scientifique sur cette question. Les premières recherches, à partir des années 1970, se sont consacrées à la reconnaissance des femmes migrantes, en cherchant à éclairer leur rôle de travailleuses et pas seulement d’épouses, mères ou suivantes. Dès 1984, un numéro important de la revue International Migration Review ouvrait la voie à une saison intense de recherches sur la part des femmes dans les flux mondiaux et leur participation aux marchés du travail. Mirjana Morokvasic y signait un éditorial qui fit date : « Birds of passage are also women »[1]. Ce premier moment de recherche sur les femmes en migration coïncide avec ce qu’on a coutume d’appeler la « deuxième vague » du féminisme, sensible à l’imbrication des sphères du productif et du reproductif[2]. C’est pourquoi ces premières recherches seront particulièrement attentives à la reconnaissance du travail des migrantes[3].
Puis, les années 1990 marquent le début d’une deuxième phase de recherche, pendant laquelle le rôle de la famille et des réseaux familiaux devient un élément central de réflexion sur les causes et les modalités des migrations[4]. Ces recherches ouvrent la « boîte noire du foyer » comme lieu d’exploitation et d’oppression.
D’un côté, en effet, les foyers de départ poussent les femmes sur les routes et les inscrivent dans des « contre‑circuits de la mondialisation » et des mobilités transnationales qui n’ont rien d’émancipateur, ni de transgressif[5]. De l’autre, les foyers des familles des pays de destination emploient les migrantes en tant que nounous et assistantes de vie, travailleuses du soin et travailleuses domestiques, dans le cadre d’un marché du travail segmenté à l’échelle mondiale. Aussi, les deux figures de la migration féminine les plus présentes dans cette littérature des années 1990 sont celles de la domestique et de la prostituée, toutes deux racisées et minorisées dans les sociétés d’accueil[6].
Ces travaux mettent en lumière la face sombre de la phase actuelle du capitalisme, qui repose sur le travail des « servantes de la mondialisation »[7]. En appréhendant l’articulation du productif et du reproductif à l’échelle mondiale, ces travaux abordent la division sexuée et inter‑ nationale du marché du travail selon des mécanismes de domination articulant classe, race et sexe[8]. Ces développements s’effectuent en concordance avec une nouvelle saison du féminisme, dit « intersectionnel », qui met au cœur de ses préoccupations les femmes minoritaires et racisées. Les travaux sur l’Europe du Sud sont alors nombreux dans cette littérature : il s’agit d’une des régions du monde le plus en demande de travail domestique féminin, du fait des spécificités de son modèle de welfare, qui délègue la responsabilité du travail du soin et de care aux familles.
Ces travaux sont encore d’une grande actualité. Mais, en parallèle, les recherches les plus récentes sur les migrations féminines ont contribué à mettre au jour d’autres formes de migrations. Une partie de ces travaux s’est attelée à faire reconnaître la part des femmes dans les migrations les plus qualifiées. Ils pointent le processus de déqualification entraîné par la migration pour des femmes qui passent, par exemple, du statut de médecin à celui d’infirmière, ou d’infirmière à aide‑soignante[9]. « Si féminisation il y a, c’est surtout au sens où les femmes sont devenues majoritaires dans l’immigration totale des diplômés de l’enseignement supérieur dans les pays de l’OCDE », écrivent ainsi Speranta Dumitru et Abdeslam Marfouk[10]. Pour ces deux chercheurs, la mise en visibilité des femmes les plus marginales ou subalternes, « prostituée, mère, épouse, femme de ménage ou victime de trafic », ne doit pas éclipser celle des plus qualifiées, qui travaillent dans le secteur de la santé ou des hautes technologies.
D’autres travaux enfin mettent en lumière la présence des femmes au sein des multiples exils et déplacements forcés, dont la part dans les flux mondiaux ne cesse d’augmenter. Ces travaux, dont il a été souvent question dans ce livre, cultivent les exigences d’une lecture féministe et politique, attentive aux articulations d’échelles, du corps des femmes migrantes aux grands enjeux géopolitiques internationaux[11].
Ces quarante ans de recherches sur les migrations féminines ont permis de se représenter les femmes en tant que sujets sociaux sans toutefois jamais se référer à la figure de « La Femme » (la femme migrante, en l’occurrence)[12]. Ils ont montré la nécessité d’analyses situées des migrations féminines, dont la diversité interdit toute généralisation.
Ces travaux de recherche nous montrent que l’analyse des migrations féminines doit être comparative et intersectionnelle : comparative, car la mise en relation de différents contextes régionaux et historiques permet de restituer la complexité des migrations et leur variation selon les lieux, les époques, les provenances, les destinations ; à l’encontre de toute vision naturalisante et univoque des femmes migrantes. Quant à la perspective intersectionnelle, elle permet de montrer combien les positionnements féminins sont imbriqués au sein de rapports de pouvoir multiples, en termes de genre, mais aussi de classe, de sexualité, d’ethnicité, de race, d’habilité physique ou encore de génération. La dimension juridique des rapports de pouvoir est également fondamentale quand on traite de migrations, qui peuvent tour à tour, et pour la même personne, être qualifiées d’irrégulières, de demandeuses d’asile, de déboutées et de « dublinées », à l’instar de celles dont les histoires sont rapportées dans ce livre : les limbes peuvent prendre plusieurs formes, et l’irrégularité des migrantes et migrants se décline de plusieurs manières, dans une tension entre expulsabilité et inexpulsabilité.
Enfin, ces travaux invitent à la pratique d’une « intersectionnalité située », inscrite dans un contexte spécifique, un « ici et maintenant »[13]. Dans ce livre, l’« intersectionnalité située » s’est manifestée en situation d’observation ethnographique, parfois quand je m’y attendais le moins : ce fut le cas quand ce gérant de centre d’accueil, évoqué dans le chapitre 4, me raconta que les femmes africaines n’étaient pas en mesure de nettoyer leur chambre et de travailler dans les foyers italiens. Sans le vouloir, il devenait à mes yeux le témoin du retournement historique évoqué en introduction de ce livre et qui, effectivement, a fait « sortir » les femmes africaines des foyers italiens – remplacées par d’autres nationalités dans le travail domestique – pour les envoyer à la rue ou dans les camps. L’approche intersectionnelle doit s’articuler à une réflexion sur l’historicité du moment.
De ces quarante ans de recherches sur les migrations féminines, je retiens enfin l’imbrication de l’économie des familles et des États, l’articulation des sphères du productif et du reproductif autour de différentes formes d’échanges matériels et immatériels, émotionnels et affectifs, économiques et sexuels. Une telle approche[14] se montre attentive à la complexité et à la multiplicité des ressorts du phénomène migratoire et des connexions qu’il implique, entre public et privé, entre ici et là‑bas.
Féminiser le regard
Féminiser le regard, ce n’est donc pas adhérer au scénario myope et anhistorique d’une féminisation des flux, mais proposer un changement d’approche sur les flux, un regard plus complet, « augmenté » en quelque sorte, par la présence des femmes. Comment faire ? Il s’agit d’une part de poursuivre une entreprise de restitution de la part et du rôle des femmes dans les flux initiée depuis les années 1970, mais encore « parent pauvre de la production scientifique »[15] : c’était le premier objectif de ce livre que de faire remonter, de mettre au jour l’histoire de celles qui traversent la Méditerranée.
Féminiser pour reconnaître : car, malgré tous les travaux qui viennent d’être évoqués, à bien des égards les femmes sont encore effacées ou minorées du grand tableau médiatique et universitaire des mobilités contemporaines. En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’on fait leur histoire qu’elles rejoignent la grande Histoire[16].
On peut se demander pourquoi cette invisibilité : c’est peut‑être que « ramener les femmes sur la scène migratoire »[17]met sérieusement en danger le récit habituel des migrations, fondé sur des figures masculines inquiétantes ou menaçantes, à l’instar des prophéties de la « ruée vers l’Europe »[18]. Mais cette sous‑estimation du rôle des femmes en migration n’est pas que le fait des détracteurs des migrations.
Dans les sociétés de départ et d’accueil, prendre en compte la migration féminine déstabilise les ordres locaux fondés sur une distribution symbolique des rôles entre sédentarité et mobilité, entre mobilité active et mise en circulation passive. La circulation des femmes n’a‑t‑elle pas été décrite par l’anthropologie structurale comme la prérogative des hommes pour préserver et assurer la reproduction du groupe[19] ?
Notes
[1] Titre en forme de clin d’œil à l’ouvrage de Michael Piore sur la segmentation des marchés du travail : Michael PIore, Birds of passage. Migrant labor in industrial societies, Cambridge, Cambridge University Press, 1979.
[2] La reproduction est un concept large qui inclut un ensemble d’activités qui va bien au‑delà de l’élevage des enfants. L’approche par la sphère reproductive, généralement assimilée au privé, se nourrit des travaux des féministes sur le travail domestique dont elles ont montré le caractère situé historiquement et géographiquement, à l’instar de Danièle Kergoat : « La notion de “travail domestique” n’est pas anhistorique : c’est la formeconcrète que prend le travail reproductif assigné au groupe des femmes dans une société salariale. Ce terme est utilisable à partir du moment où se meten place une séparation spatio‑temporelle entre un lieu et un temps pour produire et gagner son salaire et un autre lieu et un autre temps pour sereproduire (reproduire sa force de travail et reproduire sa famille) », Danièle Kergoat, « La division du travail entre les sexes », in Danièle Kergoat,Josiane Boutet, Henri Jacot, Danièle LInhart (dir.), Le Monde du travail, Paris, La Découverte, 1998, p. 324‑325.
[3] Bien que les relations entre le féminisme et les mouvements sociaux de migrantes n’aient pas toujours été faciles, les revendications etbesoins pouvant être disparates, voire opposés.
[4] Monica Boyd, « Family and personal networks in international migration : Recent developments and new agendas », International Migration Review, vol. 23, 1989, p. 638‑671.
[5] Saskia Sassen, « Countergeographies of globalization : The feminization of survival », op. cit. ; Brenda Yeoh et Geraldine Pratt, « Transnational (counter) topographies », Gender, Place and Culture, vol. 10, n° 2, 2003, p. 156‑166.
[6] Mara TognettI Bordogna, Donne e percorsi migratori. Per una sociologia delle migrazioni, Milan, Franco Angeli, 2012.
[7] Rhacel Parrenas, Servants of Globalization, Palo Alto, Stanford University Press, 2001.
[8] Voir, parmi d’autres, Helena HIrata, « Division sexuelle et internationale du travail », Futur antérieur, vol. 16, n° 2, 1993, p. 27‑40 ; Bridget Anderson, Doing the Dirty work ? The Global Politics of Domestic Labour, Zed Books, 2000 ; Barbara EhrenreIch et Arlie Russell HochschILd(dir.), Global Woman : Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy, New York, Metropolitan books, 2003 ; Christine Verschuur et Fenneke Reysoo (dir.), Genre, nouvelle division internationale du travail et migrations, Paris, L’Harmattan, 2005 ; Jules FaLquet, Helena HIrata,Danièle Kergoat, Brahim LabarI, Nicky Lefeuvre, Fatou Sow (dir.), Le Sexe de la mondialisation. Genre, classe, race et nouvelle division dutravail, Paris, Presses de Sciences Po, 2010 ; Francesca ScrInzI, Genre, migrations et emplois domestiques en France et en Italie : constructionde la non-qualification et de l’altérité ethnique, Paris, Petra, 2013.
[9] Eleonore Kofman et Parvati Raghuram, « Gender and global labour migrations. Incorporating skilled workers », Antipode, vol. 38, n° 2, 2006, p. 282‑303.
[10] Speranta DumItru et Abdeslam Marfouk, « Existe‑t‑il une fémini‑ sation de la migration internationale ? », Hommes et migrations, 1311, 2015, p. 31‑41.
[11] Jennifer Hyndman, « The (geo) politics of gendered mobility », op. cit. ; Alison Mountz, « Political Geographies III : Bodies », Progress in Human Geography, vol. 42, n° 5, 2018, p. 759‑769.
[12] Gilian Rose, Feminism and Geography : the Limits of Geographical Knowledge, Cambridge, Polity Press, 1993.
[13] Martina RIchter et Bettina BüchLer, « Here and Now : Spatializing intersectionality », in Kamala MarIus et Yves RaIbaud, Genre et construction de la géographie, Bordeaux, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2013, p. 39‑52.
[14] Qui permet de prendre de la distance vis‑à‑vis des modèles d’explication mécanistes de type push/pull ou de certaines catégories (migrations familiales versus migrations économiques).
[15] Janine DahInden, Magdalena Rosende, Natalie BeneLLI, Magali NaseLman, Karine Lempen, « Migrations : Genre et frontières – frontières de genre », Nouvelles Questions féministes, n° 26, 2007, p. 4‑14.
[16] Linda Guerry, (S’)exclure et (s’)intégrer. Le genre de l’immigration et de la naturalisation. L’exemple de Marseille (1918-1940), thèse de doctorat en histoire, université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 2008 ; Linda Guerry, « Femmes et genre dans l’histoire de l’immigration. Naissance et chemine‑ ment d’un sujet de recherche », Genre & Histoire [en ligne], n° 5, automne 2009.
[17] Michel PéraLdI et Meriam CheIkh, Voyages au féminin entre Afrique et Méditerranée, Casablanca, Le Fennec, 2009.
[18] Stephen SmIth, La Ruée vers l’Europe, Paris, Grasset, 2018.
[19] On renvoie ici, bien entendu, aux travaux d’anthropologie structurale.