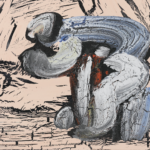Comment la finance s’empare de nos villes, et les transforme
Extrait de : Antoine Guironnet, Au marché des métropoles. Enquête sur le pouvoir urbain de la finance, Editions les Etaques, 2022.

Du 15 au 18 mars 2022, le gratin de l’urbanisme s’est réuni à Cannes pour le plus grand salon immobilier au monde. Chaque année, quelques mois avant les stars de cinéma, ce sont les promoteurs anglais, les fonds de pension américains, les architectes japonais·es et les élu·es des métropoles françaises qui foulent les marches du Palais des festivals.
Mais, à l’image du marché qu’il incarne, le salon déroule avant tout le tapis rouge aux grands investisseurs pour qui l’immobilier n’est qu’un placement financier. En nous plongeant dans les allées et les coulisses du Marché international des professionnels de l’immobilier (MIPIM), Au marché des métropoles d’Antoine Guironnet donne à voir comment la financiarisation de la ville se joue à travers «l’accréditation» des territoires par les investisseurs.
Cette enquête menée entre Cannes, Paris, Londres et Lyon dévoile le rôle de la finance dans la transformation de pans entiers de nos villes. Ce livre constitue ainsi une contribution inédite à la critique des rouages par lesquels le capital étend son pouvoir sur nos vies quotidiennes, c’est pourquoi nous en reproduisons ici l’introduction.
Antoine Guironnet mène des recherches sur la financiarisation du capitalisme urbain. Il a notamment participé à l’ouvrage Le capital dans la Cité. Une encyclopédie critique de la ville, paru aux éditions Amsterdam (2020).
***
Introduction. « Welcome to the world’s property market »
Chaque année, le gratin de l’immobilier et de l’urbanisme se réunit à Cannes pour le Marché international des professionnels de l’immobilier (Mipim), autoproclamé « salon de l’immobilier mondial ». Pendant quatre jours, la ville pulse au rythme de l’événement qui se déroule dans le Palais des Festivals, et aux alentours : dans les suites et les halls des palaces, sur des terrasses d’appartements loués, dans les cafés et restaurants privatisés, et sur le pont des yachts amarrés au quai d’honneur. Une ambiance affairiste où se côtoient les milliards des marchés financiers et les slogans du marketing territorial. « Welcome to the world’s property market » : le message qui coiffe l’événement est on ne peut plus clair.
« Yes, we Cannes »
Le Mipim compte parmi les institutions les plus importantes du monde de l’immobilier. Au-delà des cercles d’initiés et de quelques reportages sensationnalistes, c’est pourtant l’une des plus méconnues[1]. À la différence d’autres salons ouverts au grand public dont on peut voir les publicités dans le métro, celui-ci s’adresse aux professionnels : promoteurs et constructeurs, agents immobiliers et consultants, avocats et experts fiscalistes, banquiers et investisseurs, architectes et urbanistes, mais aussi aménageurs et décideurs politiques. S’il n’y a pas d’attestation à présenter pour prouver sa qualité de « professionnel », c’est que la sélection se fait par l’argent : pour franchir les portes du Palais, il faut débourser l’équivalent d’un SMIC ; et pour en être la vedette, mieux vaut avoir en bagage de grands projets d’aménagement et dans le viseur de belles affaires immobilières.
Depuis sa première édition en 1990, le nombre des participants a régulièrement augmenté, jusqu’à atteindre plus de 30 000 en 2008 – soit presque la moitié de la population locale. Scandales et faillites liés à la crise financière se sont ensuite répercutés sur la fréquentation, mais après quelques années difficiles l’affluence est repartie à la hausse : lors des trois dernières années, l’événement rassemblait autour de 25 000 personnes, dont 5 400 investisseurs. Derrière ces statistiques et leur oscillation au gré du flux et du reflux des capitaux dans l’immobilier, le visage du salon s’est transformé. Reflétant la mondialisation des marchés, le nombre de pays représentés est passé de 22 à 100 au cours des trente dernières années. Au fur et à mesure de la plus grande mobilité des capitaux et la circulation des modèles urbains d’une ville à l’autre, l’horizon du Mipim s’est élargi, à l’image des entrées remarquées de la Russie et du Qatar.
Dans le même temps, le salon est devenu celui « des marchands de villes »[2]. Élus, services d’urbanisme et de développement économique, ou encore aménageurs s’y pressent pour défendre les couleurs de leur territoire et ainsi intégrer le club fermé des métropoles « attractives » sur le marché immobilier mondial. Ici, on est invité à « join the vibe » de « Magnetic Bordeaux » ; là, à découvrir Hounslow, « l’opportunité en or à Londres ». Jusque dans les sous-sols du Palais, on est sollicité par « Just Dijon ». Devenue massive au cours des années 2000, cette participation des pouvoirs publics locaux passe non seulement par des conférences, mais surtout par la location de stands où ils exposent leurs politiques de développement territorial et projets d’urbanisme à grands renforts de slogans marketing, de statistiques sur leur marché immobilier, de maquettes et de présentations powerpoint. Déclinés sous toutes les coutures, depuis leur design jusqu’aux goodies distribués (stylos, clefs USB, cahiers, tasses, peluches, tote bags), ces stands sont les vitrines de leur territoire. Dans les allées du salon et les couloirs des palaces se croisent et se côtoient désormais les dirigeants des plus grands fonds d’investissement mais aussi les maires de tous bords politiques.
Par-delà les mondanités et les flutes de champagne, le salon reflète plus fondamentalement les politiques urbaines typiques de la ville néolibérale[3], qui accordent du poids aux acteurs privés – et en particulier ceux du secteur de l’immobilier et de la finance. Pour caractériser l’application des préceptes néolibéraux aux politiques urbaines, le géographe David Harvey parle d’« entrepreneurialisme urbain »[4], qui prend concrètement la forme de partenariats où le public cherche à attirer des capitaux privés en garantissant leurs risques, notamment à travers de grands projets iconiques. Ce type de politiques est fondé sur l’idée que la plus grande mobilité du capital exacerbe la compétition entre les villes. Pour y faire face, les territoires rivalisent d’investissements publics et de politiques fiscales pour attirer entreprises, ménages aisés, touristes et capitaux, ainsi que de campagnes de marketing à destination de ces cibles[5]. Réputées moins perméables au néolibéralisme, les grandes agglomérations françaises se sont pourtant embarquées dans la course à la « métropolisation », ce mot d’ordre qui sanctifie leur inscription dans les hautes sphères de la compétition urbaine[6].
L’immobilier occupe une place clé dans ces politiques guidées par la croissance et la compétition économiques. Pour faire partie des territoires gagnants de la mondialisation, élus et aménageurs font de l’urbanisme et de l’immobilier des outils du développement économique à des fins d’attractivité[7]. Comme le remarquait avec prescience l’économiste hétérodoxe Anne Haila, les politiques entrepreneuriales « informent les investisseurs que la ville suit les règles familières du jeu de l’immobilier. L’investisseur est ainsi convaincu par la présence de bâtiments conformes aux logiques d’investissement »[8]. Compte tenu de l’importance des jugements dans les décisions d’investissement, ces politiques ont une dimension symbolique importante. Pétries de l’idée de concurrence, elles prennent souvent d’autres villes en exemple pour se légitimer.
Placer le capital
De quoi le Mipim est-il le nom – ou, plus exactement, le lieu et le moteur ? Sur quelques milliers de mètres carrés, se concentrent en réalité trente ans de transformations du capitalisme urbain. Le Mipim traduit d’abord la mondialisation des marchés de capitaux, dont la mobilité a été accrue par les politiques néolibérales des années 1980 et les innovations financières qui les ont accompagnées[9]. Cette mondialisation du capital concerne principalement le marché de l’investissement et l’immobilier d’entreprise, à la différence de la promotion immobilière et du logement qui sont longtemps restés des domaines davantage organisés par des acteurs nationaux et régionaux[10]. Si cette transformation n’efface pas l’importance des acteurs publics qui détiennent encore des pouvoirs de décision (règlements d’urbanisme) et d’investissement (dans les transports publics par exemple), elle complique leur exercice : en jouant Paris contre Tokyo, les investisseurs détiendraient un avantage stratégique dans les négociations[11].
La circulation mondiale du capital s’accompagne aussi de celle de l’expertise et des modèles de développement urbain qui s’exportent d’une ville à l’autre via des réseaux de conseil et d’ingénierie[12]. Situés à l’interface des marchés globaux de capitaux et immobiliers locaux, les promoteurs et conseils en immobilier jouent un rôle charnière dans cette circulation[13] : depuis leur internationalisation dans les années 1980, les entreprises anglo-américaines de conseil en immobilier comme BNP Paribas Real Estate, CBRE, Cushman & Wakefield ou Jones Lang Lasalle, proposent une variété de services standardisés à des clients privés (investisseurs, grandes entreprises locataires), mais aussi publics, depuis l’élaboration de stratégies d’investissement et de programmation urbaine jusqu’à la gestion locative[14]. Elles contribuent ainsi à la circulation des capitaux et des « bonnes pratiques » pour les attirer.
La mondialisation de l’immobilier va de pair avec sa financiarisation, c’est-à-dire avec le « rôle accru d’acteurs, de capitaux, d’instruments et de méthodes calculatoires de la finance » dans le secteur[15]. Ce processus de financiarisation se concrétise par l’importance des acteurs des marchés de capitaux, à l’instar des Deutsche Bank, Crédit Suisse ou CBRE Global Investors. Investisseurs institutionnels (compagnies d’assurance et mutuelles, fonds de pension et caisses de retraite, fonds souverains) et alternatifs (société de gestion de portefeuille, hedge funds), ou encore sociétés cotées en Bourse (les real estate investment trusts aux États-Unis, connus sous le nom de sociétés immobilières d’investissement cotées en France) : par-delà leurs différents statuts, ces acteurs se chargent de collecter les capitaux des individus (retraités, assurés, particuliers fortunés) et des organisations (entreprises, État) et de les placer pour les rémunérer, notamment via la construction et/ou la location d’immeubles dont ils sont propriétaires. Dans le cas de l’immobilier d’entreprise par exemple, les bâtiments ne sont plus seulement un moyen de production pour les entreprises qui en sont locataires, mais aussi un objet de placement. À l’échelle mondiale, les placements immobiliers des cents plus gros investisseurs pèsent près de 5 000 milliards d’euros, soit plus de deux fois le PIB de la France[16]. Un chiffre en progression dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille chargées d’investir pour le compte des institutionnels et des particuliers : depuis la crise de 2008, le montant des actifs sous gestion des dix plus grosses d’entre elles a été multiplié par trois[17].
La financiarisation de l’immobilier passe aussi par le développement d’instruments de titrisation. En transformant des droits de propriété sur des terrains ou des immeubles en titres financiers qui peuvent s’échanger sur les marchés internationaux, ces instruments permettent de « créer de la liquidité à partir de la fixité »[18]. C’est par exemple le cas des fonds : en achetant des parts de ces produits plutôt que des immeubles directement, les investisseurs peuvent par exemple entrer (et sortir) plus facilement de l’immobilier. La valeur de ces titres est désormais calculée en fonction des revenus futurs « ajustés du risque », c’est-à-dire en comparaison à d’autres placements financiers perçus comme sûrs (comme les titres de dette émis par les États les plus stables). Les investisseurs cherchent à réduire ces risques en diversifiant leurs placements entre produits (actions, obligations, secteurs dits alternatifs dont fait partie l’immobilier), espaces (pays, villes, quartiers), ou encore timing dans la chaîne de production urbaine (acquisition foncière, promotion-construction, gestion locative). Et pour booster leurs revenus, ils jouent simultanément sur des techniques d’endettement leur permettant de décupler leur pouvoir d’achat et la rentabilité de leurs capitaux.
Peu accessibles au profane, ces transformations dans la mécanique immobilière ont pourtant de puissants effets sur les villes. La plus grande interconnexion entre marchés financiers internationaux et marchés immobiliers locaux se traduit par la formation fréquente de bulles spéculatives, et leur éclatement. Dans le cas de la crise des subprimes survenue aux États-Unis en 2007, ces dynamiques ont débouché sur l’expulsion de millions de ménages incapables de rembourser leurs crédits et sur la prise en charge publique des pertes financières privées.
La financiarisation de l’immobilier n’aboutit pas uniquement à de violentes secousses : elle produit également des effets moins spectaculaires mais tout autant structurels. Elle contribue à renforcer le pouvoir des acteurs financiers lorsqu’il s’agit de décider comment, pourquoi, pour qui, et où produire la ville. Ils tendent en effet à privilégier les métropoles dominantes, leurs pôles économiques et leurs grands projets d’aménagement. Dans ces espaces, l’immobilier de bureau constitue leur domaine de prédilection, à condition que les bâtiments offrent une taille critique, une architecture standardisée permettant leur adaptabilité, et qu’ils soient occupés par des locataires réputés[19]. Centres commerciaux et plateformes logistiques ont aussi leur faveur – tout comme le logement qui, longtemps délaissé, émerge aujourd’hui comme une « classe d’actif » certes un peu moins rentable, mais plus sécurisée.
Sous ce rapport, « le Marché international des professionnels de l’immobilier » décline en réalité une approche très financière de l’immobilier, mobilisé comme une source de revenus financiers futurs (via les loyers et/ou une plus-value à la revente) et comparables avec d’autres placements. « En poussant la logique à l’extrême, un investisseur pourrait téléphoner depuis New York et acheter des “bureaux prime à Londres” avec un besoin d’information aussi limité que lorsqu’il achète de l’or ou des titres de dette souveraine », ironisait déjà un urbaniste aux prémices du processus[20]. C’est dans cette optique que les investisseurs viennent à Cannes, où on leur déroule le tapis rouge. En tant que visiteurs, ils sont libres de déambuler parmi les opportunités présentées par les territoires à l’affût de leurs milliards. Ils constituent ainsi l’argument commercial de l’événement, comme l’exprime la communication officielle mettant systématiquement leur présence en avant[21].
S’intéresser au Mipim, c’est donc l’occasion de saisir la financiarisation de la ville. Pour reprendre les observations du sociologue Romain Lecler sur d’autres salons mondialisés, le Mipim se présente comme l’un des avant-postes de la financiarisation « en train de se faire, ou plutôt en train d’être faite »[22]. Autrement dit, l’événement ne doit pas seulement se comprendre comme le reflet d’un processus extérieur, mais participe directement de sa production. En tant que place marchande de l’immobilier au croisement des politiques urbaines entrepreneuriales et des marchés de capitaux, il donne accès à son épaisseur spatiale et sociale.
Le pouvoir d’accréditation de la finance
Comprendre ce qui se joue sur le salon suppose toutefois d’aller au-delà de la stricte métaphore du marché. L’événement se présente certes comme le « marché » où se rencontrent l’offre de projets en demande de capitaux d’une part (les territoires), et l’offre de capitaux en demande d’opérations immobilières d’autre part (les investisseurs). Et pourtant : rares sont les transactions au Mipim. Il y a bien quelques signatures, mais elles relèvent plutôt de la communication orchestrée que de négociations topées à Cannes. Même les initiés qui passent leur temps à côtoyer des investisseurs sur le salon reconnaissent cette « vérité déroutante » : en matière de transactions strictes, « très peu de choses se passent réellement au Mipim »[23].
Avancé par le philosophe Michel Feher, le concept « d’accréditation » permet de dénouer cet apparent paradoxe. Dans son essai Le temps des investis, il caractérise les logiques sociales et politiques du capitalisme financiarisé[24]. Alors que le projet néolibéral visait à généraliser « l’ethos entrepreneurial » guidé par la raison utilitariste, force est de constater que les entreprises, les gouvernements et les individus se comportent plutôt comme des « investis » qui dépendent de l’obtention du crédit auprès des marchés financiers. Ce crédit est double : il est à la fois monétaire, au sens où les investisseurs des marchés apportent des capitaux ; et moral, car la relation entre un créancier et son débiteur repose sur la réputation de ce dernier et fait intervenir un ensemble de devoirs pour honorer ses engagements[25]. L’accréditation peut donc se concevoir comme une forme du pouvoir des investisseurs fondée sur l’évaluation de la valeur sur ces deux plans. Pour Feher, ce pouvoir se manifeste ainsi « par un infléchissement de la conduite des agents économiques : car, dans la mesure où ceux-ci sont prioritairement habités par le souci de se rendre attractif aux yeux des investisseurs, leur motivation prioritaire n’est pas tant le profit qu’ils espèrent tirer de leur activité que l’obtention du crédit qui lui permet de l’exercer »[26]. Il opère ainsi un tri parmi les organisations et individus en fonction de leur capacité à donner des gages de rentabilité et de moralité.
En tant que grille de lecture des mécanismes de valorisation économique – et donc de pouvoir – au cœur du capitalisme, l’accréditation permet de comprendre le fonctionnement du Mipim et son rôle dans la production urbaine. Dans le langage des salons, l’accréditation désigne généralement le badge autorisant à participer à l’événement, qui signale ainsi que l’on fait partie d’un cercle fermé. Sur un plan plus conceptuel, elle fournit une clé d’interprétation des rapports de pouvoir entre les acteurs de la finance et de l’urbanisme dans les territoires où les premiers cherchent à déployer leur emprise.
Au Mipim, l’accréditation se joue à deux niveaux. À travers les thématiques abordées dans les conférences (le développement durable hier, l’innovation numérique et le défi climatique aujourd’hui), la publication des résultats sur tel secteur d’investissement ou telle région, ou la myriade d’interactions dans les allées du Palais et les suites des hôtels, le salon contribue d’abord à alimenter les représentations des investisseurs et de leurs intermédiaires – et donc leur perception du risque. En ce sens, l’événement n’est pas un simple « baromètre » indiquant passivement la conjoncture du marché à mesure que se déversent les litres de champagne, comme on peut souvent le lire dans la presse[27]. Au contraire, il contribue directement aux anticipations des acteurs de marché, et donc à leurs décisions. En faisant la promotion de tel territoire ou sujet, les acteurs impliqués dans le salon participent donc à produire et faire évoluer les réputations qui interviennent dans l’accréditation par les marchés financiers.
Dans le même temps – c’est le second niveau –, le salon facilite la circulation des représentations des investisseurs auprès des acteurs publics qui cherchent à obtenir leur crédit. Cette fonction est d’autant plus importante que la participation des pouvoirs publics s’est développée depuis deux décennies. Elle permet de comprendre pourquoi, malgré l’absence de transactions sur le salon, ces derniers continuent d’y participer régulièrement au prix de moyens humains et budgétaires sans commune mesure : en venant au Mipim, les élus et aménageurs cherchent à obtenir le crédit des investisseurs dans le but de pouvoir mener à bien leurs politiques de développement territorial et leurs projets d’urbanisme. Selon la logique néolibérale du ruissellement, il s’agit de compter aujourd’hui dans l’opinion des investisseurs pour espérer accéder à leurs capitaux demain, et créer des emplois, des retombées fiscales et obtenir des votes après-demain.
C’est pourquoi l’absence de transactions immédiates ne veut pas dire que l’accréditation est sans effets. Soumis aux jugements des investisseurs, les métropoles tentent d’anticiper leurs attentes en matière de produits immobiliers et leurs implications pour l’urbanisme, par exemple en termes de mixité des usages des bâtiments ou de connexion aux transports. Cette acculturation se donne à voir sur le salon, où les choix en apparence triviaux comme l’aménagement d’un stand, le lieu d’une conférence, ou encore le contenu d’un discours sont autant d’occasions pour les exposants de démontrer leur prise en compte des normes d’investissement. Des normes qui, dans certains cas, infusent bien au-delà du déplacement à Cannes jusque dans l’élaboration ici d’une stratégie métropolitaine, là d’un grand projet d’aménagement.
En définitive, l’accréditation permet de saisir à quel point les logiques de gouvernement des métropoles sont celles en vigueur sur les marchés financiers, où dominent les investisseurs et leurs représentations, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne des populations qui y vivent.

Enquêter dans les allées et les coulisses du salon
Ce livre s’appuie sur une enquête de terrain menée au long cours depuis 2012. Pour appréhender en pratique l’accréditation telle qu’elle se joue au Mipim, autant s’y rendre. Mais pousser les portes du Palais soulève immédiatement des enjeux matériels et stratégiques, par exemple en matière d’accès à l’événement et de positionnement dans son ambiance affairée[28]. J’ai arpenté les allées du salon comme visiteur, où j’ai pu observer l’organisation et l’activité sur les stands, assister à des conférences et aborder des exposants lors des éditions 2012 et 2018 à Cannes, et en 2018 à Londres (pour la version du salon dédiée au marché britannique). Se rapprocher des « investis » en quête de crédit a permis d’approfondir de l’intérieur le décryptage des logiques de l’accréditation. En 2019, j’ai accompagné l’un des exposants publics dans le pavillon du Grand Paris pour suivre au plus près l’activité de ses représentants, depuis l’accueil sur le stand jusqu’aux rendez-vous d’affaires, en passant par les cocktails et autres moments informels.
Il est aussi nécessaire d’enquêter sur le salon, mais ailleurs : dans la presse et les archives des exposants publics[29] ; et surtout dans les bureaux des responsables chargés de l’organisation générale de l’événement, ou de ceux qui coordonnent la présence de tel territoire, et se chargent de le représenter sur place[30]. En bref, dans les coulisses de l’événement, et plus exactement de sa préparation. Tracer la circulation des normes d’investissement et leur éventuelle incorporation suppose de considérer le Mipim comme l’une des scènes où se joue désormais la pratique quotidienne de l’urbanisme, et dont les effets se mesurent selon une double temporalité et spatialité. D’une part, l’acculturation transite autant in situ, pendant les trois ou quatre jours sur place à Cannes, que dans la préparation du salon et le suivi des contacts noués sur place. D’autre part et comme on le verra, le salon peut potentiellement avoir des effets au long cours, qui excèdent l’espace-temps de l’événement.
À partir de cette approche, le livre combine trois angles pour tirer le fil rouge de l’accréditation des territoires par la finance. Le premier reconstitue la fabrique du Mipim et son évolution au gré des transformations de l’immobilier, et singulièrement de sa financiarisation (chapitres 1 et 2). Suivant l’idée que les salons sont le fruit d’un « travail marchand » à travers lequel leurs organisateurs « participent à la construction et à la définition du marché »[31], l’enquête s’intéresse à Reed Midem, l’entreprise qui gère l’événement, et à ses relations avec d’autres acteurs à l’intérieur et à l’extérieur du salon. Ses choix en matière de positionnement commercial du salon, de son agencement spatial, de sa programmation thématique, ou encore ses conseils aux exposants publics sont autant d’occasion d’interroger son rôle dans l’accréditation.
La participation des métropoles constitue le second angle au coeur de l’enquête (chapitres 3 à 6). En suivant les représentants du Grand Paris et du Grand Lyon dans les allées du salon et les coulisses de sa préparation, il s’agit de saisir l’accréditation depuis le point de vue de deux territoires « investis » qui occupent des places privilégiées dans la hiérarchie urbaine, quoique différentes. Occasionnellement, le détour par Londres s’impose, tant la capitale britannique est perçue comme l’avant-garde de la participation des métropoles au salon. Ici, l’enjeu central est de comprendre dans quelle mesure et comment le Mipim à l’appréhension des attentes des investisseurs par les élus et les aménageurs, et à leur éventuelle incorporation dans des politiques urbaines.
Le troisième et dernier angle part de l’émergence de tentatives de remise en cause de l’accréditation. À partir de 2014, le Mipim devient la cible de mobilisations dénonçant la participation des responsables politiques au salon et les dynamiques de spéculation foncière et immobilière qu’elle génère. La couverture médiatique et les récits militants ont permis de reconstituer les contours de ces contestations émergentes. Aux côtés de militants pour le droit au logement et à la ville mobilisés contre sa version parisienne de 2019, l’enjeu était aussi de comprendre comment le Mipim était approché, et de quels débats théoriques et tactiques il est porteur pour les luttes urbaines en se situant sur leur « seuil »[32]. Côté salon, ces mobilisations permettent d’interroger la réception de la critique militante en sondant ses liens éventuels avec la place croissante accordée au logement sur le Mipim.
En dévoilant les ressorts et les effets de l’accréditation des territoires par la finance ainsi que ses contestations, il s’agit en somme de proposer une analyse critique des transformations du capitalisme urbain.
*
Illustration : Antoine Guironnet, MIPIM au Palais des Festivals, Cannes, 2019.
Notes
[1] « Champagne, béton et quête de sens pour la grand-messe de l’immobilier », Le Monde, 11 mars 2019 ; « Mipim : un marché très promoteurs », Libération, 15 mars 2015.
[2] G. Rabin, « MIPIM : le règne des marchands de ville », Urbanisme, n°344, 2005.
[3] G. Pinson, La ville néolibérale, Presses Universitaires de France, 2020.
[4] D. Harvey, « Vers la ville entrepreneuriale. Mutation du capitalisme et transformations de la gouvernance urbaine », in C. Gintrac, M. Giroud (dir.),Villes contestées. Pour une géographie critique de l’urbain, Les Prairies ordinaires, 2014.
[5] M. Adam, « Marketing. La quête du capital symbolique », in M. Adam, E. Comby (dir.), Le capital dans la cité. Encyclopédie critique de la ville, Éditions Amsterdam, 2020.
[6] A. Delfini, R. Snoriguzzi, Contre Euralille : une critique de l’utopie métropolitaine, Les Étaques, 2019.
[7] L. Halbert, « Les deux options métropolitaines des politiques de développement territorial », Annales de Géographie, n°689, 2013.
[8] A. Haila, « The neglected builder of global cities », in O. Källtorp, I. Elander, O. Ericsson, M. Franzén (dir.), Cities in Transformation – Transformation in Cities: Social and Symbolic Change of Urban Space, Aldershot: Ashgate, 1997. Sauf mention contraire, toutes les traductions de l’anglais sont celles de l’auteur.
[9] J. R. Logan, « Cycles and Trends in the Globalization of Real Estate », in P. Knox (dir.), The Restless Urban Landscape, Prentice-Hall, 1993.
[10] A. Wood, « The Scalar Transformation of the U.S. Commercial Property-Development Industry: A Cautionary Note on the Limits of Globalization », Economic Geography, n°2, 2004.
[11] J. R. Logan, « Cycles and Trends in the Globalization of Real Estate », op. cit.
[12]K. Olds, Globalization and urban change: capital, culture, and Pacific Rim mega-projects, Oxford University Press, 2001.
[13]L. Halbert, H. Rouanet, « Filtering Risk Away : Global Finance Capital, Transcalar Territorial Networks and
the (Un)Making of City-Regions : An Analysis of Business Property Development in Bangalore, India », Regional Studies, n°3, 2014.
[14]T. LaPier, Competition, growth strategies, and the globalization of services: real estate advisory services in Japan, Europe, and the United States, Routledge, 1998.
[15]A. Guironnet, « Financiarisation. Quand la finance capitalise sur la ville », in M. Adam, E. Comby (dir.), Le capital dans la cité. Encyclopédie critique de la ville, Éditions Amsterdam, 2020.
[16] « Top 100 Real Estate Investors 2019 », IPE Real Assets, mai-juin 2019, https://realassets.ipe.com/
[17]Property Funds & Institutional Real Estate, Inc., « Global Investment Managers 2019 », 2019, http://www.propertyfundsresearch.com/.
[18] K. F. Gotham, « Creating Liquidity out of Spatial Fixity: The Secondary Circuit of Capital and the Subprime Mortgage Crisis », International Journal of Urban and Regional Research, n°2, 2009.
[19] A. Guironnet, L. Halbert, « Produire la ville pour les marchés financiers », Espaces et sociétés, n°174, 2018.
[20] M. Edwards, « Planning and the land market: Problems, prospects and strategy », in M. Ball, V. Bentivegna, M. Edwards, M. Folin (dir.), Land Rent, Housing and Urban Planning. A European Perspective, Croom Helm, 1985.
[21] Reed Midem, « Les plus grands investisseurs et institutions financières de l’immobilier seront au MIPIM 2018 », communiqué de presse, 28 février 2018.
[22] R. Lecler, « Resituer la mondialisation. Récit d’une enquête sur la prise en charge administrative de l’audiovisuel international en France », Terrains/Théories, n°5, 2016.
[23] « Feature : MIPIM Uncensored », 1er avril 2011, PERE, https://www.perenews.com/.
[24] M. Feher, Le temps des investis : essai sur la nouvelle question sociale, La Découverte, 2017.
[25] D. Graeber, Dette. 5000 ans d’histoire, Babel, 2016.
[26] M. Feher, Le temps des investis, op. cit., p. 15.
[27] « Depuis vingt-cinq ans, le miroir fidèle des hauts et des bas du marché immobilier », Les Échos, 12 mars 2014.
[28] Le prix d’accès au salon (auquel il faut ajouter celui de l’hébergement) constitue un premier obstacle. Hormis le Mipim UK de Londres en 2018, mes trois participations aux éditions cannoises ont été gratuites. En 2012, l’accès au salon m’a été accordé dans le cadre d’un contrat entre Reed Midem et l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, en contrepartie d’une étude sur les évolutions de la fréquentation du salon menée à partir de la base de données interne de l’entreprise. Sans avoir été impliqué dans sa réalisation, j’ai pu accompagner Ludovic Halbert sur le salon. Qu’il en soit ici remercié. En 2018 et 2019, la gratuité m’a été accordée sur demande et sans aucune contrepartie, vraisemblablement grâce à ce premier contact. Idem pour l’accompagnement d’un exposant du pavillon du Grand Paris. Une fois sur le salon, il a fallu s’orienter parmi une foule de 25 000 personnes en trouvant une forme d’équilibre pour « en être », tout en tenant à marquer ma position extérieure, par exemple en ne portant pas de costume. Dans un salon avant tout fréquenté par des hommes blancs, ma propre position d’homme blanc anglophone a sans doute facilité ma capacité à accéder à certaines personnes et à me fondre dans des situations d’observation.
[29] Au total, près de 250 articles composent ce corpus croisant entrées thématiques (sur le salon, le pavillon du Grand Paris, et les mobilisations contre le Mipim) et revue de la presse généraliste (Le Monde), économique (Les Échos), et professionnelle (Le Moniteur, Business Immo).
[30] Une trentaine d’entretiens semi-directifs ont été menés de mars 2018 à novembre 2019, complétée par une dizaine d’entretiens à la volée menés lors de l’édition 2018, et ceux réalisés antérieurement avec les membres de la délégation représentant l’agglomération lyonnaise et la Seine-Saint-Denis.
[31] J. Brailly, G. Favre, E. Lazega, « Organiser la concurrence sur un salon : soutien, discipline et laisser-faire », in P. Castel, L. Hénaut, E. Marchal (dir.), Faire la concurrence, Presses des Mines, 2016.
[32] D. Fassin, « Une science sociale critique peut-elle être utile ? », Tracés, n°9, 2009.