
Relier Marx et féminisme à l’ère de la mondialisation
Nous publions ici un chapitre du livre de Martha E. Giménez, intitulé : Marx, Women and Capitalist Social Reproduction (publié chez Brill dans la collection « Historical Materialism »). Théoricienne féministe très importante, mais quasiment inconnue en France (à notre connaissance un seul de ses textes a été traduit en français, par la revue Actuel Marx), Martha E. Gimenez est d’origine argentine et a enseigné la sociologie à l’Université du Colorado.
Son livre (et ce chapitre) aborde les questions de la reproduction de la force de travail, du travail domestique, de la féminisation de la pauvreté, ou encore des technologies reproductives. Son propos consiste à relier ces analyses à leurs enjeux politiques, plaidant pour une articulation entre les luttes féministes et les luttes de classe, par-delà les approches – intellectuelles et politiques – en termes d’intersectionnalité.
Ce chapitre a été traduit par Christelle Compte.
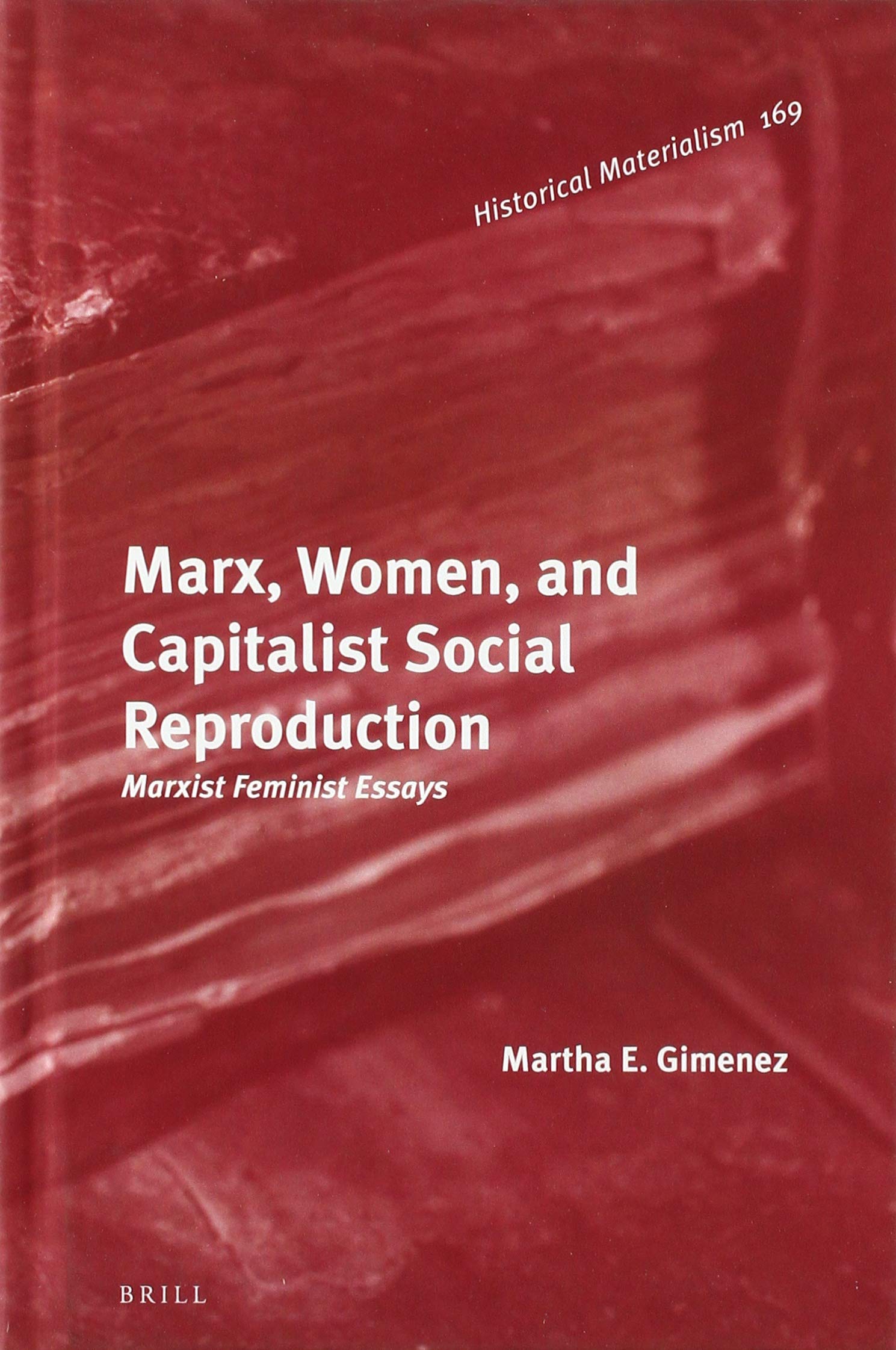
L’objectif de ce chapitre est d’explorer la pertinence de certaines perspectives méthodologiques de Marx pour penser des problématiques et politiques féministes dans le contexte de la mondialisation. Dans cette brève introduction, je voudrais énoncer ci-après quelques observations générales.
Depuis la chute de l’Union soviétique et le démantèlement du bloc socialiste, la « mondialisation » est devenue l’angle par lequel tout doit être vécu, interrogé et pensé. Contre la posture selon laquelle tout ce que l’on connaissait ou que l’on pensait connaître – y compris Marx et le féminisme – doit être repensé sous l’angle de la mondialisation, j’affirme au contraire que c’est à travers l’angle des travaux de Marx et de celles et ceux qui ont suivi ses traces que nous pouvons pleinement saisir la nature de la mondialisation. Plus encore, c’est à travers l’angle du féminisme marxiste que nous pouvons pleinement saisir non seulement les répercussions de la mondialisation sur les femmes, mais aussi les conditions matérielles qui déterminent les schémas idéologiques à travers lesquels les femmes comprennent l’évolution de leurs conditions d’existence. Finalement, pour aller au-delà de ces schémas idéologiques, je soutiens qu’une nouvelle forme de féminisme est nécessaire, qui serait pleinement consciente de ses présupposés idéologiques, de ses spécificités et conditions de possibilités historiques et, par conséquent, des limites capitalistes des politiques du genre.
Pour étayer cette affirmation, je traiterai des caractéristiques de la mondialisation et de ses effets sur les femmes. Je présenterai une critique marxiste du concept de mondialisation. Je tracerai les grandes lignes des polarisations théoriques et idéologiques au sein de la pensée féministe qui ont émergé dans le contexte de la mondialisation. Enfin, je présenterai une manière alternative de penser Marx, le féminisme et la mondialisation qui transcende ces polarités dans la pensée féministe et ouvre la voie à une compréhension théorique et politique différente des options politiques pour les femmes dans le contexte de la mondialisation.
1. Postulats de départ
Tout d’abord : qu’est-ce que la mondialisation ? La mondialisation est une manière dépolitisée et euphémistique de faire référence à l’expansion du capitalisme à travers le monde. C’est une manière fétichisée de parler des effets du développement capitaliste sans avoir à parler du capitalisme en soi. Utiliser le terme de mondialisation permet de ne pas reconnaître la base matérielle capitaliste des phénomènes regroupés sous le terme de « mondialisation »[1]. À la mode, omniprésente, la mondialisation est, comme le confirme sa valeur marchande, une manière fondamentalement conservatrice de penser et d’analyser les processus actuels de transformations sociales, économiques, politiques et culturelles. L’intensité, la vitesse et les effets dramatiques des victoires économiques et idéologiques du capitalisme au sein de pays pauvres et endettés, y compris en Europe de l’Est, renforcent l’idée qu’il n’y a pas d’alternatives aux politiques économiques libérales ni à la mainmise de rapports et d’idéologies capitalistes sur l’ensemble de la planète. Le discours autour de la mondialisation lui-même matérialise une puissante idéologie qui dissimule la nature capitaliste de ces processus et de leurs effets, et, par conséquent, les racines, dans le mode de production capitaliste, des inégalités croissantes et du déclin des niveaux de vie, ces phénomènes touchant la majorité de la population mondiale, en particulier les femmes, depuis la chute du mur de Berlin en 1989[2].
Ensuite : qu’est-ce que le féminisme ? J’affirme que le mouvement des femmes constitue une réponse au développement du capitalisme dans les économies post-industrielles. Dans les pays capitalistes avancés, le capitalisme a produit des effets contradictoires sur les femmes. Il a contribué à ébranler les formes traditionnelles d’inégalités de genre, tout en créant de nouvelles formes qui, paradoxalement, ont contribué à l’accroissement des inégalités de genre à long terme. L’économie capitaliste a ouvert la voie à de nouvelles opportunités d’emploi et d’éducation pour les travailleuses, particulièrement pour les femmes de classes moyenne et moyenne supérieure. À leur tour, ces opportunités participent à leur capacité de concevoir et de lutter pour leur autodétermination. À court terme, se crée une intensification des inégalités, mais à long terme les opportunités des travailleuses non propriétaires s’améliorent.
Il est important de reconnaître les différences qui existent dans les effets et dans la temporalité de ces processus, différences liées aux caractéristiques spécifiques des différents pays, à leur histoire, à leur niveau de mainmise et de développement capitalistes et à leur mode d’insertion dans l’économie mondiale. Néanmoins, il serait possible d’affirmer qu’à mesure que le capitalisme s’est développé, les travailleuses ont pu cesser le travail à la ferme, comme domestique et les stratégies de survie économique dans la sphère domestique (par exemple prendre des pensionnaires, faire la lessive, coudre, ou produire des biens pour des marchés locaux) pour trouver du travail en usine, en bureau, dans les grands magasins, dans les écoles, et finalement dans les professions libérales et dans les affaires. Dans les pays capitalistes plus avancés, comme aux États-Unis, les injonctions contradictoires de la famille et du travail rémunéré ou salarié ont déclenché la résistance des femmes et contribué à l’ascension du Women’s Liberation Movement (Mouvement de Libération des Femmes) dans les années 1960.
L’un des problèmes politiques et théoriques majeurs était le travail domestique, un sujet qui a engendré une littérature abondante et intéressante ainsi que la montée d’idéologies exhortant à une division égalitaire du travail domestique. Comme je l’affirmais dans de précédents travaux[3], si la plupart des travailleuses aux États-Unis comme dans d’autres pays riches avaient pu bénéficier de servantes domestiques à temps plein, le sujet controversé de la division du travail domestique n’aurait pas émergé. En Argentine, pays au sein duquel le capitalisme n’avait pas encore créé d’opportunités pour la plupart des femmes de la classe ouvrière, le travail domestique durant les années 1950 et 1960 était la source principale d’emploi pour les femmes modestes, particulièrement les jeunes et les célibataires, et la plupart des foyers de classe moyenne employaient des domestiques, des cuisinières et des nourrices, à l’heure ou en les faisant vivre sur place, comme c’était souvent le cas. À mesure que les opportunités de travail salarié se sont accrues en Argentine, le travail domestique est devenu plus rare, plus cher et accessible seulement pour les très riches. Les États-Unis comme l’Argentine ont été et continuent à être régis par des inégalités de genre ; mais ces dernières ont pris différents visages et provoqué différents degrés de conscientisation parmi les femmes.
Aux États-Unis, les luttes des femmes ont fini par permettre des changements juridiques, politiques et idéologiques qui ont fait avancer l’intégration des femmes dans la population active, dans l’éducation et comme soutien de famille. En Argentine, le développement du capitalisme a finalement créé des opportunités pour les femmes de classe ouvrière, leur offrant de meilleurs alternatives que l’emploi domestique. Pour autant, l’expérience argentine, qui a reproduit les changements ayant eu lieu aux États-Unis à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, n’est pas caractéristique de tous les pays en développement, mais elle permet de mettre en lumière les différences de temporalité et d’autres conditions caractérisant l’évolution de l’impact du développement du capitalisme sur le statut des femmes.
En outre, ces processus sont inégaux ; ils contribuent aux objectifs libératoires et émancipatoires des femmes les plus privilégiées tout en renforçant l’oppression des femmes prolétaires. Aux États-Unis par exemple (et très probablement dans d’autres pays riches), les médias vantent l’accroissement du nombre d’entreprises (cependant généralement modestes) possédées par des femmes et la présence d’un nombre dérisoire de femmes dans les listes annuelles des personnes les plus fortunées. Et la proportion des femmes dans les postes de direction, d’administration et de management, tout comme dans des professions considérées autrefois comme « masculines » (par exemple : médecin, avocat, architecte), a en effet augmenté depuis les années 1970 ; aujourd’hui, les femmes constituent environ 50% de la population étudiante à l’université. La discrimination positive et l’amélioration des droits civiques ont ouvert des portes aux femmes et leur ont permis de lutter pour des salaires équitables et de meilleures conditions de travail.
Mais en dépit d’avancées considérables en matière d’éducation, d’emploi et de revenu, la majorité des femmes est toujours restreinte à certains postes en fonction de leur sexe et remplit les fonctions hiérarchiques les plus subalternes. Les travailleuses ont toujours de plus fortes probabilités d’être infirmières, diététiciennes ou institutrices que pilotes, ingénieures ou dentistes[4]. Les changements sont par conséquents inégaux, et autant les opportunités et la qualité de vie des travailleuses diplômées et relativement privilégiées s’améliorent, autant les choses ont empiré pour les femmes qui demeurent majoritairement piégées dans des emplois peu rémunérés et qui leur sont réservés en tant que femmes. Il n’y a pas de meilleur indicateur de l’approfondissement des différences de classes et de statuts socio-économiques parmi les femmes que la croissance du nombre de sociétés comme Merry Maids, qui propose des domestiques pour les femmes de classe supérieure et moyenne-supérieure et leurs familles[5].
Ces avancées dans le statut des femmes les plus privilégiées ont été caractéristiques de l’expérience des pays capitalistes avancés, dans lesquels le développement capitaliste a entraîné des changements non seulement au niveau de la production (par exemple : la prolétarisation et la marchandisation) mais aussi au niveau du droit à la propriété, de la division du travail, de l’urbanisation, de l’éducation, de la santé, des processus démographiques (par exemple : le déclin de la mortalité et de la fertilité, la baisse de la taille de la famille), de l’éducation de masse et de l’emploi, à mesure que les pays ont suivi le pas de la Grande-Bretagne sur deux siècles d’industrialisation. Surtout, les contradictions du développement capitaliste ont mené à des mobilisations et à des contestations politiques majeures du statu quo par des syndicats et d’autres mouvements sociaux. Parmi ces derniers, l’ascension des mouvements de libération des femmes à la fin des années 1960 et le développement, dans son sillage, du féminisme universitaire, furent centraux.
Une fois ces mouvements disparus, le féminisme universitaire est devenu le lieu principal des activités féministes, la théorisation et la recherche étant devenues des alternatives fonctionnelles au militantisme et les politiques féministes, ayant perdu leurs préoccupations radicales et socialistes, se sont poursuivies dans une voie essentiellement réformiste et libérale, via des lobbys, des élections ainsi que de multiples cadres institutionnalisés et implantés localement. Ces changements ont été propices à l’émergence d’une « aristocratie » de femmes, aussi différente dans ses destins de vie des femmes du reste du monde (excepté les femmes de la bourgeoisie dans les pays pauvres) que les premières « aristocraties du travail » l’étaient de la majorité de la classe ouvrière.
Troisièmement, j’affirme que l’émergence d’une aristocratie de femmes provient d’une exploitation du tiers-monde. L’émergence d’une classe de travailleuses riches et puissantes dans les pays capitalistes avancés a été rendue possible par les relations d’exploitation des pays impérialistes sur leurs colonies ou néo-colonies. Du fait de la nature systémique du développement du capitalisme, où la richesse d’un petit nombre est basée sur l’exploitation et la pauvreté d’un grand nombre, les inégalités économiques au sein et entre les nations sont inévitables. Dans le meilleur des cas, certains pays « intermédiaires » (par exemple les dénommés « tigres asiatiques ») peuvent progresser alors que la plupart des pays stagnent ou perdent du terrain (par exemple : l’Argentine, la Russie ou le Brésil), si bien que « le profil de stratification » du monde tend à demeurer relativement inchangé. En d’autres termes, les inégalités structurelles, à un niveau d’analyse mondial, demeurent relativement inchangées, même si certains États-nations peuvent monter ou descendre les échelons sociaux, tout comme la distribution de richesses et de revenus dans les pays capitalistes centraux ou avancés ne sont pas fondamentalement altérés / modifiés, en dépit du fait que chaque année une proportion variable de la population vit une mobilité sociale ascendante ou descendante.
Par profil de stratification, j’entends la distribution structurelle des richesses et des revenus. Historiquement, le profil de stratification aux États-Unis est resté relativement inchangé jusqu’aux années Reagan, lorsque l’écart entre les plus riches et le reste de la population a commencé à se creuser, processus qui s’est accéléré sous Bush avec ses réductions d’impôts approuvées en 2002-2003[6]. Pourtant, à la même époque, les sociologues ont rendu compte d’un certain degré de mobilité individuelle et structurelle. On pourrait relier cela au déclin du secteur industriel et à l’émergence dans l’économie des cols blancs, des services et des technologies de l’information, ce qui signifie que davantage de personnes travaillent en dehors du secteur industriel, du fait non seulement du fait de leur « motivation pour la réussite », mais aussi de la réduction de la demande pour des emplois d’ouvriers. Bien sûr, de temps à autre, des individus se sont élevés de la classe moyenne ou même de la plus basse strate de la classe ouvrière vers la classe capitaliste (par exemple : Bill Gates, Sam Walton, Oprah), tandis que d’autres ont chuté dans la hiérarchie de la classe capitaliste ou de la classe moyenne, et ceci en plus des nombreux individus qui ont vécu une désastreuse mobilité descendante sous l’effet de la désindustrialisation et de la réduction d’effectifs[7]. Mais l’image d’ensemble du profil de stratification états-unien est celle d’une stabilité séculaire.
Je fais la même hypothèse concernant le profil de stratification mondial. L’ascension de certains pays (comme le Japon et la Corée du Sud) et la chute d’autres pays (tels que la Russie et l’Argentine – qui était la 10ème économie mondiale au début du XXe siècle)[8] n’altèrent pas significativement la part de la richesse mondiale contrôlée par les pays centraux. Giovanni Arrighi fait cette hypothèse dans son article : ‘World Income Inequalities and the Future of Socialism’[9]. En d’autres termes, les mobilités ascendante et descendante des individus ou des pays ne changent pas la macro-distribution des richesses. C’est un jeu à somme nulle. Ce qui est possible historiquement pour quelques individus ou États-nations ne l’est pas pour tous les individus et tous les États-nations en même temps. Ainsi, pendant que certains s’élèvent, d’autres chutent et, en pratique, la division générale entre les classes ou entre le centre, la périphérie et la semi-périphérie demeure la même.
Aujourd’hui, les ajustements structurels imposés par le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale sur les pays endettés, qui requièrent la mise en œuvre de politiques économiques néolibérales (incluant la privatisation d’anciens secteurs publics, des coupes claires dans les dépenses de l’État, le démantèlement de provisions sociales et ce que l’on nomme la flexibilisation des contrats de travail) commencent à faire régresser l’économie dans de nombreuses régions du monde. Le chômage et la croissance du secteur de l’économie informelle, la féminisation de la pauvreté, l’exode masculin et plus récemment féminin, ainsi que les inégalités croissantes de revenus et de richesses constituent quelques-uns des effets des politiques économiques visant à entretenir la dette extérieure plutôt que de répondre aux besoins basiques des populations. Pour les riches et les puissants, la mondialisation a pu annoncer « la fin de l’histoire ». Pourtant, pour la grande majorité de la population mondiale vivant dans les pays pauvres et endettés d’Afrique, d’Amérique Latine, d’Asie et d’Europe de l’Est, cela a signifié « la revanche de l’histoire », à mesure que le démantèlement de l’industrialisation subventionnée par l’État et l’adoption du discours néolibéral de la libéralisation et des libres marchés ont sapé le pouvoir des syndicats et détruit à la fois les marchés internes et les économies nationales. (Je préfère mettre l’accent sur les réalités de la situation internationale en me référant aux pays pauvres et endettés plutôt que d’utiliser des métaphores idéologiques ou géographiques comme le Sud ou le Tiers-monde).
Quatrièmement, je soutiens que pour comprendre le féminisme il est nécessaire de distinguer deux niveaux d’analyse. Le premier se situe au niveau du mode de production, alors que le second se situe au niveau de la formation sociale. Selon l’une des injonctions méthodologiques de Marx, il faut faire la différence entre, d’une part, les macro-processus conflictuels et objectifs des changements structurels, et, d’autre part, les processus idéologiques menant les individus à prendre conscience de ces conflits et à lutter contre eux[10]. Au niveau de l’analyse du mode de production en tant que tel, il est théoriquement possible d’identifier les macro-processus capitalistes d’extraction du surplus qui opèrent à la fois dans l’ensemble du monde et au sein des États-nations. Au niveau de l’analyse des formations sociales, en revanche, les contextes politiques, sociaux, culturels et idéologiques au sein desquels ces processus se déroulent sont extrêmement complexes et divers. Ce qui rend difficile, sinon impossible, de prévoir, au sein même des États-nations, les effets empiriques des changements macro-structurels sur les relations politiques et sociales ainsi que sur les degrés de conscientisation.
Il est certain que les médias internationaux et les industries culturelles, associés à la distribution et à la consommation mondiales des biens occidentaux, exercent une influence homogénéisante sur les autres cultures. Je qualifierais cependant cet effet de superficiel. La consommation de nourriture, d’habillement et de divertissement de type occidental ne peut modifier significativement le rôle des États-nations et de cultures locales et nationales dans la production et la reproduction des premières formes d’identités ainsi que des degrés de conscientisation des individus.
Nous pouvons avancer que les effets du pouvoir colonial et néocolonial compromettent l’intégrité des cultures nationales et locales. Il en est peut-être ainsi pour l’observateur extérieur. Mais du point de vue des personnes élevées dans ces contextes, en l’absence d’une étude critique théoriquement fondée de la culture et des identités, qui elles sont et comment elles vivent (ainsi que les idéologies qui guident leurs vies) constituent la « réalité ». Le poids de ces forces sociales et idéologiques est mis en évidence par la manière dont toute personne immigrée participe à recréer des facettes de ses terres d’origine. Que ce soit un combat perdu d’avance, qu’à terme ces personnes développent des identités « hybrides » reflétant à la fois leurs vécus réels et leurs « communautés imaginées » d’origine, là n’est pas la question. L’enjeu crucial au sein des communautés immigrées est la persistance (quoiqu’entremêlée avec de nouvelles habitudes) de traditions, de modèles de parenté, de rôles genrés et d’attentes qui façonnent des identités et des capacités individuelles de concevoir la possibilité de changement. En parallèle, il est néanmoins évident que l’expansion du capitalisme occidental a ébranlé la variété des réseaux économiques et sociaux traditionnels au sein desquels la plupart des gens menaient leur vie, et, par conséquent, les conditions matérielles déterminant les effets des contraintes culturelles, religieuses, idéologiques et morales traditionnelles sur le comportement des gens. C’est dans le cadre de cet ensemble complexe de stabilité et de changement que des questionnements au sujet de Marx, du féminisme et de la mondialisation doivent surgir.
2. Individualisme occidental, féminisme et leurs critiques par des féministes postmodernistes et du tiers-monde
L’émergence de l’individu abstrait, détenteur de droits économiques, politiques, civils et humains, est à la fois un prérequis au développement du capitalisme et un effet structurel capitaliste qui contribue en continu à sa reproduction. Le féminisme est l’une des manifestations principales de l’individualisme occidental. La possibilité de penser non seulement les femmes « en tant que femmes », mais aussi leurs problèmes, leurs droits et leurs besoins comme dissociés des autres relations sociales au sein desquelles les vies des femmes sont nécessairement ancrées, a requis des conditions matérielles qui ne surgissent que dans le contexte d’un capitalisme avancé.
Qu’elles soient libérales, radicales, socialistes ou marxistes, les idéologies féministes reposent sur le socle conceptuel d’une conception des femmes abstraite et transnationale. Les critiques envers cette notion sont similaires à celles érigées à l’égard des sujets ou citoyens politiques, individuels et abstraits qui peuplent le terrain de la démocratie occidentale formelle. La Déclaration et le Programme d’Action de Beijing adoptés lors de la 4ème Conférence mondiale sur les femmes de 1995 organisée par les Nations Unies illustre parfaitement ce positionnement théorique et politique, comme le résume le slogan : « Les droits des femmes sont des droits humains ». L’inclusion explicite des femmes et des filles dans au sein de documents et d’accords sur les droits humains internationaux tels que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 est en elle-même une étape importante dans les luttes féministes. L’engagement en faveur de la totalité des droits humains pour les femmes en tant qu’êtres humains (y compris le droit au travail, à la propriété privée, à l’obtention de crédit, à l’éducation et à la formation pour l’emploi ; à la participation politique, à la liberté de pensée et de culte ; à la santé, à la sexualité et à l’autodétermination en matière de reproduction) fait émerger une conscience sociale sur l’ampleur des problèmes auxquels font face la plupart des femmes aujourd’hui dans le monde, ainsi que sur les nombreux obstacles qui empêchent d’obtenir la moindre amélioration pour les conditions de vie des travailleuses.
Ces droits, qui matérialisent les timides réussites des femmes occidentales, ne sont pas tous accueillis positivement par les femmes dans le reste du monde, car ils questionnent des croyances culturelles et religieuses profondément ancrées. Selon le contexte, ils peuvent être perçus comme une manière d’effriter des réseaux familiaux et sociaux bénéfiques. Un important débat sur les carences du modèle « les droits des femmes sont des droits humains » anime le féminisme académique depuis 30 ans. Tant les théoriciennes féministes postmodernes que les féministes non-occidentales affirment que des notions universalistes des droits des femmes sont inévitablement suspectes, car elles reposent sur une compréhension essentialiste[11] des femmes et de leurs besoins[12]. En outre, ces notions expriment les visions et les vécus de femmes occidentales privilégiées, ignorant ainsi les différences (de classe, de race, d’ethnicité et d’origine nationale) qualitatives (c’est-à-dire significatives, non superficielles) entre les femmes au sein et entre les États-Nations.
Les femmes diffèrent considérablement en termes d’identités, de problèmes et de besoins historiquement déterminés. Du fait des contextes familiaux et communautaires situés et circonscrits qui façonnent leurs vécus, elles se retrouvent nécessairement impliquées dans des luttes politiques différentes, qui sont menées avec divers résultats en tête, au sujet desquels les femmes occidentales ne sont pas nécessairement d’accord. Par exemple, les féministes de cultures musulmanes peuvent considérer l’utilisation du voile comme un acte de résistance face à l’impérialisme occidental, ou bien comme une pratique permettant aux femmes de quitter la maison et de préserver une conduite modeste au regard d’exigences traditionnelles et religieuses, tout en se déplaçant librement pour acquérir des compétences et une formation ou pour participer à la main-d’œuvre. De même, pour les féministes occidentales, la mutilation génitale des femmes est une expression odieuse de domination patriarcale et une violation des droits des femmes. En revanche, certaines féministes africaines voient de telles critiques comme le reflet d’un « manque total de considération du contexte particulier dans lequel les femmes africaines luttent (…) c’est essentiellement aux (…) femmes africaines de décider de se mobiliser sur certains aspects de leur réalité – ceux qui semblent les plus urgemment nécessaires de changer, et de décider comment cette lutte pourrait être menée[13] ». Les féministes non-occidentales rejettent ainsi ce qu’elles perçoivent comme des intentions impérialistes et ethnocentriques qui essentialisent les femmes non-occidentales comme des victimes impuissantes, opprimées par un patriarcat universel et omniprésent. De telles intentions masquent la réalité des vies des femmes non-occidentales et les réalités historiques qui déterminent leurs priorités politiques, leur connaissance d’elles-mêmes et leurs possibilités concrètes[14].
Les féministes postmodernes occidentales identifient l’essentialisme comme la faille centrale des préoccupations des féministes libérales, consistant à conférer aux femmes du monde entier les droits des femmes, et à s’assurer que la mondialisation ne les laisse pas sur le bas-côté. A contrario, les féministes non-occidentales se concentrent sur le fort impact du nationalisme, de la culture, de la religion et des réseaux de parenté sur la structuration de la vie des femmes. Ce sont là des formes de subjectivités et de responsabilités qui rendent l’agenda féministe, non seulement irréalisable, mais aussi inacceptable pour nombre de femmes. Aihwa Ong[15], par exemple, souligne comment, dans les pays asiatiques où des luttes coloniales et postcoloniales ont été menées en termes d’intérêts collectifs du peuple, il est très difficile, voire contraire à la compréhension que les femmes ont d’elles-mêmes, de postuler des droits individuels comme indépendants voire supérieurs aux intérêts de l’État. Dans ce contexte de luttes de libération nationale, les droits individuels des femmes sont subordonnés aux exigences politiques et économiques de l’État pour faire avancer le type de développement économique qui assurerait le bien-être de la population entière. Les idéologies d’État concernant les devoirs des citoyen·ne·s ne sont pas les seules idéologies légitimant les inégalités. Les normes et attentes communautaires, religieuses et familiales restreignent les opportunités des femmes et légitiment l’appropriation de leurs revenus et la subordination de leurs besoins à ceux de la collectivité dans laquelle elles vivent. C’est dans de tels contextes que les femmes doivent développer leurs propres stratégies en vue d’atteindre des objectifs féministes, stratégies qui reconnaissent et soutiennentleur loyauté aux idéologies et réseaux relationnels au sein desquels elles doivent construire leurs vies. Ces femmes ont besoin d’une vision de l’égalité qui n’implique pas le rejet total de leur appréhension d’elles-mêmes et de leurs responsabilités sociales et religieuses.
Il y a ensuite une forte polarité des points de vue. D’un côté, nous avons les objectifs universalistes des féministes libérales exprimés dans des documents produits par les Nations Unies ainsi que par d’innombrables ONG à travers le monde. De l’autre, nous avons la critique par les féministes postmodernes et non-occidentales de ces objectifs, rejetés car perçus comme essentialistes, et l’accent qu’elles mettent sur les différences culturelles, religieuses et nationales par rapport à toute notion universaliste des droits des femmes. Je soutiens ici que cette polarisation des opinions exprime, au niveau idéologique, le développement matériel inégal du monde capitaliste. Ces opinions sont l’expression, au niveau de l’idéologie et des formes de conscientisation, de l’écart conséquent entre les conditions matérielles qui façonnent les expériences et la conscience politique de femmes occidentales et de femmes éduquées en Occident relativement privilégiées d’un côté, et la vaste majorité de la population féminine du monde entier de l’autre.
Une hypothèse majeure sous-tend les deux côtés de cette polarisation. Les féministes libérales partent du principe que les objectifs du féminisme libéral, comme indiqué dans la Déclaration de Beijing et dans d’innombrables autres documents, sont difficiles à réaliser, mais seront un jour atteints après de longues et interminables luttes politiques. Les féministes non-occidentales font cette même supposition. Elles pensent que des visions localisées et alternatives de l’intégration politique, économique et sociale des femmes, qui adoptent les idéaux universalistes occidentaux tout en les modifiant, peuvent se réaliser. Les féministes postmodernes, d’un autre côté, dans la mesure où elles écrivent sur la politique et avec leur positionnement théorique invariablement anti-essentialiste, voient la sphère publique comme fragmentée en une multiplicité de luttes locales impliquées dans des objectifs non généralisables.
3. Les débats au sein du féminisme font écho aux débats sur la théorie de la modernisation : les deux amènent à une impasse
Ces deux voies vers la libération féministe rappellent les débats autour de la théorie de la modernisation qui ont eu lieu entre les années 1950 et les années 1970. Tout comme les théories de la modernisation des années 1950 et du début des années 1960, y compris celles de W. W. Rostow et de bien d’autres[16], qui posaient comme principes les processus de diffusionnisme technologique et culturel, la pensée des féministes libérales présuppose la possibilité de ce qui pourrait être nommé la « modernisation des femmes ». Elles envisagent pour des femmes de pays plus pauvres l’obtention d’opportunités et de droits similaires à ceux dont jouissent les femmes relativement privilégiées dans les pays capitalistes avancés. De même que les critiques non-occidentales de la théorie de la modernisation[17], les féministes non-occidentales soulignent ce qui conduit à une multiplicité de cheminements locaux vers la modernisation féministe, des cheminements qui à la fois modifient et préservent les différences nationales, religieuses et culturelles[18].
Les deux parties, dans ce débat, supposent que l’expérience des pays capitalistes avancés – que ce soit en atteignant la « modernisation » ou le développement économique, ou dans des avancées sur le statut économique et politique des femmes en lien avec la modernisation – peut être reproduite. Elles diffèrent dans leur degré de certitude quant au fait quechaque pays doive suivre la même voie de développement économique (c’est-à-dire l’industrialisation capitaliste), plutôt qu’une « troisième voie » populiste à la Juan Perón, ou bien une voie socialiste ou communiste, comme Cuba ou l’ancienne Union Soviétique.
Pourtant, les archives historiques des 50 dernières années ont montré l’échec à la fois de la théorie de la modernisation et des projets de développement nationaux, qu’ils proviennent de la droite, du centre ou de la gauche. La réussite du développement économique national ou du « capitalisme dans un seul pays » (c’est-à-dire d’un développement économique avancé, ou, dans le cadre d’un système-monde, du statut de « pays central ») est aussi impossible que le succès du « socialisme dans un seul pays », car le capitalisme est, depuis ses origines, un système-monde[19]. Comme Wallerstein l’a affirmé de manière éloquente[20], l’objectif développementaliste qui sous-tend les stratégies de développement bourgeoises nationalistes, populistes, socialistes et communistes en Amérique Latine, en Afrique et en Europe de l’Est s’est soldé par un échec[21].
Malgré les milliards de dollars prêtés aux pays non-socialistes, les objectifs de l’Alliance pour le Progrès en Amérique Latine et les succès à court-terme de stratégies de développement financées par l’État en provenance de la gauche (c’est-à-dire de l’URSS et du bloc socialiste) et de la droite (c’est-à-dire de l’Argentine sous Juan Perón), les pays dits « en développement » n’ont pas réussi à atteindre des niveaux de croissance économique soutenus propices à la croissance des classes moyennes et à la réalisation d’une « modernisation » tant politique que culturelle. Que ce soit sous l’égide d’idéologies et stratégies de développement capitalistes, socialistes ou communistes, le statut de pays « développé » ou « central » est demeuré inatteignable pour la plupart des pays, à l’exception de quelques-uns, comme les dénommés « dragons asiatiques » qui ont atteint un statut semi-périphérique.
La Russie, le premier « pays sous-développé »[22], a échoué également, en dépit de ses succès initiaux et de l’accès au « statut de superpuissance ». Tout comme les pays bien moins « développés » d’Amérique Latine, l’URSS était divisée entre son petit secteur industrialisé « moderne » et son vaste arrière-pays, pauvre et sous-développé, et n’a pas pu résister aux effets des changements technologiques et économiques exponentiels du système-monde. En dépit de sa taille et de son pouvoir, l’URSS, tout comme le reste des pays sous-développés, n’ont pu échapper aux « lois du mouvement » du système-monde capitaliste, qui, alors qu’elles autorisent des pays à connaître individuellement une mobilité ascendante, en font chuter d’autres simultanément afin que le profil de stratification du monde demeure relativement inchangé.
De la même manière, l’obtention en pratique de l’ensemble des droits humains ou des droits des femmes dans chaque pays reste dans une large mesure hors d’atteinte tant que de tels droits présupposent un degré relativement avancé de développement économique, politique et juridique de nature capitaliste. Les États peuvent reproduire des formes d’organisation politique et des documents fondateurs (tels que les constitutions) venus de l’Occident. Ils peuvent aller jusqu’à faire passer une législation destinée à faire tomber les barrières juridiques, économiques, politiques et éducatives à la participation pleine et entière des femmes et à leur autodétermination.
Mais la véritable mise en place et en pratique de telles réformes présuppose des conditions matérielles inaccessibles à tous les pays simultanément. Il y a à la fois des limites systémiques et écologiques à cet accomplissement, par tous les pays en même temps, du statut de « pays capitaliste avancé ». Par systémiques j’entends enracinées dans le fonctionnement du capitalisme comme un système-monde[23]. Par écologiques, j’entends la contradiction entre l’implacable poursuite capitaliste de la croissance économique et la préservation de la durabilité environnementale. Ces mêmes limites sont aussi celles de l’émancipation universelle des femmes, que nous empruntions les sentiers du libéralisme féministe d’un côté, ou ceux du féminisme postmoderne et tiers-mondiste de l’autre.
4. Le concept alternatif de l’enracinement universel dans les conditions matérielles des femmes
D’un point de vue marxiste, étudier ces problématiques au plus haut niveau d’abstraction (c’est-à-dire le mode de production)[24] signifie que l’alternative aux problèmes inhérents aux notions transhistoriques et universalistes qui sous-tendent le féminisme occidental n’est pas de « privilégier » sans recul critique une multiplicité de contextes qui produisent de la « diversité » parmi les femmes, engendrant des luttes localisées avec des objectifs limités et parfois non transférables.
Par objectifs non transférables, je veux dire ceci : à un niveau local, les femmes, selon le lieu où elles vivent, s’organisent pour obtenir ce que des femmes dans d’autres parties du monde possèdent déjà (par exemple : l’accès à des moyens de contraception), qui ne ferait pas sens ou qui serait inacceptable pour l’ensemble des femmes partout ailleurs (par exemple : le droit de porter un voile ; le droit de s’organiser en tant que travailleuses du sexe ; le droit de conserver leurs revenus pour elles-mêmes ou de voyager sans l’accord de leur père ou d’un autre homme de la famille). Par « non-transférable », je ne veux pas dire « indésirable » ; je veux dire soit spécifique sur le plan culturel, soit redondant, dans le sens que certaines batailles ont déjà été remportées dans certains endroits alors qu’elles n’ont même pas été entreprises dans d’autres.
Plutôt que cela, l’alternative serait de reconnaître qu’il y a un mode d’universalité différent, enraciné dans les conditions matérielles qui façonnent les vies de la plupart des femmes sur la planète : leur positionnement dans les organisations de production et de reproduction. La vaste majorité des femmes dans le monde travaille pour leur survie économique ainsi que pour celle de leur famille ; les femmes, pour la plupart, participent également aux structures dans lesquelles la reproduction, biologique et sociale, quotidienne et générationnelle, se déroule en continu. Je n’affirme pas qu’il y a une unité essentielle parmi les femmes parce que la production et la reproduction sont des activités explicables en termes de nature.
J’attire ici l’attention sur le fait que la plupart des femmes, au-delà de leurs différences de nationalité, de religion, de culture, de race, etc., sont des travailleuses, engagées dans des tâches de reproduction et de production qui, tandis qu’elles varient dans leurs formes d’organisation entre et parfois au sein des pays, sont en même temps sujettes aux effets des fluctuations de l’économie capitaliste nationale et mondiale. Pour de nombreuses raisons économiques, démographiques, politiques et idéologiques complexes et liées, la grande majorité de la population active dans le monde est constituée de femmes ; les femmes sont les plus pauvres des pauvres dans le monde. 70% des 1,3 milliards de personnes qui vivent sous le seuil absolu de pauvreté sont des femmes. Les femmes effectuent les 2/3 des heures de travail comptabilisées dans le monde, produisent la moitié de la nourriture ; pourtant, elles gagnent seulement 10% du revenu mondial et elles possèdent moins d’1% de la propriété dans le monde[25].
Enfin, la majorité du travail qu’implique la reproduction physique, sociale, quotidienne et générationnelle de la population prolétaire et non propriétaire est effectuée par des femmes. Leur positionnement commun dans les relations de production et de reproduction est une base matérielle universelle et cependant historique pour leur potentielle mobilisation et organisation politique. Ceci fait référence, non pas aux femmes au sens abstrait, mais aux travailleuses qui, alors qu’elles sont divisées par leurs milieux historiquement spécifiques, partagent néanmoins un intérêt objectif commun (bien qu’il ne soit pas toujours formulé ou compris à travers des principes idéologiques « féministes »), basé sur leurs conditions de travail, leur pouvoir d’achat et leurs inquiétudes concernant leur bien-être matériel et celui de leurs familles.
En théorie, au niveau d’analyse du mode de production, les intérêts économiques des travailleuses sont objectivement similaires à ceux des travailleurs. Un féminisme qui s’exprime au nom des intérêts des travailleuses, plutôt que des femmes en tant que telles, doit catégoriquement reconnaître la nature contre-productive des luttes politiques et idéologiques féministes qui placent au premier rang les intérêts de femmes individuelles. De telles idéologies omettent la réalité suivante : les femmes, comme les hommes, sont des « ensembles de relations sociales », et qu’en conséquence leur bien-être importe autant aux autres qu’à elles-mêmes.
A ce haut niveau d’abstraction, l’existence d’intérêts matériels objectifs qui transcendent le genre découle du fait que les hommes et les femmes non propriétaires soient situés dans une même classe. Mais au niveau des formations sociales et dans le contexte d’interactions sociales quotidiennes, de tels intérêts communs sont masqués par des relations conflictuelles et oppressives entre hommes et femmes, enracinées dans l’articulation historique entre production et reproduction. Ces relations affectent leur degré de pouvoir et leur accès à des ressources économiques, politiques, sociales et culturelles cruciales. Ces relations sont contradictoires, associant coopération et oppression, et elles sont aussi puissantes que les relations de classes dans le façonnement des opportunités de vies, des consciences et des identités des travailleurs et des travailleuses. Les effets concrets et observables de ces relations, cependant, ne peuvent pas être déduits a priori des intérêts qui peuvent théoriquement leur être imputés, compte tenu l’organisation capitaliste de production et de reproduction dans laquelle ils prennent leur source ; de tels effets seront façonnés par les conditions historiquement spécifiques dans lesquelles les gens vivent, à savoir les caractéristiques politiques, juridiques, idéologiques et culturelles du contexte historique (c’est-à-dire la localité, la région, l’État-nation) considéré.
J’ai mentionné plus tôt la nécessité de suivre l’injonction méthodologique de Marx qui différencie les macro-processus de changements structurels et les schémas idéologiques à travers lesquels les gens prennent conscience des conflits engendrés par de tels changements et s’engagent dans des luttes politiques. Si l’on considère les façons dont les femmes se mobilisent et s’organisent politiquement, depuis le déclin des mouvements de libération des femmes des années 1970, on observe qu’elles le font – tant dans les pays capitalistes avancés que dans le reste du monde – autour de questions qui affectent directement leurs vies en tant que travailleuses, mères et personnes responsables du bien-être d’autrui. Elles se mobilisent autour de sujets qui affectent leur survie physique et économique ainsi que celle de leurs familles, et dans ce processus, elles luttent en vue d’obtenir les droits civils, économiques et politiques nécessaires pour atteindre ces objectifs. Les femmes impliquées dans les luttes locales ne déploient pas des identités individualistes. Leur compréhension d’elles-mêmes, spontanée et basée sur du sens commun est profondément relationnelle et façonnée par leur positionnement au sein des relations de production et de reproduction.
Ce ne sont pas les femmes riches et capitalistes qui se mobilisent et s’organisent afin de lutter pour de petits emprunts, pour le droit à une éducation, pour la formation professionnelle et pour l’accès au contrôle de leur reproduction, à la santé, au travail et à de meilleurs salaires. Ce sont majoritairement les femmes de la classe ouvrière, pauvres et non propriétaires qui le font. Cependant, elles agissent souvent sous la direction de femmes instruites dont les aspirations à la mobilité ascendante et à l’indépendance économique sont contrariées par les attentes familiales, sociales et politiques dominantes. Historiquement, les femmes ne se sont pas mobilisées exclusivement sous des bannières spécifiquement féministes, tout comme les luttes de classes ont souvent été menées au nom de diverses légitimations idéologiques. Les mouvements de femmes au niveau local autour de problématiques axées sur des moyens de subsistance ne sont pas nouveaux, mais se sont répandus à travers le monde suite au désastre annoncée par la mondialisation. Comme les ajustements structurels réduisent la disponibilité de travail rémunéré, les hommes comme les femmes doivent compter sur des stratégies de survie individuelles, telles que la migration et la production de biens et de services, à vendre ou à troquer, au sein du secteur informel croissant de l’économie nationale.
Du point de vue du féminisme libéral occidental, les mouvements locaux peuvent être loués comme des exemples de résilience et d’ingéniosité des femmes, perçus comme une étape dans le processus du développement de la conscience féministe, ou, selon leurs légitimations idéologiques, vus comme des exemples de la manière dont des coutumes, cultures et relations patriarcales empêchent les femmes de développer une « véritable » conscience féministe. Du point de vue du féminisme postmoderne, de tels mouvements sont non seulement des exemples du seul mode de politique possible après le démantèlement des métarécits, mais surtout la preuve que les Lumières et les métarécits marxistes ont complètement échoué.
Du point de vue de la théorie marxiste, cependant, ces mouvements illustrent les façons dont les femmes prennent conscience des processus matériels qui détruisent leurs vies, et font de leur mieux pour leur survie et celle de leurs communautés. Elles incarnent un féminisme qui s’exprime à travers des luttes centrées sur des problématiques qui incluent, mais aussi transcendent, le genre. Les problèmes auxquels ces femmes font face sont ancrés, non dans leurs identités, mais dans leur positionnement commun dans les structures d’oppression qui régissent leurs vies. Ces structures sont un ensemble complexe d’éléments universels et particuliers : l’universel renvoie au capitalisme ; le particulier renvoie à la configuration historiquement spécifique des inégalités familiales, raciales, ethniques et religieuses qui caractérisent les formations sociales dans lesquelles ces mouvements émergent.
Plutôt que de partir du triptyque abstrait de race, genre et classe, et/ou des imbrications abstraites d’oppressions incluant et allant au-delà de la référence standard au triptyque[26] invoquée systématiquement dans la littérature scientifique de nos jours, la théorie marxiste dirige notre attention vers deux domaines : (1) les conditions matérielles affectant les vécus et les obstacles des femmes ; et (2) les différentes formes, simples ou combinées[27] (par exemple : de genre, d’ethnie, d’origine nationale, raciale ou culturelle), dans lesquelles les femmes prennent conscience de leur besoins collectifs et luttent pour atteindre leurs objectifs.
Ces formes de conscientisation peuvent aller d’analyses théoriques sophistiquées à une compréhension spontanée, fondée sur le bon sens, de leurs responsabilités en tant que femmes et mères. Toutes constituent des outils idéologiques avec lesquels les femmes construisent leurs identités, prennent conscience de leurs besoins et conçoivent leurs objectifs. Ces diverses formes de conscientisation ne devraient pas être interprétées comme le seul niveau d’analyse dans lequel ces phénomènes devraient être théorisés. Il est important de lier ces formes de conscientisation à leurs conditions historiques de possibilité ; c’est-à-dire aux processus de changements sociaux qui ont conduit à leur mobilisation et à leur organisation politiques.
La théorie féministe a reconnu l’hétérogénéité historique des femmes dans la réalité et s’est morcelée en une myriade de féminismes pensant des différences. À partir de ce moment, le sujet politique féministe est devenu extraordinairement insaisissable, fragmenté par chaque axe possible de différence[28]. La théorie marxiste met en lumière les conditions matérielles sous-jacentes, communes à toutes les femmes non propriétaires, qui sont la clé pour la compréhension des limites des théories et des politiques ignorant la base capitaliste des vies des femmes.
Les luttes des femmes contre le capitalisme, qu’elles soient consciemment anticapitalistes et antimondialisation ou dissimulées sous différentes formes de légitimation idéologique, sont des illustrations pratiques de la pertinence de la vision profonde de Marx : que nous sommes un ensemble de relations sociales et que c’est comme tel que nous faisons tout ce que nous faisons, y compris lutter pour la survie économique et les droits politiques et sociaux. Ce qui sous-tend la variabilité historique et interculturelle des idéologies et identités déployées dans la résistance des femmes à la mondialisation, se trouve être leur positionnement commun au sein des modes de production et de reproduction.
Conclusion
Le féminisme à l’ère de la mondialisation se doit d’être un féminisme marxiste, un féminisme qui, tandis qu’il soutient les luttes pour des droits et opportunités qui importent à toutes les femmes, ait le courage de reconnaître que toutes les femmes ne partagent pas les mêmes intérêts de classe. Un tel féminisme se doit d’admettre que la plupart des femmes dans le monde sont des travailleuses, qu’elles soient ou non prolétarisées, et que c’est sur ces bases qu’une nouvelle forme de théorisation et de politique féministe pourrait émerger. C’est ainsi que je conçois les liens entre Marx et ce que je nomme le féminisme des travailleuses à l’ère de la mondialisation.
La théorie marxiste met en lumière le positionnement commun de la majorité des femmes au sein du mode de production, en tant que les membres les plus opprimés et les plus exploités des classes ouvrières du monde entier. En même temps, elle met en lumière les structures de pouvoir et de domination ainsi que les relations hiérarchiques qui sous-tendent les différences culturelles, religieuses, idéologiques, nationales et ethniques entre les femmes.
Plus important encore, la théorie marxiste montre les limites des luttes pour les droits des femmes dans un contexte où la pratique de ces droits peut être éternellement remise à plus tard, étant donné les barrières systémiques à l’accomplissement de changements substantiels de niveau et de qualité de vie de la majorité de la population mondiale, hommes comme femmes. Tout en reconnaissant l’importance de ces droits économiques, sociaux et politiques, elle montre la nécessité de garder à l’esprit que le succès des luttes pour ces droits n’est pas le point d’arrivée, mais le point de départ, un premier pas dans la lutte pour un changement systémique.
Les luttes des femmes, soulignant l’importance de subordonner le profit à la satisfaction des besoins matériels et spirituels des gens, indiquent la voie à suivre pour atteindre les objectifs que toute alternative durable au capitalisme doit viser afin d’offrir aux gens la possibilité de vivre à la hauteur de leur potentiel.
*
Extrait de : Martha E. Giménez, Marx, Women, and Capitalist Social Reproduction, Brill, Historical Materialism Series, Leyde, 2018, chapitre 14.
Traduction : Christelle Compte.
Bibliographie
Alcoff, Linda 1989, ‘Cultural Feminism versus Poststructuralism: The Identity Crisis in Feminist Theory’, in Feminist Theory in Practice and Process, edited by Micheline Malson et al., Chicago: University of Chicago Press.
Amin, Samir 1976, Unequal Development, New York: Monthly Review Press.
Andersen, Margaret L. and Patricia H. Collins (eds) 1995, Race, Class and Gender: An Anthology, second edition, Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
Arrighi, Giovanni 1991, ‘World Income Inequalities and the Future of Socialism’, New Left Review I/189 (September–October): 39–65.
Belkhir 1994, ‘The “Failure” and Revival of Marxism in Race, Gender & Class Issues’, Race, Sex & Class, 2, 1: 79–107.
Blau, Francine D. and Anne E. Wingler 1998, The Economics of Women, Men, and Work, third edition, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Brooks, Ann 1997, Postfeminisms: Feminism, Cultural Theory and Cultural Forms, New
York: Routledge.Gimenez, Martha E. 2002, ‘The Global Fetish’, Latin American Perspectives, 29, 6 (November): 85–7.
Cardoso, Fernando Henrique and Enzo Faletto 1979, Dependency and Development in Latin America, Berkeley, CA: University of California Press.
Collins, Patricia H. 1993, ‘Toward a New Vision: Race, Class and Gender as Categories of Analysis and Connection’, Race, Sex & Class, 1, 1: 25–45.
DiStefano, Christine 1989, ‘Dilemmas of Difference: Feminism, Modernity, and Post-modernism’, in Feminism/Postmodernism, edited by Linda Nicholson, New York:Routledge.
Eagleton, Terry 1996, The Illusions of Postmodernism. London: Blackwell.
Ehrenreich, Barbara 2000, ‘Maid to Order: The Politics of Other Women’s Work’, Harper’s, April: 59–70.
Gimenez, Martha E. 1990, ‘The Dialectics of Waged and Unwaged Work’, in Work Without Wages, edited by Jane L. Collins and Martha E. Gimenez, New York: State University of New York Press.
Gimenez, Martha E. 2001, ‘Marxism and Class, Gender and Race: Rethinking the Trilogy’, Race, Gender & Class, 8, 2: 23–33.
Inkeles, Alex 1974, Becoming Modern, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Levy Jr., Marion J. 1966, Modernization and the Structure of Societies, Princeton: Princeton University Press.
Mander, Jerry and Edward Goldsmith 1996, The Case Against the Global Economy: And For a Turn Toward the Local, San Francisco: Sierra Club Books.
Marx, Karl 1972, Contribution à la critique de l’économie politique, « Préface », trad. M. Husson et G. Badia, Paris: Editions sociales.
Marx, Karl 1977, Le Capital, Livre III, trad. C. Cohen-Solal et G. Badia, Paris: Éditions sociales.
Mohanty, Chandra T., Ann Russo and Lourdes Torres, Third World Women and the Politics of Feminism, Indiana: Indiana University Press.
Newman, Katherine S. 1988, Falling From Grace: The Experience of Downward Mobility in the Middle Class, New York: Free Press.
Newman, Katherine S. 1993, Declining Fortunes: The Withering of the American Dream, New York: Basic Books.
Ong, Aihwa 1996, ‘Strategic Sisterhood or Sisters in Solidarity? Questions of Communitarianism and Citizenship in Asia’, Indiana Journal of Global Legal Studies, 4, 1 (Fall):107–35.
Phillips, Kevin 1990, The Politics of Rich and Poor: Wealth and the American Electorate inthe Reagan Aftermath, New York: Random House.
Ramazanoglu, Caroline 1989, Feminism and the Contradictions of Oppression, New York:Routledge.
Rostow, W.W. 1991, The Stages of Economic Growth, third edition, Cambridge: Cambridge University Press.
Rothenberg, Paula S. (ed.) 2000, Race, Class, and Gender in the United States: An Integrated Study, fifth edition, New York: Worth Publishers.
Rowbotham, Sheila and Stephanie Linkogle 2001, Women Resist Globalisation: Mobilising for Livelihood and Rights, London: Zed Books.
Shanin, Teodor 1985, Russia as a ‘Developing Society’, New Haven, CT: Yale University Press.
Stiglitz, Joseph E. 2002, Globalisation and its Discontents, New York: W.W. Norton & Co.
Wallerstein, Immanuel 1995, After Liberalism, New York: New Press.
Notes
[1] Gimenez 2002, pp. 85–7.
[2] Pour une analyse critique de la mondialisation, voir Mander et Goldsmith 1996; Rowbotham et Linkogle 2001; et Stiglitz 2002.
[3] Gimenez 1990, pp. 25–45.
[4] Blau et Wingler 1998, Chapitres 6 et 7.
[5] Pour une analyse claire / incisive de ce phénomène, voir Ehrenreich 2000, pp. 59–70.
[6] Phillips 1990.
[7] Voir, par exemple, Newman 1988 et 1993.
[8]Voir :http://www.economist.com/news/briefing/21596582‑one‑hundred‑years‑ago‑argentina‑was‑future‑what‑went‑wrong‑century‑decline.
[9] Arrighi 1991.
[10] Voir Marx 1972, p. 18.
[11] L’essentialisme est une manière de conceptualiser les femmes comme si elles partageaient une nature universelle commune ; il postule une convergence universelle et anhistorique parmi les femmes qui transcende les différences historiques et interculturelles. Les visions essentialistes des femmes peuvent être basées sur la biologie (par exemple : leurs capacités reproductives), la psychologie (par exemple : leurs tendances naturelles à prendre soin), ou des expériences historiques, lorsque ces expériences sont universalisées (par exemple, les suppositions de féministes occidentales selon lesquelles le travail domestique est une forme d’oppression universelle subie par toutes les femmes). Voir par exemple : Brooks 1997, pp. 20–1.
[12] Pour des débats sur l’essentialisme et ses implications, voir Alcoff 1989, pp. 295–326; et Ramazanoglu 1989.
[13] Bilotti, http://www.medmedia.it/review/numero3/en/art2.htm.
[14] Ramazanoglu 1989, seconde partie ; Mohanty, Russo et Torres 1991.
[15] Ong 1996.
[16] Voir par exemple : Levy 1966; Rostow 1991; et Inkeles 1974.
[17] Voir par exemple : Amin 1976; et Cardoso et Faletto 1979.
[18] Ramazanoglu 1989, troisième partie.
[19] Alors que la théorie bolchévique postulait que le succès de la Révolution Russe dépendait de la propagation de la révolution à travers l’Europe et au-delà, la théorie staliniste a introduit la notion de socialisme dans un seul pays en 1924, après la mort de Lénine. La théorie de la modernisation et les projets de développement des années 50 et 60 présupposaient qu’il était possible pour un pays d’atteindre seul le « capitalisme dans un seul pays », indépendamment de la place de ce pays au sein de l’économie mondiale. Si la nature systémique du capitalisme comme le mode de production dominant dans le monde est certes reconnue, il est clair que la capacité des États-nations individuels à se « développer » et à se « moderniser », achevant ainsi une mobilité ascendante au sein du système-monde capitaliste, est circonscrite par des réseaux politiques et économiques complexes qui échappent au contrôle d’une nation seule.
[20] Wallerstein 1995; voir en particulier ‘The Concept of National Development, 1917–1989: Elegy or Requiem?’
[21] Cela dépasserait l’objectif de ce chapitre de présenter les différents arguments proposés par les chercheur·e·s pour expliquer l’échec des stratégies de développement de substitution à l’export dans les pays pauvres et relativement pauvres ainsi que la chute de l’Union Soviétique et de ses pays satellites.
[22] Shanin 1985.
[23] Wallerstein 1974.
[24] Dans Le Capital, Marx théorise, au plus haut niveau d’abstraction, le fonctionnement du mode de production capitaliste fonctionne, et explique sa structure, ses processus, ses tendances et ses contradictions, comme si le capitalisme existait dans un état pur, non affecté par la nature et l’histoire. Mais dans le monde réel, nous n’observons pas ainsi le mode de production capitaliste en tant que tel ; à un moindre niveau d’abstraction, nous pouvons observer ce que Wallerstein appelle le « capitalisme historique », ou ce que des théoristes marxistes comme Poulantzas appellent des formations sociales. La distinction théorique clé entre le niveau d’analyse du mode de production et le niveau des formations sociales est exprimé par Marx comme suit : « Cette forme économique spécifique dans laquelle du surtravail non payé est extorqué aux producteurs directs, détermine le rapport de dépendance, tel qu’il découle directement de la production elle-même et réagit à son tour de façon déterminante sur celle-ci. C’est la base de toute forme de communauté économique, issue directement des rapports de production et en même temps la base de sa forme politique spécifique. C’est toujours dans le rapport immédiat entre le propriétaire des moyens de production et le producteur direct (…) qu’il faut rechercher le secret le plus profond, le fondement caché de tout l’édifice social et par conséquent de la forme politique que prend le rapport de souveraineté et de dépendance, bref, la base de la forme spécifique que revêt l’État à une période donnée. Cela n’empêche pas qu’une même base économique (la même quant à ses conditions fondamentales), sous l’influence d’innombrables conditions empiriques différentes, de conditions naturelles, de rapports sociaux, d’influences historiques extérieures, etc., peut présenter des variations et des nuances infinies que seule une analyse de ces conditions empiriques pourra élucider. » (Marx 1977, p. 717). En conséquence, théoriser au niveau des modes de production et de reproduction implique d’identifier les structures, processus et contradictions communs à toutes les formations sociales (c’est-à-dire les régions, les États-nations) où le mode de production capitaliste est dominant, ce qui, en retour, produit des effets similaires sur les populations. Des hypothèses faites au niveau du mode production doivent cependant être nuancées par les « innombrables conditions empiriques différentes… » etc. caractéristiques de la formation sociale considérée.
[25] D’après le National Council of Women’s Organizations, Facts on Women, http://www.womensorganizations.org/facts/facts_11.htm.
[26] La perspective de la race, du genre et de la classe sociale, qui a émergé au début des années 1990, a acquis une importante visibilité comme le démontrent la multiplication d’articles de journaux et d’ouvrages mentionnant « race, genre et classe » dans leurs titres, ainsi que la création d’une section déjà conséquente et qui ne cesse de prendre de l’ampleur au sein de l’American Sociological Association, et d‘un journal, Race, Gender & Class, nommé à l’origine Race, Sex & Class. Cette perspective a émergé comme une réaction aux théories féministes qui négligaient les différences raciales, ethniques et de classes parmi les femmes, et pour pallier les limites supposées du marxisme. L’invocation systématique de ce triptyque à travers l’utilisation d’une variété de métaphores descriptives (par exemple : race, genre et classe forment une « matrice » d’oppression ; ils « interagissent », « s’entremêlent » ou « s’imbriquent ») est insuffisante pour la compréhension de la nature des relations que cette perspective considère comme fondamentale. Pour des exemples de lectures, voir Collins 1993 ; Belkhir 1994 ; Andersen et Collins 1995 ; et Rothenberg 2000. Pour des études critiques de ce triptyque, voir Eagleton 1996 et Gimenez 2001.
[27] Par exemple, des femmes d’ascendance mexicaine peuvent s’identifier aux États-Unis comme mexicaines-américaines (un marqueur ethnique) ou mexicaines (dans le sens de l’origine nationale, souvent choisi par des femmes immigrantes nouvellement arrivées), ou des femmes mexicaines-américaines, comme hispaniques ou latinas ; cela dépend de leur classe sociale, leur citoyenneté, leur éducation, la région du pays où elles vivent, et les effets des politiques états-uniennes de classification raciale et ethnique en vigueur à un moment donné, parmi d’autres facteurs.
[28] Ramazanoglu 1989, Parties 2 et 3 ; Alcoff 1989; DiStefano 1989, pp. 37–45; Brooks 1997, pp. 92–113.









