
Gramsci, l’histoire et le paradoxe de la postmodernité
À l’occasion de la publication de L’Histoire et la question de la modernité chez Antonio Gramsci, aux éditions Classiques Garnier, nous reprenons un extrait de l’ouvrage, précédé d’une introduction de l’auteur. Ce livre montre que le marxisme ouvert d’Antonio Gramsci permet de redéfinir la philosophie de l’histoire en échappant à tout dogmatisme.
Gramsci cherche en effet à penser le processus historique dans sa consistance tout en accordant un rôle central à l’activité et aux luttes humaines, en particulier grâce aux notions de praxis, d’hégémonie et de rapports de forces. L’auteur des Cahiers de prison parvient ainsi à comprendre à la fois la complexité de la modernité européenne, depuis ses origines jusqu’à la crise organique de son temps, en s’arrêtant notamment sur la Renaissance, la Réforme, la Révolution française, le Risorgimento, l’américanisme, le fascisme et le socialisme soviétique.
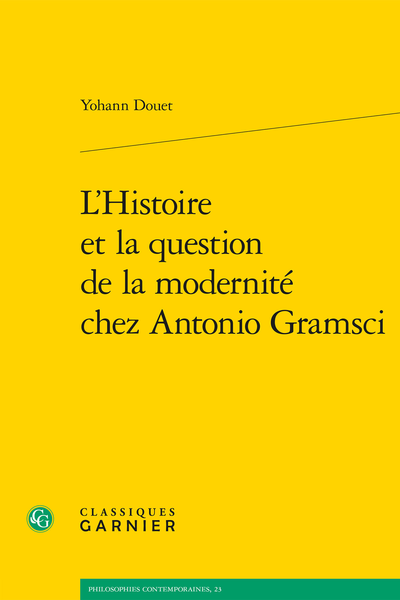
Introduction
Les philosophies de l’histoire en général – et le marxisme en premier premier lieu – ont été radicalement remises en cause dans leur projet même, cela pour différentes raisons, théoriques mais aussi politiques. On les a accusées de transposer un schéma religieux sur le cours des événements humain (Löwith[1]), de plaquer des lois rigides sur la réalité concrète (Popper, pour ne citer qu’un nom[2]), de promouvoir des conceptions a priori et homogénéisantes aux antipodes de la pratique réelle des historiens. Elles nieraient la diversité empirique et l’imprévisibilité essentielle à l’action humaine (Arendt[3]) – négation qui a pu être considérée comme le pendant théorique du totalitarisme, l’écrasement théorique de l’individu annonçant ou inspirant en quelque sorte son écrasement politique. Incapables d’appréhender les catastrophes et crimes de masse du XXe siècles, et dépassées par de multiples avancées intellectuelles et historiographiques, les philosophies de l’histoire s’avéreraient anachroniques, et définitivement enfermée dans le XIXe siècle (Foucault[4]). Enfin, en raison de leur caractère européocentré, les philosophies de l’histoire classiques, escamoteraient la pluralité irréductible des trajectoires historiques.
Ces critiques présentent de nombreux éléments pertinents, dans la mesure où elles visent des philosophies de l’histoire dogmatiques : visions acritiques du progrès ou de la décadence ; conceptions religieuses, téléologiques ou idéalistes du processus historique, qui serait guidé par la Providence, la Raison ou l’Esprit ; ou encore versions déterministes, mécanistes et économicistes du marxisme. Mais le marxisme bien compris, notamment tel qu’il est développé par Gramsci en tant que « philosophie de la praxis », échappe largement à de telles critiques.
Les réflexions de Gramsci, le plus souvent formulées à l’occasion de l’analyse de cas concrets et liées à des enjeux pratiques, ne sacrifient jamais la singularité irréductible des situations et des événements historiques ni la complexité des rapports entre les acteurs et forces en présence. Et il parvient pourtant à forger un cadre et des outils théoriques (méthodes, notions ou thèses) qui rendent intelligible la cohérence et les lignes de force du processus historique, et permettent de penser les différences qualitatives entre les époques constituant ce processus, en premier lieu l’époque moderne. L’ouvrage cherche à déployer cette conception de l’histoire gramscienne, qui parvient à se rendre « sensible au multiple » tout en conservant son ambition totalisante.
Or c’est en particulier autour des idées de modernité et de postmodernité que ces problèmes se nouent, et que deux écueils apparaissent apparaissent clairement : l’impossibilité de réduire l’histoire à un « grand récit » (Lyotard) qui correspondrait au développement d’un principe donné (raison, liberté, progrès, etc.), et de réduire les différentes époques à un « esprit du temps » ; mais aussi l’impossibilité de s’en tenir à une attitude purement critique envers toute totalisation historique, sous peine de se retrouver désorientés à la fois intellectuellement et pratiquement, comme l’a démontré Fredric Jameson. Les lignes qui suivent sont un extrait (p. 19-25) du chapitre introductif de L’Histoire et la question de la modernité chez Antonio Gramsci qui porte précisément sur ce point[5].
***
Le paradoxe de la modernité
[…] L’idée de postmodernité a un rapport ambivalent avec la conception du processus historique comme constitué d’époques cohérentes et qualitativement différentes entre elles. D’une part, la « condition postmoderne », telle que l’a diagnostiquée Lyotard, correspond à un abandon des « grands récits (…) comme la dialectique de l’Esprit, l’herméneutique du sens, l’émancipation du sujet raisonnable ou travailleur, le développement de la richesse[6] », au profit d’une ouverture à la pluralité de jeux de langages incommensurables. Toute appréhension totalisante du processus historique ou même d’une seule époque semble alors suspecte. D’autre part, la postmodernité semble bien être une époque nouvelle, succédant à la modernité : « Notre hypothèse de travail est que le savoir change de statut en même temps que les sociétés entrent dans l’âge dit postindustriel et les cultures dans l’âge dit postmoderne[7]. » On est donc placé face au grand récit de disparition des grands récits[8], la postmodernité se manifestant comme l’époque de la dissolution des époques : tel est son paradoxe essentiel.
Pour Jameson, l’un des « traits ou caractères semi-autonomes et relativement indépendants[9] » que présente le postmodernisme est ainsi la « surdité à l’Histoire », la « crise de l’historicité » ou la perte du « sens du passé »[10]. L’absence de toute véritable capacité à se représenter le processus historique, à penser ses ruptures fondamentales et plus encore à se projeter dans un avenir qualitativement nouveau (« l’angoisse de l’utopie »[11]), s’accompagne d’un accent mis sur la prolifération des différences particulières aux dépens des « abstractions périodisantes ou totalisante[12] », et d’une prédominance des catégories du synchronique et du spatial sur celles du diachronique et du temporel dans « notre vie quotidienne, notre expérience psychique, et nos langages culturels » contrairement à la période antérieure du « haut modernisme[13] ». Le passé est considéré comme dépendant du présent, et comme lui étant relatif : pour « une société privée de toute historicité », son « passé putatif n’est guère plus qu’un ensemble de spectacles poussiéreux[14] », de simulacres, sécrétés et reconfigurés en fonction d’éléments actuels. De ce fait, aucune représentation périodisée du processus historique, même passé donc, ne peut acquérir une véritable consistance, et encore moins représenter un fondement stable pour l’action collective[15].
Pour autant, lorsque l’on parle de postmodernité, on présuppose
une conception narrative de la temporalité qui sépare clairement un passé et un présent : auparavant nous vivions dans une société industrielle / capitaliste / moderne, maintenant nous vivons dans une société post-industrielle / désorganisée / postmoderne / postfordiste / globalisée / détraditionnalisée / individualisée / du risque / en réseaux, etc.[16]
On peut donc reformuler le paradoxe du postmodernisme ainsi : la dissolution de l’historicité se retourne dans l’affirmation d’une différence historique qualitative et même absolutisée entre présent et passé – affirmation qui est du reste analogue à la manière dont les théories de la modernité distinguent cette dernière du passé prémoderne.
Jameson s’efforce d’échapper à ce paradoxe sans abandonner l’idée de postmodernité. Pour cela, il s’interdit d’abord d’adopter une conception homogénéisante des époques historiques, et caractérise le postmodernisme par plusieurs « traits ou caractères semi-autonomes et relativement indépendants[17] » – méthode proche de celle de Gramsci comme on le verra. De plus, en concevant le postmodernisme comme la « logique culturelle » d’un nouveau stade du capitalisme (le capitalisme tardif), il fait droit à l’originalité de l’époque contemporaine sans pour autant absolutiser sa différence et la couper du processus historique :
Il faut réaffirmer encore et encore (…) l’idée d’une périodisation, à savoir que le postmodernisme n’est pas la dominante culturelle d’un ordre social entièrement nouveau (dont la rumeur, sous le nom de « société postindustrielle », courut dans les médias il y a quelques années) mais seulement le reflet et le concomitant d’une modification de plus du capitalisme lui-même[18].
Enfin, il considère le postmodernisme comme la logique culturelle « dominante » mais non exclusive de cette nouvelle période, comme sa « norme hégémonique »[19] :
Je suis très loin de penser que la production culturelle actuelle est, dans sa totalité, « postmoderne » au sens que je vais attribuer à ce terme. Le postmodernisme est pourtant le champ de forces où des élans culturels très différents (que Raymond Williams a utilement qualifiées de formes « résiduelles » ou « émergentes » de production culturelle) doivent se frayer un chemin. Si nous ne parvenons pas à acquérir un sens général de dominante culturelle, nous retombons dans une vision de l’histoire actuelle comme pure hétérogénéité, différence aléatoire, coexistence de multiples forces distinctes dont l’effectivité est indécidable[20].
Jameson pense donc l’unité de l’époque contemporaine (dans sa dimension culturelle) à partir de l’hégémonie du postmodernisme[21], contre laquelle il convient de lutter. Alors que l’« on est immergé dans l’immédiat », et que « la conception même de la périodisation historique apparaît des plus problématiques », retrouver une profondeur historique et une représentation du processus historique en sa consistance est essentiel pour espérer reconquérir une certaine « maîtrise » de l’histoire, c’est-à-dire y agir collectivement d’une manière cohérente[22].
La pensée de l’histoire de Gramsci, une réponse au postmodernisme ?
Gramsci avait conscience de l’importance décisive de parvenir à une conception adéquate du processus et des époques historiques. Ses Cahiers de prison sont émaillés de réflexions qui, comme par avance, permettent d’affronter la crise de l’historicité contemporaine, et ce que l’on pourrait appeler le refoulement postmoderne de l’histoire, tout en faisant droit à ce que les critiques des philosophies de l’histoire, et celles des périodisations classiques, ont de pertinent.
Si Gramsci peut constituer une aide précieuse pour répondre au postmodernisme, c’est d’abord parce qu’il partage avec ce dernier une certaine « sensibilité au multiple[23] ». Il est particulièrement attentif à la pluralité des éléments et acteurs historiques, et il se garde de tout essentialisme, en particulier économique. Il ne conçoit l’histoire ni à partir de structures simples ni à partir de sujets préconstitués. Pour lui, les structures et les événements historiques dépendent des rapports entre les multiples forces socio-politiques en présence, et, réciproquement, chacune de ces forces, tout en étant conditionnée économiquement, se forme au cours d’un processus historique de lutte où l’activité d’organisation politico-idéologique joue un rôle décisif. Ces raisons permettent de comprendre pourquoi Laclau et Mouffe ont pu tenter de présenter Gramsci comme un précurseur, sinon du postmodernisme, du moins de leur projet « postmarxiste[24] ». Ce projet consiste à éliminer du marxisme tout ce qui relèverait de la philosophie de l’histoire (déterministe ou téléologique), en premier lieu l’étapisme (la succession réglée a priori des modes de production et des classes fondamentales qui leur correspondent) et l’essentialisme économique (la définition de l’identité des sujets collectifs par leurs caractéristiques économiques). Cela aboutit à nier radicalement toute nécessité historique, ainsi que la possibilité de penser l’espace social comme une totalité unifiée. Laclau et Mouffe soutiennent l’irréductible pluralité des acteurs socio-politiques et l’indépassable précarité de leurs identités, dans la mesure où les identités des acteurs collectifs sont intégralement définies par leurs rapports mutuels – de différenciation, d’opposition, d’alliance ou d’hégémonie –, contingents et toujours susceptibles d’être modifiés[25]. En interprétant Gramsci comme le précurseur le plus avancé de leur théorie, Laclau et Mouffe mettent en évidence à juste titre son attention au multiple, mais ils laissent de côté son effort tout aussi marqué pour penser la consistance du processus historique. En effet, Gramsci ne voit pas l’histoire comme « une série discontinue de formations hégémoniques ou de bloc historiques[26] », c’est-à-dire comme la succession parfaitement contingente de différentes configurations de rapports entre les acteurs politiques – rapports qui redéfiniraient à chaque fois intégralement leurs identités. Au contraire, il fait droit aux régularités immanentes à la série des événements et des situations (ou configurations de rapports de forces), et pense les continuités partielles du processus historique et la cohérence relative de chacune des époques. De même, il reste marxiste – et non « postmarxiste » – dans la mesure où il n’abstrait pas les acteurs politiques de leurs conditions économiques.
Comment comprendre que les réflexions gramsciennes semblent intégrer des éléments qui seront au cœur du postmarxisme ou du postmodernisme, tout en dépassant certaines de leurs limites ? On peut évoquer deux raisons. La première est peut-être que la pensée de Gramsci s’est construite dans un rapport intime et critique avec celle du libéral Benedetto Croce, qui a pu être décrite comme l’une des premières philosophies « postmarxistes[27] ». Croce, après avoir frayé avec le marxisme durant sa jeunesse, sous l’influence d’Antonio Labriola, en était rapidement venu à défendre des positions révisionnistes (refusant la théorie de la valeur, la détermination en dernière instance par l’économie, etc.)[28], et a par la suite développé sa propre conception, l’« historicisme absolu ». Il s’agissait pour lui de libérer l’histoire de tout carcan extérieur – transcendant – qu’on pourrait lui imposer : cause première, fin dernière, logique abstraite ou schéma a priori régissant son cours. Il rejette ainsi toute philosophie de l’histoire, et affirme la singularité absolue de chaque situation historique concrète[29]. Comme Croce, Gramsci fait droit à la singularité historique, et reprend d’ailleurs à son compte l’expression d’« historicisme absolu » ; mais il cherche également à restituer ce qu’il y a de structuré dans le processus historique, l’unité relative des époques et la logique immanente à leur succession.
Si la pensée de Gramsci est pertinente face au défi postmoderne, c’est peut-être aussi car il était lui-même confronté à une crise de la modernité[30]. Il diagnostique une crise organique, ou crise de l’hégémonie bourgeoise, qui est particulièrement intense après la Première Guerre mondiale, et dont la prise du pouvoir par les fascistes est un symptôme. Cette crise s’accompagne en particulier d’un bouleversement des représentations de l’histoire comme progrès. Toutefois, certaines des tendances immanentes à l’époque moderne semblent poursuivre leur développement, l’américanisme attestant ainsi que le dynamisme technico-économique du capitalisme n’est pas épuisé. Par ailleurs, la Révolution d’Octobre et l’élan qu’elle a donné aux luttes des dominés ouvrent l’horizon de l’émancipation des subalternes dans une société à la fois égalitaire et concrètement démocratique. La crise multiforme de la modernité correspond ainsi à la possibilité, et donc à la tâche, d’en réaliser les promesses. Contre une croyance dogmatique dans le progrès, Gramsci en est venu à concevoir la situation dont il est le contemporain comme déchirée entre plusieurs alternatives historiques, et, contre une compréhension naïve de la modernité, il l’a pensée d’une manière complexe et problématique, mais sans pour autant abandonner l’espoir de faire triompher un progrès véritable[31].
*
Illustration : Pasolini devant la tombe de Gramsci, en 1970 (ANSA Foto)
Notes
[1] Karl Löwith, Histoire et salut : les présupposés théologiques de la philosophie de l’histoire [1953], Paris, Gallimard, 2002.
[2] Karl Popper, Misère de l’historicisme [1944-45], Paris, Plon, 1956.
[3] Hannah Arendt, « Le concept d’histoire : antique et moderne » [1958], in La crise de la culture [1961], Paris, Gallimard, 2015, p. 58-120.
[4] Michel Foucault, « Sur les façons d’écrire l’histoire » [1967], in Dits et écrits. 1954-1988, Paris, Gallimard, 1994, vol. 1, p. 585‑600.
[5] La table des matières de l’ouvrage est disponible par ce lien.
[6] Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979, p. 7.
[7] Ibid., p. 11.
[8] Fredric Jameson, Le Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif [1991], Paris, Éditions de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, 2007, p. 18.
[9] Ibid., p. 17.
[10] Ibid., p. 17, p. 63, p. 431.
[11] Ibid., p. 459.
[12] Ibid., p. 474.
[13] Ibid., p. 55.
[14] Ibid., p. 58.
[15] Ce diagnostic est proche de celui de François Hartog, qui oppose le « présentisme » contemporain au « régime d’historicité » (manière dont les catégories de présent, passé et futur sont combinées, qui constitue la conscience de soi temporelle d’une communauté) futuriste, polarisé par l’attente du nouveau, qui caractérisait l’époque moderne, bornée par les dates symboliques de 1789 et de 1989 (Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Paris, Le Seuil, 2003).
[16] Mike Savage, « Against Epochalism : An Analysis of Conceptions of Change in British Sociology », Cultural Sociology, vol. 3, no 2, juillet 2009, p. 218. Savage parle d’« épocalisme » pour désigner ce schéma, dont il analyse la prédominance dans les sciences sociales en Grande-Bretagne.
[17] Fredric Jameson, Le Postmodernisme…, op. cit., p. 17.
[18] Ibid., p. 19.
[19] Ibid., p. 39.
[20] Ibid.
[21] Cette présence chez Jameson de Gramsci (via Williams) est une exception : c’est « le penseur du marxisme occidental dont Jameson s’est le moins inspiré » (Perry Anderson, Les origines de la postmodernité [1998], Paris, Les Prairies ordinaires, 2010, p. 102-103). Pour la lecture de l’hégémonie par Williams, qui s’intéresse principalement à sa dimension culturelle, voir Raymond Williams, Marxism and Litterature, Oxford University Press, 1977, « Hegemony », p. 108‑114.
[22] Ibid., p. 550, p. 36, p. 474.
[23] Leonardo Domenici, « Unificazione politica e pluralità del reale nei Quaderni del carcere », Critica marxista, 1989, no 5 (septembre-octobre), p. 75.
[24] Voir Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, Hégémonie et stratégie socialiste. Vers une politique démocratique radicale [1985], Paris, Les Solitaires intempestifs, 2009 p. 20-21.
[25] Laclau et Mouffe font référence à Saussure, chez qui la définition d’un mot dérive de ses différences aux autres, pour penser le primat des relations sur les identités.
[26] Ibid., p. 147.
[27] Eric Hobsbawm, L’ère des empires. 1875-1914 [1987], Paris, Fayard, 1989, p. 345.
[28] Benedetto Croce, Matérialisme historique et économie marxiste [1900], Paris, Giard et Brière, 1901.
[29] Benedetto Croce, Théorie et histoire de l’historiographie [1917], Genève, Droz, 1968, chap. 4 « Genèse et dissolution idéale de la “philosophie de l’Histoire” », p. 45-56.
[30] Je me permets de renvoyer à Yohann Douet, « Affronter la crise de la modernité. Hégémonie et sens de l’histoire chez Antonio Gramsci », Actuel Marx, no 68, 2020/2, p. 175-192.
[31] Pour les différentes significations que prend la notion de progrès chez Gramsci, voir infra, p. 281-282.









