
Gramsci : un marxisme singulier, une nouvelle conception du monde
À l’occasion de la publication aux Éditions sociales de l’ouvrage « Une nouvelle conception du monde » – Gramsci et le marxisme, nous publions une partie de l’introduction écrite par Yohann Douet, qui a coordonné le volume, et est par ailleurs membre de la rédaction de Contretemps.
Ce livre est composé de contributions de certains des plus importants spécialistes de Gramsci : Fabio Frosini, Francesca Izzo, Pierre Musso, Giuseppe Vacca, et les regrettés Domenico Losurdo et André Tosel. On trouvera la table des matières ici, ainsi que sur le site de l’éditeur.
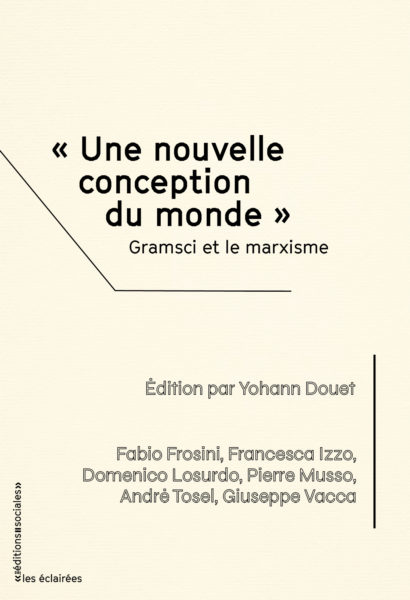
Yohann Douet (éd.), « Une nouvelle conception du monde » – Gramsci et le marxisme, Les Éditions sociales, coll. Les éclairées, juin 2021, 184 p.
***
Introduction : Le marxisme ouvert de Gramsci, « une nouvelle conception du monde »
La singularité du marxisme de Gramsci
On attribue généralement à Antonio Gramsci, à juste titre, le mérite d’avoir étudié et mis en lumière des phénomènes sociaux qui avaient été largement laissés au second plan par la tradition marxiste[1]. Notamment avec la notion d’hégémonie, il a ainsi souligné l’importance du rôle des intellectuels, de la lutte culturelle ou encore de la société civile[2]. Et, même si ces aspects sont moins connus, il a produit des analyses et des réflexions d’une grande profondeur sur la religion, la littérature, le journalisme, le folklore ou encore la langue. Cependant, si un tel constat ne peut qu’être partagé, il a donné lieu à des interprétations divergentes. On a ainsi pu voir en Gramsci un « théoricien des superstructures[3] » qui aurait étendu et enrichi le marxisme classique en étudiant de nouveaux objets, mais aussi considérer que l’attention particulière qu’il porte à la culture et à la société civile correspondait à un éloignement du marxisme et à un glissement implicite vers des conceptions libérales[4].
Le nom de Gramsci est également associé à des conceptions politiques et stratégiques novatrices. À ses yeux, en effet, la lutte des classes ne se limite pas à une « guerre de mouvement » dont l’issue serait rapidement tranchée, mais consiste aussi en une « guerre de position » âpre et complexe, qui se déroule dans le temps long, et implique la construction d’une hégémonie alternative à celle de la classe dominante[5]. La guerre de position est liée au poids des superstructures, particulièrement fort dans les sociétés capitalistes les plus avancées. Gramsci distingue ces sociétés – qu’il désigne comme « l’Ouest » – de celles de « l’Est » où la société civile est à l’inverse très peu développée, et dont le paradigme est la Russie d’avant 1917 ; et il propose ainsi une stratégie adaptée à des conjonctures différentes de celles où les bolcheviks ont mené leurs luttes. Mais ces analyses ont pu être interprétées, elles aussi, de manières opposées : comme un complément du marxisme révolutionnaire, ou au contraire comme sa remise en cause.
En réalité la réflexion de Gramsci n’implique pas un rejet, même tendanciel, du marxisme de Marx, ni de celui de Lénine : il s’attache plutôt à en développer le sens véritable. Mais il ne s’agit pas pour lui de simplement apporter des compléments à la tradition marxiste antérieure, du reste très diverse, et dont il critique de nombreuses déformations. Il serait donc plus juste de dire – et la suite de cette introduction, comme les différents textes de ce livre, préciseront cette idée –, que la pensée gramscienne constitue un renouvellement du marxisme, à la fois fidèle et créateur.
Pour parler de ce qu’est véritablement le marxisme, Gramsci en vient ainsi à employer l’expression de « philosophie de la praxis », et il affirme qu’il s’agit d’« une nouvelle conception du monde »[6]. Elle doit, à ses yeux, être à même de saisir l’histoire d’une manière théorique et pratique, c’est-à-dire de la rendre intelligible et d’y produire des effets décisifs. Cette nouvelle conception du monde est une pensée des contradictions sociales et politiques, élaborée à partir du point de vue de l’une des forces en lutte (les classes dominées), et qui œuvre à dépasser ces contradictions[7]. En tant que telle, est vise à intensifier l’activité autonome des groupes subalternes et à leur offrir une meilleure compréhension d’eux-mêmes, ce qui suppose qu’elle parvienne à se rendre « populaire », à être largement diffusée dans les masses. C’est lorsqu’elle est indissociablement activité consciente et conception agissante, en tant que praxis donc, qu’elle réalise une véritable unité de la théorie et de la pratique.
La singularité de sa conception du marxisme doit être appréhendée à la lumière du parcours personnel, intellectuel et militant de Gramsci. Né en 1891 en Sardaigne, il grandit dans une région pauvre, où la misère quotidienne ainsi que l’absence de développement économique s’opposaient à toute vision de l’histoire comme triomphe du progrès. En raison de déboires judiciaires, son père, contrôleur au bureau de l’état civil, a été emprisonné pendant cinq ans, et la famille de Gramsci, même si elle appartenait à la petite-bourgeoisie, a vécu durant cette période dans une grande pauvreté. Gramsci s’installe à Turin en 1911 pour entamer des études supérieures, envisageant un temps de se consacrer à des recherches en linguistique, qu’il abandonnera cependant pour la lutte politique. Il est alors profondément inspiré par la tradition néo-hégélienne italienne, notamment par l’historicisme de Benedetto Croce (1866-1952) et l’actualisme de Giovanni Gentile (1875-1944), qui mettaient l’accent sur l’activité humaine libre, à la fois contre l’obscurantisme catholique et contre le déterminisme matérialiste. Gramsci proposera plus tard une critique radicale de ces philosophes néo-idéalistes, pour des raisons aussi bien théoriques que politiques – Gentile étant devenu le philosophe officiel du fascisme, et Croce étant jusqu’à sa mort le philosophe libéral le plus influent d’Italie –, mais sa pensée se construira toujours dans et par le dialogue avec eux. Dès ses premiers écrits, Gramsci rejette toute attitude passive et fataliste à l’égard du cours de l’histoire[8]. Il s’attaque plus spécifiquement aux versions positivistes et scientistes du marxisme, dominantes au sein de la IIe Internationale dans son ensemble, mais plus encore dans le Parti socialiste italien (PSI), au sein duquel il milite à partir de 1913. Le réformisme, le gradualisme et, au fond, l’attentisme du fondateur et dirigeant du PSI, Filippo Turati (1857-1932), s’appuyaient ainsi sur l’idée que le triomphe du socialisme était prévu scientifiquement. L’advenue de la révolution en Russie, qui allait à l’encontre des prévisions du socialisme dit « scientifique », lui est apparue comme une réfutation en acte de ce dernier, idée qu’il expose dans l’article « La révolution contre Le Capital » (24 décembre 1917)[9], dont il est plusieurs fois question dans le présent ouvrage. Mais, comme en témoigne notamment un autre article de cette époque, intitulé « Notre Marx »[10], cette réfutation est aussi le point de départ d’une nouvelle conception du marxisme, qui ne réduit pas l’histoire à des schémas mécaniques et des déterminants économiques, mais laisse toute sa place à l’activité humaine.
Les années suivantes, Gramsci, alors à la tête de l’Ordine Nuovo[11] avec ses camarades Angelo Tasca, Umberto Terracini et Palmiro Togliatti, a exercé une profonde influence sur le mouvement des conseils ouvriers de Turin lors du biennio rosso de 1919-1920[12]. En conflit avec la direction bureaucratisée et implicitement réformiste du PSI lors de ce mouvement, il participe à la fondation, au congrès de Livourne en janvier 1921, du Parti communiste d’Italie (PCd’I)[13]. Il en prend la direction à partir de 1924, en évinçant Amadeo Bordiga dont il jugeait la ligne sectaire et les analyses dogmatiques et économicistes. Député depuis avril 1924, il est pourtant emprisonné par le régime fasciste le 8 novembre 1926 et, à partir du 8 février 1929, il entame la rédaction de ses Cahiers de prison. Son projet de jeunesse d’un marxisme vivant, ouvert et agissant, certes largement développé et profondément refondu, restera le fil directeur de ses réflexions, jusqu’à ce que sa santé l’empêche d’écrire en 1935. Il meurt le 27 avril 1937. […]
Une pensée en débats
La complexité des réflexions gramsciennes ouvre un vaste domaine de discussion pour les lecteurs de son œuvre. Dans les lignes qui suivent, j’aborderai certaines des questions les plus importantes, et esquisserai certains éléments de réponse en mobilisant les études réunies dans ce livre – évidemment sans aucune prétention à l’exhaustivité
La philosophie de la praxis et le matérialisme historique
La « nouvelle conception du monde » développée dans les Cahiers de prison s’oppose à une compréhension schématique et économiciste du marxisme sur différents points : abandon de la dichotomie entre structure économique d’une part, et superstructures politiques et idéologiques de l’autre ; refus d’une vision déterministe du cours de l’histoire ; rejet d’une conception des sujets historiques – des classes en l’occurrence – comme dotés d’une identité fixe et prédéfinie par une essence économique. On sait que Gramsci met l’accent sur la question de la lutte hégémonique, et en particulier sur celle du rôle décisif qu’y jouent les intellectuels. De même, il affirme la nécessité de privilégier, du fait de la massification et complexification des sociétés du XXe siècle, et de l’importance de la société civile, une stratégie politique de « guerre de position » plutôt que de « guerre de mouvement », en cherchant à gagner le consentement des masses, notamment par la construction d’une culture populaire autonome et opposée à celle des dominants. Loin de faire de la politique ou de la culture l’expression passive de l’économie, Gramsci considère qu’entre ces différents éléments de la réalité socio-historique peuvent s’établir des relations de « traductibilité [traducibilità] réciproque »[14] – tout comme entre théorie et pratique, et entre pensée et action.
Pour ces différentes raisons, la « philosophie de la praxis » développée par Gramsci semble se détacher progressivement du « matérialisme historique » compris d’une manière mécaniste. C’est ce que défendent, en utilisant la méthode diachronique décrite plus haut, des chercheurs comme Fabio Frosini ou Giuseppe Vacca[15]. Ce dernier, notamment dans l’article que nous publions, retrouve au cœur de la « philosophie de la praxis », la notion de traductibilité et une théorie de la « constitution » politique des sujets collectifs. Aux yeux de Gramsci les sujets collectifs ne peuvent pas être pensés comme déterminés sans reste par leur situation économique. Il les conçoit comme toujours à construire et à organiser, c’est-à-dire comme pris dans un processus de formation historique. Ce processus n’est jamais achevé mais doit être continuellement repris et poursuivi. Et il est relationnel, dans le sens où il met en jeu les rapports sociaux, et en particulier les rapports de forces et les luttes, avec d’autres sujets collectifs.
Mais, en dépit de son anti-économicisme, Gramsci n’en vient pas à promouvoir un « politicisme », et à défendre un primat de la politique aux dépens de l’économie[16]. Les contributions de Pierre Musso, et du regretté Domenico Losurdo, mettent ainsi en lumière l’importance qu’a eu pour Gramsci la réflexion sur l’américanisme et le fordisme, et plus généralement sur la dynamique et les transformations du système économique capitaliste. La reconnaissance du terrain économique s’avère en ce sens indispensable pour toute conception correcte des luttes sociales et des acteurs politiques. Si l’identité d’un acteur socio-politique collectif (comme une classe) se forme historiquement, et émerge en particulier de ses rapports avec d’autres acteurs, elle dépend néanmoins de son ancrage dans la situation socio-économique. Par ailleurs, si d’autres rapports et groupes sociaux peuvent être pris en considération à côté des classes, ces dernières sont aux yeux de Gramsci les acteurs collectifs qui jouent le rôle le plus fondamental au sein du processus historique[17]. Du reste, la référence continue (que Domenico Losurdo souligne) de Gramsci à la révolution russe – véritable rupture existentielle et politique pour lui – et au bolchévisme, laisse penser que, loin de s’en distancier, il a cherché à approfondir la politique révolutionnaire de classe dont le marxisme est indissociable.
C’est dans cette perspective que l’on peut comprendre la notion d’hégémonie. Ainsi, l’hégémonie d’une classe dirigeante, c’est-à-dire sa capacité à susciter et organiser un certain niveau de consentement chez les autres groupes sociaux, ne saurait être réduite à la culture. D’une part, elle est toujours également, et indissociablement, politique. Le terrain d’exercice premier de l’hégémonie est certes la « société civile », c’est-à-dire « l’ensemble des organismes dits vulgairement “privés”[18] », dans la mesure où la plupart de ces organisations (Églises, écoles, universités, médias, maisons d’édition, associations, groupes d’intérêts, partis, etc.) produisent, plus ou moins directement, l’hégémonie de la classe dirigeante. Mais les classes subalternes disposent aussi sur ce terrain de marges de manœuvre pour s’organiser (elles ont leurs syndicats, associations, partis, etc.) et pour contester l’hégémonie établie : une lutte de classes se déroule donc dans la société civile, et cette lutte est tout autant politique que culturelle. En outre, bien que Gramsci définisse la société civile en la distinguant de la « société politique », c’est-à-dire de l’État au sens strict – l’État tel qu’il est communément compris dans la tradition marxiste, comme instance coercitive au service de la classe dominante –, la société civile et la société politique sont unies dialectiquement dans la réalité concrète, et forment ce que Gramsci appelle l’« État intégral[19] ». Il peut ainsi définir l’État, dans ce sens élargi, comme « l’ensemble des activités pratiques et théoriques grâce auxquelles la classe dirigeante non seulement justifie et maintient sa domination, mais réussit à obtenir le consensus actif des gouvernés[20] ». D’autre part, l’hégémonie politico-culturelle d’une classe a aussi, nécessairement, une dimension économique. C’est ce que montre à nouveau la conception gramscienne de l’américanisme, analysée ici par Pierre Musso – qui met à ce propos en évidence, d’une manière originale, un certain nombre de similarités avec le productivisme de Saint-Simon. Dans la situation socio-historique des États-Unis du début du XXe siècle, en effet, « l’hégémonie naît de l’usine [nasce dalla fabbrica] et elle n’a besoin, pour s’exercer, que du concours d’un nombre limité d’intermédiaires professionnels de la politique et de l’idéologie[21] ». Elle repose moins sur la médiation de l’État ou d’organisations de la société civile, ou sur des idéologies et des conceptions du monde construites et diffusées par différentes strates d’intellectuels, que sur l’efficacité et le dynamisme de la production (y compris la rapidité des innovations techniques) et le niveau relativement élevé des salaires. Plus encore, Musso soutient d’une manière convaincante, à propos du néo-libéralisme mais à partir de suggestions de Gramsci, que les méthodes mises en œuvre dans le procès de production et dans la gestion de la main d’œuvre (le management en premier lieu) peuvent sécréter leurs propres intellectuels et idéologies organiques, à même d’essaimer dans le reste de la société et d’y produire des effets d’hégémonie.
La structure, l’événement et l’historicisme réaliste de Gramsci
L’attention accordée par Gramsci à l’émergence d’une logique capitaliste nouvelle (l’américano-fordisme, donc) capable de dépasser – dans une certaine mesure et provisoirement – la crise de l’époque antérieure, ne l’amène toutefois pas à escamoter les contradictions sociales et les conflits politiques. Plus généralement, Gramsci n’abstrait jamais les systèmes socio-économiques des activités humaines dont ils tirent leur effectivité. De même, s’il met en lumière des phénomènes historiques massifs (l’apparition d’une nouvelle logique économique, l’établissement ou le maintien d’une certaine hégémonie, etc.), il les discerne dans des situations historiques singulières, et les conçoit comme émergeant des luttes socio-politiques. L’« historicisme réaliste » de Gramsci – c’est-à-dire qui fait droit à la réalité historique concrète – s’efforce ainsi d’échapper à deux écueils[22]. D’une part, il refuse d’adopter une perspective subjectiviste et idéaliste, ce dont témoigne sa critique de l’« historicisme spéculatif[23] » du philosophe néo-hégélien Benedetto Croce, qui à ses yeux substantialise voire personnalise l’histoire sous les traits d’un Esprit perpétuellement à l’œuvre, et dissout ainsi ce qui dans le processus historique est consistant ou structuré. D’autre part, Gramsci se détourne d’une conception objectiviste et mécaniste, qu’incarne notamment la présentation du matérialisme historique faite par Boukharine dans son Manuel populaire[24], qui d’après lui ne fait pas droit, en raison de son déterminisme, à cette dimension constitutive de l’histoire qu’est l’activité humaine[25].
Le marxisme structuraliste, tout en étant beaucoup plus riche et articulé, constitue également une compréhension objectiviste du matérialisme historique. Dans son article, Francesca Izzo montre l’importance du rapport critique qu’Althusser entretient à l’historicisme et à Gramsci en particulier, à la fois pour sa propre pensée et pour l’histoire du marxisme en général[26]. Pour Althusser, la science de l’histoire qu’est le matérialisme historique doit forger, d’une manière abstraite, la théorie de structures socio-historiques objectives (comme le mode de production capitaliste). Elle doit ainsi se garder de l’historicisme, et de l’empirisme auquel il est lié, et cela pour au moins deux raisons. D’une part, indexer la théorie sur les fluctuations historiques, et donc la faire dépendre de la conjoncture immédiate, conduirait au révisionnisme et à l’opportunisme. D’autre part, croire avoir un accès immédiat – par expérience, et donc sans détour par la théorie – à l’histoire concrète, implique de rester pris dans des catégories idéologiques (comme celle de sujet) qui nous condamnent à méconnaître la réalité sociale, en l’appréhendant notamment à partir des actions libres et conscientes de sujets humains plutôt qu’à partir de structures intelligibles et déterminantes. Gramsci s’exposerait d’après Althusser à ces deux dangers. Les voies théoriques, et en premier lieu épistémologiques, empruntées par les deux auteurs divergent radicalement, et il n’est pas possible d’évaluer ici leurs mérites respectifs. On peut cependant affirmer qu’un certain nombre des critiques émises par Althusser ne sont pas pertinentes : l’« historicisme réaliste » gramscien est loin de tomber dans l’empirisme naïf qu’il dénonce, mais s’attache au contraire de comprendre des phénomènes historiques de grande ampleur et « structurés », et cela à partir de notions générales (hégémonie, État intégral, bloc historique, etc.) ; et la « philosophie de la praxis », tout en faisant droit à l’activité humaine, ne conduit pas à abstraire ou absolutiser les sujets – qu’ils soient individuels ou collectifs –, mais au contraire à les concevoir comme nécessairement pris dans des rapports sociaux contraignants, et comme définis par ces rapports[27].
Gramsci ne voit donc les phénomènes historiques ni comme intégralement déterminés, ni comme complètement contingents ; bien qu’ils ne soient pas des développements parfaitement objectifs, ils ne sont pas non plus des événements purs. Une crise organique est ainsi un cas où se manifeste par excellence l’unité dialectique de la continuité et de la discontinuité en histoire : elle tire ses origines de contradictions profondes[28], et prolonge en les accentuant des tendances fondamentales du processus historique, mais elle constitue une période où la possibilité d’une rupture avec le passé est particulièrement vive, sans que rien ne garantisse pour autant sa réalisation. C’est ce qu’indique la célèbre thèse selon laquelle « la crise consiste justement dans le fait que l’ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître », ce qui ouvre un « interrègne » où « l’on observe les phénomènes morbides les plus variés[29] », dans la mesure même où les contradictions antérieures ne sont pas encore dépassées. Dans sa contribution à cet ouvrage, Fabio Frosini montre ainsi que la notion de crise est décisive dans les Cahiers de prison – où elle est même mobilisée comme paradigme pour comprendre l’époque bourgeoise-moderne dans son ensemble[30] – et il soutient qu’elle permet de critiquer et d’éviter les écueils rencontrés par les théoriciens qui, comme Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, érigent la notion d’événement en catégorie première de l’entendement historique[31].
Dès leur premier ouvrage « postmarxiste », Hégémonie et stratégie socialiste publié en 1985, ces auteurs, en se revendiquant de la pensée de Gramsci, s’attaquent à l’essentialisme et à l’économicisme qui, pour eux, caractérisent le marxisme. À leurs yeux, les subjectivités collectives ne sont pas déterminées par leur situation économique mais sont le fruit d’une articulation politique – parfaitement contingente – entre forces alliées, sous l’égide d’une force hégémonique, et contre des forces antagoniques[32]. Par exemple, si le mouvement ouvrier est longtemps apparu comme le porteur de l’émancipation humaine dans son ensemble ce n’est pas, contrairement à ce que le marxisme a d’après eux théorisé, parce que le prolétariat aurait été, du fait de sa position économique dans les rapports de production capitalistes, une classe par essence universelle dont la libération impliquait la fin de toute domination, mais plutôt parce que les organisations communistes et socialistes sont parvenues, d’une manière contingente, à agréger politiquement un ensemble de demandes émancipatrices hétérogènes (féministes, antiautoritaires, antiimpérialistes, etc.) autour d’un projet anticapitaliste, hégémonique dans la mesure où il représentait toute la série de ces demandes[33]. Rien ne garantissait que cette articulation réussisse, ni qu’elle se maintienne ; et, réciproquement, d’autres articulations (où d’autres revendications, féministes ou anti-impérialistes par exemple, auraient joué un rôle hégémonique) auraient été possibles. L’identité d’un acteur collectif comme le mouvement ouvrier serait donc intégralement dépendante des demandes qu’il prend en charge, des modalités selon lesquelles il parvient à les articuler et des ennemis contre lesquels il lutte.
Or on sait que Gramsci refuse une telle conception unilatérale des subjectivités collectives, qui ne s’attache qu’à leur dimension politico-idéologique et occulte leur ancrage dans des situations socio-économiques déterminées. La tâche de la philosophie de la praxis est précisément de penser la dialectique entre l’action humaine et ses conditions et – ce second couple ne recoupant pas le premier – entre la politique et l’économie. Fabio Frosini montre de surcroît que les réflexions des Cahiers de prison s’opposent à la vision du temps historique donnée par Laclau. Pour ce dernier, dans la mesure où chaque configuration socio-historique n’est définie que par une articulation politique contingente, il faut penser la réalité sociale comme pouvant être bouleversée à chaque instant, par un événement pur qui n’est pas déterminé par la configuration antérieure[34]. Certes, comme Fabio Frosini le met en évidence, Gramsci ne conçoit pas l’histoire comme le développement continu d’un principe donné d’emblée, qu’il s’agisse du déploiement de la Raison décrit dans une perspective hégélienne, ou de la maturation progressive des contradictions du capitalisme pour le grand récit des versions essentialistes du marxisme. Mais il n’y voit pas non plus de discontinuités absolues, ou de moments d’indétermination pure. S’il est évident que des événements comme la révolution d’Octobre ont une importance décisive aux yeux de Gramsci, il ne les appréhende pas d’une manière isolée, et s’attache toujours à rendre compte des tendances historiques dans le sillage desquelles ils s’inscrivent, ainsi que de la situation socio-historique déterminée de leur advenue, qui dans le cas d’une révolution correspond précisément à une crise. À ses yeux, l’histoire est le lieu, toujours « plein », des conflits entre différentes forces : une crise d’hégémonie n’est pas un vide d’hégémonie, mais le vacillement du système hégémonique actuel du fait de la poussée d’une autre classe vers une hégémonie nouvelle.
Notes
[1] Je remercie Vincent Heimendinger, Richard Lagache et Marion Leclair pour leurs lectures perspicaces et leurs remarques pertinentes.
[2] Sur l’importance de ne pas réduire l’hégémonie à sa dimension culturelle, voir infra, p. 27.
[3] Cette expression a été employée par Jacques Texier, dans « Gramsci, théoricien des superstructures », La Pensée, n°139, juin 1968, p. 35-60. Remarquons toutefois que Texier souligne l’unité dialectique des structures et superstructures chez Gramsci.
[4] Voir par exemple Norberto Bobbio, « Gramsci e la concezione della società civile » [Gramsci et la conception de la société civile] [1967], in Saggi su Gramsci, Feltrinelli, Milan, 1990, p. 38-65.
[5] « La structure compacte [massiccia] des démocraties modernes, aussi bien comme organisations d’État que comme ensemble d’associations dans la vie civile, constitue pour l’art politique l’équivalent des tranchées et des fortifications permanentes du front dans la guerre de positions : alors qu’auparavant, le mouvement était “toute” la guerre, etc., elles le réduisent à n’être qu’un élément “partiel”. » (Cahier 13, §7, in Cahiers de prison, Paris, Gallimard, 1978-1996, p. 364).
[6] Cahier 10 II §12, p. 55 ; Cahier 11, §27, p. 235.
[7] La philosophie de la praxis « est la pleine conscience des contradictions, dans laquelle le philosophe lui-même, entendu individuellement ou comme l’ensemble d’un groupe social, non seulement comprend les contradictions, mais se pose soi-même comme élément de la contradiction, élève cet élément au rang d’un principe de connaissance et par conséquent d’action » (Cahier 11, §62, p. 283).
[8] On le constate à la lecture de son premier article, « Neutralité active et agissante » (31 octobre 1914), in Ecrits politiques, Gallimard, Paris, 1974-1980, tome 1, p. 63-67.
[9] « La révolution contre Le Capital » (publié – en partie censuré – le 24 décembre 1917 dans l’édition milanaise de l’Avanti !, repris dans Il Grido del Popolo le 5 janvier 1918), in Écrits politiques , op. cit., tome 1, p. 135-138 [l’édition française Gallimard indique, d’une manière erronée, le 24 novembre comme date de publication dans l’Avanti !].
[10] Il Grido del Popolo, 4 mai 1918, in Écrits politiques, op. cit., tome 1, p. 145-149.
[11] L’Ordine nuovo est fondé le 1er mai 1919. Il est à l’origine dirigé par Angelo Tasca et a pour objectif de contribuer à construire une culture prolétarienne. Sa ligne change cependant rapidement sous l’impulsion de Gramsci, suivi par Togliatti et Terracini : l’hebdomadaire se fait le porte-voix des luttes des ouvriers turinois, et promeut notamment le développement des conseils d’usine dans le but de réaliser « la démocratie ouvrière » (titre de l’article du 21 juin 1919 qui inaugure cette nouvelle ligne).
[12] L’expression « biennio rosso » (les « deux années rouges ») renvoie à l’ensemble des luttes sociales particulièrement puissantes et radicales qui se sont déroulées en 1919 et 1920. À la campagne, les paysans pauvres et les journaliers occupent les terres. À Milan, Gênes et surtout Turin (capitale industrielle de l’Italie et siège de la Fiat), les ouvriers s’auto-organisent en conseils, font massivement grève, occupent les usines, mettent en place des milices d’auto-défense et relancent eux-mêmes la production. L’absence de soutien de la part des directions du PSI et de la CGL (Confédération générale du travail, principal syndicat), les concessions illusoires et vites oubliées obtenues du patronat dans le cadre de négociations biaisées, la répression étatique et les assauts des fascistes ont finalement eu raison du mouvement. La responsabilité du PSI dans cet échec a renforcé la croyance de Gramsci en la nécessité de former un nouveau parti, à partir des éléments réellement révolutionnaires du PSI. Quelques semaines après la fin du mouvement (novembre 1920), il défendra cette ligne au XVIIe congrès du PSI à Livourne.
[13] Le Parti communiste d’Italie (PCd’I) se renommera Parti communiste italien (PCI) en 1943.
[14] Voir notamment Cahier 11, §§ 47-49, p. 264-269. Gramsci développe la notion de « traductibilité » entre « cultures nationales », entre « langages scientifiques » et en définitive entre les champs de réalité auxquels ces langages renvoient, à partir de l’idée – qui remonte au moins à Hegel, en passant par Marx, Kautsky ou Lénine – selon laquelle il existerait une correspondance ou une convertibilité entre la politique française, la philosophie allemande et l’économie anglaise. Sur cette question, voir Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini, « De la traduction à la traductibilité : un outil d’émancipation théorique », Laboratoire italien, n° 18, 2016/2 [en ligne].
[15] Voir Fabio Frosini, Gramsci e la filosofia. Saggio sui « Quaderni del carcere » [Gramsci et la philosophie. Essai sur les Cahiers de prison], Carocci, Rome, 2003, et La religione dell’uomo moderno. Politica e verità nei « Quaderni del carcere » di Antonio Gramsci [La religion de l’homme moderne. Politique et vérité dans les Cahiers de prison d’Antonio Gramsci], Carocci, Rome, 2010 ; et Giuseppe Vacca, Modernità alternative. Il Novecento di Antonio Gramsci [Modernités alternatives. Le vingtième siècle d’Antonio Gramsci], Einaudi, Turin, 2017.
[16] Sur l’importance des réflexions économique chez Gramsci, voir Giuliano Guzzone, Gramsci e la critica dell’economia politica. Dal dibattito sul liberismo al paradigma della « traducibilità » [Gramsci et la critique de l’économie politique. Du débat sur le libéralisme au paradigme de la « traductibilité »], Viella, Rome, 2018.
[17] La conception complexe des phénomènes et des acteurs historiques, qui n’abandonne pas pour autant l’idée d’un rôle central possédé par les classes, transparaît bien du passage suivant – que Giuseppe Vacca cite d’ailleurs dans son texte : « La conception de l’État selon la fonction productive des classes sociales ne peut s’appliquer mécaniquement à l’interprétation de l’histoire italienne et européenne de la Révolution française à la fin du XIXe siècle. Bien qu’il soit certain que, pour les classes productives fondamentales (bourgeoisie capitaliste et prolétariat moderne), l’État n’est concevable que comme la forme concrète d’un monde économique déterminé, d’un système de production déterminé, il n’est pas sûr que le rapport entre la fin et les moyens soit aisément repérable et prenne l’aspect d’un schéma simple et évident au premier coup d’œil. […] Il y a aussi le problème complexe des rapports de forces internes du pays considéré, du rapport des forces internationales, de la position géopolitique du pays considéré. » (Cahier 10 II §61, p. 157. Je souligne, Y.D).
[18] Cahier 12, §1, p. 314.
[19] Cahier 6, §88, p. 83 ; Cahier 6, §155, p. 126. Voir aussi la lettre à Tania du 7 septembre 1931, in Lettres de prison, Gallimard, Paris, 1971, p. 333.
[20] Cahier 15, §10, p. 10. Sur la conception de l’État chez Gramsci, voir l’ouvrage classique et toujours pertinent de Christine Buci-Glucksmann, Gramsci et l’État : pour une théorie matérialiste de la philosophie, Fayard, Paris, 1975.
[21] Cahier 22, §2 p. 183, le texte A (première rédaction de la note) se trouve dans le Cahier 1, §61 (publié uniquement en italien : Quaderni del carcere, Einaudi, Turin, 1975, tome 1, p. 72).
[22] Sur ces questions, je me permets de renvoyer à Yohann Douet, « Affronter la crise de la modernité : hégémonie et sens de l’histoire chez Gramsci », Actuel Marx, n° 68, 2020/2, p. 175-192.
[23] Pour l’opposition entre historicismes « spéculatif » et « réaliste », voir notamment Cahier 10 I Sommaire, p. 17, Cahier 10 I §8 p. 31-33, et Cahier 10 I §11, p. 39.
[24] Nikolaï Boukharine, La théorie du matérialisme historique. Manuel populaire de sociologie marxiste [1921], Anthropos, Paris, 1969.
[25] La critique de Croce est en grande partie développée dans le cahier 10, et celle de Boukharine dans le cahier 11.
[26] Remarquons d’ailleurs que les textes d’Althusser ont donné une impulsion décisive à la recherche gramsciennes en France. Une part importante des études en français sur l’œuvre de Gramsci ont ainsi été écrites par des auteurs influencés plus ou moins directement par Althusser (Christine Buci-Glucksmann, Maria-Antonietta Macchiocchi, Hugues Portelli, André Tosel). L’article d’André Tosel dans ce volume revient sur certains éléments de l’histoire des lectures gramsciennes en France. Pour une étude approfondie de la réception française de Gramsci, on se reportera aux travaux d’Anthony Crézégut, et en particulier à sa thèse, soutenue en décembre 2020 à l’Institut d’études politiques de Paris : « Inventer Gramsci au XXe siècle. Décomposition d’une intelligence française au prisme italien ».
[27] Pour une discussion de ces points et une réponse aux critiques althussériennes, on peut se reporter à Peter Thomas, The Gramscian Moment. Philosophy, Hegemony and Marxism [Le moment gramscien. Philosophie, hégémonie et marxisme], Brill, Leiden/Boston, 2009. Sur le rapport complexe d’Althusser à Gramsci, et ses évolutions au fil de son parcours intellectuel et politique, voir aussi Vittorio Morfino, « Althusser lecteur de Gramsci », Actuel Marx, n° 57, 2015/1, p. 62‑81.
[28]« Une crise se produit, qui parfois se prolonge sur des dizaines d’années : cette durée exceptionnelle signifie que dans la structure se sont révélées (sont venues à maturité) des contradictions irrémédiables et que les forces politiques qui travaillent positivement à la conservation et à la défense de la structure elle-même s’efforcent cependant d’y remédier à l’intérieur de certaines limites et de les surmonter » (Cahier 13, §17, p. 377, texte A dans le Cahier 4, §38, publié seulement en italien : Quaderni del carcere, op. cit., tome 1, p. 455).
[29] Cahier 3, §34, p. 283.
[30]« Le développement du capitalisme a été, si l’on peut s’exprimer ainsi, une “crise continuelle”, un mouvement très rapide d’éléments qui s’équilibraient et se neutralisaient » (Cahier 15, §5, p. 112).
[31] On pourrait étendre la critique de Fabio Frosini à un auteur comme Alain Badiou, qui accorde également une importance philosophique fondamentale aux notions d’événement et de sujet, même si la discussion serait plus difficile à mettre en œuvre qu’avec Laclau et Mouffe, qui prétendent construire leur propre pensée à partir de celle de Gramsci.
[32] « Pour Gramsci, les sujets politiques ne sont pas – à strictement parler – les classes, mais des “volontés collectives” complexes ; de la même façon, les éléments idéologiques articulés par une classe hégémonique n’ont pas d’appartenance de classe nécessaire. […] La volonté collective est une conséquence de l’articulation politico-idéologique de forces historiques dispersées et fragmentées » (Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, Hégémonie et stratégie socialiste. Vers une politique démocratique radicale, Les Solitaires Intempestifs, Besançon, 2009, p. 140‑1).
[33]« La centralité politique de la classe ouvrière a un caractère historique, contingent : elle exige de la classe qu’elle sorte d’elle-même, qu’elle transforme sa propre identité en y articulant une pluralité de luttes et de revendications démocratiques » (ibid., p. 145).
[34] Cette conception est exposée longuement par Ernesto Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time [Nouvelles réflexions sur la révolution de notre temps], Verso, Londres, 1990. On en trouvait cependant déjà les prémices dans Hégémonie et stratégie socialiste…, op. cit. : les auteurs y affirmaient ainsi que, pour Gramsci, l’histoire est « une série discontinue de formations hégémoniques ou de blocs historiques » (ibid., p. 147).



![Gramsci, penseur de l’hégémonie [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Gramisci-150x150.jpg)




