
L’État contre la société. À propos de Homo Domesticus, de James C. Scott
James C. Scott, Homo Domesticus. Une histoire profonde des premiers États, Paris, La Découverte (préface de J.-P. Demoule), 2019.
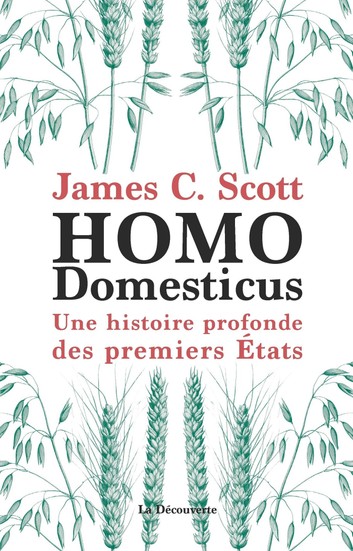
James C. Scott occupe une place bien particulière dans le paysage des sciences sociales en France. Il est tout d’abord connu parmi les anthropologues pour ses travaux sur les sociétés paysannes[1]. Il est également connu parmi les politistes pour ses travaux sur l’État[2]. Enfin, ses concepts, notamment ceux de « texte caché », de « texte public » et d’ « infra-politique des groupes subalternes »[3], circulent parmi un large public de chercheurs qui visent à saisir les formes de domination et de résistance.
Dans Homo Domesticus. Une histoire profonde des premiers États[4], il fait cette fois-ci une incursion chez les archéologues afin de livrer une analyse originale des liens entre l’agriculture et la forme-État dans les premières sociétés humaines — on pourrait rapprocher sa démarche de celle de David Graeber dans Dette : 5000 ans d’histoire. Dans son livre, Scott prolonge des thèses qu’il développe ailleurs dans la continuité de ce que l’on pourrait appeler une « anthropologie anarchiste » où, au lieu de mettre l’accent sur les dynamiques sociales qui ont favorisé l’apparition de l’État et la bureaucratisation des sociétés, il s’attarde plutôt sur le refus de la domination étatique et la soif d’autonomie et d’autosuffisance des groupes humains.
Contre le « récit standard » de l’histoire de l’humanité
Comment sommes-nous devenus des sujets sédentaires, cultivateurs de céréales et éleveurs de bétail, gouvernés par des États ? Répondre à cette question revient à se demander pourquoi, pendant 90 % de la durée de l’existence humaine, nous avons vécu dans des bandes de chasseurs-cueilleurs et pourquoi, à partir d’un certain moment, nous avons « choisi » de vivre dans le cadre de concentrations humaines, animales et végétales sous la domination d’un État.
Jusqu’à il y a quatre siècles au moins, une large partie de la population mondiale était encore constituée de chasseurs-cueilleurs, de cultivateurs saisonniers, des peuples pastoraux et horticulteurs, c’est-à-dire une humanité « non administrée ». En effet, l’hégémonie de l’État est extrêmement récente. Cette hypothèse invite à relativiser son rôle dans l’histoire de l’humanité :
« Pendant les milliers d’années qui ont suivi son apparition initiale, l’État n’a pas été une constante mais une variable — et une variable assez mineure dans l’existence d’une bonne partie de l’humanité » (p. 32).
Il n’y a pas d’équivalence entre sédentarité, agriculture et émergence de l’État. Des centres urbains pouvaient exister sans que l’on trouve des traces d’agriculture. De la même manière, l’agriculture pouvait coexister avec le nomadisme des populations. Enfin, les premiers États collecteurs d’impôts et constructeurs de fortifications apparaissent seulement quatre millénaires après la domestication d’espèces végétales et la sédentarité. L’incursion de Scott chez les archéologues se fait à partir de ses propres connaissances et de ses propres analyses sur l’État mais surtout sur les résistances à sa domination dans des sociétés agricoles contemporaines.
Son objectif n’est donc pas seulement de synthétiser les connaissances existantes, mais aussi de tirer des conséquences sur l’analyse de la forme-État elle-même. Pour cela il choisit d’étudier la période allant de 6 500 à 1 600 avant notre ère en Mésopotamie, où auraient émergé les « premiers États « purs » de l’humanité » (p. 13).
À lire l’auteur, le grand récit du progrès de l’humanité est faux. L’hypothèse principale de Scott consiste à affirmer qu’il n’y a pas de supériorité sociale de l’agriculture et de la sédentarité sur d’autres configurations sociales :
« On présuppose tout simplement qu’Homo sapiens, fatigué de ses tribulations, ne désirait qu’une chose : se fixer définitivement et en finir avec des milliers de millénaires de nomadisme et de mouvements saisonniers » (p. 24).
Plutôt, les peuples nomades ont opposé une grande résistance à la sédentarisation. Il n’y a donc rien de naturel dans le passage du nomadisme à l’agriculture, et ce passage ne représente pas un bond historique pour l’humanité en termes de bien-être et de progrès. Reprenant la célèbre thèse de Marshall Sahlins dans Âge de pierre, âge d’abondance, il affirme que les sociétés de chasseurs-cueilleurs n’étaient pas des sociétés de privation et de pénurie, au contraire.
Pour Scott, la « domestication » du feu est un événement bien plus important que la domestication des animaux et des plantes. En lui permettant de modifier son environnement naturel (en concentrant le gibier, en faisant disparaître certaines plantes), le feu serait la clé de l’influence de l’humanité sur le monde naturel. En effet, le feu, véritable outil d’aménagement du territoire, a eu des effets sur des centaines de milliers d’années dans la création d’un environnement favorable à l’humanité, bien avant la domestication des plantes et des animaux.
En outre, comme c’est bien connu, le feu a permis la consommation d’aliments jusque-là impossibles à digérer, amplifiant la gamme d’aliments accessibles, autorisant donc l’installation de nouveaux foyers dans des environnements hostiles. Pour Scott, si le feu a permis à l’humanité d’adapter son environnement à ses besoins, l’humanité s’est aussi adaptée au feu, dans la mesure où nous nous sommes adaptés (socialement et physiologiquement) à son usage, au point où nous ne saurions survivre sans lui. C’est pourquoi l’auteur peut renverser le rapport et affirmer : « Nous avons littéralement été domestiqués par le feu » (p. 59).
L’agriculture et la domestication des animaux et ensuite l’apparition des premiers centres urbains ne sont pas venus mécaniquement. Les travaux classiques insistent sur la mobilisation d’une large main-d’œuvre grâce à une autorité publique dans les travaux d’irrigation du désert, au fondement des premières communautés sédentaires. Or, comme le rappelle Scott, les travaux les plus récents attestent qu’il n’y a pas eu de correspondance entre sédentarisation et agriculture.
Ainsi, l’ « hypothèse des zones humides » veut que les premiers grands établissements sédentaires soient apparus dans des zones humides où l’agriculture n’était pas nécessaire en raison de l’abondance des ressources naturelles :
« [Dans le récit dominant] le travail de civilisation consistait précisément à drainer les marais et à les transformer en champs de céréales et en villages productifs et bien ordonnés. Civiliser les terres arides, c’était les irriguer ; civiliser les marais c’était les assécher » (p. 71).
Comment expliquer alors le décalage de quatre millénaires entre les premiers indices de domestication des céréales et l’apparition des premières sociétés agropastorales ? Scott défend l’hypothèse que les populations quasi sédentaires de la plaine alluviale mésopotamienne ont adopté des stratégies de subsistance mobiles et hybrides, en fonction des variations brusques de l’environnement. Il n’y a donc pas eu des sociétés de chasseurs-cueilleurs, puis des sociétés d’éleveurs, mais plutôt une coexistence de ces différentes pratiques.
Ceci a pour conséquence d’infirmer une vision linéaire de la sédentarisation progressive des sociétés : pourquoi augmenter l’insécurité alimentaire des populations (en se spécialisant dans un seul créneau technologique) en se mettant à cultiver des céréales ?
La plantation de certaines graines n’est qu’une technique de survie parmi d’autres des premières populations semi-sédentaires. Il est donc difficile de pointer du doigt un moment précis qui marque le début de l’agriculture. Quelle que soit la raison du recours croissant aux céréales et aux animaux domestiqués, celui-ci a un effet majeur sur l’homo sapiens : l’apparition d’unités domestiques qui regroupaient individus, animaux, semences et céréales, avec son lot d’insectes, de parasites et de maladies, produit de la concentration d’espèces différentes dans un même lieu.
Cette domus a eu pour effet de rendre dépendant de notre intervention un certain nombre d’espèces végétales et animales, sans laquelle elles cesseraient tout simplement d’exister. Ainsi, les animaux domestiques sont devenus des espèces différentes à part entière, produites par l’intervention humaine, par rapport à leurs cousins sauvages. La nature devient donc de moins en moins « naturelle » et de plus en plus du travail accumulé. Les animaux domestiques et les plantes cultivées sont progressivement « filtrés » par le travail humain, dirait Marx dans le Capital.
Mais il en est de même des humains, eux aussi « fabriqués » par l’autodomestication : la domus en tant qu’ « environnement artificiel culturellement modifié » (p. 100) a modifié profondément la morphologie humaine (réduction de la taille des dents, raccourcissement du faciès et des mâchoires, etc.). Autrement dit, nous ne sommes pas simplement les sujets des récits de la domestication ; nous en sommes aussi l’objet.
Enfin, la dernière conséquence considérable de la constitution de la domus a été le développement de maladies capables de passer d’une espèce à une autre, produit de la concentration sur un seul et même espace de plusieurs espèces d’animaux (vaches, chèvres, poules, chiens, chats, rats, humains…).
Repenser l’origine de l’État
L’agriculture, la sédentarité, la domus et les premiers peuplements urbains étaient déjà en place avant l’apparition de l’État. Pour Scott, l’ « agrocomplexe néolithique était une plateforme nécessaire mais pas suffisante de l’émergence de l’État ; il la rendait possible, mais pas inéluctable » (p. 132).
Mais comment reconnaître un État à partir de quelques indices archéologiques épars ? Faut-il qu’il ait le monopole sur un territoire à travers l’exercice d’une force coercitive ? Faut-il qu’il possède une couche de fonctionnaires dont une des tâches principales est la collecte de l’impôt ? Faut-il enfin qu’il possède une armée, des murailles, un roi ou une reine ? Même s’il retient certaines caractéristiques fondamentales (des murailles/frontières, une fiscalité et l’existence d’une couche de fonctionnaires), pour l’auteur la forme-État est plus une question de degré que de nature. À partir de là on peut affirmer que des cités-États ont progressivement émergé en Proche-Orient au troisième millénaire avant notre ère.
Cependant, si la sédentarité, des peuplements urbains et l’agriculture existaient avant l’État, comment celui-ci est-il parvenu à imposer son contrôle sur un territoire et sur ses ressources ? Pour l’auteur, un changement climatique aurait provoqué une sècheresse, ce qui aurait favorisé une concentration de la population dans des centres urbains. Le climat sec aurait mis à disposition de la forme-État une concentration de population et de cultures céréalières. L’État aurait donc « colonisé » ce noyau de ressources et de main-d’œuvre.
D’autres facteurs entrent aussi en jeu, tels que l’existence de terres particulièrement fertiles capables d’alimenter une population non productrice et l’existence de voies navigables. Il s’en suit aussi que si les sols bien arrosés favorisaient l’émergence de l’État et des sociétés étatiques, d’autres régions étaient peu propices à son émergence, comme les déserts ou les régions montagneuses.
Mais concentrer les populations sur un seul lieu n’était pas suffisant pour que l’État « colonise » les jeunes centres urbains, puisque les deux (concentration urbaine et constitution d’un appareil étatique) ne coïncident pas historiquement. Il faut noter que si Scott fournit les éléments qui permettent de comprendre les conditions d’émergence de la forme-État ; en revanche il n’explique pas pourquoi l’État colonise le noyau « main-d’œuvre/céréales », ni pourquoi se développe une élite non productrice dont l’intérêt est d’accaparer l’excédent agricole.
Alors qu’Engels situe la clé de la compréhension de l’émergence de l’État dans l’apparition de la propriété privée et la fin de l’organisation gentilice, cette émergence se situe plutôt pour Scott dans la prédominance des céréales dans l’alimentation humaine : celles-ci se prêtent mieux que d’autres aliments à être comptées, mesurées, évaluées, stockées. Toutefois, les céréales ne sont pas la cause de l’émergence de l’État ; elles en sont seulement la condition. Pour Engels, l’État est l’institution qui vient sanctionner et par la suite perpétuer des inégalités inconnues jusqu’alors dans l’histoire de l’humanité, tandis que pour Scott, l’État apparaît plutôt comme un parasite qui vient se greffer sur noyau « céréales/main-d’œuvre ».
Contrairement aux tubercules ou les légumineuses telles que les lentilles, les céréales sont des « cultures d’État » parce qu’elles peuvent être facilement évaluées et prélevées par le fisc :
« ce sont ces caractéristiques qui ont fait du blé, de l’orge, du riz, du millet et du maïs des cultures politiques par excellence » (p. 148).
L’usage des céréales comme étalon de mesure fiscale permettait de mettre en équivalence les autres marchandises, à commencer par le travail humain. Ce n’est donc pas un hasard si les bols servant à mesurer les rations alimentaires journalières des travailleurs est un des restes archéologiques les plus courants en Mésopotamie. Ce n’est pas non plus un hasard si les « barbares » désignaient surtout les populations en dehors des cités-États dont les activités économiques n’étaient pas appropriables (chasse, cueillette, horticulture, etc.), donc que l’on ne pouvait pas taxer.
Dès lors, l’érection de murailles autour des villes-États revêt un double sens : il s’agissait à la fois de maintenir éloignés les « barbares » qui pourraient piller les stocks de céréales et de confiner les paysans-contribuables au sein de l’État. Les murailles ont alors autant une fonction de défense que de contrôle politique des populations.
C’est à peu près aussi à cette période que l’écriture a fait son apparition. En effet, une des conditions de l’appropriation étatique est l’inventaire des ressources disponibles. Il y a dès le départ un effort immense en vue de rendre la société lisible et mesurable pour les dirigeants politiques et religieux. La « scripturalisation » de la société pouvait atteindre des degrés relativement élevés : rations, prisonniers, esclaves, travailleurs, taille et qualité du sol, rendement des cultures, distances, méthodes de travail, etc., tout était consigné sur des tablettes. Enfin, cela permettait aussi d’uniformiser l’administration du territoire. Les règles et lois pouvaient être inscrites et imposées sur l’ensemble du royaume et des sujets.
Le rôle de l’État est alors fondamental dans l’organisation de l’appropriation de tout excédent de la production. Autrement dit, en l’absence de contrainte étatique, il n’y avait aucune incitation à aller au-delà d’une reproduction simple parmi les sociétés vivant de techniques de production mixtes. Il fallait donc contraindre les communautés paysannes à produire un excédent qui ne serait pas consommé dans des activités rituelles ou récréatives, pour qu’il soit approprié par l’élite non productrice.
Les guerres avaient pour but non seulement de conquérir de nouveaux territoires, mais surtout d’intégrer de nouvelles populations non taxées à l’ordre étatique. La capture de prisonniers pour les transformer en esclaves était alors un moyen pour accroître la population d’un territoire et maximiser l’excédent appropriable. Il s’agissait d’une sorte de « prélèvement » de main-d’œuvre que l’État n’avait pas besoin de produire lui-même.
On constate aussi l’existence de déportations massives et de réinstallations forcées de populations dans des colonies agricoles plus proches du centre du royaume, de sorte que la production puisse être plus facilement contrôlée et accaparée. L’État devient dès lors un État-contremaître, organisant la production et l’appropriation de l’excédent de la production. Scott rappelle toutefois que l’État n’a pas créé l’esclavage : celui-ci existait déjà dans des sociétés pré-étatiques, mais l’État l’a massifié et s’en est servi pour constituer une source de main-d’œuvre asservie.
Cet ordre politique était fragile, dans la mesure où tout bouleversement plus ou moins important (catastrophe écologique, épidémie, mauvaise récolte, guerre ou invasion, etc.) favorisait la fuite et l’exode de populations cherchant à échapper à la domination étatique et à reconstruire des formes d’autosuffisance locale. Attentif toujours aux capacités d’agir des subalternes, Scott rappelle que les révoltes d’esclaves n’étaient pas non plus rares et ont souvent été bien documentées par les élites, dans la mesure où la concentration d’étrangers dans une condition de servilité favorisait leur révolte.
Il insiste aussi sur le fait que l’effondrement des royaumes anciens ne signifiait pas nécessairement un déclin de la population, une détérioration de sa santé, de son régime alimentaire ou une dissolution de sa culture. L’effondrement d’un royaume voulait dire souvent la chute d’une élite dominante, mais non de la population. Ainsi, pour Scott, au lieu d’ « effondrement » il vaudrait mieux parler de « désagrégation » des royaumes et des États. La disparition d’un roi et la destruction de son palais et de ses temples ne se traduisaient pas toujours par des conséquences néfastes pour le reste de la population ; celle-ci abandonnait la sédentarité ou retournait vers des régions moins peuplées et plus rurales.
***
Ce nouveau regard sur l’histoire des premiers États nous rappelle que cette forme d’organisation ne s’est imposée que très lentement au cours d’une histoire qui n’a rien de linéaire, et que les périodes qui se situent entre deux apogées civilisationnelles — interrègnes souvent appelés « âges sombres » — ont surtout été « sombres » pour les dynasties centralisatrices et pour les archéologues friands de traces écrites et de monuments.
En outre, ces États n’ont contrôlé qu’une partie infime du territoire mondial pendant la période allant de 6 500 à 1 600 avant notre ère : « phénomènes alors essentiellement agraires, les États de l’époque ressemblaient à de petits archipels situés dans les plaines alluviales d’une poignée de grands fleuves, ou bien à titre exceptionnel dans quelques vallées intramontagneuses » (p. 234). Tout le reste appartenait au monde des « barbares », c’est-à-dire aux peuples sans État.
Ces derniers étaient loin d’être les « perdants » de la civilisation, mais bien plutôt le produit de la domination de l’État. Ils vivaient dans une étrange co-dépendance avec les sociétés étatiques, à partir de razzias, mais aussi à partir d’accords et de traités commerciaux. Toujours est-il que l’État réussit à imposer son hégémonie sur le monde (non sans mal), jusqu’au point où, vers le XVIIIe siècle, tous les « barbares » avaient disparu du territoire européen.
Notes
[1] The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia, Yale University Press, 1979 ; Weapons of the Weak : Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale University Press, 1985.
[2] Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, Yale University Press, 1998 ; Zomia ou l’art de ne pas être gouverné, Seuil, 2013.
[3] La Domination et les arts de la résistance. Fragments d’un discours subalterne, Amsterdam, 2009.
[4] Malheureusement, le jeu de mots du titre original du livre en anglais se perd dans sa traduction française. Against the grain signifie à la fois « à contre-courant » et « contre le grain », en référence à la nouvelle lecture qu’il offre de l’histoire des premiers États et au rôle central des céréales dans celle-ci.








