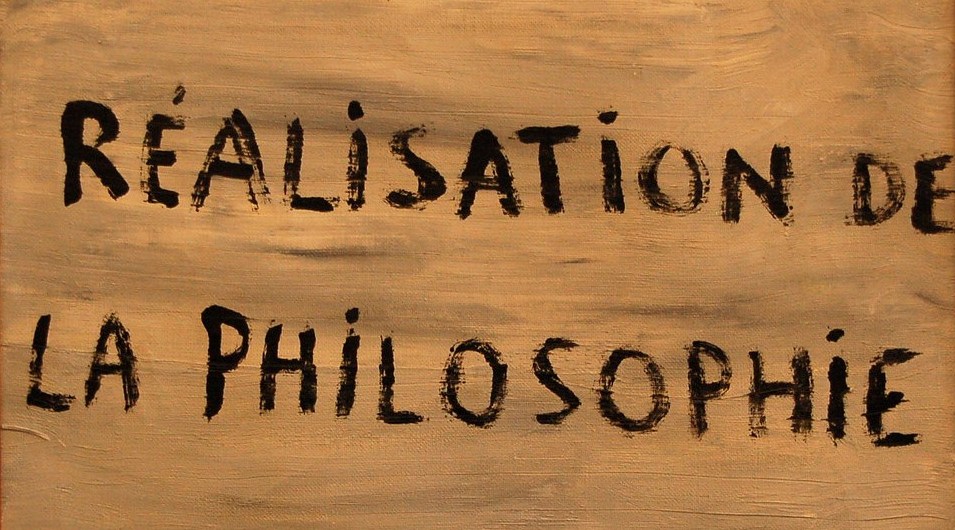
Un partage des savoirs. Intellectuels, fonction critique et rapports au pouvoir
« Redessiner la carte du possible ». Telle est la tâche que Jacques Rancière attribue au travail intellectuel et à l’exigence qu’il requiert : non pas seulement une fonction critique mais une perspective politique, le renversement d’un monde qui ne va pas de soi et dont l’évidence même est interrogée. Cet horizon est forgé par les futurs imaginés, partant du présent et conçus activement.
Il faut le dire d’emblée, Jacques Rancière ne considère pas l’« intellectuel » avec le regard qu’on a l’habitude de lui porter – l’écrivain, l’universitaire ou l’expert tout à la fois engagé et solitaire. Il ne le/la voit pas davantage comme une parole autorisée par un savoir dûment breveté. Car, pour Rancière, la distribution instituée des compétences est la marque d’un système policier : le terme est à entendre ici comme l’assignation figée des places et des rôles qui ne cesse de reconduire la domination et l’autorité. C’est justement cette hiérarchie des fonctions qu’il s’agit de mettre à bas : l’intelligence s’impose là où on ne l’attend pas. L’« intellectualité » est dès lors conçue tout autrement, dans le partage de l’intelligence et de savoirs mis en commun :
intellectuel sera alors quiconque, en un point quelconque de la société, sort de son rôle habituel d’exécutant du système social pour affirmer qu’il a en plus quelque chose à dire sur la machine qu’il fait fonctionner, sur la machine sociale en général et sur la capacité de n’importe qui à en parler.
Cette conception rejoint la manière dont la politique est définie par Rancière : non pas les institutions, les élections et la manière de gouverner, en bref le pouvoir assimilé plutôt à une « police » au sens d’un « circulez, il n’y a rien à voir », mais le contraire de cet ordre-là, reproduit et cristallisé. La politique n’est pas « l’art de diriger les communautés », mais un rapport fort à l’égalité. Elle passe par la conflictualité et la lutte pour l’émancipation. Elle est elle-même sans cesse contrée par les tentatives d’effacement de la politique, qui consistent à nier le dissensus, à le lisser ou à le tourner en dérision, au profit de la seule « gestion de la population ».
La politique advient justement quand est brisé le consensus supposé dominer ; elle surgit quand, collectivement, se dessine « une possibilité de monde qui se rend perceptible et met en cause l’évidence d’un monde donné ». L’intellectualité consiste, partant, dans la manifestation de cette capacité à élaborer les visions d’une autre société. Celles et ceux qui n’ont pas l’estampille officielle de l’intellectuel le sont pourtant. On ne leur accorde pas la parole mais ils/elles la prennent ; on ne leur demande pas leur avis mais ils/elles le donnent. « C’est cela la politique : trouver une manière de faire ce qu’on n’est pas supposé faire, d’être là où on n’est pas censé être »[1].
C’est cette double dimension – de l’intellectuel et du politique – que je veux retenir ici. Elle ouvre en effet d’autres perspectives que celles, toutes tracées, de ces experts à la mode, ressassant leurs obsessions de l’identité, leurs peurs de l’étranger, leurs fabriques nostalgiques – et mythologiques – du passé. Non seulement, dans cette perspective et cette alternative, l’intelligence est collective mais elle porte l’espoir agissant d’un monde différent.
Quand le rejet de l’intellectuel universel masque l’abandon des projets
Comme le souligne Isabelle Garo en revenant aux origines de la sphère intellectuelle, en apparence dissociée de la production matérielle mais en réalité intimement mêlée à elle,
l’apparition d’activités intellectuelles spécialisées est liée, pour Marx et Engels, à la formation de classes antagonistes, à l’organisation de l’exploitation du travail et à l’apparition d’un mode inégalitaire de répartition des richesses produites. Toute la complexité du problème est liée au fait que la production des idées est à la fois séparée de la production matérielle mais associée à l’ensemble de son organisation la plus concrète et aux exigences de sa reproduction sociale[2].
La réflexion a, on le sait, été régulièrement réactivée quant au rôle des « intellectuels » et à leur légitimité. Le débat est donc ancien et ce sont deux visions politiques qu’il exprime : on a coutume d’opposer Sartre et Foucault en les renvoyant, pour le premier, à l’intellectuel universel, pour le second, à l’intellectuel spécifique, penché sur des luttes précises désormais, sans plus de prétention aux généralités. En fait, l’opposition va au-delà, même s’il est aussi des points de rapprochement et de comparaison entre ces deux conceptions.
Certes, Sartre a pu sembler incarner la figure de cet intellectuel à vocation universelle tant, depuis la Libération, son engagement est de toutes les luttes et de tous les instants : partisan actif de la décolonisation, militant ardent de l’anti-impérialisme, soutien aux grèves ouvrières et à la jonction travailleurs/étudiants, en bref porteur d’un plaidoyer : « on a raison de se révolter ». Mais il est aussi le théoricien de la condition infligée à l’homme par le capitalisme : ce que toutes ces luttes portent en puissance à ses yeux, c’est le renversement d’un système tout entier. De là découle sa conception de l’intellectuel. Ce n’est pas celle du grand penseur ni du grand savant, comme on le lui a attribuée de longtemps.
Devient intellectuel/le pour lui tout homme ou toute femme qui « refuse d’être agent subalterne de l’hégémonie », prend conscience des contradictions dans lesquelles elle ou il est pris et refuse désormais sa mutilation par la puissance écrasante de l’idéologie. Est intellectuel/le celle ou celui pour qui se révèle l’intériorisation de l’autocensure et du principe d’autorité, et qui décide de la briser. L’intellectualité est une praxis, ce n’est pas seulement une pensée. Agissante, elle commence par nier ce qui est, au profit de ce qui n’est pas encore, une fin à atteindre : « le champ pratique se donne comme une situation à changer ». Alors s’opère le dévoilement des contradictions fondamentales dans lesquelles la société est comme embourbée. Sartre est absolument clair sur ce point. Ces tensions sont
des conflits de classe et, au sein de la classe dominante elle-même, d’un conflit organique entre la vérité qu’elle réclame pour son entreprise et les mythes, valeurs et traditions qu’elle maintient et dont elle veut infecter les autres classes pour assurer son hégémonie[3].
Foucault revient à de nombreuses reprises sur la fin supposée de l’intellectuel universel, Sartre étant, on le sait, le premier visé : celle de la conscience et de l’éloquence, celle qui parle haut et fort. Chez Foucault, ce rejet surgit aussi de son propre positionnement politique : il n’a guère d’intérêt pour la lutte de classes et fait peu de cas de la classe ouvrière. A ses yeux, le prolétariat n’est plus un sujet universel ; par correspondance, l’intellectuel ne l’est plus lui non plus. A présent, par conséquent, il faut travailler de manière locale et limitée, sur des sujets circonscrits, qu’il s’agisse de la famille, de l’école, de l’hôpital, de l’asile, de la prison ou bien encore de l’université. Son rôle est de « réinterroger les évidences et les postulats, de secouer les habitudes, les manières de faire et de penser ». Sa pensée est essentiellement critique, le mot étant défini comme « l’art de l’inservitude volontaire, celui de l’indocilité réfléchie ». Foucault est bien conscient cependant de la limite intrinsèque à cette réduction : le risque est en effet de rabattre l’intervention sur des combats sectoriels et conjoncturels, sédimentant les luttes et les milieux, s’empêchant une stratégie globale et de long terme[4].
Surtout, les clivages perdent de leur tranchant. A l’opposé des marxistes, Foucault abandonne la ligne de force fondamentale qui passe selon eux dans l’opposition de classes, dans l’hégémonie d’une classe possédante et dirigeante, dans l’Etat qui en est la complexe incarnation. Pour Foucault, le pouvoir est partout, profus, dispersé et dilué. Il s’exerce « à partir de points innombrables », dans chacune des relations, dans la moindre des interactions[5]. Il était de fait essentiel de le repérer. Autre chose est d’en arriver à une critique tout aussi diffuse qui, si elle ne renonce pas à la lutte, perd cependant certains leviers. Ni l’Etat, ni le profit, ni les rapports de production, ni le capitalisme ne sont l’objet de sa réflexion. Cette forme de pouvoir dominante et écrasante qu’est l’exploitation n’est quasiment plus questionnée ; elle disparaît comme sujet.
C’est aussi perdre de vue la perspective de la révolution, comme renversement d’un système économique et de ses institutions politiques. Dans la vision foucaldienne, il n’y a pas de climax : « la lutte ne culmine jamais »[6]. Il n’y a pas de fin, au sens d’une finalité.
Tombeau pour la révolution
La critique du capitalisme vient se perdre là, à l’orée de ces années 1980 au cours desquelles il ne semble même plus question de, tout simplement, l’évoquer. « Il n’y a pas d’alternative » : on attribue la formule à Margaret Thatcher, mais elle est loin d’être seule à la prononcer.
Toute la décennie 1980 en est imprégnée et elle s’aligne sur la valeur du marché, dont le ministre Pierre Bérégovoy dit alors qu’il « n’est ni gauche ni de droite ». Et de préciser : « il a une fonction d’échange qu’il s’agit de restaurer ». Dans La République du centre, publié en 1988 par François Furet, Jacques Julliard et Pierre Rosanvallon, les engagements des décennies précédentes sont raillés : Julliard évoque « les faux-semblants du luttisme de classe » et assimile le militantisme à une « gesticulation » « ridicule ». Par un retournement singulier, c’est le socialisme et non plus, comme chez Marx, la religion qui devient sous sa plume un « opium du peuple ». L’économie est pensée comme un champ de neutralité, celui de la « raison » substituée à la « passion ».
La fragilisation de l’URSS par ses dissidences puis sa chute accélèrent cette impression et avec elle tant d’impensés : la sortie du capitalisme ne saurait être envisagée. L’alternative n’est plus possible et « la Révolution est terminée ». En 1986, l’historien François Furet déclare à propos de cette formule qu’il a forgée : c’est « une manière d’exprimer un vœu et un constat ». En 1989, Daniel Bensaïd, en écrivant sur et contre les commémorations qui figent la Révolution française pour, en quelque sorte, l’embaumer ou l’enterrer, a ces mots de déploration :
Expulsée du lexique, la Révolution ! Vous n’avez plus à la bouche que le mot de « mutation » : une mutation, ça a l’air savant, et, surtout, ça ne se fait pas, ça marche tout seul, ça mute en temps voulu, sans qu’on y touche ; ça n’engage jamais à rien[7].
Chez les penseurs critiques, la perspective révolutionnaire disparaît aussi du vocabulaire, tout comme le rapport à la classe ouvrière, portée disparue. En août 1983, Jean-François Lyotard rédige un « Tombeau pour l’intellectuel » et y affirme que
l’intellectuel n’existe plus, du moins au sens d’un esprit s’identifiant à un sujet doté d’une valeur universelle, décrivant, analysant de ce point de vue une situation ou une condition et prescrivant ce qui doit être fait pour que sa réalisation progresse[8].
Si le capitalisme n’est plus même nommé, c’est sa phase présente, appelée – de manière disputée – néolibéralisme qui est seul l’objet des critiques. Il ne s’agit plus de s’opposer à la logique même du capital, mais à la manière dont l’emprise de la marchandise grignote peu à peu tous les secteurs de la société, à l’heure de privatisations généralisées. Le temps n’est donc plus à une pensée de la transformation sociale et de l’émancipation, mais à la « résistance », signe d’une relative impuissance[9]. La pensée stratégique n’est plus de mise et le « possible » n’est plus pensé. Pierre Bourdieu en témoigne lui-même, au tout début des années 2000 :
la force des défenseurs du « modèle » dominant c’est qu’ils se présentent comme détenteurs du monopole de la vérité sur le monde social. C’est une de leurs forces. Avec l’effondrement des régimes dits communistes, cette impression de monopole est portée à sa pleine puissance. On a le sentiment qu’il n’y a pas d’alternative. Cela dit, on a trop souffert des grands modèles prophético-apocalyptiques pour être tenté de proposer quoi que ce soit de semblable[10].
Evidemment, présenté en ces termes cataclysmiques (« prophético-apocalyptiques »), tout projet apparaît comme un repoussoir. On peut y voir tout aussi bien une position d’humilité – partir des luttes quotidiennes, s’opposer aux contre-réformes, ne plus laisser faire/laisser passer – que l’aveu d’un renoncement. Dans la même conférence, datée de janvier 2000, P. Bourdieu s’en remet à l’Etat, sans le considérer comme une panacée mais en l’estimant comme « l’une des seules armes que nous ayons pour contrôler toutes sortes de fonctionnement et de processus tout à fait vitaux ». On connaît son expression « la main gauche de l’Etat »[11], associée aux services publics et, au-delà, à l’« intérêt général ». Le rapport de force et de classe qu’incarne l’Etat est un autre de ces impensés, en un temps où il faut défendre les services publics pied à pied. L’heure est donc à la défensive et non plus aux projets : il est significatif que Pierre Bourdieu voie la pensée critique comme un contre-pouvoir et propose d’allumer des contre-feux.
C’est à cette époque que sinue sans jamais pleinement s’imposer la notion d’« intellectuel collectif » – une formule qui pouvait passer jusque-là pour un oxymore et dont Bourdieu s’efforce de réconcilier les deux termes, dans des configurations pratiques, telles la collection Savoir/Agir et, bien sûr, la grande mobilisation de l’automne 1995. Parallèlement, puis plus tard en dialoguant avec Jacques Derrida, Daniel Bensaïd écrit Marx l’intempestif, paru en cette même année : « audacieux passeur du possible », Marx incarne un contretemps, une brèche qui permet de faire face aux courants dominants. D. Bensaïd vient alors de fonder la Société pour la résistance à l’air du temps, avec l’éditeur François Maspero, les écrivains de polars Jean-François Vilar, Thierry Jonquet et Didier Daeninckx. Les études sur Marx comme les usages de Marx, peu à peu, se revitalisent. « Mille marxismes », peut-être selon l’expression d’Immanuel Wallerstein reprise par André Tosel – et avec eux un anticapitalisme réaffirmé.
Le temps ravivé de l’anticapitalisme
Prolongement de cet héritage tâtonnant et hésitant, ces dix dernières années ont ouvert sur deux principales – et décisives – nouveautés : l’occupation de places et de lieux publics pour y porter une parole critique et politique, débouchant parfois sur des processus révolutionnaires – comme en Tunisie, en Egypte et en Syrie – alors que la révolution avait été jusque-là jetée dans les oubliettes du passé ; une manière de renouer avec une perspective radicale, qui comme l’adjectif l’indique s’attaque à la racine du système pour ouvrir la perspective de le renverser.
Le capitalisme n’est plus un mot tabou désormais. Razmig Keucheyan a pu faire remarquer qu’en publiant Le Nouvel Esprit du capitalisme, en 1999, Luc Boltanski et Eve Chiapello ont, par-delà leur analyse et leurs apports, contribué d’abord à le remettre en circulation[12]. Il s’agit d’en revenir, comme le fait Frédéric Lordon, à une conception du capitalisme comme rapport marchand, monétaire, salarié et de propriété, donc un rapport de production pensé comme rapport social, et non de s’en tenir à l’une de ses dimensions les plus superficielles : patrimoniale. C’est un
rapport social complexe qui, au rapport monétaire des simples économies marchandes, ajoute – c’est le cœur de toute l’affaire – le rapport salarial, constitué autour de la propriété privée des moyens de production, de la fantasmagorie juridique du « travailleur libre », individu pourtant privé de toute possibilité de reproduire par lui-même son existence matérielle, par-là jeté sur le marché du travail, forcé pour survivre d’aller s’employer et de se soumettre à l’empire patronal, dans une relation de subordination hiérarchique[13].
Le capitalisme est analysé dans le même mouvement par la logique de désir et de servitude qu’il crée, en se donnant le luxe de fabriquer des consentements : tant il est vrai que « le délire de l’illimité » propre au capital apparaît comme « une visée de subordination totale, plus précisément d’investissement total des salariés »[14].
Même si le néolibéralisme continue d’être combattu en étant souvent déconnecté de son ancrage général et fondamental dans un capitalisme dont il pousse la logique jusqu’au bout, l’imbrication d’une opposition antilibérale dans une opposition anticapitaliste plus radicale est en train de se faire, comme le suggère encore Jacques Rancière :
Nous sommes parvenus au terme d’une grande offensive, que certains appellent néolibérale, et que je nommerais plutôt l’offensive du capitalisme absolu, qui tend à la privatisation absolue de tous les rapports sociaux et à la destruction des espaces collectifs où deux mondes s’affrontaient[15].
Le réel de l’utopie
Face à cette offensive destructrice, de plus en plus nombreuses sont les pensées précises et tangibles d’alternatives, où le « réel de l’utopie » se fait concret[16]. André Gorz réfléchit aux manières palpables de rompre avec la société salariale. A ses yeux, la multiactivité est un enjeu de société crucial. Diminuer considérablement le temps de travail permet de libérer un autre temps, différent, voué à tous les épanouissements ; il offre aussi de dissocier le droit à un revenu suffisant et l’occupation permanente et stable d’un emploi ; il suppose enfin de refuser la soumission de nos vies aux impératifs de la rentabilité du capital et de la compétitivité. En citant Marx dans les Grundrisse – « la véritable économie – celle qui économise – est économie de temps de travail », Gorz conclut que « la “véritable économie” aboutit à l’élimination du travail comme forme dominante de l’activité » :
le besoin d’agir, d’œuvrer, d’être apprécié des autres n’aura plus à prendre la forme d’un travail commandé et payé. Celui-ci occupera de moins en moins de place dans la vie de la société et dans la vie de chacun. Le temps de travail cessera d’être le temps social dominant[17].
Parlant à la première personne de luttes, d’enthousiasmes et de colères, le Collectif « Mauvaise Troupe » trace au travers de quelques récits quelques « outils du mouvement révolutionnaire ». « Outils » doit s’entendre dans tous les sens d’un mot à la fois pratique et politique. Ainsi y a-t-il là de nouveaux rapports aux objets, ou peut-être plus encore des rapports retrouvés :
Le “monde industriel” a progressivement sapé toute relation aux objets en général, et aux outils en particulier. Dans cette grande dislocation, il n’y a pas de retour en arrière possible, juste une certaine aptitude à la magie, c’est-à-dire une aptitude à ranimer d’anciens usages et à en inventer de nouveaux. En ne perdant jamais de vue quel type d’outillage crée un monde particulier[18].
En adressant ses « adieux au capitalisme », Jérôme Baschet retrace de son côté l’expérience zapatiste dont il est familier. Il définit le capitalisme comme une organisation sociale – et non pas seulement comme un système économique – à la « redoutable plasticité », capable comme on sait d’intégrer toutes les contestations. C’est bien pourquoi il faut lui rétorquer par des formes d’existence absolument différentes, qui lui échapperaient : il s’agit donc de penser « la possibilité d’une organisation non capitaliste de la vie ».
Cette expérience pratique existe dans les zones zapatistes du Chiapas au Mexique, sans qu’elle soit vue là comme un schéma à appliquer voire à plaquer. Des formes non étatiques de gouvernement y sont proposées dans les communes autonomes, sur la base d’une rotation rapide de mandats révocables à tout moment et d’un rejet de toute spécialisation/professionnalisation des tâches politiques – vues davantage comme des charges (cargos) sans rémunération –, dans la perspective d’un autogouvernement. Le principe y est celui d’une dignité partagée. La connaissance de sociétés non capitalistes peut inspirer des projets, sans une fois encore être considérées comme des modèles. L’« âge du faire » remplacerait le travail, chacun.e mettrait ses savoir-faire en commun et les choix seraient arrêtés collectivement. Il y a lieu également de penser à tout ce qui deviendrait inutile une fois la logique marchande extirpée : banques, finance, assurances, marketing et publicité, dont la disparition entraînerait elle-même une diminution considérable de la consommation du papier et de toute la chaîne qui lui est liée[19].
Le commun des savoirs
Le mot de communisme est lui-même remis sur le métier. Comme l’écrit Laurent Jeanpierre,
ce que l’écrivain Maurice Blanchot a appelé “l’exigence communiste” survit à l’échec du communisme historique. Elle lui survit parce qu’elle vient de plus loin[20].
La période qui a vu le communisme rabattu, déformé, sans cesse assimilé au stalinisme ou au totalitarisme, paraît peu à peu se refermer. La présente revue, Contretemps, lancée par Daniel Bensaïd en 2001, se sous-titre « Revue de critique communiste ». Le communisme, selon Marx, n’est ni un état ni un idéal mais un mouvement, « le mouvement réel qui abolit l’état actuel des choses ». Pierre Dardot et Christian Laval sont de celles et ceux qui explorent à nouveaux frais la notion de « communs »[21]. Les communs ne sont pas forcément des choses, des objets ou des biens : plutôt des actions collectives et des formes de vie – des relations sociales fondées sur le partage et la coproduction. A l’opposé de la privatisation, de l’exploitation et des prédations exacerbées par la compétition, les communs constituent moins un donné qu’une intelligence collective en acte et en action[22].
Cette mise en commun porte notamment sur le partage des savoirs : de fait, les intellectuels collectifs sont désormais légion. Leur resurgissement et plus encore leur formidable expansion sont favorisés par un certain nombre de facteurs matériels : prolongement des études généralisé, accroissement du nombre de chercheurs statutaires et, de plus en plus, précaires, développement exponentiel d’internet et des réseaux sociaux qui offrent de publier largement et de démultiplier auteurs et lecteurs. Les intelligences collectives sont nombreuses et déterminées ; elles sont loin d’être invisibles si l’on veut bien y être attentif/ve, mais elles sont dispersées.
Des initiatives comme Savoirs en action (SEA), association créée en 2015, se donnent pour but, parmi d’autres, de contribuer non pas seulement à interpréter le monde, mais à le changer. SEA entend mettre en partage les savoirs, en faisant le constat que chacune, chacun, possède des savoir-faire, des formations, des connaissances nées de métiers, d’expériences et de luttes. Pour accroître la compréhension du monde, il s’agit de les mutualiser et d’en faire un bien commun. Ce partage des apprentissages est conçu comme source de solidarité mais aussi comme ressource de combat : à la joie possible d’apprendre ensemble se mêle la force de réagir et d’agir. Concrètement, Savoirs en action propose des ateliers rompant avec le dispositif classique d’une parole accaparée par une ou un intervenant.e. devant un public passif. Ici, pas de monopole de la parole : elle circule sans chaire ni tribune et sans brevet de légitimité. « Loin du postulat selon lequel seul.e.s certain.e.s auraient une parole autorisée, le projet est de rompre avec ce qui nous sépare, nous isole et nous enferme dans nos positions assignées comme s’il s’agissait de fatalités. Le principe de “Savoirs en action” est que chacun.e d’entre nous peut donner et recevoir du savoir »[23].
De tels objectifs se sont réalisés « en grand » avec la mobilisation de ce printemps, signe que la grève libère du temps pour penser et agir autrement. Lancée le 31 mars au cœur de plusieurs semaines déjà de grèves et de manifestations, Nuit Debout, malgré d’inévitables tensions et contradictions, a d’emblée repris le mot d’ordre de retrait de la loi « Travail » (vite rebaptisée « loi Travaille ! ») tout en l’élargissant : le mouvement s’est fondé « contre la loi El Khomri et son monde » – ce monde marchand du capitalisme à la fois triomphant et contesté. L’une des thématiques qui l’a traversée, la grève générale, devait aider à la jonction entre occupation des places et mobilisation dans les lieux de travail. On comprend que cette appropriation de l’espace public ait fait frémir les gens de pouvoir. On se rappelle peut-être les propos d’Anne Hidalgo jugeant inadmissible une supposée « privatisation de l’espace public » (6 avril 2016), quand précisément les gouvernements PS qui se sont succédé n’ont eu de cesse de privatiser tout ce qui leur tombait sous la main ; ou quand encore cette municipalité parisienne a vu ses « partenariats public-privés » se multiplier (pour quelques exemples récents : gestion de la « fan zone » durant l’Euro par Lagardère Sports, location des catacombes à AirbnB, projet de location d’un tronçon souterrain du canal Saint-Martin à une société privée spécialisée dans l’« événementiel » ; de surcroît, sur la place de la République elle-même s’est installé il y a quelques mois un café, tout ce qu’il y a de privé aussi celui-ci). On se souvient aussi des déclarations du maire PS du 3e arrondissement, Pierre Aidenbaum, jugeant que cela ne pouvait pas durer et arguant qu’il fallait revenir « à un État de droit sur cette place de la République » (10 avril). Ou enfin de Jean-Christophe Cambadélis estimant la chose intolérable à partir du moment où ce n’est pas « bon enfant » (11 avril). Ces réactions en chœur s’explique parce que Nuit Debout a fait peur : les rassemblements de milliers de personnes lors d’assemblées ont indiqué ce que pouvait être une récupération de la parole politique dans des espaces portant enfin le vrai nom de « publics » ; ils ont permis de mesurer ce que pouvait être une agora. Le travail en commissions, du travail à la santé, du féminisme et des luttes LGBT à l’égalité, de l’économie à la démocratie et de l’enfance à la justice, pour n’en citer que quelques-unes, a manifesté la vivacité des intelligences collectives lorsqu’elles ont des lieux pour le faire et du temps pour se déployer. Les artistes anonymes ont pu faire découvrir œuvres, engagements et détournements. Ni l’humour ni l’art n’ont alors manqué, comme le « mouvement de libération graphique et artistique » l’a montré, en imaginant notamment un temps libéré[24].




En soi productrice d’idées et témoin d’intelligences politiques à l’œuvre, où la parole se distribue dans l’égalité, consciente aussi de ses limites et réfléchissant aux manières de les surmonter (liens à établir avec les syndicats et le mouvement ouvrier, lutte contre la ségrégation sociale et spatiale, etc.), Nuit Debout a porté un projet émancipateur, travaillant à imaginer une sortie du capitalisme pour d’autres futurs possibles.
Parmi ces commissions, l’une en particulier a fonctionné dans le succès et la durée (elle se prolonge d’ailleurs à l’heure où ces lignes sont écrites, en janvier 2017) : Debout Education Populaire. Comme Savoirs en action, le principe qui a présidé à sa création repose sur l’égalité : pas de « grands noms » – les « penseurs.ses » un peu connu.e.s viennent non pour leur identité mais pour ce qu’elles et ils ont à proposer et sont présenté.e.s par leur seul prénom. Les interventions sont courtes (une vingtaine de minutes) pour laisser la place primordiale à la discussion. Les expériences et les thématiques sont multiples : banques et finance, santé, éducation, environnement… Pendant sept mois des ateliers ont eu lieu chaque soir, à raison de trois à quatre environ, davantage dans les après-midis du week-end, signe d’une inventivité toujours renouvelée comme d’une capacité tenace et intransigeante à pratiquer critique et imagination politique. La toute première journée, le dimanche 10 avril 2016, a surtout été tournée vers l’histoire et plus spécialement vers les révolutions du passé, en témoignage d’une intense demande non pas d’un passé figé mais d’une manière de renouer avec le fil interrompu mais jamais brisé des luttes et de leurs héritages. Peu à peu, les ateliers se sont organisés autour d’une thématique, elle-même déclinée de multiples façons : « quelle société veut-on ? ». Dans les différentes approches pour l’aborder se retrouvent le partage des richesses et la gestion des biens communs[25]. L’intellectuel collectif que certain.e.s appelaient de leurs vœux est bien là, avec nous et sous nos yeux.
Depuis le milieu des années 1990, le renouveau de la pensée critique a donc été réel et aujourd’hui la production intellectuelle est substantielle dans l’analyse du capitalisme néolibéral et des différentes formes qu’il revêt[26]. Plus récemment, une part de cette production intellectuelle s’est attelée à sortir de la seule perspective critique pour tenter de réfléchir à des projets, à de « premières mesures révolutionnaires », à une société du « commun ». Il manque cependant là un maillon essentiel et devenu un impensé, même dans les organisations qui se réclament de l’anticapitalisme et qui n’ont pas su y pourvoir : une perspective stratégique, qui définisse quelques objectifs à atteindre en premier lieu et les moyens d’y parvenir. Si la détermination et la créativité ne manquent pas, les décisions communes pour passer enfin à l’offensive peinent à être formulées – et cette carence majeure nous envoie régulièrement dans le mur (ou pour le moins y contribue). La grève générale n’est pas seulement un slogan ou un credo ; mais elle ne suffit pas à dessiner une stratégie. C’est une autre carence à combler désormais : quelques hypothèses stratégiques qui poseraient concrètement la question du pouvoir et du rapport de forces à instaurer pour mettre un terme aux « reculs intériorisés en échec historique de longue durée »[27] et, enfin, gagner.
Cet article est paru dans le numéro 32 de Contretemps, en janvier 2017.
Notes
[1] Jacques Rancière, Moments politiques. Interventions 1977-2009, Paris, La Fabrique, 2009, p. 168-169, 165 et 215 ; id., Aux bords du politique, Paris, Gallimard, 2007, p. 16.
[2] Isabelle Garo, L’Idéologie ou la pensée embarquée, Paris, La Fabrique, 2009, p. 44.
[3] Jean-Paul Sartre, « Plaidoyer pour les intellectuels », in Situations VIII, 1966, repris in Situations philosophiques, Gallimard, coll. « Tel », 1990, p. 236, 228 et 222.
[4] Michel Foucault, « Le souci de la vérité » (1984), repris in Dits et écrits, tome 4, Paris, Gallimard, 1994, p. 734 et 676 ; id., « Qu’est-ce que la critique ? », Conférence donnée à la Société française de Philosophie, 27 mai 1978, rééd. Qu’est-ce que la critique ?, Paris, Vrin, 2015.
[5] Michel Foucault, Histoire de la sexualité. I. La volonté de savoir, Gallimard, 1976, rééd. 1994, p. 123-124. Cf. Isabelle Garo, Foucault, Deleuze, Althusser et Marx. La politique dans la philosophie, Paris, Demopolis, 2011, notamment « Michel Foucault l’artificier », p. 79-179 (« L’interrogation critique se veut saisie par l’actualité politique, et par l’actualité la plus décisive : la révolution et son horizon d’échec. La défaite politique sera ainsi convertie mais aussi amplifiée en projet théorique, marqué au sceau de l’abandon du projet d’abolition du capitalisme », p. 84).
[6] Razmig Keucheyan, Hémisphère gauche. Une cartographie des nouvelles pensées critiques, Paris, La Découverte/ Zones, 2010 rééd. 2013, p. 62.
[7] Daniel Bensaïd, Moi, la Révolution. Remembrances d’une bicentenaire indigne, Paris, Fayard, 1989, p. 280.
[8] Jean-François Lyotard, Tombeau de l’intellectuel et autres papiers, Galilée, 1984, p. 20.
[9] Hugues Jallon et Lilian Mathieu, « Après Bourdieu, le travail de la critique », Mouvements, 2002/5 n° 24, p. 9.
[10] Pierre Bourdieu, « Mondialisation et domination : de la finance à la culture », Cités, 2012/3 n° 51, p. 130.
[11] Pierre Bourdieu, « Démocratie effective et contre-pouvoir critique », Lignes, 1992/1 n° 15, p. 37.
[12] Razmig Keucheyan, Hémisphère gauche, op. cit., p. 238.
[13] Frédéric Lordon, « Avec Thomas Piketty, pas de danger pour le capital au XXIe siècle », Le Monde diplomatique, avril 2015, p. 18-19.
[14] Frédéric Lordon, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, Paris, La Fabrique, 2010, p. 107.
[15] Jacques Rancière : « La transformation d’une jeunesse en deuil en une jeunesse en lutte », entretien mené par Joseph Confavreux pour Mediapart, 30 avril 2016 https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/300416/jacques-ranciere-la-transformation-d-une-jeunesse-en-deuil-en-jeunesse-en-lutte?onglet=full consulté le 23 décembre 2016.
[16] Selon l’expression de Michèle Riot-Sarcey, Le Réel de l’utopie. Essai sur le politique au XIXe siècle, Paris, Albin Michel, 1998.
[17] André Gorz, Misères du présent. Richesse du possible, Paris, Galilée, 1997, p. 123-124 et 151.
[18] Collectif Mauvaise troupe, Constellations. Trajectoires révolutionnaires du jeune 21e siècle, Paris, L’Eclat, 2014, ici p. 124 (« Outils et fabrique », texte de Johanna).
[19] Jérôme Baschet, Adieux au capitalisme. Autonomie, société du bien vivre et multiplicité des mondes, Paris, La Découverte, 2014, notamment p. 9 et 13, 53, 57-58, 72, 95-96. Voir aussi Eric Hazan & Kamo, Premières mesures révolutionnaires, Paris, La Fabrique, 2013.
[20] Laurent Jeanpierre, Postface à Slavoj Zizek, Le Spectre rôde toujours. Actualité du Manifeste du Parti Communiste, Paris, Nautilus, 2002, p. 101.
[21] Pierre Dardot et Christian Laval, Communs. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014. Le « commun », écrivent-ils, est une « manière de tourner définitivement le dos au communisme étatique » ; ils rappellent aussi que le commun « n’est pas un bien » ; il ne s’agit donc pas de l’essentialiser (p. 16 et 50).
[22] Cf. Christian Laval et Pierre Dardot, « Entre communauté et association », Cités, 2010/3 n° 43, p. 56) ; id., « Du public au commun », Revue du MAUSS, 2010/1 n° 35, p. 116-120.
[23] Plateforme de Savoirs en action, mai 2015.
[24] https://nuitdebout.tumblr.com Consulté le 20 décembre 2016
[25] https://educpopdebout.org consulté le 19 décembre 2016.
[26] Cette conclusion reprend un texte-manifeste rédigé avec Daniel Blondet.
[27] Isabelle Garo, Foucault, Deleuze, Althusser et Marx, op. cit., p. 7.









