
Islamophobie et dispositions d’exception
Extrait de : Olivier Le Cour Grandmaison, « Ennemis mortels ». Représentations de l’islam et politiques « musulmanes » en France à l’époque coloniale, Paris, La Découverte, 2019, 400 p., 23 €.
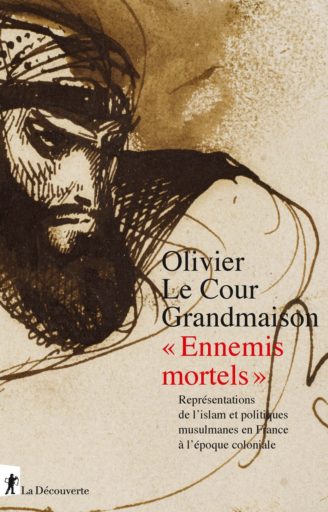
Alors qu’on ne compte plus les assauts d’islamophobie chez les acteurs politiques et médiatiques, Olivier Le Cour Grandmaison offre un regard historicisé sur la construction des perceptions de l’Islam pendant la période coloniale et leurs conséquences ultérieures, en s’appuyant sur des sources diverses et souvent largement sous-estimées. Contretemps vous en propose ici un extrait.
***
Islamophobie et dispositions d’exception
En 1890, Louis Rinn défend l’ensemble des dispositions que nous venons d’évoquer. À ceux qui les condamnent, il rétorque qu’on ne peut juger de leur bien-fondé en s’appuyant sur les conceptions juridiques élaborées et mises en œuvre sur le Vieux Continent. Là, les Européens jouissent d’un « sens moral » et d’une « intelligence » autrement plus « raffinés » que ceux des « indigènes dont la civilisation et les idées retardent de plusieurs siècles ». À l’universalisme des principes établis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, il convient d’opposer un relativisme juridique fondé sur les différences raciales, religieuses et culturelles qui existent entre les peuples avancés et ceux d’Afrique du Nord. Dans ces contrées, la « société musulmane » et les autochtones sont identiques à ce qu’ils étaient « il y a quatre ou cinq cents ans », et cet « état social impose des tempéraments à notre législation », conclut Louis Rinn. En Algérie, la légitimité de cette dernière ne peut ni ne doit être appréciée à l’aune d’un « idéal juridique ou philosophique » hérité des Lumières et de la Révolution française. Seules comptent l’efficacité des dispositions en vigueur et leur capacité à répondre « aux intérêts solidaires » de la métropole, des nationaux installés outre-Méditerranée et des « indigènes ». Habile rhétorique qui permet à cet officier d’accréditer l’idée selon laquelle la « pacification » et la colonisation de cette possession, et les mesures indispensables à leur réalisation, bénéficient à l’ensemble des populations. La suite éclaire cette généreuse assertion puisqu’il précise que, « de notre côté », ces besoins et ces intérêts sont : « l’affirmation de la souveraineté de la France, le rétablissement de l’ordre et de la sécurité, la récupération des dépenses de répression et de réparation des dommages matériels » pour œuvrer au plus vite à la « reconstitution normale des forces productives ». D’une critique radicale de l’universalisme qui le conduit à promouvoir un relativisme qui ne l’est pas moins, Louis Rinn se fait in fine l’avocat d’une conception purement instrumentale du droit dont la fonction n’est pas de garantir des prérogatives fondamentales mais de servir au mieux l’ordre colonial et la « mise en valeur » de l’Algérie. Ces objectifs deviennent ainsi l’ultima ratio des dispositions à appliquer et à défendre contre ceux qui, en métropole, ignorent les différences des temps, des populations et des civilisations, et les tâches nécessaires au développement de ce territoire. Défaire le « parti musulman », à l’origine de troubles nombreux et récurrents, exige de soumettre les « indigènes » à « un traitement tout à fait spécial » où le « droit commun » ne saurait avoir cours. Pis encore, se conformer à ce dernier est « une imprudence et une faute », conclut Louis Rinn, ce qui permet de comprendre pourquoi et comment, dans un contexte où l’urgence et la « nécessité » commandent, l’exception est devenue la règle pour les autochtones algériens. L’internement administratif, la responsabilité collective, le séquestre et le Code de l’indigénat en témoignent. Pour ce militaire, qui a très tôt dénoncé les dangers du « panislamisme », des « congrégations » et des « associations religieuses » mahométanes, de telles dispositions sont indispensables et elles le resteront longtemps[1].
Cette conception n’a rien de radical ou de marginal. En 1890, Louis Rinn, alors conseiller du gouvernement général d’Algérie, n’entend pas innover mais apporter sa contribution aux débats comme spécialiste jouissant d’une double légitimité, celle d’homme de terrain qu’il a été et qu’il demeure, et celle d’historien désormais reconnu par ses contemporains pour la qualité de ses travaux consacrés à cette possession. À preuve, il met constamment ses pas dans ceux du sénateur Ernest Picard qu’il cite d’abondance pour justifier, avec et après lui, la responsabilité collective soutenue par tous les membres de la « commission chargée d’élaborer et de présenter la loi du 17 juillet 1874 relative aux incendies et à leur prévention ». Faisant siens les propos de ce parlementaire, il affirme : « La conquête a ses lois. Elle emploie la force pour imposer le droit comme pour résister aux retours offensifs de la barbarie. À ceux qui l’attaquent […], elle répond en donnant à la justice les moyens d’exécution que le pouvoir militaire a dans la main » afin de servir au mieux « l’intérêt de la politique française en Algérie »[2]. Seize ans plus tard, en 1890, il faut persévérer dans cette voie. Si les périls insurrectionnels ont été conjurés, les responsables exécutés ou déportés en Nouvelle-Calédonie et les tribus soumises à des amendes collectives qui ont précipité leur ruine, la surcriminalité des « indigènes » et la menace islamiste demeurent. Pour préserver la sécurité, il est nécessaire de maintenir des dispositions extraordinaires adaptées à cette situation que beaucoup jugent fragile.
Internement administratif et responsabilité collective
« Les musulmans, comme tous les peuples de civilisation peu avancée, sont très attachés à leur foi religieuse, et, comme chez tous les ignorants, la religion tourne aisément au fanatisme » qui est la « cause la plus redoutable des crimes des indigènes sur les roumis »,
affirme en 1902 Émile Larcher, spécialiste du droit colonial algérien. Les émeutes de Margueritte (26 avril 1901) confirment que le « milieu » autochtone est « particulièrement propice au crime et à l’insurrection » pour des raisons diverses où se mêlent des facteurs ethniques, sociaux, culturels et cultuels. Si une telle énumération est juste, elle demeure trop générale ; pour ce juriste, comme pour beaucoup d’autres, l’islam joue un rôle essentiel dans les mouvements collectifs, notamment, où la haine religieuse à l’endroit des Européens est un puissant ressort. L’ensemble justifie la défense et le maintien de l’internement administratif même si cette mesure, « attentatoire à la séparation des pouvoirs », est « contraire aux principes les plus certains de notre droit public », reconnaît Émile Larcher. En effet, cette sanction est prononcée par le gouverneur général pour une durée indéterminée qu’il établit seul cependant que le lieu de son exécution n’est pas non plus fixé a priori. Cela peut être en Algérie ou à Calvi[3], ajoute ce juriste qui précise : dans ce dernier cas, cela rend l’application de l’internement plus pénible aux « indigènes » qui vivent alors « loin de l’odeur de l’islam ». Intéressante précision. Elle permet de découvrir que l’internement se double de la déportation qui, pour taire son nom, n’en est pas moins effective et connue des spécialistes. Frappés parce que musulmans potentiellement fanatiques ou déjà tenus pour tels, les autochtones doivent être soumis, de surcroît, à des conditions particulières conçues pour aggraver la sanction qui les frappe. À l’instar de beaucoup, Émile Larcher estime que les mahométans craignent beaucoup moins la privation de liberté, en raison de leur fatalisme légendaire, que la séparation d’avec leurs coreligionnaires. Ainsi mis en œuvre, l’internement est adéquat aux fins poursuivies par les autorités coloniales : réprimer durement les sectateurs de Mahomet réputés menaçants pour l’ordre public et dissuader les autres de les imiter[4].
À ceux qui critiquent cette disposition, Émile Larcher rappelle combien l’internement a été un instrument répressif essentiel. Enfin, ajoute-t-il, les « Algériens » (comprendre, les colons) y « voient l’un des meilleurs moyens d’obtenir cette sécurité dont ils sentent si vivement le besoin », ce que confirment les « assemblées, coloniales ou départementales » qui « ont maintes fois manifesté leur prédilection pour cette peine que n’affaiblissent pas les lenteurs de l’instruction et du jugement ». Aux Européens, conformément aux principes de l’État de droit, le respect indispensable des procédures afin de garantir la présomption d’innocence, les prérogatives des justiciables et ceux de la défense ; aux « indigènes » mahométans, conformément aux principes de l’état d’exception permanent, la promptitude d’une sanction décidée dans les conditions que l’on sait et contre laquelle ils ne peuvent faire appel. Une fois encore l’efficacité et la célérité sont érigées en critères exclusifs d’évaluation ; les seuls qui vaillent lorsqu’il s’agit de réfléchir à la légitimité d’une mesure destinée à s’appliquer aux musulmans réputés inférieurs, dangereux et rétifs au progrès. Au terme de ce plaidoyer, qui confirme le triomphe du relativisme juridique, Émile Larcher conclut :
« Nous n’éprouvons […] aucun embarras en ce qui concerne la régularité ou la légitimité de l’internement. C’est le cas, modifiant une pensée célèbre, de dire : vérité d’un côté de la Méditerranée, erreur de l’autre. Le principe de la séparation des pouvoirs est excellent dans une société civilisée » mais « il n’est point de mise avec des tribus qui portent toute leur admiration et tout leur respect vers la force. Qu’un châtiment suive toujours et rapidement le crime, tel est le but à atteindre ; notre procédure ne l’atteint pas ; des mesures administratives l’atteignent, donc celles-ci doivent être préférées à celle-là »[5].
Victoire de la raison d’État, également, puisque les dérogations aux principes fondamentaux comme à la législation ordinaire sont justifiées par un impératif majeur : préserver les intérêts de la colonie et des Européens. Le salut de l’Algérie française : telle est la loi suprême qui légitime ces dispositions.
Douze ans plus tard, en 1914, alors que les critiques formulées par des « indigènes », des députés et des sénateurs se multiplient, que la conscription imposée aux « musulmans » place la métropole dans l’ « obligation morale » de leur « accorder […] les compensations et droits légitimes que mérite partout l’impôt du sang », il n’est plus possible de maintenir l’internement administratif. Pour beaucoup, il est désormais perçu pour ce qu’il a toujours été : l’ « arbitraire érigé en système » au temps où « l’occupation militaire était encore toute guerrière », affirme Albin Rozet lors des débats parlementaires de juillet 1914. Après avoir fustigé cette « tradition », il ajoute : « on s’explique mal » qu’elle ait été suivie si longtemps « dans un pays pacifié et organisé par une puissance civilisée ». Sous sa forme initiale, l’internement administratif a vécu, dans les territoires civils du moins puisqu’il est maintenu dans le « reste de l’Algérie » : les territoires du Sud[6]. Magnanime, la République a fait un geste politique, juridique et symbolique important en direction de ses « sujets musulmans ». Est-ce à dire que le gouverneur général est maintenant privé de la possibilité de recourir à des dispositions d’exception ? Nullement. Il serait « singulièrement imprudent et dangereux de supprimer dès aujourd’hui […] les pouvoirs indispensables au dépositaire de l’autorité française pour assurer le maintien de la sûreté publique », précise Albin Rozet. À l’internement succède donc « la mise sous surveillance » des « indigènes » dans « une tribu, un douar ou une localité » pour une durée de deux ans maximum et pour les motifs suivants : « 1. Actes d’hostilité contre la souveraineté française ; 2. Toutes prédications politiques ou religieuses, toutes menées de nature à porter atteinte à la sécurité générale », et « tous actes » qui « favorisent manifestement les vols de récoltes ou de bestiaux ». Qu’est-ce qui justifie cette mesure sans équivalent en métropole ? Entre autres, le « fanatisme » et la « haine » des « musulmans » qui, « entretenus par les marabouts et les confréries religieuses », sont la cause de la plupart des troubles survenus en Algérie, affirme ce député.
Plus encore, il ne s’agit pas de réprimer uniquement des atteintes à l’ordre colonial mais de les prévenir autant que possible en accordant au gouverneur général les « moyens » d’intervenir dès qu’une « rumeur de révolte » gronde « parmi les indigènes ». En ces circonstances, poursuit Albin Rozet, « il faut qu’immédiatement la main de la France puisse s’abattre sur les meneurs et paralyser leurs mauvais desseins »[7]. Des ouï-dire et des informations collectées par la police et les autorités locales suffisent pour appliquer la mise sous surveillance et priver de leur liberté les personnes visées alors qu’elles n’ont pas commis d’acte répréhensible. Si les dispositions répressives d’exception mobilisées contre les musulmans évoluent, les fondements de leur légitimité demeurent : la peur de l’islam comme de ses effets politiques, et la suspicion à l’endroit des mahométans, de certains religieux et des confréries. Remarquable bégaiement discursif qui soutient l’exorbitance de cette mesure présentée par celui qui l’a défendue comme l’expression d’une volonté réformatrice, libérale et généreuse. Banalisation, extension et permanence de l’exception en fait rendues d’autant plus aisées que la mise sous surveillance est perçue, par la majorité des parlementaires qui l’ont votée, comme une disposition modérée soutenue par le réalisme, une bonne connaissance des musulmans et de l’histoire mouvementée de l’Algérie. Initialement prévue pour une période limitée à cinq ans, cette « variété de l’internement », écrivent Émile Larcher et Guy Rectenwald, est pérennisée par la loi du 4 août 1920. Importante précision qui révèle ceci : la mise sous surveillance ne sonne nullement le glas de l’internement administratif puisque la première n’est qu’une forme particulière du second désormais encadré par des règles nouvelles.
Après la Grande Guerre et la victoire de la Révolution russe, les autorités métropolitaines et coloniales redoutent les « influences malsaines » des « propagandistes panislamiques ou bolcheviks[8] » ; la mise sous surveillance est donc jugée indispensable pour lutter contre ces menaces. Douze ans plus tard, en 1932, alors que les envolées lyriques sur le soutien et la combativité des « sujets » et « protégés » musulmans français au cours du dernier conflit mondial ne sont plus que souvenirs, de même les promesses faites dans l’euphorie de la victoire, le Parti communiste dénonce la trahison des autorités qui n’ont jamais honoré ces dernières. Aussi les « indigènes » algériens sont-ils toujours soumis aux « actes d’arbitraire » du « gouverneur » qui, « pour un rien », les place sous « surveillance » et en « résidence forcée »[9].
Quant à l’« amende collective », qui « frappe les collectivités indigènes, tribus ou douars », il est « impossible de trouver le texte » ayant permis au général en chef, puis au gouverneur général, d’employer cette mesure conforme aux « traditions musulmanes et aux lois de la guerre » dont l’existence, précisent Émile Larcher et Guy Rectenwald, a été consacrée par Bugeaud dans une circulaire du 2 janvier 1844 « en même temps qu’il détermine ses conditions d’application ». Les « cas où il y a lieu de prononcer » cette sanction « ne sont déterminés par aucun texte sauf pour l’incendie de forêts : c’est la jurisprudence du conseil du gouvernement qui a précisé les conditions dans lesquelles il y a lieu de l’appliquer »[10]. Favorables à cette disposition, ces juristes n’en rappellent pas moins qu’elle est contraire à un principe majeur du droit pénal moderne : celui de l’individualité de la peine. De plus, ils confirment que celui qui dirige l’Algérie coloniale jouit de pouvoirs discrétionnaires remarquables ; « sa liberté d’action » est entière et les « considérations politiques seules doivent l’emporter quand il examine l’opportunité, la nécessité et la mesure du châtiment qu’il inflige ». Autant d’éléments qui corroborent la nature exceptionnelle de cette disposition qui permet de sanctionner des individus alors qu’ils ne sont pas directement et personnellement impliqués dans les faits qui leur sont reprochés.
L’amende collective, infligée pour cause de troubles graves à l’ordre public, est justifiée par les « mœurs indigènes », les pratiques des « khalifes arabes », des « émirs berbères » et des « Turcs », soutient Louis Rinn en 1890. Favorable à son maintien, qui permet à l’«exécutif » d’intervenir avec célérité et fermeté, il rappelle que la responsabilité collective, massivement utilisée au lendemain de l’insurrection de 1871 en Kabylie, a été déterminante pour rétablir l’autorité de la France et frapper de stupeur les populations soulevées. Elles furent ainsi soumises à une amende de « 63 millions » de francs à laquelle s’est ajouté le séquestre de près de 2,6 millions d’hectares de terres, soit l’équivalent de cinq départements français[11].
En 1921, comme beaucoup de ses contemporains, le magistrat Charles Barbet défend toujours les sanctions collectives motivées par les comportements des « conspirateurs indigènes » qui « s’obstinent » le plus souvent « à rester muets » en dépit des « objurgations des officiers de police judiciaire ». Face à ces silences complices, d’autant plus persistants que les « attentats commis » l’ont été sur la « personne d’un roumi », la « répression » doit être « rapide, énergique et proportionnée à la gravité de la faute » pour surmonter les conséquences désastreuses de solidarités villageoises, ethniques et « confessionnelles » qui entravent la bonne marche de la justice. Faute d’éléments, cette dernière est souvent obligée de classer les affaires ou de prononcer des « ordonnances de non-lieu », ce qui permet aux « indigènes » coupables d’actes répréhensibles d’échapper à une condamnation, en jouissant de facto d’une impunité dangereuse pour la sécurité publique. Aussi est-il nécessaire de frapper les musulmans « d’une façon exemplaire en les rendant collectivement responsables » des troubles « commis ». À ceux qui s’étonneraient de cette position, Charles Barbet répond : compte tenu des mœurs des « indigènes », c’est la seule façon de faire plier ces « Conspirateurs du silence » qui font passer la solidarité avec leurs coreligionnaires avant le respect de la loi et de l’ordre. De plus, ce magistrat estime qu’il faut frapper aussi les « caïds » lorsqu’ils refusent de collaborer avec les autorités coloniales. La révocation immédiate : telle doit être la sanction des individus qui, en agissant de la sorte, trahissent la confiance de la France et portent atteinte à son « prestige ».
Enfin, certains articles du Code de l’indigénat sont eux aussi déterminés par des considérations relatives à la dangerosité des sectateurs de Mahomet. De même pour la peine capitale, puisque de nombreux contemporains estiment que la guillotine suscite chez les mahométans une terreur singulière alors que la privation de liberté et l’obligation de travailler consécutives à une condamnation, aussi sévère soit-elle, sont souvent accueillies avec indifférence. Comme beaucoup de ses pairs, Charles Barbet affirme : les autochtones « s’accoutument très vite à la réclusion et ne souffrent, ni moralement ni physiquement, de ce régime ». Inefficaces sont la prison et les « tâches matérielles parfois pénibles » imposées aux condamnés arabes[12]. Aussi faut-il privilégier des sentences plus exemplaires car plus adaptées à la mentalité fruste des « indigènes ».
Sur quelques articles du code de l’indigénat et sur la peine de mort
9 février 1875. L’arrêté général sur les infractions à l’indigénat entre en vigueur en Algérie. Son objectif majeur : doter l’ « administration » de « pouvoirs discrétionnaires et extrajudiciaires » jugés nécessaires pour défendre l’ordre colonial si souvent menacé par les autochtones désormais soumis à « un régime de répression tout particulier ». Si ce dernier peut sembler « exorbitant à certaines personnes, peut-être un peu trop imbues d’idées théoriques et abstraites dont l’application serait […] néfaste » dans cette possession, « sa raison d’être » est inscrite dans la situation même des Français. Face à plus de « quatre millions » d’Arabes et de Berbères vaincus, certes, mais prompts à se soulever, « il convient d’être toujours prêts à frapper » pour garantir la « sécurité des colons » indispensable au développement économique et social de l’Algérie. Écrites en 1906, ces lignes, martiales et lumineuses, relativement à la nature et aux finalités du code de l’indigénat, sont écrites par le juriste Jacques Aumont-Thiéville qui ajoute : « sur le principe, il n’y a plus d’hésitation » même si des divergences existent sur les moyens à employer pour parvenir aux fins énoncées. À preuve, poursuit-il, « ce régime [de l’indigénat], qui ne devait être qu’un essai » temporaire, a été constamment prorogé sans difficulté par les parlementaires puis étendu aux autres colonies de l’empire. Le général Gallieni, qui, avec beaucoup d’autres, a œuvré en ce sens, se félicite de cette évolution puisque les « administrateurs » des différents territoires disposent eux aussi de « cette arme » bien faite pour réprimer les autochtones des possessions françaises[13]. Les mesures précitées du droit colonial et les Codes de l’indigénat des différents territoires exotiques peuvent être interprétés comme la poursuite de la « pacification » par d’autres moyens. L’exorbitance des pouvoirs conférés aux gouverneurs généraux, celle des mesures adoptées, leurs origines parfois, leurs modalités d’application et le vocabulaire employé pour en rendre compte l’attestent.
En Algérie, l’article 20 du Code de l’indigénat du 9 février 1875 vise les autochtones en tant que musulmans puisqu’il sanctionne les « réunions sans autorisation pour zerda, ziara (pèlerinage et repas public) ou autres fêtes religieuses » pensées, par la majorité des spécialistes et des responsables, comme des causes importantes de troubles graves à la sécurité publique. Maintenue dans les versions successives de ce code votées par les parlementaires, cette mesure est constamment défendue puis étendue aux réunions de « plus de 15 personnes de sexe masculin » tenues sans l’accord préalable des autorités. Selon le gouverneur général, Jules Cambon, ces dispositions offrent de nombreux avantages : elles autorisent « une surveillance à la fois prudente, éclairée et étroite » des ordres religieux et des confréries, ce qui permet aux fonctionnaires d’être « au courant[14] » des moindres faits et gestes des populations musulmanes et des personnalités influentes susceptibles d’être à l’origine de menées antifrançaises. Particulièrement exhaustive et répressive en raison de la multiplication des proscriptions établies, la loi du 28 juin 1881, qui porte énumération des « faits considérés » comme des « infractions spéciales de l’indigénat », ajoute à cette disposition deux articles. L’article 31 vise les « quêtes faites sans autorisation par les khouans, marabouts ou tolbas[15] » pour contrôler autant que possible les hommes et certaines sources de financement qui sont, pour ces mahométans, l’occasion de se déplacer et de faire du prosélytisme. L’article 37 impose également une autorisation pour l’« ouverture de tout établissement religieux ou d’enseignement »[16]. Par la suite, cette mesure a été maintenue en raison de son « incontestable utilité » puisqu’il importe, affirme Émile Larcher, de suivre les agissements des « confréries musulmanes » afin que les administrateurs soient « armés contre elles » et capables de « déjouer, dès le début, toute menée hostile de leur part »[17]. La peur de l’islam et la volonté corrélative de disposer d’un maximum d’informations, indispensables pour connaître les humeurs réputées changeantes des mahométans, sont au principe de ces dispositions.
Enfin, relativement à la peine capitale, il convient de la maintenir et de l’appliquer sous des formes particulières pour susciter l’effroi des musulmans. Si en 1899 Émile Larcher et Jean Olier s’interrogent sur la légitimité de cette peine en Europe, où elle « recule devant la civilisation », il n’en est pas de même en Algérie. Là, les autorités judiciaires sont confrontées à un « milieu beaucoup moins policé » qui exige des mesures plus dissuasives et sévères. Les « travaux forcés » ? Ils laissent « trop d’espoirs d’évasion » aux condamnés, estiment ces deux juristes. De plus, si cette peine infamante est redoutée sur le Vieux Continent, il en va autrement dans cette colonie où les Arabes, habitués à des conditions d’existence sommaires, la subissent avec résignation. La prison ? Elle est « plus que bénigne » pour les « indigènes », précisent les mêmes. Jugés moins affectés par la privation de liberté, les autochtones trouvent dans les geôles algériennes des conditions matérielles souvent supérieures aux leurs lorsqu’ils étaient libres. Eux qui vivaient dans des « taudis enfumés, enfiévrés et puants », découvrent des établissements pénitentiaires propres et bien aérés, « une nourriture » tenue pour « exquise et abondante », et des « heures très douces au grand soleil du préau » où ils s’abandonnent à leur paresse légendaire. Dans un contexte marqué aussi par la fréquence des « assassinats », il est impératif de maintenir la peine de mort et des modalités particulières d’exécution.
En métropole, la « publicité » de cette sentence est jugée « détestable » par Émile Larcher et Jean Olier qui réprouvent le spectacle offert par la peine capitale parce qu’il heurte la sensibilité des Français et qu’il est dépourvu de vertu dissuasive, selon eux[18]. Rien de tel en Algérie où le « condamné » à mort est conduit en plein jour sur le lieu de son crime afin que les « indigènes, accourus de tous les douars voisins », puissent assister à son « dernier supplice »[19]. Là, il s’agit d’exhiber la puissance souveraine de la France et de sa justice à des populations arriérées qui n’entendent que la force, comme la majorité des contemporains le répètent. Plus encore, l’atteinte portée à l’intégrité physique du corps de l’individu exécuté heurte les croyances des mahométans qui sont convaincus que ce dernier ne pourra jamais, à cause de cela, être reçu au paradis. Aussi n’est-il pas rare que la femme ou les parents du guillotiné s’emparent de sa dépouille pour recoudre la « tête ». « Cette pratique, généralement tolérée », affaiblit l’exemplarité de la peine, écrit Émile Larcher, qui estime nécessaire, lorsque le crime est particulièrement « grave », de s’opposer à « cette reconstitution » afin que les « musulmans » soient frappés de « stupeur ». Soucieux d’apporter des précisions sur la façon dont il convient d’agir, ce juriste ajoute : « Il faudrait donc, pour l’intimidation, exiger que toujours la tête demeurât séparée du corps. » Intéressantes analyses qui attestent une bonne connaissance des croyances des mahométans, lesquelles déterminent un cérémonial et des dispositions spécifiques conformes aux objectifs poursuivis par Émile Larcher : terroriser les adeptes de Mahomet en donnant de la justice française une image implacable et supposément dissuasive. Fort de ces principes, il se prononce contre le « droit de grâce [qui] ne devrait jamais s’exercer » ; pour les « indigènes », une telle décision est l’« aveu d’une injustice commise », un « signe de faiblesse » et une regrettable « concession à l’Islam »[20].
Dix-neuf ans plus tard, en 1921, le magistrat Charles Barbet défend des positions voisines. Favorable à l’abolition de la peine de mort en Europe, à l’instar des « philosophes » des Lumières et des « éminents penseurs » du xixe siècle – Lamartine et Hugo, notamment –, il estime que la situation particulière de l’Algérie condamne par avance une telle évolution. Alors que l’insécurité demeure l’un des problèmes majeurs de cette colonie, puisque les « malandrins indigènes » n’hésitent pas à « torturer » leurs victimes, selon lui, on ne saurait se priver de ce châtiment. Ce qui est juste sur le Vieux Continent est fort dangereux outre-Méditerranée où la moindre réforme tendant à limiter la répression à l’encontre de « nos sujets musulmans » est interprétée par eux comme un signe d’indulgence susceptible d’encourager insubordination et troubles à l’ordre public. Pour « enrayer » la multiplication des crimes commis par les autochtones, qui « font bon marché de la vie d’autrui », surtout si la victime est un « infâme roumi », seule la guillotine est efficace. Elle suscite d’autant plus l’effroi que la « décapitation » empêche la « résurrection suprême », affirme-t-il lui aussi, ce pourquoi la peine capitale est « un frein à la féroce brutalité des indigènes »[21]. Ces derniers sont bien visés comme mahométans puisqu’il s’agit, en s’appuyant sur leurs croyances, de redoubler la mort physique par une autre plus effrayante encore puisqu’elle est réputée éternelle ; tuer le mort[22] et tuer la mort, en quelque sorte, pour mieux terrifier les vivants.
Après l’impôt du sang payé, entre autres, par les autochtones d’Algérie au cours de la Première Guerre mondiale, de nombreuses réformes sont intervenues. Suppression des tribunaux répressifs et des « pouvoirs juridictionnels de l’administrateur des communes mixtes », encadrement juridique des « sentences du gouverneur général », qui demeure cependant un « juge répressif, ce qui est anormal », non-application du Code de l’indigénat à environ 400 000 musulmans alors que l’écrasante majorité continuent d’y être soumis, constate le juriste Paul-Émile Viard en 1937[23]. À preuve, entre la loi du 15 juillet 1914, qui réforme et reconduit ce code d’exception, et 1926, « 40 641 condamnations se montant à 223 490 francs d’amende et 142 271 jours de prison » ont été prononcées. Les motifs principaux sont les suivants : « actes de désordre sur les marchés et les lieux de rassemblement », « retard dans le paiement des impôts » et « refus de fournir les renseignements demandés par les agents de l’autorité »[24]. Le « monstre juridique » de l’indigénat a donc continué de sévir et de servir l’ordre colonial inégalitaire, raciste et islamophobe, y compris à l’époque du Front populaire qui n’a ni supprimé ni réformé le premier. Seule la Libération a eu raison de ce code et des dispositions d’exception en vigueur dans les territoires de l’empire. Quant aux discriminations frappant les « indigènes » puis les « Français musulmans d’Algérie », elles ont continué de prospérer sous la IVe comme sous la Ve République. De même pour les héritiers de l’immigration coloniale et postcoloniale.
Notes
[1] L. Rinn, Marabouts et Khouan. Étude sur l’Islam en Algérie (1884), op. cit., p. V.
[2] L. Rinn, Régime spécial de l’indigénat en Algérie… (1890), op. cit., p. 10, 79, 86 et 33. Juriste et spécialiste de l’Algérie, Henry Drapier affirme : « notre droit pénal, destiné à des civilisés, n’est pas […] en harmonie avec les mœurs indigènes » en raison des « vols, razzias, crimes et vengeances privées, passions et vices qui forment l’héritage » de ce « peuple livré à lui-même ». Aussi est-il indispensable, face à des autochtones « aux instincts frustes », de recourir à des mesures contraire aux principes de la législation métropolitaine (La Condition sociale des indigènes algériens, Paris, A. Rousseau, 1899, p. 154).
[3] Voir F. Colonna, « Les “détenus” arabes de Calvi 1871-1903. Le bagne, une expérience de dépaysement ? », in Horizons Maghrébins. Le droit à la mémoire, 2006, n° 54, p. 89-99.
[4] Ailleurs, É. Larcher et G. Rectenwald confirment que l’internement fut en partie conçu et appliqué pour atteindre spécifiquement les musulmans puisqu’il vise « la répression des discours factieux », les « pèlerins qui vont gagner à La Mecque le titre vénéré de hadj, malgré les prohibitions », et « les fanatiques » qui appellent à chasser « les roumis à la mer ». Pour étayer plus encore leur argumentation, ils ajoutent : « La cause la plus fréquente des troubles insurrectionnels a toujours été le fanatisme musulman entretenu par les marabouts et les confréries religieuse » (Traité historique, théorique et pratique des juridictions musulmanes en Algérie, préface de M. Morand, doyen de la faculté de droit d’Alger, Alger, J. Carbonnel, 1931, p. 29 et 47. Souligné par nous). L’internement pour violation des dispositions relatives au pèlerinage à La Mecque s’élève, entre 1889 et 1914, à 14 %, selon Sylvie Thénault mais de fortes disparités existent puisque le pourcentage est de 37 % à Constantine et de 3 % à Alger (Violence ordinaire dans l’Algérie coloniale. Camps, internements, assignations à résidence, Paris, O. Jacob, 2012, p. 48).
[5] É. Larcher, Trois années d’études algériennes, op. cit., p. 87 et suiv.
[6] É. Larcher et G. Rectenwald, Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., tome 2, p. 230.
[7] A. Rozet, « Rapport fait au nom de la commission des Affaires extérieures, des protectorats et des colonies »…, 15 juillet 1914, op. cit., p. 1183-1184.
[8] É. Larcher et G. Rectenwald, Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., tome 2, p. 233. Le 14 septembre 1916, Charles Lutaud, gouverneur général de l’Algérie, précise dans une circulaire : la mise sous surveillance vise notamment « les personnages politiques ou religieux qui, par leurs actes ou leurs discours, cherchent à combattre notre influence ». La généralité des termes employés permet d’étendre au maximum l’application de cette mesure et de préserver les pouvoirs immenses du gouverneur (cité in É. Larcher et G. Rectenwald, Traité historique…, op. cit., p. 48).
[9] H. Cartier, Comment la France « civilise » ses colonies suivi par Code de l’indigénat, code de l’esclavage (1932 et 1928), Paris, Les Nuits rouges, 2006, p. 82. De ces réformes, Gilbert Meynier écrit : « La montagne a accouché d’une souris. » « Le code de l’indigénat est adouci, non supprimé : l’arbitraire des administrateurs court encore pour cinq ans et rien n’est changé aux juridictions d’exception » (L’Algérie révélée. La guerre de 1914-1918 et le premier quart du xxe siècle, op. cit., p. 50). Contrairement aux affirmations de S. Thénault, le « régime pénal de l’indigénat » ne tend pas « à s’éteindre après la Première Guerre mondiale… » ; il n’est que réformé. Le prouvent les nombreux écrits des contemporains favorables ou hostiles à ce régime. (S. Thénault, « Le régime pénal de l’indigénat algérien, au cœur de la discrimination coloniale », in Algérie-France : Comprendre la passé pour mieux construire l’avenir, Les Documents de travail du Sénat, décembre 2012, n° GA 105, p. 16).
[10] É. Larcher et G. Rectenwald. Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., tome 2, p. 235 (souligné par nous).
[11] L. Rinn, Régime pénal de l’indigénat. Le séquestre et la responsabilité collective, op. cit., p. 32, 45 et 86. La première citation reproduit les propos tenus par Ernest Picard en 1874.
[12] Ch. Barbet, Questions sociales et ethnographiques, op. cit., p. 146-147 et 133.
[13] J. Aumont-Thiéville, Du régime de l’indigénat, Paris, A. Rousseau, 1906, p. 1, 6, 47 et 74. Le régime de l’indigénat fut appliqué en Cochinchine (1881, supprimé en 1903), au Sénégal et en Nouvelle-Calédonie (1887), à Madagascar (1889), en A-OF (1904) et A-EF (1910).
[14] « Sur la surveillance politique et administrative des indigènes algériens et musulmans étrangers », in R. Estoublon et A. Lefébure, Code de l’indigénat annoté, op. cit., p. 1017. Voir également art. 5 du code de l’indigénat de 1914 (in ibid., p. 1190).
[15] Le terme khouan – frère – est utilisé par les membres des congrégations religieuses musulmanes. Tolbas désignent les écoliers d’une zâouia.
[16] É. Sautayra, Législation de l’Algérie. Lois, ordonnances, décrets et arrêtés, Paris, Maisonneuve & Cie, 1884, tome 2, p. 268. Magistrat, Émile Sautayra (1826-1885) fut vice-président du tribunal d’Alger puis conseiller à la Cour.
[17] É. Larcher, Traité élémentaire de législation algérienne, Paris, A. Rousseau, 1911, 2e édition, tome 1, p. 472. Mesure incluse dans l’art. 6 du code de l’indigénat du 15 juillet 1914.
[18] Sur ce point, Émile Larcher et Jean Olier sont en avance sur leur temps puisque les exécutions publiques n’ont été abolies en métropole que le 24 juin 1939.
[19] É. Larcher et J. Olier, Les Institutions pénitentiaires de l’Algérie, op. cit., p. 69 et 71. Les « cours d’assises d’Algérie prononcent à elles seules plus de condamnations à mort que toutes les cours métropolitaines », notent-ils. Preuve d’une sévérité plus grande ? Nullement. Ces sentences confirment la surcriminalité des « indigènes », la gravité des crimes commis et la nécessité de châtier leurs auteurs de façon exemplaire.
[20] É. Larcher, Trois années d’études algériennes… (1902), op. cit., p. 239 et 136. Dans sa thèse de droit, Jules Vernier de Byans affirme : « la peine de mort […] ne doit pas être commuée. Cette théorie peut paraître trop absolue, surtout en présence du mouvement qui se dessine en Europe pour l’abolition de la peine capitale, mais nous ne devons pas oublier que la moindre faiblesse » à « l’égard des indigènes peut entrainer […] les conséquences les plus graves… » Quant à « l’exécution de la peine de mort », elle doit être réglée « autant que possible, d’après les coutumes locales » pour « mieux frapper l’esprit des populations » (Condition juridique et politique des indigènes dans les possessions coloniales, Paris, A. Leclerc, 1905, p. 137-138). Vernier de Byans est « officier d’administration de 2e classe du Commissariat des troupes coloniales. »
[21] Ch. Barbet, Questions sociales et ethnographiques. France – Algérie – Maroc, op. cit., 133-134.
[22] Voir P-L. Assoun, Tuer le mort. Le désir révolutionnaire, Paris, PUF, 2016.
[23] P-E. Viard, Les Droits politiques des indigènes d’Algérie, Librairie du Recueil Sirey, 1937, p. 8. D’après le recensement organisé en 1921, la population musulmane de l’Algérie s’élève à 4 923 000. Seule une minorité échappe donc au code de l’indigénat.
[24] Journal officiel de l’Algérie du 21 juin 1927, cité in H. Cartier, « Code de l’indigénat, code d’esclavage » (1928), in Comment la France « civilise » ses colonies, op. cit., p. 140.








![Islamophobie : l’expérience des converti·es comme révélateur [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/114_-_img_9661-modifier-150x150.jpg)