
Peut-il y avoir de la joie dans nos luttes ? Militantisme et liens inter-personnels
Même dans le camp de l’émancipation, le militantisme ne rime souvent pas avec la joie. Comment est-ce possible et comment dépasser des formes d’organisation et d’action qui, bien souvent, reproduisent les traits de la société contre laquelle nous luttons ? C’est à ce problème que se confrontent carla bergman et Nick Montgomery dans leur livre Joie militante (Éditions du commun, 2021), traduit par Juliette Rousseau.
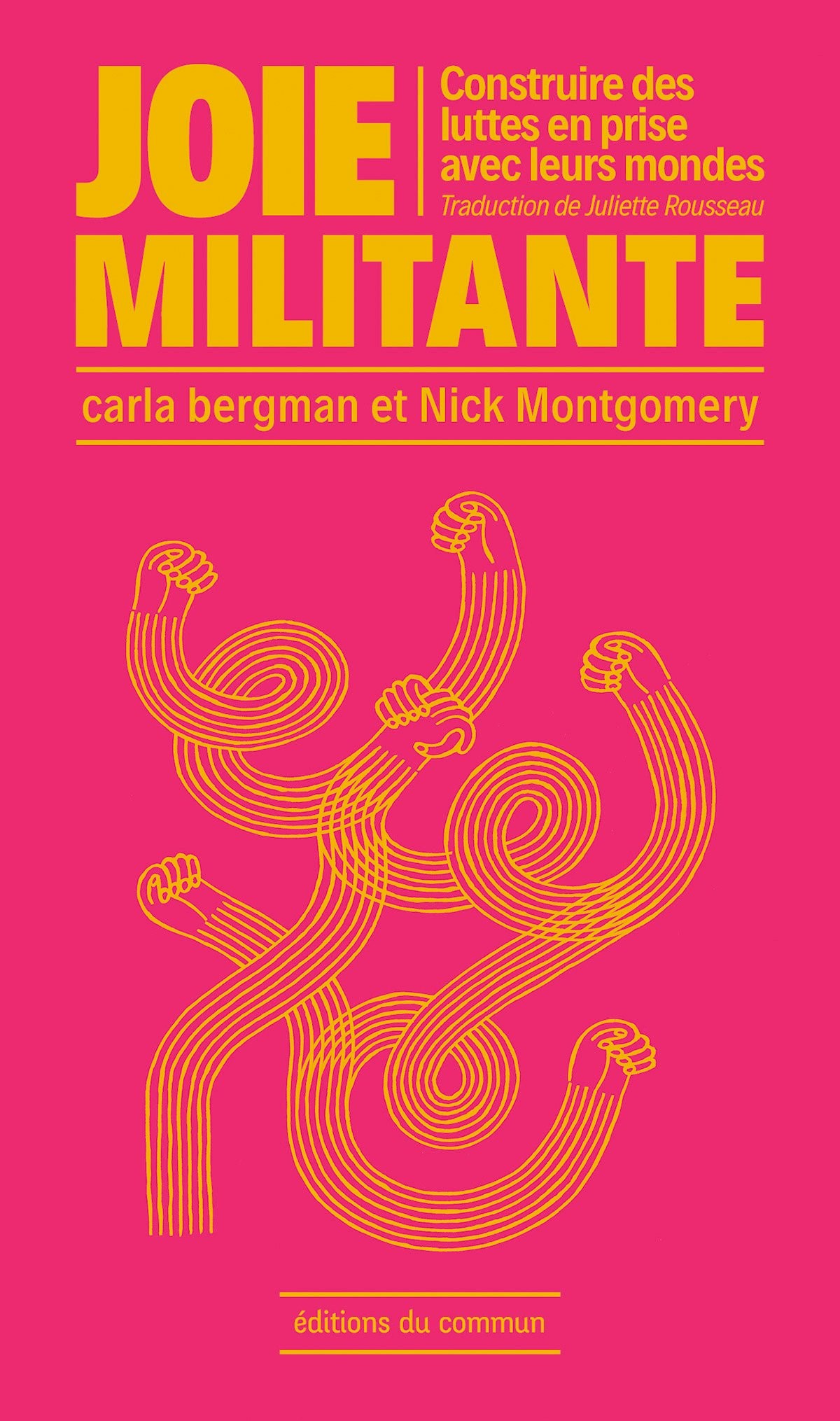
« À ceux et celles qui, dans les espaces exigus et les atmosphères étouffantes, laissent entrer de l’air frais et trouvent de l’espace pour se déhancher ; embrassent tout à la fois les erreurs et le désordre ; apprennent à se mouvoir, entre amour féroce et incertitude, nous rendant capable de nouveauté. » (Épigraphe, Joie militante, carla bergman et Nick Montgomery, éditions du commun, page 11)
Il aura fallu dépasser un a priori de départ pour entrer dans la lecture du livre de carla bergman et Nick Montgomery. La formule-titre « Joie militante » apparaissait comme une association d’idées bien audacieuse. Des manifestations aux grèves, en passant par les réunions de collectifs, il nous a toujours semblé que le militantisme s’entretenait avec des affects aussi particuliers que divers qu’il était difficile d’associer à la « joie ».
Le militantisme ne va pas nécessairement avec la joie. Il y a une part d’obligation quasi-scolaire dans le travail militant, qu’il s’agisse d’une association, d’un syndicat, d’un parti, d’un « mouvement », d’une ZAD. C’est aussi, souvent, la prise d’une énergie considérable. On puise dans une source qui s’assèche (bien vite) à la mesure du temps investi face à des situations toujours plus insoutenables. Faire du lien semble être une des perspectives permettant de contrebalancer l’épuisement général : se retrouver, s’entendre, s’enlacer (entre autres) pour retrouver un peu de force.
Les personnes à qui s’adressent ce livre ont dû, à un moment donné, ressentir cette puissante présence : celle d’être uni·es à quelque chose de plus grand et de plus intense – qui nous a donné, un certain temps, une force unique en son genre. Joie militante parle pourtant peu de ces instants et de ce qu’ils produisent (état difficile à décrire brièvement avec des mots justes), ou encore de l’ingratitude ponctuelle du travail militant. Il s’agit davantage d’une réflexion (d’une recherche, en fait), parfois hésitante, sur la manière dont les désirs émancipateurs les plus subversifs peuvent produire des formes de rigidité mortifères, et les façons de s’en sortir (ou pas ?).
Le point de départ est un constat simple et non moins déprimant, que nous avons tou·tes vécu d’une manière ou d’une autre dans nos expériences de lutte, à ce moment où, au lieu de nous libérer, elle nous enferme. Elle nous rend triste, elle nous stresse, et pire que tout, nous avons le sentiment de ne pas être à la hauteur. Ce ne sont pas des belles paroles qui peuvent nous rassurer (« tu es merveilleux·se, tu es indispensable ») : il ne s’agit pas là d’un problème personnel de confiance en soi, mais bien de la réalité d’affects négatifs qui circulent dans nos milieux militants.
En dehors des mots, c’est bien parfois les gestes qui manquent, et la réelle prise en charge du collectif et de ses membres dans toutes leurs dimensions qui peinent à se mettre à l’œuvre. Souvent, c’est le sentiment d’urgence qui vient alors dicter les comportements : pour faire vite, pour faire au mieux, on omet parfois de prendre la mesure du désarroi de chacun·e autant que du possible épuisement, voire du burn-out qui s’invite également.
Sous le monde qui brûle, y a-t-il vraiment la possibilité de s’extasier encore ?
« Quelque chose circule dans de nombreux mouvements et espaces radicaux, et les vide de leur potentiel de transformation. Quiconque a fréquenté ces espaces l’a ressenti. Beaucoup, (nous compris.es) y ont participé activement, l’ont diffusé, et en ont été blessé·e·s. Ce quelque chose alimente la rigidité, le manque de confiance et l’anxiété précisément là où nous devrions nous sentir les plus vivant·es. » (p. 23)
Ce phénomène au sens large est qualifié par les auteur·ices de « radicalisme rigide ». L’idée est bien d’en comprendre les rouages, les origines, et les possibilités de l’empêcher sans lui opposer un autre système tout aussi rigide. Tâche d’ampleur, puisqu’il s’agit d’emblée d’embrasser ensemble la conflictualité des différences, la nécessaire violence de la résistance, sans s’enfermer dans un blabla lénifiant à base de pensée positive et de communication non-violente. Il s’agit aussi de contrer cette tendance naturelle au radicalisme rigide, par une promotion d’une éthique fondée sur les liens humains et concrets, l’amour, le soin, la confiance et la responsabilité. « Waouh », on a envie de dire. Pour les auteur·ices, « (…) des liens durables et de nouvelles complicités ne sont pas un répit ou une échappatoire, ce sont les seuls moyens de défaire l’Empire » (p. 28).
Le radicalisme rigide ressemble à l’infiltration de l’Empire dans nos champs de lutte les plus intenses. Car cet Empire qu’il s’agit de contre-attaquer, est précisément identifié dans Joie militante comme un régime permanent de destruction organisée, qui fonctionne à différents niveaux dans nos vies, de la violence la plus brutale à différentes formes de soft power qui agissent, à bas bruit, de manière à contrôler nos émotions, nos savoirs, nos désirs. Pire, à nous infliger une norme qui épuisera nos forces. Les auteur·ices posent malgré tout que cet Empire connaît des failles, et que ce sont celles-là mêmes qu’il faut creuser pour le faire basculer, par ses marges.
Joie militante se lit dans tous ces paradoxes. Sans se faire « guide », l’ouvrage se pose plutôt comme une première ouverture à de multiples questions rencontrées en terrain militant. C’est un petit cheminement où les précisions viendront se trouver dans les expériences personnelles de chacun·e. Ainsi, tel un carnet de bord, il permet de questionner nos positionnements autant que nos manières de faire.
De manière primordiale, c’est la question de nos relations interpersonnelles qui est mise sur la table. Les auteur·ices s’appuient entre-autres sur les réflexions de Donna Haraway, Silvia Federici et Jackie Wang pour défendre la nécessité de créer des relations solides qui nous permettront d’être mieux paré·es face à l’Empire. Il s’agit alors de créer des réseaux, des lieux pour la convivialité, des amitiés et donc de nouvelles « familles ».
« Créer des réseaux d’intimité et de soutien intergénérationnels est un acte radical […] Questionner la famille nucléaire ne se résume pas à un rejet puritain de tout ce qui lui ressemble, il s’agit plutôt de créer des alternatives à son hégémonie, au démembrement des relations sociales, à la division spatiale des gens par la surburbanisation, l’incarcération, l’école, la dépossession, et le déplacement. Cela implique la prolifération des relations qui peuvent être ou non basées sur des liens de sang mais sont construites dans le soin et l’amour. » (p. 106)
Carla bergman et Nick Montgomery revisitent aussi les théories trotskystes, léninistes, anarchistes (qui ont leur préférence), à travers un prisme qu’on pourrait résumer ainsi : « When and how dit it go wrong ? » (« Quand et comment cela a-t-il mal tourné ? »). L’insertion de l’Empire dans nos espaces de lutte et nos théories produit ce qu’iels appellent le « militantisme performatif », qui est un champ de compétition des radicalités (et des egos). Celui-ci vient reproduire dans le monde militant les normativités rigides et éreintantes de l’Empire : obsession de la productivité, antagonisme, mise en concurrence. Les solutions s’énoncent simplement à travers un objectif : « placer les relations devant les engagements politiques abstraits et les idéologies » (p. 110).
Les auteur·ices proposent ainsi un véritable travail sur la(les) relation(s) : prendre soin mais aussi savoir dénouer et rompre avec ce qui nous écrase. La proposition éthique est également celle de la confiance (autant aux autres qu’à soi-même) et de la responsabilité. En restant toujours attentif·ves aux rigidités qui s’invitent, se faire confiance tout en restant constamment méfiant·es de l’idéologie qui s’installe, des règles qui s’instaurent… Il s’agit d’user de « l’incertitude » non pas comme source d’angoisses, mais plutôt comme une direction fluctuante qui permet la « création permanente » (comme en usait Robert Filliou).
Forcément, on se fait sans cesse avoir, on n’est jamais totalement libéré·es de l’emprise de la société sur nos imaginaires et nos expériences, alors parfois (souvent), ça cafouille.
La joie comme remède ?
Pour contrer cela, le remède proposé est la joie. Les auteur·ices s’appuient sur l’usage qu’en fait le philosophe Spinoza (et à sa suite, si l’on peut dire, Deleuze et Guattari notamment), qui exprime une théorie des affects et de ce qu’ils produisent, en termes d’augmentation ou de diminution de notre puissance de vie. La joie n’est ni un idéal ni un objectif en soi, et elle n’a rien à voir avec le bonheur.
L’idée est plutôt celle d’adéquation : celle d’agir, et de ne pas être dans la réaction permanente aux injonctions qui nous entourent. Il s’agit d’accepter de changer, de vouloir changer, d’être changé·e, d’accepter l’incertitude, le chagrin, d’accepter de se tromper. On voit pointer ici une forme de philosophie du lâcher-prise : toute la question reposera sur l’articulation de ces affects avec l’activité politique. Loin d’une morale normative,
« les réponses transformatrices (…) sont joyeuses dans le sens spinoziste du terme, elles ne mènent pas à un accroissement du bonheur mais à un accroissement de notre capacité à affecter et être affecté·e, avec toute la douleur, les risques et l’incertitude que cela peut comporter » (p. 228).
Le livre se pose en forme de recherche ouverte : pour expliciter ces question lancinantes, carla bergman et Nick Montgomery sont allé·es à la rencontre de militant·es dans des luttes aux marges, « aux prises avec le monde », et cherchent à questionner les pratiques, les situations, avec une réflexivité impressionnante puisqu’iels reviennent souvent sur leurs pas en acceptant de se tromper. Chaque chapitre affronte l’Empire sous des angles différents, au travers de luttes diverses et très concrètes (des luttes autochtones aux expériences d’émancipation des enfants).
Les exemples foisonnent, se contredisent un peu parfois mais qu’importe, puisque les auteur·ices affirment essentiellement la chose suivante :
« le militantisme n’est pas un idéal fixe dont il faut s’approcher. (…) Plutôt que de réduire le militantisme joyeux à une façon déterminée d’être ou un ensemble de caractéristiques, nous le voyons apparaître dans et au travers de relations que les personnes nouent entre elles. Ce qui veut dire qu’il aura toujours l’air différent, en fonction des connexions émergentes, des relations et des convictions qui l’animent » (p. 80).
Le « militantisme joyeux » est donc posé comme résolument en prise avec des contextes locaux (et non une vision d’ensemble de la société) et arrimé à un assemblage de personnes et d’affects. Il jaillit de la capacité à s’ouvrir au pouvoir collectif issu de ces affects, ce qui serait une manière, peut-être, de neutraliser les rapports de pouvoir qui existent au sein de toute relation. Une marge où la vulnérabilité ne serait pas une faiblesse, mais une force. Où, plutôt, il ne serait ni question de faiblesse ou de force, mais bel et bien (toujours) de relation, de soin, d’affect et de puissance collective.
Cet aspect concret du militantisme radical ne peut pas ne pas résonner avec les expériences de nombre d’entre nous. Il y a une part de bon sens : quand on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas être camarade. Le militantisme repose d’abord sur des liens personnels, concrets, des affects et de la parole qui circule. Sinon, ce sont des constructions rigides qui nous donnent envie de pleurer. Or faire confiance n’est pas sans risque. On ne peut pas non plus accorder sa confiance trop facilement dans des relations minées par des rapports de pouvoir structurels. Il faudrait donc pouvoir se « sentir », tâtonner, « y aller doucement » (p. 174) pour expérimenter ce que serait un vrai rapport égal avec des familles partagées.
Il y a ici, de manière un peu surprenante, un incontestable écho avec certaines théories de développement personnel, dans l’affirmation de l’importance de la présence au monde, du moment présent, de profiter de l’environnement, de cesser de se voir comme le nombril du monde pour se sentir appartenir à un tout vivant, et cultiver un véritable lâcher prise.
« Une façon d’être en prise implique d’accroître la sensibilité et d’habiter plus pleinement les situations. C’est dans ce sens qu’Amador Fernandez-Savater suggère que l’alternative révolutionnaire au contrôle consiste à ‘apprendre à habiter pleinement, plutôt qu’à gouverner, un processus de changement. Se laisser être affecté·e par la réalité, être capable d’affecter en retour. Prendre le temps de se saisir des possibles qui s’ouvrent dans un moment ou un autre’. Et si la capacité à être vraiment présent·e était révolutionnaire ? Quels potentiels peuvent se révéler lorsque l’on se connecte à l’immédiateté, dans un monde qui encourage la distraction permanente, les atermoiements, et l’engourdissement ? » (p. 255)
Loin d’être facile, l’ouvrage tâtonne comme nous, et nous livre des pistes locales foisonnantes (un peu d’autopromotion aussi) permettant de rompre les liens imposés et de recréer ceux qui nous rendent vivants.
C’est sans doute la une limite des propositions de Joie militante. On comprend bien, on a envie d’essayer, on est soulagé de lire qu’on a le droit de se tromper, mais les propositions faites paraissent en deçà de la catastrophe actuelle que nous vivons. Certes, le postulat est que la dissolution de l’Empire se fera par ses marges et D’ABORD à travers les liens concrets plutôt que l’idéologie. Il nous faudrait garder cela toujours à l’esprit. Mais si on se reconnaît énormément dans nombre de situations, on reste sur un constat doux-amer de tourner un peu en rond. Dans un mouvement d’optimisme, on en vient à se demander si l’on n’étudie pas déjà ici des façons de faire pour une éventuelle société post-capitaliste ; mais dans l’état actuel des choses, quelle place stratégique pour les pistes tracées ici ? La posture qui tend à se rapprocher d’une certaine forme de résilience et d’acceptation n’est-elle pas dangereuse ?
S’aimer, s’autoriser à être vulnérable, affecter, prendre soin des autres ; oui. Se faire une nouvelle famille, se construire une mini-ZAD et considérer que cela va détruire l’Empire, vraiment ?
![Récits de militantes : Annick Coupé, de mai 68 au mouvement altermondialiste [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/annick-coupe-150x150.jpg)








