
La Commune au jour le jour. Samedi 27 mai 1871
À l’occasion des 150 ans de la Commune de Paris, Contretemps publie du 18 mars au 4 juin une lettre quotidienne rédigée par Patrick Le Moal, donnant à voir ce que fut la Commune au jour le jour.
***
L’essentiel de la journée
L’étau versaillais se resserre sur Belleville
C’est dans ce quartier ouvrier populaire récemment intégré à Paris, qui a été depuis le début un des centres névralgiques de la Commune, que les derniers combats vont se livrer.
Le jour se lève sur un brouillard pénétrant.
Au nord, l’avancée versaillaise encercle les buttes Chaumont, qui, bien que n’ayant pu se ravitailler en munitions, vont tenir, pour finir dans des combats à l’armée blanche jusqu’au milieu de la nuit. Durant six heures, le tambour, sombre et voilé, car il pleut à flots, bat la charge sans s’interrompre et mêle son appel sinistre à la fusillade. Dans certains coins on lutte de si près que les fusils servent de massue. Le jour se lève sur six cent cadavres de fédérés.
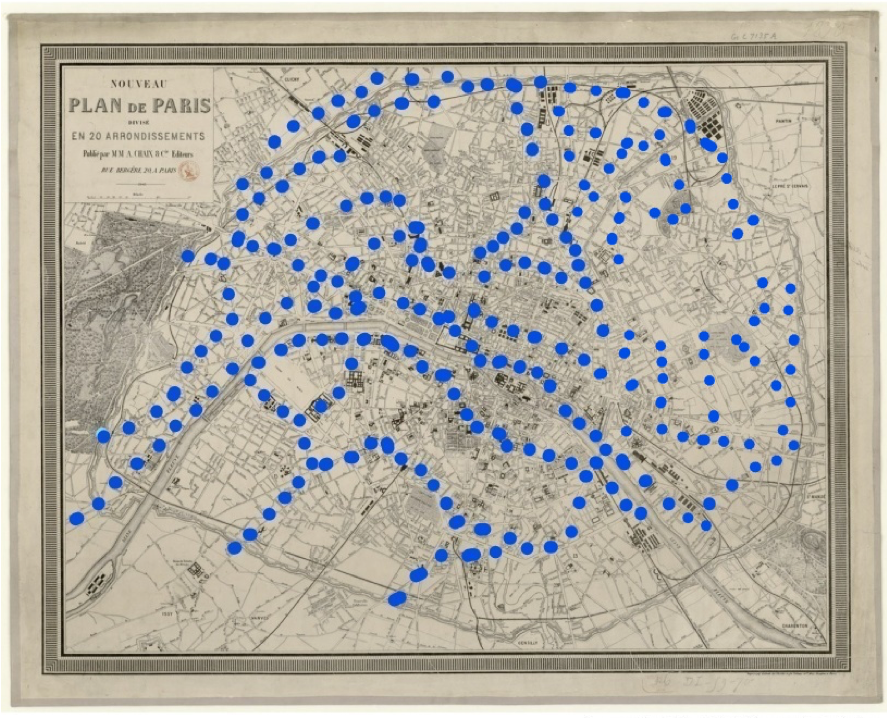
L’église rue de Flandres, qui était devenue le lieu de réunion du Club de la Marseillaise durant les semaines précédentes, a été transformée depuis l’entrée des versaillais dans Paris en magasin de poudre et de pétrole. Les fédérés s’y retranchent et opposent une forte résistance[1], arrosant de projectiles les rues adjacentes. Les éclaireurs qui réussissent à pénétrer dans le clocher par une petite porte massacrent tous les gardes nationaux.
L’encerclement devient de plus en plus serré après la prise des portes de Montreuil et de Bagnolet, qui permet à l’armée de d’attaquer le cimetière du Père-Lachaise dans la soirée, qu’ils prennent malgré une résistance acharnée des deux cent fédérés qui s’y trouvent, entre les tombes, sous la pluie et dans la nuit. Les combattants qui ne meurent pas au combat sont fusillés. La mairie du XXème est prise également .

Au sud, dès le matin les versaillais ont pris la place du Trône[2], et à partir de là ont attaqué la place Voltaire et la Mairie du XIème, les barricades tombent l’une après l’autre. L’avancée dans le faubourg du temple se heurte à une furieuse résistance.
A l’issue de cette journée de combats, les derniers défenseurs sont concentrés dans un petit périmètre du XXème arrondissement.
Prosper Olivier Lissagaray, 33 ans, journaliste
A la faveur de la pluie, les troupes descendirent dans la rue du Chemin Vert, sur les derrière de la barricade située à l’intersection des boulevards Voltaire et Richard Lenoir. Le correspondant d’un journal anglais a raconté deux épisodes qui se rattachent à la prise de cette barricade :.
Je vis fusiller environ soixante hommes, à la même place et en même temps que des femmes. Un petit incident touchant, qui m’accabla complètement, frappa mes regards. Tandis que Paris brûlait au milieu de la nuit, que le canon et que la mousqueterie pétillait, une pauvre femme se débattait dans une charrette et sanglotait amèrement. Je lui offris un verre de vin et un morceau de pain. Elle refusa en disant : « Pour le peu de temps que j’ai à vivre, ça n’en vaut pas la peine ».
Une grande rumeur suivit de notre côté de la barricade et je vis la pauvre femme saisie par quatre troupiers, qui la dépouillaient rapidement de ses vêtements. J’entendis la voix impérieuse de l’officier commandant qui interrogeait la femme, disant « Vous avez tué deux de mes hommes ».
La femme se mit a rire ironiquement et répondit d’un ton rade : « Puisse Dieu me punir pour n’en n’avoir pas tué plus.!Javais deux fils a Issy, ils ont été tués tous les deux, et deux à Neuilly, qui ont subi le même sort. Mon mari est mort à cette barricade, et maintenant faites de moi ce que vous voudrez ». Je n’en n’entendis pas davantage, je m’éloignai en rampant, mais pas assez tôt pour ne pas entendre le commandement de : « Feu ! » qui m’apprit que tout était fini. »
La résistance à Belleville
Toute la nuit les quartiers de Belleville et de Ménilmontant ont été bombardés. Dans chaque rue, des sentinelles contrôlent les déplacements. Il faut pour circuler justifier d’une mission, chaque chef de poste ou de barricade s’octroie le droit de livrer ou refuser le passage. Les maisons sont pleines, les groupes épars des restes de bataillons campent devant la mairie, sur des bottes de paille et de foin. Face aux obus qui tombent, toujours la même détermination des combattant-es, le même cri « Vive la Commune!)
Victorine Brocher, 31 ans, piqueuses en bottines, ambulancière
Nous étant reposés un peu, nous quittâmes le presbytère à une heure assez matinale.Notre petit groupe se reforma et nous marchâmes en avant; autour de nous on entendait un bruit continuel de fusillade, un tintamarre effroyable..On bombardait toujours. Les barricades sont plus nombreuses que la veille, les fédérés du quartier s’organisent pour sa défense; il y eut une confusion aux barricades, les fédérés deviennent de moins en moins nombreux; la journée est très agitée; pourtant, place de la mairie il y a une grande animation, beaucoup de morts sont placés dans la cour du bâtiment, des femmes, des mères, des enfants viennent fouiller dans le tas de cadavres, cherchant à découvrir un des leurs. Des femmes sanglotent, des enfants appellent leur père, il est difficile de reconnaître les siens.
Dans la soirée nous avions élu domicile à une barricade dans le haut de la rue de Belleville, deux des nôtres faillirent être victimes des versaillais, par erreur ils avaient sauté dans une barricade voisine de la notre, quand ils s’aperçurent qu’il y avait des lignards; ils n’eurent que le temps de sauter à nouveau et de revenir près de nous, heureusement qu’il faisait sombre.
Nous quittâmes notre barricade, et nous remontâmes la rue, nous dirigeant vers la rue Haxo. Chemin faisant, nous rencontrâmes une dizaine des nôtres que nous n’avions pas revu depuis Passy, nous étions contents de nous retrouver, il est heureux de revoir notre drapeau, seulement il paraissaient douter de nous, parce qu’il ne nous avaient pas revus, nous leur avons expliqué ce qui était arrivé, nos tourments et nos luttes, quoique séparés, chacun de nous avait fait son devoir
En fin de matinée, une dizaine de membres de la Commune se réunissent, un d’entre eux est couché, blessé à la cuisse. La proposition de demander le passage aux prussiens est écartée par vote. Arrive Ranvier qui cherche des hommes « allez vous battre au lieu de discuter :! ». Il est décidé de se rendre aux barricades et d’agir en fonction de son initiative personnelles.
Les blessés affluent à la mairie où il n’y a ni médecins, ni médicaments, ni matelas, ni couvertures, la malheureux agonisent sans secours.
À cinq heures, ferré amène rue Haxo les lignards qui étaient enfermés depuis mercredi à la petit Roquette. La foule les regarde sans menace : le peuple est sans haine pour le soldat peuple comme lui, ils sont casernés dans l’église de Belleville.
Gustave Le français 45 ans, instituteur comptable
Se sentir à l’abri de la vengeance des vainqueurs est une cause de joie bien naturelle, lorsqu’on ne laisse derrière soi aucun de ses compagnons disputer encore pied à pied le terrain à l’ennemi. Malheureusement, je ne suis point dans ce cas. À 500 mètres de moi le combat dure toujours et je ne peux plus rien savoir du sort des amis que j’ai quitté. Il me semble avoir déserté mon poste et trahi mon mandat.
Le bruit de la fusillade et de l’artillerie qui tonne avec fureur me monte au cerveau et porte au paroxysme la fièvre qui me talonne depuis plus depuis huit jours.
Je délire abominablement toute la nuit. Mes braves amis ont grand peine à me tenir au lit, pris que je suis de l’idée fixe de retourner auprès de ceux qui luttent encore.
Heureusement le corps de bâtiment qu’ils occupent est assez retiré pour que mes cris et les terribles accès de toux qui m’étranglent ne puissent révéler ma présence au voisin et dénoncer le dévouement des Lavaud.
Dans la journée, un grand nombre de personnes se sont réfugiées à la porte de Romainville, beaucoup de femmes et d’enfants, chassé-es de leurs maisons par les obus, qui voulaient gagner la campagne. La venue de francs maçons porteurs d’un drapeau blanc fait baisser le pont levis, une bousculade , et des centaines se précipitent au dehors, dans le village des Lilas. Les prussiens accompagnés de gendarmes français, fouillent toutes les maisons et arrêtent tous les porteurs d’uniformes de gardes nationaux.
Témoignage – Louise Michel, 41 ans, institutrice
Rêve sur la fosse commune.
(Victor Hugo.)
Au chenil les soirs de chasse, après la curée chaude sur le corps pantelant de la bête égorgée les valets de meutes jettent aux chiens du pain trempé de sang ; ainsi fut offerte par les bourgeois de Versailles, la curée froide aux égorgeurs.
D’abord la tuerie en masse, avait eu lieu quartier par quartier à l’entrée de l’armée régulière, puis la chasse au fédéré, dans les maisons, dans les ambulances, partout.
On chassait dans les catacombes avec des chiens et des flambeaux, il en fut de même dans les carrières d’Amérique, mais la peur s’en mêla.
Des soldats de Versailles, égarés dans les catacombes, avaient pensé périr.
La vérité est qu’ils avaient été guidés pour en sortir par le prisonnier qu’ils venaient de faire, et que n’ayant pas voulu le livrer en retour, pour être fusillé, ils lui avaient laissé la vie ce qu’ils tinrent secret : leurs maîtres, les eussent eux-mêmes punis de mort. Ils répandirent sur les catacombes d’épouvantables récits.
Le bruit ayant d’un autre côté couru que des fédérés armés se cachaient dans les carrières d’Amérique, l’ardeur se ralentit pour ces chasses, dont celles du fox en Angleterre donnent assez la marche. La bête parfois regarde passer les chiens et les chasseurs, d’autres fois on l’a vue, elle semble paresseuse à se lancer en avant, pour subir sur elle la chaude haleine des chiens ; le dégoût prenait ainsi les hommes pourchassés.
Quelques-uns en paix moururent de faim, rêvant de liberté.
Les officiers de Versailles, maîtres absolus de la vie des prisonniers, en disposaient à leur gré.
Les mitrailleuses étaient moins employées qu’aux premiers jours ; il y avait maintenant quand le nombre de ceux qu’on voulait tuer surpassait dix, des abattoirs commodes, les casemates des forts qu’on fermait, une fois les cadavres entassés, le bois de Boulogne, ce qui en même temps procurait une promenade.
Mais tout étant plein de morts, l’odeur de cette immense sépulture attirait sur la ville morte l’essaim horrible des mouches des charniers; les vainqueurs craignant la peste suspendirent les exécutions.
La mort n’y perdait rien : les prisonniers entassés à l’Orangerie, dans les caves, à Versailles, à Satory, sans linge pour les blessés, nourris plus mal que des animaux, furent bientôt décimés par la fièvre et l’épuisement.
Quelques-uns apercevant leurs femmes ou leurs enfants à travers les grilles devenaient subitement fous.
D’autre part, les enfants, les femmes, les vieux, cherchaient à travers les fosses communes, essayant de reconnaître les leurs dans les charretées de cadavres incessamment versées.
La tête basse, des chiens maigres y rôdaient en hurlant ; quelques coups de sabre avaient raison des pauvres bêtes, et si la douleur des femmes ou des vieux était trop bruyante, ils étaient arrêtés.
Il y avait dans les premiers temps je ne sais quelle promesse de 500 francs de récompense pour indiquer le refuge d’un membre de la Commune ou du Comité central, cela courait en France et à l’étranger. Tous ceux qui se sentaient capables de vendre un proscrit étaient invités.
A Versailles
A. Thiers a adressé, la dépêche suivante aux autorités civiles et militaires pour renseigner la province sur les mouvements de l’armée dans Paris :
Versailles, 27 mai 1871, 6 h. 10, soir.
Nos troupes n’ont pas cessé de suivre l’insurrection pied à pied, lui enlevant chaque jour les positions les plus importantes de la capitale et lui faisant des prisonniers qui s’élèvent jusqu’ici jusqu’à vingt-huit mille sans compter un nombre considérable de morts et de blessés. Dans cette marche, sagement calculée, nos généraux et leur illustre chef ont voulu ménager nos braves soldats, qui n’auraient demandé qu’à enlever au pas de course les obstacles qui leur étaient opposés. [….…] Ainsi les deux tiers de l’armée, après avoir conquis successivement toute la rive droite, sont venus se ranger au pied des hauteurs de Belleville, qu’ils doivent attaquer demain malin. Pendant ces six jours de combats continus, nos soldats se sont montrés aussi énergiques qu’infatigables et ont opéré de véritables prodiges bien autrement méritoires de la part de ceux qui attaquent des barricades que de ceux qui les défendent. Leurs chefs se sont montrés dignes de commander à de tels hommes et ont pleinement justifié le vote que l’Assemblée leur a décerné. Après les quelques heures de repos qu’ils prennent en ce moment, ils termineront demain matin, sur les hauteurs de Belleville, la glorieuse campagne qu’ils ont entreprise contre les démagogues les plus odieux et les plus scélérats que le monde ait vus, et leurs patriotiques efforts mériteront l’éternelle reconnaissance de la France et de l’humanité. Du reste, ce n’est pas sans avoir fait des perles douloureuses que notre armée a rendu au pays de si mémorables services. Le nombre de nos morts et de nos blessés n’est pas grand, mais les coups sont sensibles. Ainsi, nous avons à regretter le général Leroy de Dais, l’un des officiers les plus braves et les plus distingués de nos armées. Le commandant Ségoyer, du 26e bataillon de chasseurs à pied, s’étant trop avancé, a été pris par les scélérats qui défendaient la Bastille, et, sans respect des lois de la guerre, a été immédiatement fusillé. Ce fait, du reste, concorde avec la conduite de gens qui incendient nos villes et nos monuments, et qui avaient préparé des liqueurs vénéneuses pour empoisonner nos soldats presque instantanément.
En débat
Rubrique annulée vu les circonstances.
Notes
[1]Maîtron
[2]Qui s’appellera place de la Nation









