
Comment le monde est devenu capitaliste. À propos d’un livre d’Alain Bihr
À propos de : Alain Bihr, Le Premier Âge du capitalisme (1415-1763). Tome 3 : un premier monde capitaliste, Lausanne/Paris, pages 2/Syllepses, 2019, 1764 pages.
On pourra (re)lire les compte-rendu, par Guilaume Fondu, des deux premiers tomes :
– L’expansion européenne, premier âge du capitalisme
– Le rôle de l’État dans la genèse du capitalisme en Europe
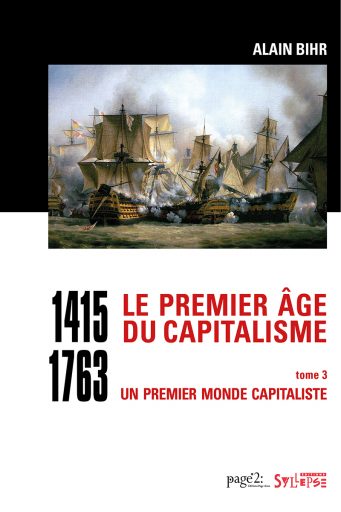
Ce troisième tome, qui se compose de deux imposants volumes, vient clore le récit par A. Bihr du « premier âge du capitalisme » ou plus exactement, comme il le précise en conclusion, de ce protocapitalisme mercantile qui précède le capitalisme à proprement parler. Par cette expression, l’auteur entend insister sur la dimension transitoire de la structure envisagée ici, ainsi que sur tout ce qui la distingue du mode de production capitaliste classique théorisé par Marx : prédominance du profit commercial sur le profit industriel, hégémonie de la bourgeoise marchande, rôle central de l’État et, surtout, règne de la consommation improductive sur la consommation productive (ce qui signifie, en dernière instance, le maintien d’une certaine hétéronomie de la dynamique du capital).
Après un premier tome consacré à l’expansion coloniale européenne et un second centré sur l’Europe occidentale, l’auteur s’attache maintenant à décrire la manière dont s’est structuré ce premier capitalisme à l’échelle mondiale. La perspective est centrale puisque cette échelle, comme l’écrivait Marx, est consubstantielle au capitalisme lui-même, dont le mouvement d’expansion ignore les limites géographiques et institutionnelles qui définissaient jusque-là les sociétés. De manière plus générale, l’ouvrage d’Alain Bihr constitue une tentative monumentale d’écrire l’histoire de la période en mettant au travail les catégories marxistes afin de faire la démonstration en acte de leur caractère heuristique : c’est le mouvement propre du capital, tel que défini par Marx dans l’ouvrage du même nom, qui permet de comprendre les évolutions et les transformations qui font passer progressivement – et non sans à-coups – d’un monde marqué par la prédominance de la valeur d’usage à un univers régi par les lois de l’échange marchand et de la mise en valeur capitaliste.
Outre son introduction et sa conclusion plus théoriques, l’ouvrage se présente comme une vaste synthèse narrative de la période, découpée selon les aires nationales envisagées. Mais il ne s’agit certainement pas de la simple juxtaposition d’histoires singulières isolées les unes des autres : en effet, comme l’auteur y insiste d’emblée, l’intérêt de raconter ce protocapitalisme mercantile tient à la manière dont on assiste, avec lui, à la structuration d’un monde capitaliste peu à peu élargi aux dimensions de la planète tout entière et ce selon une dynamique complexe. Celle-ci combine en effet trois mouvements distincts dont il faut suivre l’hybridation pas-à-pas et dans ses détails historiques : une homogénéisation (les échanges marchands s’installent peu à peu d’un bout à l’autre du globe), une fragmentation (les différentes modalités de la concurrence et les conflits qui y sont liés mettent face à face des entités distinctes et rivales) et une hiérarchisation.
Cette dernière revêt deux modalités centrales, la domination économico-politique, qui fait le partage entre un centre de commandement et des périphéries aux économies extraverties (c’est-à-dire produisant selon les besoins du centre), et l’exploitation, qui passe par des transferts de surtravail des périphéries vers le centre. Par conséquent, le mouvement d’expansion de ce protocapitalisme n’a rien de linéaire ou d’uniforme, et les aires nationales sont d’emblée partagées selon une tripartition qui structure l’ouvrage : centre, semi-périphérie et marges. En outre, ces catégories n’épuisent pas non plus les cas singuliers qu’elles subsument, et ce d’autant qu’elles sont elles-mêmes marquées par des dynamiques spécifiques : au centre, la lutte pour la suprématie fait rage et voit triompher successivement le Portugal, l’Espagne et les Provinces-Unies, avant que l’Angleterre n’assoie finalement sa domination à la fin de la période, malgré une rivalité permanente avec la France.
Les semi-périphéries sont marquées par des histoires très différentes : aires en déclin (Portugal, Espagne, Italie) ou au contraire en voie de construction (Suède, Russie), elles sont marquées par une volonté de rattrapage et d’autonomisation par rapport au centre, schéma qui permet par exemple à Alain Bihr de faire un sort à la catégorie de « despotisme éclairé », qui caractérise précisément les régimes politiques de ces systèmes (la Russie, la Prusse ou encore l’Autriche), lorsqu’ils ont à leur tête un-e souverain-e désireux de rattraper le retard pris sur l’Occident et imposant ainsi par la force – de manière évanescente et fort limitée – les idées modernes issues des Lumières.
Les marges enfin[1], principalement des empires (Empire ottoman, Chine, Iran et Japon), si elles avaient échappé à la soumission coloniale (cf. le premier tome du Premier Âge du capitalisme), se trouvent peu à peu intégrées à la circulation du capital de manière hétéronome et les quelques tentatives de résistance par l’isolement et la fermeture s’avéreront néfastes sur le long terme. Là encore, l’auteur reprend des débats historiographiques massifs sous un éclairage marxiste : par exemple, c’est la structure de la propriété régnant en Chine qui explique en dernière instance le refus de cette dernière de se lancer dans le commerce au long cours et, partant, le fait qu’elle soit demeurée à l’écart du développement capitaliste malgré des atouts réels et importants du point de vue même de ce développement (non seulement son avancée technologique, massivement soulignée par les historiens, mais aussi et surtout la formation ancienne, en son sein, d’un capital marchand, d’un protoprolétariat). En effet, la propriété foncière monopolisée par l’État est incompatible avec la genèse d’un état d’esprit entrepreneurial capitaliste. De manière générale, l’omniprésence de l’État impérial (par opposition, par exemple, aux phénomènes des villes franches occidentales, cruciales pour le développement des rapports marchands) et son quasi-monopole du pouvoir et de l’initiative économiques (auxquels s’ajoutent des éléments culturels dérivés) a bloqué la constitution d’un sujet capitaliste en Chine et, partant, le déploiement de la logique capitaliste[2].
La grande force de l’ouvrage d’Alain Bihr est donc de réinscrire chacune des trajectoires étudiées dans l’ensemble du mouvement protocapitaliste mondial qui lui donne sens. Pour cerner de près ces trajectoires, l’auteur a synthétisé une masse de lectures imposante, ce dont peut désormais prendre conscience le lecteur, puisque peu d’ouvrages sont directement cités dans le corps du texte et qu’il faut attendre ce troisième tome pour accéder à la bibliographie générale de l’ouvrage. Sans doute de nombreux historiens pourront-ils reprocher à l’ouvrage de forcer une partie des données historiques pour les faire entrer dans le schéma explicatif marxiste, d’autant que ce dernier est ici entendu en un sens causal fort, comme en témoigne la discussion des thèses de Wallerstein qui ouvre le livre.
Le théoricien du « système-monde » se voit reprocher de demeurer trop descriptif et insuffisamment explicatif, notamment pour ce qui est de la fragmentation et de la hiérarchisation de ce premier monde capitaliste. Mais il n’en reste pas moins, que le récit proposé ici conjugue le souci du détail historique et un schéma d’ensemble qui confère au matériau historique un sens et une intelligibilité indiscutables. En renouvelant l’histoire marxiste de la période, Alain Bihr inverse la charge de la preuve et lance un défi à toutes les historiographies rivales : construire un récit aussi exhaustif et sensé que celui qu’il nous propose, sous le patronage de Marx.
La reconstruction de la genèse de la modernité capitaliste qui est proposée , on l’avait souligné lors de nos précédentes recensions, est, par bien des aspects, salutaire Les catégories marxistes heuristiques – le capital, l’exploitation, l’impérialisme colonial, etc. – sont placées au centre de la démonstration. A l’encontre du substantialisme qui menace toute étude des rapports entre l’Occident et le reste du monde, l’ouvrage insiste sur la spécificité du monde capitaliste, de ses catégories et de ses dynamiques, ainsi que sur la cohérence de l’univers qu’il tisse. Enfin et surtout, l’usage des concepts centraux de Marx est conforme à leur finalité: saisir et restituer l’histoire effective, la cohérence et le rythme de ses évolutions.
Reste la question de l’usage potentiel d’un tel ouvrage, dont on peut craindre qu’il peine à trouver son public : sans doute trop éloigné des standards académiques contemporains pour faire l’objet de véritables discussions scientifiques, il risque de se heurter à la division toujours plus poussée du travail intellectuel, qui prend la forme d’une hyper-spécialisation et éloigne malheureusement les universitaires de ce genre de travail. Inversement, l’ampleur de l’ouvrage le rend également difficile à appréhender pour le lectorat militant. Mais les livres, comme le veut l’adage, ont leur destin, et il y a des raisons de penser que celui-ci fraiera sa voie. L’époque, en effet, semble voir renaître une certaine appétence pour les perspectives larges, comme en témoigne par exemple le succès récent des livres de Thomas Piketty (dont on ne se prononcera pas ici sur l’intérêt intrinsèque).
*
On ne saurait trop conseiller en tout cas à toutes celles et ceux que notre histoire longue intéresse de se reporter aux analyses déployées ici, ne serait-ce que ponctuellement sur telle ou telle question ou à propos de telle ou telle zone géographique. L’organisation rigoureuse du propos, ainsi que la précision de la table des matières, font en effet de l’ouvrage un instrument de travail précieux, dont tout laisse penser qu’il servira de synthèse de référence sur la question pour un bon moment. On ne peut que souhaiter en tout cas qu’il en soit ainsi pour toutes celles et ceux qui désirent comprendre la genèse de notre présent capitaliste et considèrent que la perspective marxiste peut et doit servir cet objectif.
Notes
[1]Il faut noter ici que les colonies ne sont pas étudiées en tant que telles dans l’ouvrage. Elles ont fait l’objet du premier volume et se trouvent ici traitées dans les chapitres consacrées aux puissances coloniales.
[2]Sur ce point, l’auteur s’oppose à la thèse à ses yeux technologiste de Kenneth Pomeranz et semble assez proche des positions de Wallerstein, dont il conteste par ailleurs l’appareil théorique (cf. infra). De manière générale, on peut faire un reproche formel à Alain Bihr : il ne cite ses sources que lorsqu’il est question de contester des interprétations très générales. Certes, cela rend l’ouvrage plus lisible que s’il avait été bardé de notes de bas de page et l’on peut se référer à la bibliographie présente en fin de volume. Mais peut-être aurait-on pu imaginer une bibliographie par chapitre ou un autre moyen qui aurait mieux permis de saisir précisément les références mobilisées ici et là par l’auteur.



![Marx, critique de l’économie politique [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/industrialization-factories-150x150.jpg)





