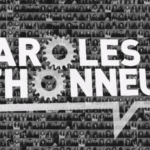Mouvements décoloniaux. Entretien avec Sadri Khiari
Militant tunisien exilé en France depuis le début de l’année 2003, Sadri Khiari est un des membres fondateurs du Mouvement des Indigènes de la République dont il est actuellement l’un des dirigeants. Il a publié notamment Pour une politique de la racaille. Immigré-e-s, indigènes et jeunes de banlieue (Editions Textuel, 2006) et La contre-révolution coloniale en France de de Gaulle à Sarkozy (Editions La Fabrique, 2000).
Le Mouvement des Indigènes de la République (MIR) est né à la suite du lancement, en janvier 2005, de l’Appel intitulé « Nous sommes les indigènes de la république », qui avait été signé par plusieurs milliers de personnes et de nombreuses associations. Depuis, le MIR tente de rassembler et d’organiser en son sein les militants issus de l’immigration coloniale et des quartiers populaires dans la perspective de constituer un instrument de lutte politique autonome, sur la base d’une problématique vertébrée par les questions du racisme, du colonialisme et de l’impérialisme. Il annonce la création d’un parti (le Parti des Indigènes de la République) et se propose d’être présent sur l’arène électorale. La porte-parole du MIR est Houria Bouteldja.
L’Appel des indigènes qui avait suscité de nombreuses controverses a déjà plus de quatre ans ; le Mouvement des Indigènes de la République (MIR) a été créé quelques mois plus tard. Où vous en êtes aujourd’hui du point de vue de votre démarche, notamment en ce qui concerne votre projet de construire un « parti politique des Indigènes » ?
L’Appel que nous avons lancé en janvier 2005 est le document fondateur du MIR et il demeure notre référence première. Depuis, nous avons effectivement précisé certaines questions, développé nos conceptions et entamé l’élaboration d’un véritable projet politique positif, qui ne soit pas uniquement de l’ordre de la contestation mais puisse être aussi un instrument de reconstruction politique du pays où nous vivons. Cela nous a amené à adopter un autre document important intitulé « Qui sommes-nous ? », à concevoir des propositions formulées à la veille des dernières présidentielles (« Elections : les exigences du MIR », L’Indigène de la république, n°3, janvier 2007) et à prendre de nombreuses positions sur différents événements politiques qui ont été autant d’occasions de préciser et d’élargir nos vues. Sans oublier les nombreuses contributions individuelles de nos militants ou de certains de nos amis. La plupart de ces textes sont disponibles sur notre site.
Cela étant, il n’y a pas de miracle. Un véritable programme et une stratégie, toutes choses indispensables pour qui ne fait pas de la politique politicienne, sont une œuvre collective ; ils ne se conçoivent pas en bibliothèque. Il faut encore avoir une insertion sociale réelle, se frotter durablement à la réalité des conflits, tester, essayer, expérimenter des orientations et, parfois, se casser la gueule ; il faut aussi que puissent s’engager de longs débats y compris avec ceux qui ne partagent pas nos vues ; il faut un organe d’accumulation, de sédimentation et de synthèse de ces multiples efforts. En bref, il faut un parti ! Pour l’heure, nous avons un cadre problématique qui permet de concevoir des solutions, un minimum d’expérience et une volonté certaine de penser par nous-mêmes. Comme Luther King – mais certainement pas comme Obama – nous avons un rêve. Le rêve d’un monde sans impérialisme, sans colonialisme, sans racisme. Nous avons une ambition collective en tant qu’héritiers de la colonisation, qu’immigrés ou enfants de l’immigration, l’ambition d’être partie prenante du gouvernement de la France, de participer à la détermination de ses choix politiques, d’agir sur son présent et son avenir, à partir de la base mais aussi des plus hautes instances de décision de l’Etat. En bref, nous ne voulons plus être en dehors de la politique, nous ne voulons plus qu’on décide à notre place, nous voulons participer au pouvoir pour engager ce pays dans une politique décoloniale.
Notre projet n’est pas de constituer un lobby mais un mouvement populaire de mobilisation. La participation aux instances de pouvoir est en effet un leurre si elle ne s’appuie pas sur un véritable rapport de forces ancré dans les résistances. Autrement dit, nous ne sommes pas là pour faire pression, ni pour pleurer, ni pour nous indigner ni seulement pour protester. Nous n’avons pas le complexe de ceux qui pensent n’avoir aucun droit sur la France, ni le sentiment d’impuissance de ceux que paralysent la crainte de la « récupération » ou qui se considèrent comme les victimes de quelques complots machiavéliques fomentés contre nous par des forces obscures. Nous ne sommes pas non plus des isolationnistes désespérés pour lesquels tout est fichu et qui tissent avec aigreur leurs cocons ou leurs « entre-nous », s’excluant ainsi eux-mêmes de la politique. L’autonomie n’est pas le séparatisme ; elle est construction d’un rapport de forces. Nous ne sommes ni maximalistes ni ultimatistes mais nous ne ferons pas la danse du ventre pour plaire. Nous sommes conscients cependant que la réalisation de nos rêves ne se fera pas d’un seul coup, qu’il faudra de nombreuses batailles, des transitions, des réformes intermédiaires, une évolution des rapports de forces philosophiques, moraux, culturels et politiques. Nous savons que l’émergence d’une majorité politique décoloniale impliquera de profondes recompositions du champ politique, qu’elle devra s’enraciner dans de larges couches populaires malgré les contradictions qui les traversent et qui nous traversent. Mais nous sommes convaincus aussi qu’un tel changement ne pourra se réaliser sans notre volonté indépendante, c’est-à-dire sans notre propre parti, un parti qui représente l’ensemble des populations indigénisées, un parti au sein duquel nous serons maîtres de notre propre pensée, de nos priorités politiques, de nos alliances, de notre « agenda » comme on dit maintenant. C’est à sa construction que nous nous attelons depuis la Marche des indigènes du 8 mai 2008 dont la banderole de tête proclamait précisément : « Prenons le parti de nous-mêmes ».
Sous une forme ou sous une autre, nous essayerons, de ce même point de vue, d’être présents lors des principales échéances électorales qui viennent. Nous ne serons pas prêts pour les régionales mais aux municipales, dans certaines communes, il faudra sans doute compter sur nous. Nous nous orienterons probablement vers la constitution de listes indigènes autonomes là où ce sera possible. Nous réfléchissons également aux législatives et aux présidentielles.
Ce choix de construire un parti « à soi » sonne en partie comme un désaveu des organisations politiques de gauche et d’extrême gauche vers lesquelles se sont pendant longtemps tournées les populations immigrées et leurs enfants. Comment expliques-tu que vous n’y ayez pas trouvé votre place ? Ou peut-être cette façon de penser la politique, par l’ « intégration » aux partis existants, est-elle encore trop dogmatique et marquée d’une certaine acceptation du monde « blanc »….
J’ai déjà évoqué certains éléments de réponse mais pour réagir plus directement à ta question, je dirais d’abord que c’est de l’ensemble du système politique que les non-blancs sont exclus et que cette exclusion est la principale incarnation du néo-indigénat. J’ajoute que cette exclusion, si elle recoupe la minorisation politique des couches économiquement défavorisées, ne s’y réduit pas et procède d’une autre logique qui est celle, justement, que nous analysons comme raciale. Pour ce qui est des partis, nous sommes bien obligés de faire le constat que des générations de militants de l’immigration ont tenté d’y agir sans résultat. Au contraire, les grands partis, de droite comme de gauche, ont mené des politiques qui allaient de plus en plus à l’encontre de nos intérêts. Quant aux organisations plus petites, à gauche, elles n’ont jamais considéré que nos préoccupations méritaient d’occuper une place centrale dans leur intervention. Il est significatif par ailleurs que dans aucune des formations politiques existantes, les populations issues de l’immigration coloniale ne sont représentées en proportion de leur réalité sociale pour ne pas parler de leur quasi absence des organes de direction. Et s’il y a, aujourd’hui, une très légère amélioration, bien ambivalente à vrai dire, il faut sans doute la rapporter à l’influence de la révolte des banlieues et, plus récemment, à l’« effet Obama ». Comment, dans cette situation, nous sentir représentés par ces partis ? C’est évidemment impossible. Tu as souligné que pendant longtemps les immigrés et leurs enfants se sont tournés vers la gauche et l’extrême-gauche mais, pour être plus précis, il faudrait dire que, pendant longtemps – et d’ailleurs, c’est encore le cas –, la majorité des immigrés d’origine coloniale et leurs enfants ont voté pour la gauche. Cela ne signifie aucunement qu’ils se reconnaissaient massivement dans la gauche et ses combats mais, plus prosaïquement, que la gauche leur a semblé un moindre mal ou, à tout le moins, ils ont pensé qu’elle ne mènerait pas les politiques racistes prônées par la droite. Ce qui s’est avéré également une illusion. D’ailleurs, depuis les dernières élections présidentielles, on a vu de nombreux français immigrés voter pour le Modem, tout simplement parce qu’ils ont constaté que sur les questions qui les intéressent en premier lieu, le PS ne faisait pas mieux que l’UMP et, tant qu’à faire, pourquoi ne pas essayer le Modem ? En aucun cas, on ne peut imaginer qu’ils se sont sentis représentés par le Modem. L’incapacité de tous ces partis à nous représenter n’est pas seulement circonstancielle. Si leur politique ne tient compte de nos besoins que de manière occasionnelle, si nous n’y avons pas de place, c’est parce que, comme l’ensemble des institutions de ce pays, ils sont partie prenante du système racial. Ils se combattent mais participent tous, à des degrés divers et selon des modalités plus ou moins complexes, de la préservation du Privilège blanc. La structuration apparente du champ politique entre droite et gauche masque l’opposition raciale en même temps qu’elle contribue à la reproduire. Si nous voulons constituer un parti indigène, c’est justement pour déchirer ce voile, faire apparaître sur la scène publique cette autre conflictualité qu’est la question raciale. Si nous voulons constituer notre propre parti, c’est parce que ce qui fonde la politique proprement indigène, c’est l’oppression raciale. Et l’une de ses incarnations, c’est l’assimilationnisme républicain dont les partis existants sont également les instruments. En effet, ces partis sont peu ou prou conçus sur le modèle républicain : en leur sein, il n’y a officiellement que des individus ou des citoyens abstraits, atomisés, dépourvus de déterminations.
Dans une partie de la gauche, il est vrai, on a tenu compte du fait qu’un individu était en fait socialement déterminé de par sa place dans le procès de travail, d’où les différentes moutures de partis des travailleurs ou de la classe ouvrière, mais on a occulté cette puissante détermination sociale qu’est la position dans le procès de reproduction de ces groupes statutaires que j’appelle les races sociales et qui résultent de la hiérarchisation entre Blancs et non-Blancs produite par les différentes moutures coloniales mais aussi par les résistances qu’elle génère. Cette occultation conduit non seulement à ne pas concevoir le rôle de ces partis dans la préservation de la suprématie blanche mais également à ne pas intégrer en leur propre sein, dans leurs modalités mêmes de structuration, la réalité de collectifs sociaux ayant des attentes particulières en termes par exemple de culture, de rapport à l’histoire, à la nation, etc. Les partis blancs ne peuvent pas résoudre ce problème parce qu’ils sont forgés dans le moule républicain à la sauce jacobine, renforcé par la tradition assimilationniste coloniale. Dès que nous évoquons cette question, on nous balance à la figure le spectre du communautarisme à l’anglo-saxonne. Je ne crois pas que ce modèle soit intéressant pour nous – il n’y a qu’à voir l’ampleur des discriminations raciales en Grande Bretagne et aux Etats-Unis – mais, en tout état de cause, il me semble de plus en plus clair que le modèle républicain français doit être dépassé, bien sûr pas de le sens que suggère Sarkozy dans certains de ces discours. La question se pose pour nous dans la conception même du parti que nous voulons construire. Nous sommes conscients en effet que les indigènes, de par leurs histoires différentes mais aussi de par les politiques menées à leur encontre, sont eux-mêmes insérés de manière différenciée et hiérarchisée dans la société, ce qui pourrait se refléter au sein du parti que nous entendons construire. C’est pourquoi nous réfléchissons à une forme de parti qui tiendrait compte de ces différences, articulant dans son mode de fonctionnement, d’élaboration et de prises de décision, des espaces rassemblant tous les militants unis par leur condition d’indigène et des espaces organisant comme collectivités les différentes composantes du nouvel indigénat sur la base de leurs particularités historiques et culturelles revendiquées.
Qui dit parti dit projet politique concret et pas seulement l’affirmation d’un modèle de société idéale…
Effectivement, comme je l’ai dit, nous avons un rêve mais nous ne contentons pas de rêver. Nous savons que le processus sera long et heurté, qu’il nous faudra convaincre, contraindre, et souvent négocier. C’est le propre de l’action politique ; c’est encore plus le cas pour nous, qui constituons actuellement une minorité sociale. C’est pourquoi, je pense qu’il faudra nous appuyer sur une sorte de programme intermédiaire qui ne soit pas un répertoire de revendications immédiates de type « syndical indigène » mais qui esquisse les lignes directrices d’une démarche réformatrice susceptible d’entamer un processus décolonial, c’est-à-dire d’enrayer et de battre en brèche les logiques impériales et raciales de l’Etat et de la société française, tout en intégrant des demandes politiques autres que celles qui nous concernent spécifiquement, voire même qui tiendra compte des inquiétudes des « autres », les Blancs. Sans renoncer à nous-mêmes, il s’agira à travers ce programme intermédiaire de nous doter d’un outil évolutif, destiné à rassembler les indigènes et les habitants des quartiers populaires, souvent eux-mêmes indigénisés, à construire des liens de partenariat et de coopération, ponctuels ou durables, avec d’autres forces y compris blanches, à développer une stratégie de construction à long terme d’une majorité politique décoloniale, enracinée dans l’ensemble des catégories défavorisées de la population. En somme, il s’agira d’esquisser une démarche qui ne soit pas incantatoire mais capable d’impulser des consensus dynamiques – j’entends par là que conflits et consensus sont les deux faces d’une même pièce -, entraînant des cercles de plus en plus larges de la société française autour d’un projet décolonial. Nous savons que notre combat s’inscrit dans la durée mais nous n’avons pas peur du temps.
Pourrais-tu nous en dire plus sur le contenu de ce programme intermédiaire ?
Je peux faire bien sûr quelques remarques génériques mais elles ne feront sens que par leur traduction en propositions concrètes. Je voudrais dire, pour commencer, que les inégalités raciales sont produites par de multiples logiques sociales, culturelles, administratives et politiques, produites notamment par la colonisation et l’impérialisme ; par conséquent, une politique qui n’appréhenderait pas tous les niveaux où s’enracine ce racisme institutionnel serait nécessairement vouée à l’échec. Des mesures contre les discriminations au travail, pour ne prendre que cet exemple, n’aboutiraient pas sans une transformation des relations de citoyenneté au sein des entreprises, une réforme culturelle, une nouvelle approche de l’immigration, ou des révisions profondes de l’ordre républicain. Il faut donc effectivement un « Plan global » contre les inégalités raciales. Il faut penser des mécanismes qui enrayent les logiques racialisantes, des instances au niveau des autorités exécutives qui auraient la charge de veiller à leur application, de permettre leur déclinaison dans tous les secteurs de l’action publique mais également d’exercer un pouvoir de contrainte – et non pas seulement d’incitation – sur le secteur privé. Un tel plan devrait, entre autres choses, inclure l’enseignement. L’Ecole est en effet une institution fondamentale dans la construction de la conscience collective et de la nation. Il ne suffit pas d’introduire quelques lignes sur la mémoire de l’esclavage pour changer l’idée que les Français se font d’eux-mêmes et de la France. Pour bousculer l’européocentrisme blanc, il faudrait revoir de fond en comble les programmes d’enseignement dans les différentes matières. Plus généralement, c’est sur l’ensemble de la politique culturelle qu’il faut agir. Il y a aussi la politique de l’immigration, la question de la laïcité, les rapports avec les « Dom Tom », la politique internationale de la France notamment à l’égard de ses anciennes colonies ou de la question palestinienne. A tous ces niveaux, il y a des logiques qui créent du racisme.
Mais ce sur quoi je voudrais insister, ici, c’est sur la citoyenneté. Le système indigénal contemporain, c’est d’abord le déni de citoyenneté. Il est frappant de constater que dans tous les projets qui sont présentés officiellement, les instances chargées de négocier ou de contrôler l’application des mesures anti-discriminatoires sont celles-là mêmes qui à un degré ou un autre participent de la reproduction des inégalités raciales. Par exemple, que peut-on attendre d’une négociation entre les chefs d’entreprises et les syndicats majoritaires, eux-mêmes soucieux avant tout de défendre les privilèges des travailleurs blancs ? Il faudrait imaginer au contraire des dispositifs qui garantissent l’implication de ceux qui sont discriminés dans le contrôle des politiques publiques et du secteur privé. Pourquoi, par exemple, ne pas prévoir, dans les entreprises comme dans la fonction publique, le contrôle des recrutements, des promotions, de l’organisation du travail par des instances représentatives des salariés indigènes et des organisations anti-racistes ? On peut concevoir également des dispositifs similaires dans les organismes qui s’occupent des logements sociaux. Plus largement, il ne saurait y avoir de progrès dans la lutte contre le racisme institutionnel si ceux qui en sont les principales victimes sont exclus des sphères de contrôle, de décision et de conception. Ils doivent y être présents en toute autonomie. Tout cela pose évidemment la question de leur auto-organisation mais aussi le problème immense de leur représentation politique dans le champ institutionnel. Jusque-là, il a été posé seulement en termes d’intégration dans les partis blancs : comment faire pour ouvrir ces partis à la « diversité » ? Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne question. A mon avis, il y a des mesures à prendre pour faciliter l’accès des indigènes aux instances de représentation et d’autorité. On a parlé de scrutin proportionnel et ce serait effectivement une bonne chose. La reconnaissance de la citoyenneté des immigrés en est une autre. De nombreuses réformes qui iraient dans ce sens pourraient être mises en œuvre à tous les échelons de la société politique pour que celle-ci soit vraiment représentative des différentes composantes de la population. Nous présenterons celles qui nous paraissent les plus importantes. Mais il y a aussi une révision institutionnelle majeure à concevoir qui n’ira pas sans heurter les républicains orthodoxes. Elle viserait à donner véritablement corps au multiculturalisme. Il ne suffit pas de dire « oui, la France est multiculturelle » ; il faut aussi développer des dispositifs qui permettent aux minorités culturelles d’exister, dans l’Etat, en tant que corps collectifs et d’avoir réellement leurs mots à dire sur les questions qui les concernent plus particulièrement. Ainsi, les courants « régionalistes » ne se privent pas de demander des droits collectifs pour les minorités territoriales « anciennes » mais, bizarrement, ils n’envisagent pas qu’une telle revendication puisse être également légitime pour les nouvelles minorités indigènes. Dans cette perspective, il importera de définir aussi des dispositifs qui garantissent les droits individuels ; il n’est pas question en effet d’assigner qui que ce soit à une minorité contre son gré. L’ensemble de ces questions, évoquées ici en vrac, font naturellement partie du travail programmatique que nous avons entamé. Cela dit, il ne faut pas que ces réflexions soient portées uniquement par nous. Elles devraient être centrales dans l’agenda de tous ceux qui considèrent que l’impérialisme et le racisme ont engendré la barbarie et continueront de le faire.
Vous parlez de « lutte des races sociales », d’ « indigènes », de « colonisés de l’intérieur », d’un « nous » auxquels vous opposez un « vous », les « autres », les « non-indigènes », les « Blancs », les « souchiens », etc. Cette lecture des rapports sociaux en termes de catégories « identitaires » n’est-elle pas trop figée ? Ne craignez-vous pas que ces catégories n’interdisent les convergences autour de ce programme intermédiaire ?
Ce qui pourrait interdire de telles convergences, ce ne sont pas les catégories d’analyses ou le fait de nommer explicitement ce que l’on s’accorde généralement à taire, en l’occurrence le clivage racial qui traverse l’ensemble de la société française, couches populaires inclues. C’est le clivage racial lui-même, ce sont les privilèges souvent socio-économiques, toujours symboliques, culturels, politiques dont bénéficient les Blancs-européens-chrétiens, qui constituent l’obstacle réel à ces convergences. Quand nous parlons de races sociales, nous soulignons seulement que le colonialisme/impérialisme fabrique des groupes sociaux hiérarchisés selon qu’ils sont définis comme Blancs-européens-chrétiens ou non. En dehors de cette forme de domination mondialisée et des résistances qu’elle suscite, les races n’ont pas d’existence historique. Par conséquent, quand nous parlons d’indigènes, de Blancs ou de races sociales, il ne s’agit nullement de catégories identitaires, selon ton expression, mais d’un rapport social colonial. Mais les identités sont aussi des rapports sociaux dans leurs dimensions culturelles et symboliques et ces identités recouvrent souvent aujourd’hui des rapports sociaux de races. Il y a des identités dominantes et des identités écrasées qui, quoiqu’elles-mêmes le reflet partiel des identités dominantes, peuvent constituer des leviers de résistance à la domination. En tant que mouvement politique, cette question identitaire nous concerne donc du point de vue de notre combat décolonial. Et elle devrait concerner tous ceux qui se réclament de l’antiracisme et de l’anti-impérialisme. Tant que la gauche ne reconnaîtra pas la réalité des privilèges blancs – y compris sur le plan identitaire -, elle pourra lancer autant de « travailleurs français, immigrés, même patron, même combat », cela sera du vent et rien que du vent, ou, pire encore, une forme comme une autre de subordination des immigrés et de leurs enfants aux enjeux propres des travailleurs blancs. Déblayer le terrain pour de futures convergences exige donc d’abord de saisir le monde tel qu’il est, même si cela peut paraître désagréable à certains. C’est ce que nous essayons de faire. Sans négliger les autres fractures sociales, les catégories que nous utilisons cherchent à appréhender la vraie vie, sans les faux-semblants de l’idéologie républicaine. Que parfois nous schématisions à notre tour la situation ou que nous utilisions des formules trop crues aux yeux de certains, d’abord ça nous fait du bien, ensuite ça suscite un débat très utile. On l’a vu, par exemple, avec l’Appel des indigènes qui ne paraît plus du tout choquant après avoir soulevé de nombreuses controverses qui ont fini par intégrer la réflexion collective.
Penses-tu qu’une alliance soit un jour envisageable entre vous et des organisations de la gauche radicale ?
La question posée est, de manière plus générale, celles des rapports que nous pourrions établir avec d’autres formations politiques dans la perspective de constituer cette majorité décoloniale à laquelle nous aspirons. C’est un mouvement qui s’inscrit dans la durée et probablement dans un échiquier politique qui sera bien différent de celui que nous connaissons aujourd’hui. Sauf à penser selon une logique binaire, la réalité des conflictualités raciales ne rend pas absurde toute convergence. Malgré les oppositions réelles, il y a évidemment des intérêts communs entre les couches populaires blanches et les indigènes, qui pourraient permettre de négocier des alliances. C’est en tous cas le pari que nous faisons. Penser le contraire nous conduirait, d’ailleurs, à une impasse stratégique ; l’objectif d’une majorité politique décoloniale en France ne serait qu’une utopie de plus. Notre priorité aujourd’hui est néanmoins de rassembler les indigènes et de construire leur indépendance politique, et, quand le moment sera venu, je suppose que nous serons ouverts à toutes les forces qui respecteront notre autonomie et s’engageront dans une perspective décoloniale, pour de bon et non pas de manière intermittente. Nous n’avons pas d’a priori idéologique dans la manière d’envisager nos alliances éventuelles, sous forme de coopérations ponctuelles ou plus durable. Celles-ci sont déterminées par leur capacité à faire avancer notre combat. Nous ne demandons pas aux organisations de la gauche radicale qu’elles partagent nos grilles d’analyses. Nous savons pertinemment qu’un Blanc de gauche se vexe quand on lui fait remarquer que, pour nous, il fait partie des dominants. Ce que nous espérons, c’est un accord sur des propositions politiques, sur les luttes à mener, sur les réformes à engager. Ce que nous exigeons, c’est le respect de notre autonomie. Nous en sommes loin.
J’ajouterais qu’il peut y avoir disjonction entre les impératifs sur le court terme ou à l’échelle locale et les impératifs sur le long terme et sur le plan national. Prenons un exemple : les dites « statistiques ethniques » qui ont été l’objet de débats violents, au début de l’année 2009, lorsque Yazid Sabeg a été nommé Commissaire à la diversité. C’est un sujet de controverse qui ne recoupe pas le clivage droite/gauche. Un autre exemple : peut-on jeter la pierre aux électeurs issus de l’immigration qui, ici ou là, votent contre un candidat de gauche qui organise le jumelage de sa ville avec une ville israélienne ? Ou encore : tel maire communiste multiplie les manœuvres contre la construction d’une mosquée dans sa commune, croyez-vous qu’il est possible de dénoncer les électeurs musulmans qui voteraient en faveur du candidat de droite parce que lui s’engage à donner les autorisations pour la construction de cette mosquée ? Tous ces exemples illustrent à leurs niveaux que l’opposition droite/gauche ne recouvre pas, à l’heure actuelle, le clivage racial. Autrement dit, la gauche, même radicale, n’est pas, contrairement à ce qu’elle croit, synonyme d’antiracisme et il lui faudra bien changer si elle veut être considérée comme un partenaire crédible aux yeux des populations issues de la colonisation. Quant à nous, il est clair qu’un des enjeux majeurs de la formation d’un parti politique indigène, agissant à l’échelle nationale, sera de parvenir à combiner des impératifs multiples : ne plus être prisonniers de l’opposition droite/gauche, gagner la capacité de mener une politique indépendante mais aussi articuler les enjeux conjoncturels ou locaux avec nos perspectives décoloniales sur le long terme. Dans la durée, j’espère que les conditions seront réunies pour que nous puissions envisager un « tous ensemble » décolonial, capable de prendre le pouvoir puisque tel est le but d’un parti politique. Si la gauche radicale s’engage effectivement dans cette voix, tant mieux. Il lui faudra faire une véritable révolution culturelle et comprendre notamment l’importance que revêtent pour nous des questions qui à ses yeux ne sont que secondaires ou, pire, des diversions.
Il en va ainsi de la question de l’islam, en particulier, parce que je sais bien qu’elle fait mal. La gauche radicale se mobilisera-t-elle, avec nous, contre l’islamophobie, pour l’abrogation de la loi sur le voile et, plus généralement, pour que les musulmans puissent bénéficier de droits équivalents aux autres cultes ? Autre chose : la question de l’histoire ou de la mémoire. Pour nous, elle est fondamentale. Quand on a une histoire et a fortiori quand elle est dominante, on peut en faire le bilan voire la rejeter partiellement ou totalement comme référence identitaire ; quand on est privés d’histoire, comme c’est notre cas, que cette privation est une des formes de l’oppression subie, il faut d’abord la conquérir. Et le rôle de la gauche radicale, c’est de nous soutenir dans cette entreprise pas de dénoncer nos mythes réactionnaires. Le contrôle de l’histoire est, en effet, une question éminemment politique. Elle est au cœur de la constitution nationale française comme nation impériale et raciale. Je vais vous citer un passage d’un essai (« La diversité contre l’égalité », éd. Raison d’agir, 2009), typique des aveuglements de la gauche radicale. L’auteur, un américain dénommé Walter Benn Michaels qui ne se gêne pas, soit dit en passant, pour déformer nos thèses, s’appuie à moment donné sur un roman de Leslie Marmon Silko intitulé Almanac of the Dead. Celui-ci raconte l’histoire d’un communiste cubain qui ressemble beaucoup à la gauche radicale en France : « le Cubain passe son temps à leur expliquer qu’ils sont exploités et qu’ils devraient entrer en lutte contre le capitalisme ; les Indiens passent leur temps à lui expliquer que ce contre quoi ils veulent lutter, c’est le peuple blanc. Quand le marxiste se lance une fois de trop dans une diatribe sur les méfaits de la propriété privée, refusant de se taire pour les écouter lui parler de leur héritage (les massacres, les spoliations, l’assimilation forcée), ils le pendent pour « crimes contre leur histoire ».» Je vous le dis tout de suite : je suis du côté de l’Indien. Walter Benn Michaels est évidemment abasourdi par une telle ignominie. Pour lui, ces sauvages, envahis par des émotions irrationnelles qui refusent l’entendre la voie de la Raison et coupent le sifflet d’un valeureux communiste, sont des contre-révolutionnaires. Pour moi, le communiste agit comme un colonialiste de gauche. Et je reconnais que, bien souvent, j’ai eu envie de donner de grands coups sur la tête d’un militant d’extrême gauche qui s’évertuait à m’expliquer que mes revendications «identitaires » et « communautaristes », c’étaient du bidon, du concentré de réaction, et que je devais m’élever à l’universalité de la lutte des classes.
Pour concevoir des alliances solides et durables, il faudrait que la gauche radicale rompe avec son matérialisme froid qui l’empêche de comprendre le besoin – apparemment universel – d’histoire, d’identité, de spiritualité et de dignité, une dignité qui ne soit pas seulement la dignité de consommer. Plus grave, je crains que la gauche radicale ne saisisse pas non plus ce qui mobilise les classes populaires blanches. Les prolos français qui ont voté pour Sarkozy n’attendaient sûrement pas de lui qu’il augmente leurs salaires. Ils ont voté pour des « valeurs », quoiqu’on puisse penser de ces valeurs. Et à des valeurs, on n’oppose pas 1500 euros mais d’autres valeurs ; on oppose de la politique et de la culture. A la politique sarkozyenne de « l’identité nationale », on ne peut plus se contenter d’opposer un internationalisme universaliste et uniformisateur (et, de notre point de vue, très européocentriste). Il faut trouver d’autres réponses. Je suis convaincu que la présence désormais massive en France de populations opprimées culturellement peut aider à renouveler la réflexion sur ce sujet. Je crois vraiment que la gauche radicale a beaucoup à apprendre des mouvements indigènes parce que ceux-ci savent, de par le statut qui est le leur en tant que descendants de colonisés brisés dans leurs identités, que la politique ne peut se réduire à la question socio-économique.