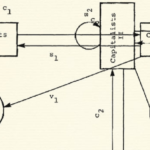Une nouvelle querelle des universaux ?
Alberto Toscano discute ici les thèses de l’ouvrage d’Étienne Balibar, Saeculum : culture, religion, idéologie. Il pointe les mérites du livre, notamment sa lecture complexe du débat sur l’universel et la religion, enrichie par les critiques anthropologiques du sécularisme. Toscano soutient en outre l’importance de considérer le capital comme quatrième terme essentiel de la triade culture, religion, idéologie.
Alberto Toscano enseigne la théorie sociale et la théorie critique au département de sociologie de la Goldsmith University de Londres. Il est l’auteur de The Theatre of Production: Philosophy and Individuation between Kant and Deleuze (2006) et de Le fanatisme, mode d’emploi (La Fabrique, 2011).
Le nouveau millénaire ne s’est pas montré jusqu’à présent très accueillant pour les partisans des Lumières radicales1. La séparation des autorités temporelles et spirituelles, le soupçon envers toute forme de piété, l’attitude profanatoire et jusqu’à l’athéisme lui-même sont désormais souvent revendiqués par les intellectuels organiques de l’impérialisme contemporain. Inversement, les intellectuels critiques sensibilisés à la question postcoloniale ont soumis les idéaux de la sécularisation aux effets corrosifs de la généalogie (foucaldienne) et de la déconstruction (derridienne)2. Le résultat est une convergence troublante et involontaire autour de la thèse qui fait du sécularisme une valeur occidentale – une valeur, du coup, bizarrement célébrée par les partisans d’une revendication de l’identité chrétienne et soupçonnée par beaucoup de ceux qui pensent qu’il est grand temps que l’Europe, la Chrétienté et l’Occident soit enfin provincialisés3.
Dans ce contexte, il est d’autant plus important de signaler l’originalité de l’entreprise d’Etienne Balibar. On sait qu’il fut un proche de Louis Althusser et un des rédacteurs de Lire le Capital (1965). On sait peut-être aussi qu’il rompit avec le Parti Communiste au tout début des années 1980 du fait notamment de son désaccord avec le Parti sur la question des étrangers. Il devint alors l’auteur d’une œuvre importante sur l’articulation entre les revendications d’universalité propres à la politique moderne et les questions de race, de classe et de genre4. Son opposition à toute instrumentalisation de l’universalisme pour reconduire des inégalités de classe, de genre ou de race ne fait aucun doute. Or, dans un ouvrage récent, intitulé Saeculum, Culture, religion, idéologie, publié en 20125, Balibar semble poursuivre cette réflexion, mais cette fois à propos du problème de la sécularisation. Nous voudrions livrer quelques réflexions sur cet ouvrage important, qui nous conduit au cœur des enjeux contemporains du débat sur la sécularisation.
I. Prendre au sérieux la sécularisation
Dans Saeculum, Balibar revient d’abord sur les débats autour de la question de la laïcité qui ont accompagnés le vote de la loi de 2004 interdisant le voile islamique (ainsi que tout autre « signe ostentatoire ») à l’école, débats qui continuent de diviser l’opinion « progressiste » en France d’une manière qui n’a aucun équivalent dans les autres pays européens. Balibar soutient avec conviction qu’une loi qui vise exclusivement les femmes, représentées comme les victimes principales de l’oppression religieuse, pour les contraindre soit à se dévoiler soit à sortir du système d’éducation publique, ne peut pas avoir « le moindre effet libérateur, la moindre valeur éducative ». Les jeunes femmes musulmanes visées par la loi ne sont alors en effet guère considérées comme des citoyens-sujets : leur pleine citoyenneté, autrement dit l’hypothèse de leur égale liberté, est conditionnelle, elle dépend de leur assujettissement préalable à un modèle imposé de liberté et d’égalité.
Pourtant, Balibar ne reconduit pas le discours typique de la gauche critique, « postcoloniale » et anti-républicaine. Ces considérations sont en effet développées dans une section consacrée à la critique des thèses que l’historienne américaine Joan Wallach Scott a exposées dans son livre The Politics of the Veil, livre qui, au demeurant, n’a jamais été traduit en français6. Bien qu’il admette l’incidence d’un héritage colonial et raciste sur les décisions de l’Etat français, Balibar n’accepte pas ce qu’il perçoit comme une réduction injustifiée de la laïcité à une logique postcoloniale, un refus qui se manifeste aussi dans sa critique très nette de la généalogie de la sécularisation proposée par Talal Asad7.
Les deux points principaux de cette critique méritent qu’on s’y arrête. Le premier est qu’en se focalisant sur l’idée d’une sorte de convergence entre la laïcité et l’exposition des corps féminins au marché et au spectacle (d’une manière qui fait écho à l’intervention cinglante d’Alain Badiou dans ce débat8), la critique de Joan Scott écrase sans autre forme de procès deux universalismes bien distincts l’un sur l’autre : celui de l’égalité devant la loi et celui de l’équivalence marchande. La relative harmonie fonctionnelle entre la loi et le marché n’est pas une donnée évidente. Le second point concerne le diagnostic porté par Joan Scott sur la mesure de 2004, dans laquelle elle voit un signe du refus, par la laïcité républicaine, de toute tentative de faire de la différence sexuelle un problème politique et sa juxtaposition à une « psychologie de la reconnaissance » musulmane. Balibar dénonce chez Scott une « extraordinaire cécité sur la façon dont un ordre social à la fois patriarcal et monothéiste investit la sexualité et la différence des sexes d’une fonction symbolique à l’efficacité redoutable pour la reproduction de ses propres structures de pouvoir ». Ce passage, qualifié par une longue note reconnaissant le caractère profondément équivoque des usages et des significations « du » « Voile », se prolonge dans une réflexion sur le double bind imposé aux femmes, dont les corps sont objets de stratégie de pouvoir de groupes « phallocratiques » concurrents (quoique non symétriques), alors que leur subjectivité ou leur résistance ne suscite aucun intérêt.
Une comparaison avec les passages concernés dans le livre de Scott montre que la polémique est quelque peu forcée et que peut-être la critique par Balibar de la forme française du sécularisme aurait gagné à discuter plus précisément l’idée de Scott selon laquelle la « préservation d’une notion mythique de la « France » est une force structurante de ces affaires du foulard ». Mais peu importe. Car la critique de Scott est caractéristique de l’inspiration de ce livre. Il s’agit de compliquer le débat sur le sécuralisme. Balibar met en avant, à travers tout le livre, l’idée d’une contradiction infinie travaillant un certain nombre de couples dialectiques qu’il multiplie : il y a celui des deux universalismes de l’État et celui du marché, mais aussi le problème du rapport à la fois solidaire et instable entre le cosmopolitisme et le sécularisme, celui de la complémentarité compétitive entre la religion et la culture, mais aussi de la sacralisation paradoxale de la sécularisation elle-même, du déplacement de la frontière du privé et du public, etc. Cette dialectique sans filet se tient toujours au bord de l’aporie, de l’antinomie ou du « différend » (au sens de Jean-François Lyotard), notions au demeurant fréquentes dans l’œuvre de Balibar. Mais l’intervention théorique autour du voile signale aussi la centralité de la notion de différence anthropologique pour cette réflexion, et, corrélativement, la thèse, centrale dans ce livre, qu’une perspective résolument philosophique peut permettre d’aller au-delà des lieux communs disciplinaires et des verrous politiques qui ont grevé le débat sur la sécularisation.
Dans Saeculum, la philosophie devient le nom de ce qui permet de traverser les oppositions conceptuelles et pratiques figées dans une perspective universalisante – une sorte de médiateur évanouissant dans la continuité de l’essai de Fredric Jameson sur Max Weber9. Certes, sous différentes formes (du problème de la « citoyenneté transnationale » à celui de ce qu’il a appelé « l’égaliberté ») l’universalisme aura été l’une des préoccupations constantes du travail de Balibar lors des trente dernières années. Et assurément, la sécularisation (Balibar préfère nommément ce terme à celui de laïcité, pour des raisons à la fois philosophiques et politiques) est un lieu privilégié pour prolonger ces questions. Surtout parce que, comme il le note dans une des rares thèses tout à fait affirmatives de ce livre, l’enjeu n’est pas (contrairement à ce que soutiennent certains partisans de la laïcité) un conflit entre l’universalisme d’un État et le particularisme d’une religion, mais bien un conflit d’universalismes, qui par définition est potentiellement insoluble.
Mais comment le philosophe, ici clairement installé du côté des politiques d’émancipation démocratique, pourrait-il ne pas se laisser enrôlée dans l’un ou l’autre de ces camps, celui de l’État ou celui de la religion ? Ici Balibar use d’un idéal régulateur qu’on pourrait appeler celui d’un universalisme réflexif ou récursif. Il s’exprime à travers ce slogan : il faut « démocratiser la démocratie » ou « séculariser la sécularisation ». Ce slogan ensemble structure les propositions de Balibar et pourrait se résumer dans l’expression : « universaliser l’universalisme ». Partir d’une contradiction et s’efforcer de la faire jouer pour mettre en œuvre un processus d’universalisation plus grand, quoiqu’inévitablement partiel et incomplet – tel est le geste fondamental proposé par ce livre comme il l’a été déployé par Balibar ailleurs.
II. Religion, culture, idéologie
Si, comme Balibar le soutient, la sécularisation se doit d’avoir une dimension cosmopolitique qui l’empêche de se territorialiser sur l’État-Nation, de même qu’inversement une perspective cosmopolitique va forcément avec une forme de sécularisation, il n’y en a pas moins des limites à ce mouvement, des limites qui ne tiennent pas à la persistance des particularismes, aux vecteurs contradictoires de l’universalité elle-même, celle-ci ne pouvant pas être rendue cohérente de manière non problématique. Sous-jacente à cette dialectique des universalismes se trouve une réponse aux critiques du sécularisme telles que Talal Asad ou Gil Anidjar10, pour qui il est indissociable de l’histoire impériale de l’Occident. Bien qu’il ne récuse pas les liens entre l’universalisme et la domination, Balibar semble croire qu’il est possible de déprovincialiser les Lumières (et peut-être même de les décoloniser), non pas au sens d’un état achevé que l’on pourrait atteindre, mais plutôt au sens d’un perpétuel travail d’auto-critique qu’il est toujours requis d’engager.
L’essentiel de Saeculum est consacré à l’opposition qui structure le débat sur la sécularisation : celle de la religion et de la culture. Balibar recense d’abord les différentes variantes de la thèse selon laquelle la notion même de « religion » est un faux universel – une imposition de la « mondialatinisation » sur des traditions incommensurables (comme le soutint Derrida), une catégorie sous laquelle l’Occident Chrétien a subsumé tous ses autres (Asad), un écran oblitérant la véritable catégorie universelle, celle de communion (Régis Debray). Pour sa part, cependant, il refuse d’abandonner ou de relativiser cette catégorie. Il semble avoir deux raisons pour cela. D’abord, la confusion de la religion (ou de la sécularisation, comme chez Anidjar) avec l’Occident chrétien serait une manière insoutenable de figer l’universalité contradictoire de la notion, mettant ainsi les paladins d’une Europe chrétienne en accord profond avec leurs critiques postcoloniaux. L’Occident chrétien n’est pas un code univoque : il peut être troublé en se mettant à penser au prisme du caractère contesté des « régimes de traduction au moyen desquels les sujets collectifs se représentent les uns pour les autres ». Par ailleurs, provincialiser ou historiciser la catégorie de « religion » sans autre forme de procès entraînerait qu’il y ait un autre code qui serve de plateforme pour déconstruire le pouvoir du premier. La critique anthropologique, du moins celle qu’offre Talal Asad, suggèrerait que cet autre code est celui de la culture ou de la tradition. L’universalité qu’on a critiqué d’un côté reviendrait donc de l’autre : la catégorie de religion ne serait pas valide universellement, mais celle de culture oui. A-t-on vraiment gagné en termes de « déconstruction » des universaux ?
Balibar soutient donc qu’il y a un reste nécessaire à la réduction de la religion à la culture. Mais il y a aussi un reste, inversement, à la subsomption de la culture sous la religion, et Balibar veut aussi le mettre en évidence, associant à chacun de ces deux échecs les noms de Clifford Geertz pour le premier et de Max Weber pour le second. Ce sont des passages très denses et elliptiques, qui témoignent d’une érudition et d’une profondeur de vue remarquables, les nombreuses notes donnant une idée de l’ampleur des débats sous-jacents. Le geste de défamiliarisation qu’opère Balibar peut sembler assez familier à certains d’entre nous : plutôt que de choisir entre un camp ou un autre, nous devrions insister sur la différence entre ces deux catégories, religion et culture, et nous appuyer sur cette solidarité différentielle pour éclairer les conflits et chicanes de l’universalisme. Mais l’excès mutuel de ces catégories, leur interférence, qui pourrait tourner en une sorte de petit jeu verbal qui reviendrait à déconstruire Weber à laide de Geertz et vice-versa, ne constitue pas le dernier mot du propos de Balibar.
Religion et culture ont en effet quelque chose en commun, qui est leur objet, autrement dit « l’homme », ou plus précisément la différence anthropologique. Il faut comprendre ce terme comme désignant l’ensemble de ces différences qui ne peuvent être ni évitées ni stabilisées une fois pour toutes, et par lesquelles la possibilité même d’un sujet se définit, ainsi la différence entre l’humain et l’animal, entre le normal et le pathologique mais aussi la différence des sexes (seuls les hommes peuvent être des sujets à part entière, etc.). La différence anthropologique est une sorte de réel au sujet duquel religion et culture ne peuvent apporter que des réponses temporaires, bien que leur forme puisse être péremptoire (ceci est un homme, cela est une femme). A la lumière de sa controverse avec Scott sur la politique du voile, il est curieux que Balibar n’accorde pas beaucoup d’attention à la race comme une forme cruciale de différence anthropologique qui a eu un impact décisif sur le débat autour de la sécularisation selon des modalités à la fois évidentes et subreptices.
Il faut aussi noter que ce recours, par Balibar, au vocabulaire de l’anthropologique n’est pas, contrairement à ce qu’on trouve chez Virno et Agamben, le recours à quelque chose de l’ordre de la potentialité : il est bien moins confortablement ontologique et signale plutôt que l’humain est toujours sur– et sous-déterminé. Dans leur effort pour déterminer l’indéterminé, démarquer le trouble, religion et culture ne sont pas symétriques. Balibar avance une hypothèse « allégorique » : alors que la culture se rapporte à la différence anthropologique pour la réguler, la religion s’y rapporte pour la révolutionner. Conjointement, elles contribuent à « l’institution historique de l’inhumain ». Mais là où les formes de vie au sein desquelles une culture se développe semblent exiger des éléments nécessairement non-généralisables et même plastiques, la religion est l’opérateur d’une sorte d’abstraction qui peut, en fonction des situations, rigidifier ou radicaliser les éléments dans la culture, tout à fait comme elle peut, et cela est crucial pour les réflexions sur le cosmopolitisme contemporain, voyager avec beaucoup de facilité.
Mais Balibar fait bien plus que déstabiliser chaque pôle de cette dualité culture/religion. Comme le sous-titre du livre l’annonce, il y a un tiers terme, qui est celui d’idéologie. Que Balibar revienne à ce motif althussérien est en soi peu surprenant. La théorie de l’idéologie est si solidaire de la critique de la religion et même de la critique religieuse (il suffit de songer aux disputes théologiques autour de l’iconoclasme et de l’idolâtrie) pour que sa pertinence dans le débat sur la sécularisation devienne évident. Mais bien que des échos althussériens demeurent dans son discours, Balibar n’approche pas le sujet en « matérialiste historique » de pure orthodoxie. Le recours à l’idéologie est fondé sur la double irréductibilité de la religion à la culture et de la culture à la religion, aussi bien que sur l’impératif de pointer, au-delà de ces disputes conceptuelles, à un « réel » du débat sur la sécularisation – un réel qui a déjà été partiellement nommé « différence anthropologique ».
Cette thèse étaye plus solidement l’idée qu’il n’y a rien de tel qu’un conflit purement religieux, non plus qu’un pur conflit des civilisations. Balibar avance une curieuse formule pour désigner cet étrange excès sur la religion et sur la culture, qui est aussi un déficit structurel au cœur de la notion d’idéologie. Cette formule est la suivante : Culture + Religion +/- x = Idéologie. Mais qu’est-ce que x ? En s’en tenant aux seules formulations proprement philosophiques, Balibar dresse une liste de termes qui viennent remplir la variable : la production (pour les marxistes), le pouvoir (pour les foucaldiens), la domination (pour les wébériens), la pratique (pour les bourdieusiens), le réel (pour les lacaniens)… Mais peut-on se permettre d’être aussi éclectique ?
III. Capital = x ?
Je crois que le contexte même du problème cosmopolitique posé par Balibar, tout comme celui du conflit des universalismes à la fois à l’intérieur, contre et au-delà de l’État-Nation, nous suggère de répondre par la négative. Après tout, il est difficile de nier que les crises et les mutations du capitalisme planétaire (et de l’impérialisme, un concept et une réalité qui est d’ailleurs malheureusement absente ici) constituent un facteur critique pour les problèmes abordés dans Saeculum. Balibar lui-même observe que le lieu du problème du sécularisme est cette « transition » interminable connue sous le nom de « mondialisation », dans laquelle l’universalité extensive, qui concerne la communication entre les êtres humains au sein d’un même espace institutionnel, n’est plus séparable de l’universalité intensive, « relative à l’égalité, c’est-à-dire à la non-discrimination et à la non-hiérarchisation des individus et des communautés dans lesquelles ils vivent ». Derrière le problème du cosmopolitique et du séculier, nous pouvons percevoir le conflit entre la logique de l’équivalence marchande et les poussées égalitaristes portées par le genre de politique démocratique que Balibar soutient, ainsi que la multiplication des différences suscitée par l’un et par l’autre.
Assurément, si à la fois la religion et la culture sont supposées constituer des réponses symboliques qui permettent de s’adapter à l’incertitude fondamentale de la « différence anthropologique », une telle situation ne peut que s’intensifier sous la pression du caractère de plus en plus clairement « dépossessif » du capitalisme contemporain. Ici, nous pourrions compléter l’enquête de Balibar en regardant plus attentivement la manière dont les conjonctures de crise ont historiquement fourni et continuent de fournir le contexte des conflits entre les universalismes incompatibles. La modernité et le millénarisme, comme Hobsbawm et Worsley le signalèrent il y a de cela un demi-siècle déjà11, sont bien plus étroitement intriqués qu’on pourrait le supposer d’abord. L’idéologie, comme Balibar lui-même l’expliqua dans les années 1960 et 1970, est aussi un domaine de la reproduction sociale et il pourrait donc être intéressant de ne pas en rester à l’idée d’une efficacité symbolique de la religion et de la culture comme codes concurrents et incompatibles nécessaires pour gérer le problème de la différence anthropologique, et de s’intéresser aux raisons matérielles du « retour » des affiliations religieuses et culturelles dans un contexte où les modes de socialisation jadis portés par les Etats sont en train de disparaître.
Cette question de la reproduction, avec celle de la spécificité de l’abstraction capitaliste, que Balibar mentionne à plusieurs moments dans son texte, y compris dans la critique de Scott, ne devrait pas avoir seulement une dimension sociologique : elle doit avoir une dimension politique. A la question, laissée pendante par Balibar, de savoir s’il faut faire une place à une sorte d’universalité marchande qui ne soit pas l’universalité du citoyen-bourgeois, la réponse doit être oui. Nous devrions donc voir, dans la variable x de la formule de Balibar, tout simplement le capital (non en tant que production mais en tant que totalité sociale).
Cette hypothèse, cependant, n’a d’intérêt que si elle permet de compliquer et non pas de simplifier le problème. Elle le fait en nous incitant à réfléchir à la dialectique du global et du national, plus précisément à la manière dont un certain sécularisme a servi de vecteur de reterritorialisation défensive de l’État et a nourri, en Europe, un discours racial-civilisationnel qui tente de compenser l’érosion de la souveraineté populaire en déplaçant toutes les inquiétudes vers « l’immigré ». Compliquer le problème voudrait dire aussi « universaliser » le problème du sécularisme lui-même. L’arrangement confessionnel fragile du Liban, dans lequel Balibar présenta les premières réflexions qui sont reprises dans ce livre, suffirait à nous encourager à ne pas nous précipiter pour croire que les catégories de la philosophie politique européenne suffisent à donner un sens à ce terme. Comme Raz-Krakotzkin l’a récemment théorisé, à propos de histoire intellectuelle du sionisme fort percutante, la division en « séculier » et du « religieux » renvoie à la situation proprement européenne d’enchevêtrement de la religion, de la culture, de l’ethnos et de l’État – une situation qu’il résume d’une phrase provoquante : « Dieu n’existe pas, mais il nous a donné la terre ! » Les conflits intenses qui entourent les politiques de sécularisation en Inde pourrait compliquer encore ce tableau, projetant le problème au-delà des histoires croisées des monothéismes et de l’État.
IV. La philosophie, hérésie généralisée
Comme il a été dit d’emblée, l’intervention de Balibar se veut clairement philosophique. La tâche de la philosophie, selon lui, est non seulement de compliquer dialectiquement les démarcations conceptuelles qui sous-tendent notre bon sens politique ordinaire, mais aussi de fonctionner comme un agent d’universalisation. Contrairement aux processus d’universalisation portés par le sécularisme d’État et l’observance religieuse, celui de la philosophie ne saurait procéder par subsomption, intégrant les particularités dans une communauté spirituelle ou les neutralisant sous son « indifférence » souveraine. Il ne peut pas s’allier non plus avec l’universalité de la forme-valeur capitaliste. Prolongeant l’approche défendue à travers tout le livre, qui consiste à mobiliser les sémantiques différentielles des concepts pour jouer avec leurs contradictions, débordements, manques, et pointer ainsi vers une universalité plus expansive, quoique sans doute plus précaire – Balibar accomplit un repositionnement de la philosophie au cœur du conflit des universalismes, comme une sorte de médiateur évanouissant ou de supplément a-religieux qui autoriserait ce qu’il nomme, dans un appel éclatant à Spinoza, une hérésie généralisée. La référence à Spinoza renvoie aussi l’aspiration à une sécularisation qui soit en même temps de nature transformative et émancipatoire, capable de dépasser l’absolutisation de la souveraineté qui caractérise le sécularisme hobbesien tout autant que la tolérance régulatrice des modèles issus de Locke (encore que Balibar conserve une préférence pour la variante libérale de ce dernier, sur la variante républicaine-française du Léviathan). Ce sécularisme auto-critique n’est pas seulement en opposition aux tendances coercitives de l’État ; il est indiscernable d’une définition prescriptive de la philosophie elle-même.
Si l’on se donne une vue panoramique du champ de la philosophie européenne contemporaine, il ne fait aucun doute que la « sécularisation de la sécularisation » y apparaît comme un projet interminable. Il y a une ironie dialectique dans les catégories religieuses, capables de se revivre dans leurs contraires, et les philosophes contemporains semblent avoir plus ou moins mélancoliquement accepté que nous ne dépasserons jamais les catégories religieuses non plus que les pratiques religieuses, qu’elles ne cesseront jamais de nous hanter, fût-ce sous leur contraire. Il peut être tentant, alors, de compliquer l’intervention de Balibar en se demandant si l’athéisme philosophique – une position tout à fait absente de tout ce dont nous avons parlé jusqu’à présent – peut bien être réduit à une « hérésie », et s’il ne dépend pas d’un présupposé profondément douteux quant à la continuité des contenus religieux à travers les diverses formes conceptuelles qu’ils ont pris à travers le temps. Ayant recours à une notion d’idéologie assurément moins sophistiquée que celle de Balibar, peut-être pourrions-nous soutenir qu’une bonne partie de ce que la philosophie représente généreusement comme des « conflits d’universalismes » pourrait bien n’être que des luttes d’intérêts particuliers formulés dans un vocabulaire universaliste, ou des projets dont l’universalité extensive pourrait bien finalement être totalement dépourvue de l’universalité intensive que Balibar associe à la notion d’émancipation. De ce point de vue, la formule de l’idéologie proposée par Balibar de manière si éclairante pourrait être accompagnée de la conscience que les idéologies religieuses et étatiques sont aussi, de manière endémique, des formes de manipulation, de domination et d’hypocrisie.
La méfiance bien légitime de Balibar envers toute philosophie qui prétendrait parler du point de vue de l’universel, avec une souveraine indifférence aux différences, similaire à celle de l’État, ne devrait pas nous empêcher de réfléchir à la manière dont une forme de radicalisme philosophique, celui qui va de Spinoza à Marx et au-delà, peut signifier une rupture avec les prétentions universalisantes de la religion et de la culture. Alors que le débat sur la sécularisation souvent reconnaît les pressions que le capital exerce sur les croyances, il reconnaît bien moins (et cela est vrai de Saeculum) le rôle qu’ont joué les défaites des « cosmopolitiques » socialistes et anti-coloniales dans le conflit des universalismes qui oppose désormais d’un côté les États capitalistes parlementaires et de l’autre les mouvements religieux. Les objections de Balibar à la critique anthropologique de la sécularisation devrait de ce point de vue être complétées par une mise en lumière du caractère politiquement insoutenable de l’idée selon laquelle le sécularisme est en soi une idée impérialiste – une idée qui méconnaîtrait profondément l’histoire des mouvements de libération communistes et nationaux de l’Inde à la Palestine.
L’appel par Balibar à une refondation critique du sécularisme mérite sans aucun doute toute notre attention, tant philosophique que politique. Mais que ses contreparties politiques puissent réellement prendre la forme de ce qu’il appelle une « citoyenneté transnationale » paraît plus incertain. Encore plus que la notion de sécularisation, celle de citoyenneté est liée à une certaine forme de transcendance de l’État, cette entité même dont Balibar conteste la capacité à contenir le problème de la religion et de la culture (autrement le problème de l’idéologie). Toute pratique d’émancipation qui romprait avec la dialectique mortifère de la religion et de la culture en même temps qu’avec la prétention de l’État à servir de régulateur impartial, devrait laisser de côté ces termes, tout en reprenant les problèmes qu’ils cristallisent. La politique aussi réclame des points d’hérésies.
Traduit par Patrice Maniglier
Nos contenus sont placés sous la licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 FR). Toute parution peut être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d’origine activée.
à voir aussi
références
| ⇧1 | L’expression « Lumières radicales » est due à l’historien des idées britannique Jonathan Israel, dans un livre qui a fait date, Les Lumières radicales, La philosophie, Spinoza et la naissance de la modernité (1650-1750), Paris, Amsterdam, 2005 (édition anglaise 2001). (NdT) |
|---|---|
| ⇧2 | Pour une histoire des liens entre le champ des études dites « postcoloniales » et la théorie dite parfois « post-structuraliste », on peut se rapporter au livre en anglais de Peter Hallward, Absolutely Postcolonial : Writing Between the Singular and the Specific, Manchester, Manchester University Press, 2002. (NdT) |
| ⇧3 | Il s’agit d’une référence à un livre marquant pour le champ de ces « études postcoloniales », le livre de Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe, Paris, Amsterdam, 2009 (édition anglaise 2000). |
| ⇧4 | Pour une introduction très rapide à l’œuvre d’Etienne Balibar on peut consulter la petite notice de Patrice Maniglier dans l’Encyclopaedia Universalis, « BALIBAR, Etienne (1942-) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le15 mai 2015. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/etienne-balibar/ et pour une discussion plus complète le numéro récent de la revue Raison Publique, « Pourquoi Balibar », Raison publique n°19, automne 2014. (NdT) |
| ⇧5 | Etienne Balibar, Saeculum, Religion, culture idéologie, Paris, Galilée, 2012. |
| ⇧6 | Joan Wallach Scott, The Politics of the Veil, Princeton, Princeton University Press,? 2007. |
| ⇧7 | Talal Asad, Formations of the Secular : Christianity, Islam, Modernity, Stanford, Stanford University Press, 2003. |
| ⇧8 | Voir Alain Badiou, « Derrière la Loi foulardière, la peur », Le Monde, édition du 22 février 2004. |
| ⇧9 | Fredric Jameson, « The Vanishing Mediator: Narrative Structure in Max Weber », New German Critique No. 1 (Winter, 1973), pp. 52-89. |
| ⇧10 | Gil Anidjar, « Secularism », Critical Inquiry 33 (2006), pp. 52-77. |
| ⇧11 | Eric J. Hobsbawm, Les primitifs de la révolte dans l’Europe moderne, Paris, Fayard, 2012 ; Peter Worsley, The Trumpet Shall Sound : A Study of ‘Cargo’ Cults in Melanesia, 2nd edition, New York, Schocken, 1988. |


![Marx, critique de l’économie politique [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/industrialization-factories-150x150.jpg)