
Argent et capital
L’économiste Laurent Baronian vient de publier en anglais Money and Capital, A critique of Monetary Thought, the Dollar and Post-Capitalism (Oxon, New York, Routledge Frontiers of Political Economy, 2023). Ce livre se propose de puiser dans les concepts de Marx sur la monnaie et le capital pour rendre compte de nouvelle manière des débats sur la pensée monétaire qui partagent toutes les familles d’économistes.
Il permet ensuite à l’auteur d’éclairer les contradictions qui traversent le système monétaire international à l’époque où le dollar a acquis le statut de monnaie internationale tout en prenant une relative autonomie par rapport à l’économie des États-Unis. C’est dire l’importance de ce livre au moment où le capitalisme est confronté à une crise multidimensionnelle, au point de remettre à l’ordre du jour la possibilité d’une société post-capitaliste.
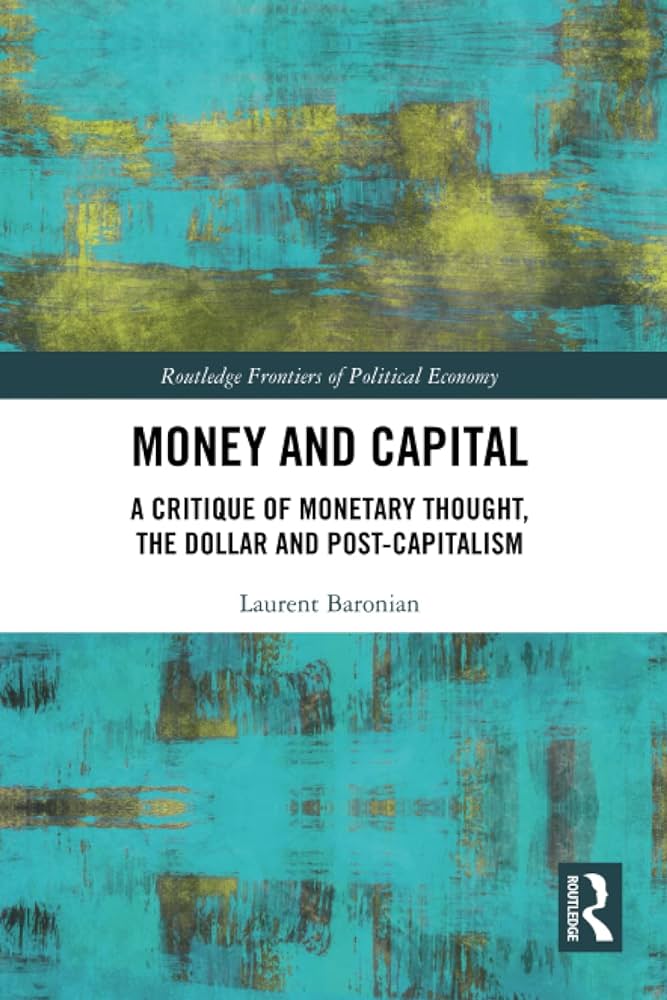
Ce livre, dont on ne cachera pas la difficulté tellement il est érudit et fourmille de références, mais dont l’intérêt est à cette mesure, est à la fois un livre de théorie et un livre d’histoire de la pensée monétaire en économie. Il est structuré en quatre parties : 1) Les modes d’existence de la monnaie ; 2) La critique de la pensée monétaire ; 3) La politique du dollar ; 4) Les politiques de la monnaie. C’est la première de ces quatre parties qui va donner le fil conducteur à toute la suite. Ce livre est d’une telle densité que nous ne pouvons en rapporter tous les éléments ; nous nous concentrons sur ceux qui nous paraissent essentiels.
Retour à Marx
En commençant par un rappel de la théorie de la monnaie de Marx, Laurent Baronian s’inscrit dans la lignée de Suzanne de Brunhoff qui, dans les années 1960-70, avait entrepris déjà de réhabiliter cette théorie dans un ouvrage (La monnaie chez Marx) qui avait fait date parmi les économistes qui, à l’époque, étaient encore influencés par la pensée marxiste et, au delà, se situaient dans un camp hétérodoxe.-.
Quel est le problème que voulait résoudre Marx ? Baronian explique :
« il consiste moins à démontrer que l’argent est une marchandise qu’à saisir le processus qui conduit une marchandise à devenir de l’argent » (p. 19)[1].
C’est le choix méthodologique de Marx d’avoir ouvert le Livre I de son Capital par l’analyse de la marchandise et de la monnaie. Et cela en faisant en ce départ abstraction de l’économie capitaliste pour ne regarder que le rapport marchand. De Brunhoff hier et Baronian aujourd’hui justifient ce choix méthodologique :
« Marx a commencé son étude de la production capitaliste par une analyse des marchandises, des échanges et de la circulation qui se réfère à la notion d’une production marchande vide de rapports sociaux déterminés : la monnaie apparait sans ses déterminations capitalistes »[2].
Pour Marx, il y a une nécessité logique de l’existence de la monnaie : c’est ce qu’il nomme la contrainte marchande, ou comme le dit Baronian :
« Lorsque nous disons que la valeur se manifeste dans la relation d’échange, […] cela signifie que le travail vivant des producteurs acquiert son caractère social par la médiation de l’échange des produits de ce travail. Il est donc nécessaire que le produit du travail en tant que marchandise soit échangé contre un produit du travail qui représente le caractère social du travail. » (p. 23).
On voit par là comment Marx relie le rôle que joue la monnaie pour que le caractère social du travail soit exprimé, c’est-à-dire que la théorie de la valeur-travail est une théorie de la validation sociale de la valeur par le biais de l’échange marchand. Voilà de quoi apporter une pierre supplémentaire à la réfutation des critiques idéologiques, et donc fausses, apportées à cette théorie de la valeur, aussi bien par l’école néoclassique depuis un siècle et demi que par l’école institutionnaliste aujourd’hui[3].
Armé de cette articulation entre valeur et monnaie, Marx peut alors explorer les fonctions habituellement distinguées par les économistes. Puisque la monnaie est l’équivalent général dans lequel doivent se convertir les marchandises pour valider leur existence en tant que produit du travail social, apparaît une division, sinon une contradiction entre deux « modes d’être » de la monnaie, c’est-à-dire
« entre la fonction de moyen d’échange général des marchandises et la fonction de réserve de valeur, ou entre la monnaie comme forme de l’échangeabilité générale et la monnaie comme forme générale de la valeur, et c’est à travers ce dernier mode d’être que la monnaie impose sa contrainte de marchandise » (p. 28).
En d’autres termes, écrit Baronian, en approuvant De Brunhoff :
« La monnaie comme équivalent général désigne donc à la fois le représentant général de toutes les valeurs et la contrainte monétaire qui pèse sur l’échange des valeurs. Cette contrainte est spécifique à toute économie de marché, irréductible au mode de production capitaliste, et continue à s’imposer comme telle dans les formes les plus abstraites et éthérées de la circulation monétaire. Ainsi, le double aspect de la contrainte monétaire – à la fois spécifique à l’économie capitaliste en tant qu’économie marchande et distincte de l’économie capitaliste en tant que capitaliste – explique le statut particulier de la première section du Capital : à la fois distincte des sections ultérieures et en même temps absolument indispensable à l’intelligibilité du reste de l’ouvrage. Non seulement Suzanne de Brunhoff explique ce statut particulier, mais elle le justifie, et elle fait en sorte qu’il projette son ombre sur toutes les parties ultérieures du Capital. » (p. 28).
La monnaie mesure les valeurs, et sa forme comme prix des marchandises est déduite de la genèse de l’équivalent général. C’est parce qu’elle circule qu’elle peut remplacer toutes les marchandises. Mais comme elle est aussi réserve de valeur, en tant qu’instrument de thésaurisation, elle est source de perturbation des échanges.
« Si la monnaie porte en elle sa transformation en capital, c’est-à-dire en valeur valorisée, c’est parce qu’elle surmonte ainsi la contradiction entre sa fonction de moyen général d’échange (forme d’échangeabilité générale) et sa fonction de réserve de valeur (forme générale de valeur). L’argent en tant que capital circule mais uniquement en vue de s’accumuler, de revenir à son point de départ en quantité accrue. De même, l’argent s’accumule, mais seulement pour revenir immédiatement dans la sphère de la circulation. C’est donc la tension résolue entre ses deux fonctions. Par le retour cyclique de la monnaie à son point de départ, sa fonction de moyen de circulation est mise au service de sa fonction d’accumulation privée de la richesse sociale sous sa forme générale. Inversement, cette accumulation sert prioritairement à accroître la production capitaliste et à développer la circulation des marchandises et se subordonne ainsi à la fonction sociale de l’argent comme moyen de circulation. » (p. 28).
Il s’ensuit un paradoxe : comme objet privé, la monnaie remplit sa fonction sociale de moyen d’échange, tandis que c’est en tant que forme de la richesse sociale qu’elle remplit sa fonction privée de réserve de valeur. Le paradoxe devient un paroxysme dans le capitalisme financier. En se référant à François Chesnais, Baronian écrit :
« La plus-value (le profit), en tant que résultat du mouvement spécifique du capital-argent, de l’argent comme capital, porte la contradiction de l’argent à un niveau supérieur, parce que le capital-argent inclut dans son concept la tendance à faire de l’argent avec de l’argent sans passer par toutes les phases de circulation qu’exige son processus de croissance, c’est-à-dire l’échange contre des marchandises et sa conversion en la seule marchandise dont la valeur d’usage consiste à créer de la valeur, à savoir la force de travail. C’est pourquoi l’argent-capital trouve sa forme finale et définitive dans le capital porteur d’intérêts, dans le capital-prêt, où la formule générale du capital, A-M-A′, se réduit à la formule épurée A-A′ pour le propriétaire de l’argent. Le fétichisme de l’argent-capital qu’il exprime trouve directement sa source dans le fait que l’argent semble résoudre dans son propre mouvement la tension immanente à l’argent lui-même entre ses deux attributs essentiels. Que l’argent comme capital et l’intérêt comme prix de l’argent résultent du développement de la nature même de la monnaie est illustré par le fait que l’usure et, plus généralement, le prêt à intérêt s’observent dans toutes les sociétés où il y a circulation monétaire. C’est lorsque la production sociale est soumise au métabolisme de l’argent et que celui-ci trouve dans la force de travail la source de sa croissance que les lois sur l’usure disparaissent. Sous le capitalisme, le prêt à intérêt surmonte les contradictions de l’argent mais en le soumettant aux lois de la valorisation du capital industriel. Ou plutôt, c’est en se soumettant aux exigences de la production capitaliste que le capital d’emprunt trouve les conditions de sa généralisation et donc que la monnaie surmonte les contradictions entre les différentes fonctions qu’elle remplit dans la simple circulation des marchandises. » (p. 29).
On retrouve alors l’opposition entre ce que Baronian nomme les deux modes d’être de la monnaie, car « la crise ne signifie donc rien d’autre que l’abolition des fonctions sociales de la monnaie circulante au profit de sa seule fonction privée de réserve de valeur » (p. 31).
Laurent Baronian pourra plus loin dans son livre comparer cette thèse marxiste de la monnaie à l’approche institutionnaliste bien représentée par Aglietta, Orléan ou Lordon. Pour ces derniers, la recherche de la monnaie exprime le besoin de liquidité : « Le processus de recherche n’est pas motivé par la nécessité pratique de surmonter le problème de la double coïncidence des besoins ou de réduire les coûts de transaction, mais par le désir de détenir une richesse liquide. Ce désir s’explique tantôt par une sorte de rivalité mimétique entre commerçants (Aglietta et Orléan, 1982), tantôt par la recherche de sécurité face à l’incertitude du marché (Aglietta et Orléan, 2002). Mais dans tous les cas, l’argent émerge d’un processus spontané et aléatoire qui s’inspire directement de Hayek comme « le but commun des efforts acharnés de chacun » (Lordon et Orléan, 2006 : 5).
C’est donc une théorie subjective de la valeur qui doit plus à Simmel qu’à Walras, l’échange ne résultant pas de l’utilité des marchandises mais de la vénération de la richesse par excellence, à savoir l’argent. Avant d’être un moyen de faciliter l’échange, la monnaie est l’institution par laquelle les biens ont de la valeur à condition qu’ils soient échangés contre elle. » (p. 82-83, je souligne JMH).Mais, rétorque Baronian, pour ces institutionnalistes, la valeur est égale à la monnaie ; or, « comme la monnaie, pour Aglietta et Orléan, émerge d’un processus de recherche qui elle-même passe par l’échange (2002 : 31), une relation quantitative entre les biens échangés doit être établie avant que la monnaie n’apparaisse, et cette relation est donc une relation de valeur.
Par ailleurs, la recherche de liquidité suppose que le commerçant puisse acquérir le bien liquide en échange de ses propres biens. Et pourquoi quelqu’un d’autre lui donnerait-il des liquidités, sinon pour satisfaire un besoin tout autre que le désir de posséder des liquidités ? » […] (p. 83).Et il conclut :« Pour Orléan, la monnaie est nécessaire car c’est la désirabilité absolue qui détermine la commensurabilité et l’échangeabilité des biens. Mais dans la mesure où il confond ainsi la valeur économique de la monnaie avec la valeur du désir de monnaie, les rapports d’échange restent quantitativement indéterminés. La genèse de l’argent n’est même pas une genèse de l’argent comme forme générale de valeur, mais comme simple forme de richesse abstraite.
Orléan ne veut pas de valeur sans argent, mais c’est une monnaie sans valeur fixe qui est engendrée par le désir universel de richesse pour elle-même, et donc, par conséquent, une monnaie sans valeur. Et dans un article cosigné avec un économiste d’inspiration spinoziste, il va jusqu’à reléguer le problème de la formation des prix, dans lequel la monnaie fonctionne comme unité de compte et moyen de circulation, à la théorie de la concurrence. Bien qu’ils nous assurent qu’il est « vain d’essayer de penser le prix comme l’expression d’une grandeur qui lui préexisterait et dont il ne serait que l’expression » (Lordon et Orléan, 2006 : 26-27), Lordon et Orléan se désintéressent de la question de « la forme marchande du pouvoir du conatus » au moment précis où, pour « persévérer dans leur être marchand » (2006 : 12), les « candidats-richesses » demandent : combien ? » (p. 84)[4].
Avant de clore ce retour à Marx, nous souhaitons poser deux questions à Laurent Baronian, puisque nous ne pouvons plus les poser au fondateur. Premièrement, celui-ci a eu raison d’analyser d’emblée le rapport marchand simple, logiquement (et pas seulement historiquement) en amont du rapport marchand capitaliste, et il a fait dériver la nécessité de la monnaie de ce rapport d’échange marchand. Mais comment rendre compatible la logique de cette contrainte marchande avec le fait que toutes les études anthropologiques et ethnographiques montrent l’existence de la monnaie dans les sociétés humaines en dehors de l’échange marchand proprement dit ?
Certes, à l’époque de Marx, ces études étaient encore fort peu développées. Mais n’y a-t-il pas là matière à relativiser le lien logique souligné par Marx ? Par exemple, l’anthropologue Alain Testart[5] indique deux éléments susceptibles de déporter partiellement le regard : premièrement, il atteste que le crédit a précédé la monnaie ; deuxièmement, il souligne la fonction de paiement de la monnaie qui ne doit pas être confondue avec celle de l’échange marchand, car il existe des paiements ne correspondant à aucun échange marchand (paiement pour avoir une épouse dans certaines sociétés primitives, paiement de l’impôt…). D’ailleurs, Baronian cite Testart, mais sans s’attarder à cet endroit sur le paiement distinct de l’échange :
« Comme le dit Testart, le crédit précède logiquement et historiquement la monnaie, et tant que la monnaie n’est pas inventée, l’économie reste prise dans le jeu des relations personnelles (Testart, 2001 : 48-49). Et on ne peut même pas dire qu’un système de crédit pur est nécessairement plus limité qu’un système de crédit monétaire. Là encore, il s’agit d’une différence de nature et non de forme. Dans les sociétés égalitaires, la dette n’est pas une forme d’échange, c’est une unité d’alliance (Deleuze et Guattari, 1983 : 185). Par ailleurs, entre la monnaie-dette des sociétés traditionnelles et la monnaie-crédit des sociétés capitalistes, il existe aussi des différences qui n’appartiennent pas à la même histoire et ne sont pas subsumées sous l’universalité du fait monétaire. » (p. 123-124).
Deuxièmement, si la monnaie procède logiquement de l’échange marchand, prélude conceptuel aux rapports capitalistes, comme l’entend Marx et comme le confirment De Bruhoff et Baronian, alors comment intégrer le rôle de l’État, puisqu’il sera affirmé plus loin que « sans État, pas de monnaie » (p. 146) ? En partant de la monnaie-marchandise pour aboutir à une monnaie qui n’est pas une marchandise comme les autres puisqu’elle est déjà valeur sociale par excellence, la question qui vient est : ne faut-il pas considérer que la monnaie est a priori instituée ? Baronian répondrait sans doute : peut-être, mais pas en tant qu’équivalent général… En tout cas, c’est l’une des pommes de discorde au sein même des théoriciens hétérodoxes.
Itinéraires monétaires entre orthodoxie et hétérodoxie
La monnaie bancaire moderne émise indépendamment de réserves métalliques dépasse la contradiction entre les deux modes d’être évoques auparavant. En effet, même si la banque prévalide la production sociale en créditant l’entreprise, la monnaie se distingue des instruments de crédit et des marchandises dans laquelle ils doivent se convertir pour valider le travail social qu’ils représentent. Alors que pour l’orthodoxie monétaire la monnaie est un simple instrument d’échange de biens et service dont les prix relatifs sont fixés avant qu’elle n’intervienne, pour l’hétérodoxie monétaire la monnaie est souvent représentée comme une dette ou le règlement d’une dette. Mais, dans les deux cas, on ne retrouve pas la monnaie comme forme générale de la valeur.
Pour Milton Friedman, chef de file contemporain du courant monétariste ayant imposé la vision politique de neutralité de la politique monétaire, la monnaie est un actif financier parmi d’autres, et un changement du taux d’intérêt est neutre sur la demande de monnaie, celle-ci dépendant de tous les actifs de long terme qui composent le revenu permanent ou qui constituent la richesse des agents économiques. C’est le tour de force de Friedman d’avoir « reformulé la théorie quantitative sur la base même de la définition keynésienne de la monnaie comme actif » (p. 60).
« C’est précisément parce qu’il généralise la préférence pour la liquidité en comparant la monnaie à l’ensemble des actifs que Friedman peut tirer des conclusions contraires à celles de Keynes. » […] Ainsi, la différence de nature entre la demande de monnaie des consommateurs et la demande de monnaie des entreprises disparaît. Désormais, tous les biens, services et actifs font partie d’une même fonction d’utilité dont la maximisation consiste à égaliser les rendements implicites ou explicites de ces différentes ressources possédées par l’agent économique. » (p. 81).
« Friedman définit donc la monnaie comme un actif financier dans un sens tout à fait différent de celui de Keynes : comme un stock de pouvoir d’achat et donc comme un stock de pouvoir social. D’où la revendication d’une politique monétaire entièrement dédiée à la stabilité du niveau des prix, c’est-à-dire à la stabilité du pouvoir social des détenteurs de liquidités. » (p. 82).
Laurent Baronian examine ensuite de manière critique les courants de la pensée monétaire hétérodoxe, dont il est sans doute moins éloigné que par rapport au courant néoclassique, mais qui, selon lui, souffrent de projeter sur l’histoire des monnaies les catégories de l’économie moderne. Il s’agit bien sûr du courant institutionnaliste qui
« prétend s’opposer à l’économie standard, mais en réalité, tout comme l’économie standard, comprend les conditions de la reproduction sociale à partir des phénomènes observés dans la sphère de la circulation » (p. 122).
Baronian conteste l’interprétation en termes d’universalité de la dette de vie qui a été largement diffusée :
« S’il existe une universalité monétaire, disent les institutionnalistes, alors, compte tenu des variations historiques du rôle, des usages et des fonctions de la monnaie dans les sociétés, elle ne peut être qu’anthropologique (Servet, Théret et Yildirim, 2008 : 184). Ainsi, l’échange marchand présuppose l’existence de la monnaie, mais celle-ci trouverait son origine dans les paiements sacrificiels, c’est-à-dire dans les dettes générées non pas par des échanges horizontaux régis par le principe de réciprocité, mais par des « échanges » verticaux entre des humains et des puissances supposées souveraines.
Ainsi, la monnaie procéderait de la dette par rapport à la souveraineté et donc d’une hiérarchie de valeur (monnaie souveraine) : l’obligation pour l’être vivant de racheter, de son vivant, cette puissance vitale dont il a été fait le dépositaire (Aglietta et Orléan, 1998 : 21-22). Mais si l’impôt n’est qu’une mesure de notre dette à l’égard de la société qui nous a créés, comment expliquer qu’une dette de vie aussi infinie puisse être convertie en argent, alors que l’argent est le moyen de mesurer et de comparer la valeur de différentes choses ? Comment passer de la dette infinie que nous avons envers les dieux à la dette finie que nous avons envers nos semblables ? En réalité, la dette infinie appartient essentiellement aux sociétés étatiques et n’appartient qu’à elles. Car s’il existe des sociétés primitives sans dettes, il n’y a guère d’États sans argent. Mais c’est avec l’argent et l’État, et avec la circulation de l’argent dans la société étatique, que la dette devient véritablement infinie. » (p. 122).
« […] ce néocolonialisme de la pensée anthropologique ne se contente pas d’extrapoler à toutes les formes monétaires de l’histoire le rôle de la monnaie comme lien social exclusif du travail dans les sociétés capitalistes. […] Cette extrapolation ne prend pas en compte le rôle de la monnaie comme lien social exclusif du travail dans les sociétés capitalistes. Autrement dit, cette extrapolation ne se fait pas sans un renversement, une inversion des valeurs. […] Tant que les relations économiques au sens large restent imbriquées dans les relations familiales, tribales, symboliques ou religieuses, ce n’est pas la monnaie qui contient en elle-même la relation des individus ou des groupes à la totalité sociale ou cosmique ; au contraire, c’est la prise en compte de cette totalité qui assigne à la monnaie le sens et le rôle particuliers qu’elle pose au sein de cette totalité. » (p. 122-123).
Par rapport aux discussions sur les liens entre monnaie, crédit et dette, Baronian s’écarte assez largement de l’interprétation qu’en a donnée David Graeber. En arguant que la monnaie passe d’une fonction d’unité de compte à une fonction de moyen de paiement, et qu’elle est ainsi un instrument de dette, Graeber, nous dit Baronian, « glisse de l’argent au crédit pour identifier la monnaie circulante à la monnaie-crédit » (p. 129). À l’appui de sa critique, Baronian estime que :
« les traces archéologiques des tablettes mésopotamiennes […] signifient seulement que les dettes étaient enregistrées dans des tablettes, et non pas que ces dettes entraient dans la circulation marchande en même temps que la monnaie. […] Rejetant avec horreur l’idée que l’on puisse trouver trace de paiements en espèces en dehors de nos froides et inhumaines économies de marché, les institutionnalistes ont généralement été induits en erreur par le rôle de la monnaie dans la tenue des comptes par les fonctionnaires des temples mésopotamiens. […] Les livres de comptes de Mésopotamie témoignent moins de relations de crédit entre marchands que d’une organisation tenant une comptabilité des achats et des ventes ou des taxes à payer. Le fait que la monnaie soit utilisée pour payer les impôts n’en fait pas une économie d’endettement. […]
Cela montre seulement que la monnaie jouait le rôle d’unité de compte dans la perception des impôts et, surtout, que la monnaie dans laquelle les impôts devaient être payés n’était pas émise par l’État, contrairement à ce que prétend le chartalisme. […] Ni l’orge ni l’argent ne doivent leur existence en tant que monnaie à d’autres forces que celles du commerce lui-même. Il n’existe aucune trace de décret ou de loi fixant l’argent ou l’orge comme moyen général de règlement obligatoire des biens achetés ou des dettes contractées » (p. 130-131).
De l’institutionnalisme au keynésianisme il n’y a qu’un pas et Baronian nous propose un chapitre entier consacré aux « deux monnaies » chez Keynes. L’une est celle du Traité de la monnaie (1930) de celui-ci, l’autre est celle de sa Théorie générale (1936). Keynes refuse la théorie quantitative de la monnaie (indissociable de la loi des débouchés de Say), il récuse l’impossibilité pour celle-ci de penser la demande de monnaie pour elle-même, ainsi qu’un taux d’intérêt comme prix du renoncement à la consommation présente. Mais, dans son Traité, il n’inclut pas les profits dans le revenu global, alors qu’il les inclut dans la Théorie générale, ce qui lui permet d’établir l’identité entre l’investissement et l’épargne. Baronian explique que si Keynes a changé d’avis, c’est parce que
« l’épargne n’est pas constituée d’une somme de biens en attente de consommation, mais de liquidités thésaurisées, et surtout d’actions et d’obligations, dont la valeur varie avec la variation du taux d’intérêt. Ainsi, une variation du taux d’intérêt modifie certes la propension à épargner, mais elle modifie aussi en sens inverse la valeur de l’épargne déjà constituée : il y a donc un effet de prix ou de substitution sur les flux d’épargne et un effet de richesse inverse sur les stocks, ce qui laisse indéterminé l’effet du taux d’intérêt sur l’épargne globale.
Ce qui perturbe la fonction d’épargne chez Keynes, et qui justifie sa rupture avec les classiques, c’est la prépondérance des actifs financiers dans la richesse, le rôle des marchés financiers dans la constitution de l’épargne des agents et l’influence des politiques monétaires sur la dynamique de ces marchés. Keynes est donc le penseur de l’ère du capital financier, de la financiarisation des richesses, et tous ses efforts sont dirigés vers la possibilité de soumettre ce monstrueux produit du système de crédit aux conditions du plein emploi des ressources par la politique monétaire. » (p. 61-62).
« Pour que la causalité entre épargne et investissement soit inversée, le crédit lui-même doit être libéré de l’épargne existante et déterminé exclusivement par la demande d’investissement. À ce moment-là, c’est l’épargne qui devient le résultat de l’investissement. Mais ce renversement change la nature même des termes en question, car dès que l’épargne cesse d’être la source de l’investissement, elle perd son statut de variable financière et devient la partie non consommée du revenu. Ainsi, le taux d’intérêt ne détermine plus le montant de la partie non consommée du revenu puisque le taux d’intérêt est lui-même déterminé par le revenu, ce dernier déterminé par le montant de l’investissement. » (p. 62).
On a donc avec Keynes un taux d’intérêt qui cesse d’être la variable ajustant l’offre d’épargne et la demande d’investissement pour devenir une variable « essentiellement financière » (p. 63) dépendant de la préférence pour la liquidité. Si Baronian pointe que les rapports de production à la Marx sont absents chez Keynes à cause de l’indépendance du taux d’intérêt par rapport au taux de profit (p. 63), il n’en reste pas moins que :
« La monnaie joue un rôle dans le niveau d’activité, mais indirectement, à travers la valorisation des titres des entreprises sur le marché financier. La demande de monnaie dépend de l’état des marchés financiers, c’est-à-dire, compte tenu de l’état des anticipations, du prix des titres. Encore une fois, ce n’est pas le même argent qui circule dans la sphère commerciale et dans la sphère financière. On ne peut même pas dire que la monnaie spéculative soit une réserve de valeur, puisque cette fonction est expressément réservée par Keynes au motif de précaution : le désir « de détenir un actif dont la valeur est fixée en termes de monnaie pour faire face à un engagement ultérieur fixé en termes de monnaie » (Keynes, 1936 : 196). L’argent thésaurisé à des fins spéculatives n’est pas une réserve de valeur, mais une réserve d’actifs liquides. » (p. 64).
On voit par là réapparaître la dissociation entre les deux « modes d’être » rencontrés plus haut avec Marx : pour Keynes, la monnaie qui sert à acheter les biens de consommation est circulante, tandis que la monnaie de thésaurisation est une monnaie « détenue » (p. 68, citation par Baronian de De Boyer).
« En réalité, non seulement le taux d’intérêt n’est pas déterminé par le montant de l’épargne, mais au contraire le taux d’intérêt détermine l’épargne deux fois, une première fois en influençant la répartition de l’épargne entre la monnaie et les titres, et une seconde fois en modifiant la valeur de l’épargne existante telle qu’elle est représentée dans le prix des titres. » (p. 68).
La discussion sur le taux d’intérêt a une conséquence sur la nature du système bancaire dans la mesure où :
« la théorie des fonds prêtables définit le système bancaire comme un intermédiaire financier entre les épargnants et les emprunteurs, alors que la théorie de la préférence pour la liquidité fait des banques les émetteurs de monnaie. » (p. 70).
Il s’ensuit que :
« lorsqu’elle est demandée comme capital-argent, la monnaie de crédit remplit des fonctions monétaires traditionnelles dans la circulation industrielle (y compris celle de réserve de valeur) ; lorsqu’elle est demandée comme capital financier, la monnaie apparaît comme un actif qui ne sort presque jamais de la circulation financière ». (p. 71).
La dualité monétaire chez Keynes ainsi que celle du taux d’intérêt, à la fois « phénomène conventionnel et phénomène monétaire » (p. 88), expliquent selon Baronian le statut ambigu des banques et aussi peut-être le débat au sein des post-keynésiens. Ces derniers sont partagés entre « horizontalistes » et « structuralistes » Les premiers dans une démarche circuitiste pensent le taux d’intérêt comme exogène et la banque tournée vers le crédit aux entreprises ; les seconds pensent que le taux d’intérêt est endogène et que la banque agit en fonction de sa propre préférence pour la liquidité.
« Les deux courants s’accordent sur le fait que la création monétaire est endogène à la demande de crédit. La question qui les oppose est de savoir si la masse monétaire est parfaitement élastique au taux d’intérêt fixé par la banque centrale, ou si le taux d’intérêt augmente avec l’accroissement de la demande de monnaie en raison de la disponibilité limitée des réserves fournies par la banque centrale. Pour les premiers, le taux d’intérêt est exogène, pour les seconds, il est endogène, mais ce désaccord conduit en fait à deux compréhensions différentes du taux d’intérêt : pour les horizontalistes, c’est le caractère conventionnel du taux d’intérêt qui justifie le pouvoir de la Banque centrale de fixer le taux d’intérêt à court terme. Mais ce à quoi s’opposent les structuralistes, c’est précisément le caractère monétaire du taux d’intérêt, selon lequel il est déterminé par la préférence pour la liquidité des agents. » (p. 88).
Dans le cas horizontaliste, la monnaie sera un moyen de paiement distribué aux salariés, un pouvoir d’achat donc ; dans l’autre cas, la monnaie, actif financier, sera une réserve de valeur. L’interprétation que donne Baronian de la dualité monétaire de Keynes, qui pourrait s’apparenter chez celui-ci à une concession à la théorie quantitative, est que, en se débarrassant du motif de spéculation grâce à la politique monétaire, la fonction de circulation des biens de la monnaie sera rétablie, permettant alors d’agir pour le plein emploi.
Le chartalisme remis à l’honneur par la dénommée Théorie monétaire moderne (Modern Monetary Theory, MMT) stipule que la monnaie ne naît pas des relations marchandes, mais qu’elle trouve sa source dans les décisions de l’État. Ainsi, elle ne se définit pas plus comme moyen d’échange général que comme forme générale de la valeur, mais comme dette émise par l’État qui oblige de payer l’impôt avec elle. Libérée de toute contrainte marchande, elle rend possible toutes les audaces pour un État souverain.
Pour contester cette approche, Baronian fait valoir trois arguments. Premièrement, dans la mesure où la MMT – ainsi que la thèse circuitiste horizontaliste – n’a pas de théorie de la valeur, elle considère le prix de la monnaie et des marchandises comme le résultat du conflit entre débiteurs et créanciers, qui s’exprime par le taux d’intérêt fixé par la banque centrale.
Deuxièmement, la MMT nie la séparation des politiques budgétaires et monétaires, et par là « consolide » la nature et les fonctions de la banque centrale et du Trésor.
« Toute apparence d’échange disparaîtrait puisque l’émission de monnaie de banque centrale ne se distinguerait plus des dépenses de l’État par création monétaire : ces dernières, que la banque centrale effectuerait pour le compte de l’État, équivaudraient à émettre zéro bon du Trésor à coupons, et seule l’obligation de payer les impôts en monnaie de banque centrale distinguerait ces bons des titres de dette publique. Avec la consolidation, le système financier remplirait un rôle exclusivement fonctionnel, au service des politiques publiques de l’État émetteur. » (p. 114).
Troisièmement, Baronian qualifie la MMT d’« impérialisme monétaire » (p. 119) parce qu’elle attribue à la monnaie les privilèges du dollar qui a un statut de monnaie internationale et que les États-Unis n’ont aucune peine à émettre ni de contrainte pour le faire.
Il faut ajouter que, dans la phase qui va de l’entre-deux guerres à l’après-Seconde guerre mondiale et qui voit le passage de l’étalon-or à l’étalon de change-or, c’est-à-dire à l’étalon-dollar, s’est produite une modification du rapport de l’État au travail dès lors que l’État keynésien intègre « le prolétariat dans les circuits monétaires de la demande » (p. 145 et 147). Mais, selon Baronian, cela n’accrédite pas la thèse de Michel Foucault qui n’accorde pas suffisamment d’autonomie relative au pouvoir d’État capable d’agir avec souplesse pour assurer la reproduction du capital.
« Le rapport de production capitaliste implique bien un pouvoir de classe mais, précisément en tant que rapport de production, il présente des déterminations qui ne se définissent pas comme des rapports de pouvoir. Sans État, il n’y a pas de monnaie, mais cela ne signifie pas que la monnaie soit une émanation du politique ; elle implique des rapports de production et de circulation des valeurs d’échange qui diffèrent des rapports de pouvoir. En plongeant les instances de la société dans des relations de pouvoir, Foucault fait de la politique une instance sans pouvoir et de l’économie une instance sans production. » (p. 146).
D’un système de domination monétaire à une alternative ?
Le système monétaire international installé à Bretton Woods en 1944 repose sur le dollar qui devient un équivalent universel dont la particularité est, en éliminant pratiquement l’or, d’être
« une monnaie de crédit émise à la discrétion des autorités monétaires américaines. Et, depuis cette émission, toute l’histoire du FMI depuis Bretton Woods est marquée par une contradiction permanente entre le dollar comme forme générale de valeur – qui exige la stabilité de sa valeur et donc des prix mondiaux exprimés en lui – et le dollar comme forme d’échangeabilité générale – qui exige qu’il soit émis en quantité suffisante pour assurer la liquidité mondiale ». (p. 139).
Tel est le fameux dilemme de Triffin, auquel doit faire face toute devise-clé, mettant en opposition son rôle domestique et celui de réserve et de paiement internationaux. Cela se traduit alors par
« une contradiction entre les déficits croissants de la balance des paiements nécessaires pour fournir des liquidités en dollars au reste du monde et la capacité budgétaire américaine à émettre de la dette (Obstfeld, 2011 : 19) – les bons du Trésor – pour garantir la fonction de réserve de valeur du dollar. En effet, la fin du système de Bretton Woods n’a pas supprimé la base marchande du dollar. Elle a remplacé l’or par le bon du Trésor ou, pour le dire autrement, elle a remplacé une marchandise particulière, le produit d’un travail particulier, par la richesse sociale prélevée par l’impôt et décomposée en petits coupons circulant sur les marchés obligataires publics. En l’absence de base métallique, les monnaies émises par les banques centrales des États dominants reposent entièrement sur la confiance en ces institutions, directement proportionnelle aux recettes fiscales du Trésor (Bordo, 1993 : 51). Cette confiance se traduit par l’assurance pour le détenteur de la dette de percevoir des intérêts à l’échéance prévue. C’est en ce sens que les bons du Trésor remplacent le métal précieux comme support ultime de la relation monétaire (Jiang, Krishnamurthy et Lustig, 2020). » (p. 140) [6].
Avec la libre circulation des capitaux introduite dans la décennie 1970 et les changes flottants, le dilemme s’approfondit et
« ce qui inquiète Triffin, malgré le creusement du déficit de la balance des paiements, c’est la capacité du dollar à remplir sa fonction de réserve de valeur alors que sa fonction de moyen d’échange universel s’élargit sur une base métallique de plus en plus étroite. Avec la perte de confiance dans le dollar en tant qu’actif de réserve, sa fonction de moyen d’échange elle-même serait menacée, ce qui entraînerait une pénurie de liquidités et donc une nouvelle Grande Dépression. » (p. 157).
Si Breton Woods a installé officiellement le rôle du dollar comme équivalent universel, le processus avait déjà démarré au sortir de la Première Guerre mondiale. Et Baronian souligne que, dans cet entre-deux-guerres,
« la ruée vers l’équivalent universel a aboli toutes les formes de monnaie autres que l’or pour remplir les différentes fonctions de la monnaie. Dans le cadre de l’étalon de change-or, l’or ne servait que de réserve de valeur, le dollar fournissant, loin devant la livre et le franc, l’essentiel de la liquidité mondiale à travers les prêts et les investissements directs étrangers que ses énormes excédents commerciaux rendaient possibles » (p. 152).
Cette situation éclaire d’un nouveau jour la proposition de Keynes faite à Bretton Woods autour du bancor. Selon, Baronian, « la Banque de compensation internationale et sa monnaie, le bancor, devaient abolir la monnaie comme réserve de valeur de la richesse des nations » (p. 158). Mais le rejet de cette proposition a été suivi de l’extension considérable du marché des euro-dollars, symbolisant l’autonomisation de la monnaie états-unienne par rapport à l’économie de ce pays. Mais cette autonomisation, atténuant le dilemme de Triffin, ne l’a pas fait disparaître. En revanche, la dollarisation fait d’une pierre deux coups : financer les déficits jumeaux des États-Unis et fournir des devises internationales.
« Après la démonétisation de l’or, ce sont les bons du Trésor américain qui constitueront la base de marché objective du dollar. En effet, alors même que l’or disparaissait de la circulation publique, le marché des obligations américaines s’internationalisait, en particulier celui des titres du Trésor, dont la propriété étrangère est passée de 10 % à 21 % entre 1970 et 1980. » (p. 172).
Les États-Unis ont poussé à la libéralisation du mouvement des capitaux parce qu’elle préservait l’autonomie de leur politique monétaire du fait de la position internationale de leur monnaie :
« La globalisation financière ne signifie rien de plus en termes monétaires que la globalisation du dollar. Mais indépendamment du fait que le rôle universel du dollar a été préparé de longue date, le régime de taux de change flottants ne peut se passer d’une monnaie de référence. Même en l’absence de monnaie centrale, un « compromis hiérarchique » s’établit entre la nécessité d’une unité de compte internationale et le maintien de la spécificité des monnaies nationales. Avec la libéralisation du marché des changes et donc la concurrence financière internationale, cette hiérarchie s’exprime dans le degré de priorité accordé aux objectifs externes de faible inflation et de rémunération élevée de la monnaie par rapport aux objectifs internes de croissance, d’emploi, de protection sociale, etc. On peut dire que seuls les Etats-Unis, en tant qu’émetteur de la monnaie de réserve, sont épargnés par cette préoccupation. Mais le rôle international du dollar lui impose aussi de répondre aux nouvelles normes internationales de la finance, quitte à accroître les inégalités, à réduire les salaires réels et à flexibiliser au maximum le marché du travail. » (p. 200).
Il s’ensuivra ce que Baronian appelle des « crises monétaires de première génération : la dollarisation des Trésors publics » (p. 200), des « crises monétaires de deuxième génération : la dollarisation des marchés privés » (p. 202) et des « crises de troisième génération : la dollarisation de l’investissement mondial » (p. 204). Mais, dans la crise mexicaine en 1994 comme dans celle du système monétaire européen avant l’euro, « les marchés ont douté de la viabilité de leur ancrage respectif à la monnaie de référence, le dollar dans le cas du Mexique et le deutsche mark dans le cas de la France » (p. 209). Cela illustre la contradiction entre
« la fonction universelle de monnaie-capital du dollar et les fonctions monétaires d’unité de compte et de moyen d’échange des monnaies locales. Avec la libéralisation du marché des changes, toutes les monnaies particulières sont devenues des moyens de circulation locaux dans lesquels le dollar (ou le deutsche mark dans le SME) se convertit selon le taux de change du marché où il est investi en tant que capital financier. » (p. 215).
La succession des crises monétaires au cours des dernières décennies a nourri des discussions au sujet du taux d’intérêt chez les post-keynésiens. Ils jugent favorable un taux d’intérêt faible, mais laissent de côté le fait que la monnaie conditionne l’achat de biens et aussi de titres qui sont autant d’à-valoir sur la production future, surtout dans la phase de hausse du cycle, celle que Minsky a qualifiée de « paradoxe de la tranquilité ».
Pour autant, si l’on suit le fil conducteur depuis le début de ce livre – la monnaie est la forme générale de la valeur, c’est-dire du travail social validé – peut-on affirmer que le dollar et ce qui lui sert de soubassement, les bons du Trésor américains, sont devenus tels que « le bon du Trésor américain représente très certainement, à l’échelle globale, le travail universel » (p. 252), ou, en d’autres termes, que ce dollar est véritablement l’équivalent général mondial, la forme générale de valeur ? Ce serait faire fi de la modification très importante des rapports de force économiques et politiques depuis le début du 21e siècle. Ce serait aussi accréditer l’idée d’une unification du travail et des conditions d’emploi de la force de travail que la monnaie « globale » représenterait ; ce serait encore considérer que toutes les sphères de circulation monétaire ont été unifiées dans le monde. Si les États-Unis ont pu, grâce en partie à leur suprématie monétaire, imposer nombre de diktats, notamment aux pays pauvres à coup d’ajustements structurels, cela ne fait pas un monde unifié sous leur coupe. D’ailleurs, ils en savent quelque chose avec le bras de fer contre la Chine, la Russie… En d’autres termes, le monde vit sous la loi du capital, mais la mondialisation du capital, même dans sa phase financière, n’a pas engendré un gouvernement mondial du capitalisme.
C’est donc le moment d’aborder le dernier aspect du livre de Baronian, celui qu’il dresse dans l’unique chapitre de sa quatrième partie en revisitant l’expérience historique menée par les bolcheviks pendant leur Nouvelle politique économique (NEP) à partir de 1921. Quatre années de guerre civile expliquent en partie la situation à laquelle le parti bolchevik est confronté, mais cette situation résulte de la double contradiction entre les aspirations des ouvriers et celles des paysans d’un côté et entre les anciennes structures contrôle et de régulation de l’État tsariste et la nécessité de les mobiliser au service du socialisme de l’autre. Parmi les institutions en cause : celles du crédit. Après les premières mesures consécutives à la Révolution d’Octobre supprimant quasiment la monnaie et visant à un contrôle par le Gosplan, le tournant est pris en 1921 en faveur de « la « rédemption » du monstre capitaliste » (p. 241). Pourquoi s’interroger aujourd’hui sur la NEP ? Parce que
« si l’expérience de la NEP peut encore inspirer aujourd’hui des formes possibles de transition dans nos propres sociétés, c’est en raison de la manière dont elle a subverti de l’intérieur le système monétaire et financier hérité du capitalisme avancé pour créer tout un appareil dédié à la distribution, à l’organisation et au contrôle social de la production et de l’échange dans la société. Le système hérité du monde précédent avait légué aux autorités soviétiques un ensemble d’outils, de moyens et d’institutions spécifiquement capitalistes qu’elles ont pu, par les grandes ruptures décrétées dans les premiers mois de la prise du pouvoir, mettre au service de finalités spécifiquement socialistes. » (p. 241).
La création de la Banque d’État en octobre 1921 pour promouvoir l’industrie, l’agriculture et le commerce par le biais du crédit, suivie par la recréation d’un réseau bancaire, est essentielle. Mais la Banque d’État ne développe le crédit que sur ses propres revenus car elle n’a pas le droit de créer de la monnaie, elle n’est donc pas une banque centrale. Un an après cependant, en octobre 1922, elle est autorisée à « émettre une nouvelle unité monétaire adossée à l’or : le rouble chervonetz (littéralement or pur) » qui « n’avait pas cours légal, contrairement au sovznak qui était utilisé pour le paiement des impôts. (p. 243).
Or la politique de crédit très favorable aux grands groupes industriels d’État et beaucoup aux acteurs privés a provoqué une crise dite des « ciseaux » : les prix industriels augmentaient tandis que les prix agricoles baissaient. Ce que ne dit pas Baronian, c’est que deux des économistes les plus éminents au sein du parti bolchevik, Evgueni Preobrajenski et Nicolaï Boukharine, préconisaient deux politiques diamétralement opposées : le premier pensait qu’il fallait prélever un surplus important dans l’agriculture en imposant des prix bas, de façon à financer plus rapidement l’industrie, donc il théorisait l’approfondissement des ciseaux, tandis que le second était davantage soucieux de préserver l’alliance avec les paysans. Débat économique en apparence, mais en fait politique, que tranchera plus tard Staline en appliquant la stratégie de Preobrajenski, mais par l’élimination pure et simple des koulaks. Les politiques de développement dans les pays du tiers-monde retrouveront après la Seconde Guerre mondiale le problème de l’agriculture dans un processus de développement autonome.
Ce problème social et politique d’antagonismes de classes se double pour les dirigeants bolcheviks d’une contradiction entre le Commissariat du peuple aux finances (Narkomfin), favorable à l’équilibre budgétaire, et le Gosplan engagé dans de fortes dépenses pour l’industrie. C’est ce qui conduit Baronian à dire que
« par un étrange retournement de situation, cette crise a marqué la victoire de la finance sur la production dans la hiérarchie des priorités. […] La stabilité monétaire nécessitait de l’or et des devises pour constituer les réserves de la Banque d’émission, qui ne pouvaient être obtenues que par l’exportation de produits agricoles. Encourager les exportations de céréales, c’était encourager la paysannerie, et notamment la paysannerie riche des koulaks. On pense ainsi faire d’une pierre deux coups, puisque la politique d’exportation de céréales s’avère être le moyen le plus pratique et le plus efficace pour atteindre le double objectif de satisfaire la paysannerie et de fournir les réserves nécessaires à la stabilisation monétaire. […] Désormais, la politique monétaire et financière contrôlera l’ensemble de l’économie soviétique. En d’autres termes, l’économie soviétique sera organisée par la monnaie et le crédit. » (p. 244).
Prise sous la NEP, cette orientation privilégie la paysannerie aisée et consacre la prééminence de la finance sur la production. De plus, les nécessités d’une accumulation rapide ont conduit en 1925 le pouvoir soviétique à rompre avec l’étalon-or, le premier pays à le faire et, par là-même, à rompre avec l’échange international. Au moment où, observe Baronian, l’hypothèse de la révolution mondiale allait être abandonnée pour se rabattre sur le socialisme dans un seul pays. Et il cite Keynes qui regarde attentivement ce qu’il se déroule en URSS :
« La Russie fournit un exemple instructif (du moins pour le moment) d’une monnaie saine pour les transactions substantielles à côté de la petite monnaie de la vie quotidienne, dont la dépréciation progressive ne fait que représenter un taux tout à fait supportable de taxe sur le chiffre d’affaires (Keynes, 1923 : 49) » (p. 248).
Avec le contrôle d’État sur le commerce extérieur, la nationalisation de la grande industrie et un système bancaire complet, Baronian estime que
« la Russie est non seulement le premier pays européen ayant participé à la guerre à avoir réussi à stabiliser sa monnaie, mais elle est aussi le premier à avoir expérimenté un système monétaire entièrement fondé sur la stabilité politique. » (p. 249).
Mais si l’argent a ainsi perdu sa qualité de capital dans les premières années de la Russie soviétique, le mystère reste entier pour savoir comment il a pu le retrouver aussi facilement et rapidement à la fin du 20° siècle… C’est déjà une autre histoire…
Le livre de Laurent Baronian se termine par une conclusion qui n’en est pas véritablement une. Il préfère la consacrer à ce qui aurait pu être un chapitre à part entière, les monnaies numériques. D’abord, l’auteur abonde l’idée que les crypto-monnaies qui ont émergé depuis un peu plus d’une décennie ne sont pas des monnaies, ne serait-ce que parce qu’elles ne peuvent pas être des réserves de valeur. Retrouvant son fil conducteur à propos du double mode d’être de la monnaie, il conclut que
« La contradiction entre la destination sociale et les usages privés des monnaies numériques est donc la contradiction de la monnaie elle-même comme équivalent général, dont nous avons vu qu’elle la définit à la fois comme forme d’échangeabilité générale et comme forme générale de valeur. » (p. 251).
Une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) résoudrait-elle le problème ? Deux modalités de MNBC pourraient exister : soit avec un système de comptes qui ferait disparaître les espèces des transactions et affaiblirait la fonction privée de réserve de valeur, soit avec un système de jetons qui conserverait des unités comparables aux billets et pièces. Surtout, un système de MNBC tendrait à rapprocher la banque centrale de la Gosbank et le Trésor du Gosplan. Le risque de confusion des politiques monétaire et budgétaire serait accru.
Et, avec un système de comptes, la banque centrale n’aurait plus qu’à agir sur le taux d’intérêt dans un sens ou dans l’autre selon la situation économique.
C’est donc bien du statut d’équivalent général qu’il s’agit, c’est-à-dire de représentant du travail social. Son abolition réduirait la monnaie à une unité de compte et de mesure. Si cela s’avérait, la contradiction entre les deux modes d’être de la monnaie serait davantage niée qu’abolie. En revanche, au vu de la multiplicité des projets de MNBC dans le monde, l’universalité du travail social au travers de l’équivalent général universel, que Baronian croyait observer précédemment, ne se dissiperait-elle pas ? Même la domination presque sans partage du dollar en tant qu’équivalent général y résisterait-elle ? Là encore, gageons que la concurrence menée tambour battant par la Chine et peut-être quelques autres serait féroce.
D’ailleurs, Baronian pense que les systèmes monétaires numériques privés préparent simultanément « les conditions technologiques pour l’établissement de monnaies mondiales », et cela dans une perspective post-capitaliste, et « les conditions d’une dollarisation plus large et plus profonde des formations sociales périphériques » (p. 256).
Pour conclure cette recension, redisons que le livre de Laurent Baronian est un livre important. Par son érudition, nous l’avions dit d’emblée. Par sa cohérence aussi : il tient ce qu’il annonce au départ, à savoir utiliser les concepts de Marx sur l’équivalent général, représentant du travail validé socialement afin d’éclairer les nombreux débats monétaires qui partagent les économistes. Bien sûr, cela oblige le lecteur à avoir constamment en tête ce fil rouge pour suivre tous les méandres de ces débats autant techniques que théoriques, mais c’est une condition qui se révèle profitable.
Ce livre est également important par la discussion qu’il ne va pas manquer sans doute de susciter, notamment au sujet de la problématique choisie par l’auteur, car réhabiliter les concepts marxiens ne va pas de soi aujourd’hui – et il faut un courage certain pour le faire –, tellement ils ont été et ils sont malmenés, travestis, incompris et employés à contresens. Il faut dire que Marx a laissé des terrains en jachère. Les quelques questions que nous avons posées au fil de notre recension ne donnent sans doute qu’un aperçu des thèmes à approfondir. Au fondement de la monnaie équivalent-général, il y a logiquement l’échange marchand. Si l’économie marchande – l’économie capitaliste en particulier – est obligatoirement monétaire, on sait que la réciproque n’est pas vraie, c’est-à-dire des sociétés ont utilisé la monnaie comme symbolisant des relations sociales et non pas économiques. Ce sera peut-être l’objet d’une discussion autour du livre de Laurent Baronian, d’autant que la perspective post-capitaliste est toujours en toile de fond…
2 août 2023
*
Illustration : The Moneychangers, Marinus van Reymerswale / Wikimedia Commons.
Notes
[1] Money, en anglais, peut tantôt correspondre en français à monnaie, tantôt à argent. C’est le contexte qui nous fera choisir entre les deux termes français, avec toujours une marge d’erreur de notre part.
[2] Suzanne de Brunhoff, La monnaie chez Marx, Paris, Éditions sociales, 1967, 3e éd. 1976, p. 7 (voir aussi p. 14).
[3] Sur la critique de la critique institutionnaliste de la position de Marx sur la monnaie, voir Nicolas Piluso, « Postulat de la monnaie et théorie de la valeur chez Marx », La Revue de la Régulation, n° 15, 1er semestre 2014, https://journals.openedition.org/regulation/10721 ; Matthieu Montalban, « De la place de la théorie de la valeur et de la monnaie dans la théorie de la régulation : critique et synthèse », n° 12, 2e semestre 2012, https://journals.openedition.org/regulation/9797. Voir aussi à ce sujet le débat que j’ai eu avec André Orléan ces dernières années : Jean-Marie Harribey, « La valeur, ni en surplomb, ni hors sol, À propos du livre d’André Orléan, L’empire de la valeur, Refonder l’économie », La Revue de la Régulation, n° 10, automne 2011, https://journals.openedition.org/regulation/9483 ; André Orléan, « Réponse à Jean-Marie Harribey », La Revue de la Régulation, n° 10, automne 2011, https://journals.openedition.org/regulation/9502 ; Jean-Marie Harribey, « Du travail à la monnaie, Essai de perspective sociale de la monnaie, Examen critique de la vision autoréférentielle de la valeur et de la monnaie », Économie et Institutions, n° 26, 2017, http://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/valeur/monnaie-valeur.pdf. On peut également lire André Segura, « Synthèse post-classique ou marxo-keynésienne ? », Revue française d’économie, n° 8-1, 1993, p. 27-66, https://www.persee.fr/doc/rfeco_0769-0479_1993_num_8_1_922, article dans lequel l’auteur étudie l’idée selon laquelle « la seule théorie de la valeur recevable par la théorie keynésienne, c’est la théorie marxienne de la valeur-travail », afin que « la théorie keynésienne [soit] à l’abri de toute tentative d’infiltration néoclassique » (p. 50). Laurent Baronian ne cite ici aucune de ces références. En revanche, dans un livre plus ancien, il procédait à une critique de l’institutionnalisme monétaire : Marx and Living Labour, Oxon, New York, Routledge, 2013.
[4] Dans « Du travail à la monnaie, Essai de perspective sociale de la monnaie », op. cit., je posais la question suivante à André Orléan : « Est-ce le fait monétaire qui, en lui-même, explique qu’un avion Airbus vaille 500 millions d’euros, un sous-marin 2 milliards d’euros et une douzaine d’œufs 4 euros ? ». Dans « Une théorie de la valorisation ? », Revue française de socio-économie, n° 10, 2012/2, p. 289-294, https://www.cairn.info/revue-francaise-de-socio-economie-2012-2-page-289.htm, Laurent Cordonnier posait une question analogue : « Pourquoi les tomates en grappe valent-elles 4,50 euros le kilo (à l’heure où ces lignes sont écrites), et pourquoi un sac à main de luxe (arborant une marque dont l’initiale est la même que celle du mot valeur) vaut-il 600 euros ? »
[5] Alain Testart, « Moyen d’échange/moyen de paiement, Des monnaies en général et plus particulièrement des primitives », dans Alain Testart (sous la dir. de), Aux origines de la monnaie, Paris, Éd. Errance, 2001, p. 11-60.
[6] Voir aussi p. 155.

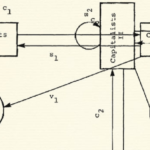


![Marx, critique de l’économie politique [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/industrialization-factories-150x150.jpg)




