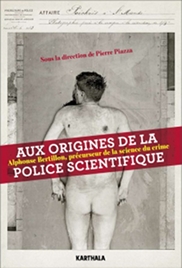
Compte-rendu : « Aux origines de la police scientifique », de Pierre Piazza (dir.)

Pierre Piazza (dir.), Aux origines de la police scientifique. Alphonse Bertillon, précurseur de la science du crime, Karthala, Paris, 2011.
L’heure est, en France, au fichage généralisé : nos parlementaires viennent d’adopter le principe d’un fichier regroupant l’ensemble de la population, afin de « protéger » l’identité. Le « fichage des honnêtes gens », pour reprendre une expression consacrée, a été voté début février. Cela vient prolonger le souci – le fantasme ? – très contemporain de lutter contre la récidive, voire d’anticipation de la délinquance et de la criminalité avant même qu’elles ne se produisent (« détection » de la délinquance en maternelle, enfermement définitif de récidivistes putatifs…). Comme nous le rappelle fort à propos l’ouvrage dirigé par Pierre Piazza, ces obsessions ne sont pas nouvelles : la question de la lutte contre le crime, en premier lieu contre la récidive, a profondément travaillé la fin du XIXe siècle, en France assurément, mais aussi bien au-delà comme le montre largement ce volume (l’Europe dans son ensemble et ses empires coloniaux d’Asie et d’Afrique, les Amériques…). Les auteurs ne manquent d’ailleurs pas de souligner cette contemporanéité.
Le sous-titre de l’ouvrage est un peu trompeur. La figure d’Alphonse Bertillon y est certes centrale, mais elle n’en constitue pas l’objet véritable. C’est moins l’homme que ses techniques qui intéressent ici. Certains articles l’évoquent d’ailleurs à peine. En effet, la question au cœur de cet ouvrage est celle du développement d’une police dite scientifique, au sens le plus étroit, « exact », du terme. Ainsi, si Alphonse Bertillon est évoqué à maintes reprises, c’est moins pour en faire une biographie stricto sensu que pour souligner son importance dans l’invention et l’institutionnalisation d’une telle police. Ce qui est en jeu ici, ce sont les conditions d’élaboration d’une « science du crime » au tournant du siècle et ses effets sur le travail policier d’identification. Si Alphonse Bertillon occupe une place incontournable, c’est parce qu’il est à l’origine d’une petite « révolution », que l’on crut grande alors mais dont cet ouvrage relativise considérablement l’ampleur. Il est en effet l’inventeur d’un procédé d’identification très raffiné, pour ne pas dire extrêmement compliqué : l’anthropométrie, ou « bertillonnage ». Le procédé, expérimenté à Paris à partir de 1882, consiste en une série de mesures biométriques (tête, bras, jambe, oreille…). Opérées systématiquement lors d’une arrestation, additionnées les unes aux autres et étoffées progressivement de photographies et d’empreintes digitales, elles doivent permettre d’identifier sans l’ombre d’un doute – c’est l’ambition, tout au moins – le criminel récidiviste, dont les mesures ont été relevées à l’occasion d’un précédent délit. De fil en aiguille, c’est l’ensemble du monde criminel qui doit être mis en fiche, et progressivement éliminé par une lutte implacable contre la récidive : une aggravation automatique des peines à partir de 1885 (relégation au bagne ou interdiction de séjour) doit conduire le criminel à s’amender ou disparaître.
L’ouvrage rassemble quinze contributions, dans une perspective pluridisciplinaire (socio-histoire et histoire de l’art, essentiellement), aux thématiques fort diverses. Sont abordés l’institutionnalisation de l’anthropométrie (Martine Kaluszynski) et ses usages en milieu carcéral (Marc Renneville) ou dans l’exposition au risque de relégation au bagne (Jean-Lucien Sanchez) ; les prolongements techniques de l’anthropométrie : l’invention de la photographie judiciaire (Stéphanie Sotteau Soualle, Stéphanie Solinas) et de la photographie métrique, qui permet de fixer l’image de la « scène de crime » (Teresa Castro) ; la concurrence entre l’anthropométrie et la dactyloscopie, i.e. le relevé des empreintes digitales, et son intégration progressive et très réservée au dispositif anthropométrique par Alphonse Bertillon, à laquelle il dut pourtant quelques-uns de ses succès (Pierre Piazza et Jean-Marc Berlière) ; une interrogation sur la véritable portée de la « révolution » anthropométrique au sein de la police : son usage limité en matière d’identification, à la Morgue de Paris par exemple (Bruno Bertherat), ou sa contribution beaucoup plus certaine à la structuration et à la professionnalisation de la police qu’à l’identification proprement dite (Laurent López) ; la diffusion internationale de l’anthropométrie et les résistances qui y ont été opposées, en Amérique latine (Diego Galeano et Mercedes García Ferrari) et aux États-Unis (Yann Philippe) ; les usages de l’anthropométrie en matière d’encadrement de catégories de Français « incertains », à ce titre toujours susceptible de dissimuler des criminels : les nomades (Emmanuel Filhol) et les sujets coloniaux, en particulier algériens (Ilsen About) ; les ultimes errements d’Alphonse Bertillon dans son invraisemblable expertise graphologique lors du procès d’Alfred Dreyfus (Roger Mansuy et Laurent Mazliak). L’extrême diversité des contributions en interdit une restitution exhaustive. D’autant plus qu’au-delà de la seule division d’objet, elles abordent le bertillonnage et ses développements sous des angles radicalement différents voire, de temps à autres, franchement contradictoires : entre considérations esthétiques sur le développement de la photographie judiciaire et ses effets sur la photographie en général, le postulat implicite de la toute-puissance de l’anthropométrie qui ne doit ses échecs qu’à l’incurie bureaucratique ou à la mauvaise volonté (Jean-Lucien Sanchez) ou l’insistance sur l’impuissance de l’anthropométrie à « réformer » en profondeur les pratiques de l’enquête policière – la police judiciaire – et son franc succès du côté de la police administrative – la constitution de fichiers dans une perspective de « sécurité » publique –, le fil conducteur est particulièrement ténu. Le regroupement thématique des articles n’aide pas toujours à y voir plus clair : en dépit de textes introductifs de Pierre Piazza, il laisse la sensation d’être plus circonstanciel que problématisé. Mais ce sont là les risques de ce type d’ouvrage : une mise en cohérence pas toujours aisée, des redondances difficilement évitables (ici, sur des éléments biographiques concernant Bertillon en particulier), etc. Il reste que l’ensemble dégage une analyse étonnante du bertillonnage et qu’elle est à plus d’un titre extrêmement utile aujourd’hui.
Même si la question n’est abordée que de façon très allusive ici, on sait, par la multiplicité des travaux qui portent sur cette période, que la question de l’identification est d’une importance cruciale à la fin du XIXe siècle. Dans un contexte de nationalisation de la société, l’État prend une place inédite, qui réorganise de fond en comble le monde social, désormais structuré par l’appartenance à l’État et la participation à la vie de celui-ci – autrement dit par la nationalité et la citoyenneté (voir, par exemple, les travaux de Gérard Noiriel). La légitimité de la soumission aux lois tient désormais aux droits que l’on peut faire valoir. Le problème de l’identification (des citoyens, des criminels…) devient ainsi primordial, identification par l’État d’une part et garantie pour les individus de leur « identité » face à l’État d’autre part. C’est dans ce double mouvement que se trouve toute la question des papiers d’identité, à l’histoire de laquelle Pierre Piazza a déjà contribué de façon significative1. Même si elle ne s’y réduit pas complètement, l’identification est donc nécessairement un problème policier, auquel est consacré cet ouvrage.
L’adoption progressive du « bertillonnage » par la police française témoigne d’une transformation importante qui la touche à la fin du XIXe siècle. En plein essor des techniques liées à la révolution industrielle, celles-ci trouvent leur application sur le terrain policier, qui doit être au diapason de son époque (Laurent López). Dans le contexte de lutte contre la récidive propre à la fin du XIXe siècle s’installe la croyance en son éradication par la science. En dépit des difficultés rencontrées par Alphonse Bertillon, d’abord pris pour un fou, il parvient à imposer l’anthropométrie comme un outil policier majeur : fondée sur des assises scientifiques et forte de ses premiers succès, elle semble pouvoir réussir là où échouent les autres techniques policières élaborées au cours du siècle (Martine Kaluszynski). L’anthropométrie connaît une diffusion internationale rapide : mise en place à titre expérimental à Paris à la fin de 1882, elle est étendue au reste de la France à partir de 1885 et adoptée en Amérique du sud et aux États-Unis avant la fin du siècle (Martine Kaluszynski, Diego Galeano et Mercedes García Ferrari, Yann Philippe). Mais le triomphe de Bertillon n’est que de courte durée. L’anthropométrie est très vite mise en question, d’abord par l’institution policière elle-même : elle est d’une rare complexité – la multiplicité des mesures à effectuer multiplie du même coup le risque d’erreur – et son efficacité est incertaine – sa contribution à l’identification des récidivistes est, tout compte fait, relativement réduite (Laurent López, Yann Philippe, Bruno Bertherat). Elle est aussi dénoncée très tôt comme une pratique excessivement abusive et vexatoire, qui porte atteinte aux droits des individus qui y sont soumis, des inculpés qui ne seraient finalement pas condamnés par exemple. Elle entre, en outre, très vite en concurrence avec un autre procédé : la dactyloscopie. Expérimentée par l’administration britannique et aux États-Unis à partir des années 1880, elle est perfectionnée, dans les années 1890, par Juan Vucetitch, un Argentin d’abord adepte de Bertillon mais perplexe sur les performances de son procédé. Alliant une fiabilité plus grande – les empreintes digitales, à la différence du squelette, ne se modifient pas au cours de la vie – à une simplification technique considérable, la dactyloscopie détrône l’anthropométrie dès le début du XXe siècle (Pierre Piazza, Marc Renneville, Diego Galeano et Mercedes García Ferrari). C’est paradoxalement d’ailleurs à celle-ci que Bertillon dut l’un de ses plus grand succès, l’identification d’un assassin inconnu – « l’affaire Scheffer », en 1902 (Jean-Marc Berlière).
Le retour, un siècle plus tard, sur l’anthropométrie de Bertillon permet d’en souligner la très grande faiblesse quant à l’objectif qui lui était assigné : elle fut au fond incapable, comme la plupart des contributions le montre ici, de lutter efficacement contre la récidive. Et pourtant elle eut une véritable efficacité, en des lieux parfois inattendus. Ainsi, la « technicisation » de la police s’est accompagnée d’un bouleversement de ses structures. La réussite au brevet de signalement anthropométrique devient, à partir de 1895, indispensable pour « faire carrière » – i.e. pour grimper dans la hiérarchie et atteindre des positions de pouvoir dans l’institution policière. Il se passe sensiblement la même chose du côté de la gendarmerie : dominée jusqu’à la fin du siècle par des officiers issus de la noblesse, domination fondée sur l’instruction équestre, la possession du brevet ouvre là aussi des perspectives de commandement, inédites jusqu’alors pour les sous-officiers issus du rang. Le « bertillonnage » a au moins ceci à son actif : avoir contribué de façon significative à « la républicanisation » de la police dans son ensemble. Ainsi s’ouvre une perspective inattendue : au tournant du siècle, l’anthropométrie, qui n’est déjà plus une véritable technique d’investigation policière, devient un savoir « scolaire » qui redéfinit totalement les savoirs professionnels et leur répartition (Laurent López). L’autre grand « succès » du bertillonnage réside dans son déplacement de la police judiciaire (la résolution d’un crime) vers la police administrative (le maintien de l’ordre). C’est par la seconde que l’anthropométrie fut finalement largement mobilisée : pour constituer des fichiers de « nomades » ou d’« indigènes » notamment, qui n’ont d’autre justification que la prévention d’un crime qui n’a pas encore été commis (Emmanuel Filhol, Ilsen About, Martine Kaluszynski). On est ici loin de la lutte contre la récidive. Dans le cadre d’une « républicanisation » de la police, pour reprendre l’expression de Laurent López, cette tentation ancienne de la République pour la constitution de fichiers interroge nécessairement le citoyen d’aujourd’hui. On en connaît désormais les dimensions discriminatoires et xénophobes2. Cela ne peut qu’inciter à la vigilance à l’heure de la constitution de « méga » fichiers, par l’État ou des intérêts privés. Ceci dit, et pour ne pas sombrer dans une forme de pessimisme face au fichage généralisé, cet ouvrage donne aussi l’occasion de sourire. Certes, l’anthropométrie s’est effondrée dans une concurrence qu’elle ne pouvait soutenir avec la dactyloscopie. Ce fut là un facteur décisif. Mais ce n’est pas le seul, croit-on lire ici. L’exploitation efficace de l’anthropométrie supposait l’élaboration d’un classement qui permette de faire le lien entre un individu et une fiche. Or, semble-t-il, cette question n’a jamais été tout à fait résolue. Si bien que l’excès d’information peut paradoxalement apparaître comme un obstacle insurmontable. Ce qui est plutôt rassurant : dans une époque, la nôtre, où les possibilités d’accès aux informations personnelles, démultipliées par les technologies de l’information et les réseaux sociaux, sont devenues un enjeu majeur, l’idée que la surabondance d’information sur les individus conduise à la paralysie de fichiers devenus impossibles à exploiter ou à relier les uns aux autres, a quelque chose de rassurant. Ultime occasion de sourire, l’article final revenant sur le rôle d’Alphonse Bertillon dans le procès d’Alfred Dreyfus et son rapport graphologique visant à l’accuser, aux prix de méandres singulièrement tortueux et torturés (Roger Mansuy et Laurent Mazliak). Il suffirait à convaincre du délire – on ne voit pas d’autre mot – auquel peut conduire l’obsession identificatoire et sécuritaire. Là aussi, les échos contemporains ne sont sans doute pas fortuits.
L’ensemble de l’ouvrage est nécessairement d’un intérêt inégal. Tout dépend des attentes du lecteur. Nul doute que du point de vue des sciences sociales, les contributions à propos de la photographie produites par des historiennes de l’art présentent un intérêt secondaire. Les raccourcis auxquels elles peuvent conduire, une confusion entre « identité » et « identification » notamment (Stéphanie Solinas), sont gênantes, et surprenantes ici. Il reste que l’ouvrage donne du grain à moudre pour penser notre présent. Enfin, il convient d’insister sur le remarquable travail iconographique. L’ouvrage est abondamment illustré de photographies, d’extraits de la presse, de reproductions de circulaires, de fiches anthropométriques, de notes intégrales rédigées par Alphonse Bertillon lui-même, tirées d’archives privées ou de la Préfecture de police de Paris. Cela renforce indubitablement son intérêt, et suffit à coup sûr à en faire un livre hors norme.
François Masure, anthropologue, IRIS/EHESS.





![Le 6 février 1934, un coup de force fasciste ? [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/1361-14_72dpi-1-150x150.jpg)



