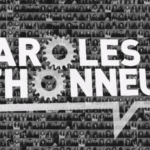Rester barbare : à l’assaut de la citadelle civilisationnelle
À propos de Rester barbare de Louisa Yousfi (La fabrique, 2022).

On peut penser ce qu’on veut du Parti des Indigènes de la République, mais l’honnêteté commande de reconnaître qu’il a constitué au cours des deux dernières décennies la matrice d’un travail idéologique dont on ne trouvera pas ou peu d’équivalent au sein des mouvements contemporains de la gauche radicale – à laquelle nous nous épargnerons ici la tâche insipide de montrer qu’il appartient de plein droit. Ou, puisque « idéologie » demeure un gros mot éveillant automatiquement le soupçon, disons plus précautionneusement qu’il n’y a guère de mouvement qui se soit tant soucié de mettre en théorie sa pratique et sa pratique en théorie, « décolonial » étant sans doute le nom même de cette articulation.
Précisons encore que le PIR a moins engendré et dirigé un tel travail qu’il l’a suscité, accompagné, abrité, nourri, inspiré de diverses manières, au sens où, n’en déplaise à ses contempteur.ices, ce qui s’est ainsi exprimé depuis la révolte des banlieues de 2005 est une pluralité de voix singulières empruntant des régimes discursifs hétérogènes et poursuivant des fins multiples. On n’en dispose pas moins aujourd’hui d’un corpus d’œuvres « complices » dont les pièces maîtresses peuvent être nommées : Pour une politique de la racaille (2006) et La contre-révolution en France (2009) de Sadri Khiari, Les Blancs, les Juifs et nous (2016) d’Houria Bouteldja, La dignité ou la mort (2019) de Norman Ajari[1] ; liste à laquelle il convient désormais d’adjoindre le livre de Louisa Yousfi, démissionnaire du PIR à l’automne 2020, Rester barbare, publié il y a quelques mois par La Fabrique et auquel les réflexions qui suivent seront consacrées.
Il est symptomatique des clivages entourant la question raciale en France que ces textes aient généralement suscité soit l’admiration, soit l’indignation (qui ont leur fonction politique évidemment), rarement des critiques dignes de ce nom (bienveillantes ou pas), ou ne serait-ce que des analyses soucieuses d’en restituer et d’en discuter les arguments sans les encenser ou les caricaturer à coup de jugements à l’emporte-pièces. Affirmer cela ne signifie pas prétendre se situer au-dessus de la mêlée, mais simplement partir du postulat – qui malheureusement ne semble pas aller de soi – que les protagonistes « indigènes », auteur.ices ou autres, ne sont pas seulement des sujets politiques, mais aussi, et indissociablement, des sujets de savoir.
Certes, doté d’une indéniable puissance littéraire, le livre de Yousfi se veut être tout autre chose qu’un sec exposé théorique de plus sur la condition immigrée. N’affirme-t-elle pas, à maintes reprises, que les œuvres avec lesquelles son propre travail entretient le dialogue le plus intime – le rap (Booba, PNL), mais aussi la littérature, algérienne (Kateb Yacine, Mohammed Dib), africaine-américaine (Chester Himes, Ralph Ellison, James Baldwin) ou encore congolaise (Sony Labou Tansi) – échappent radicalement au regard dissécateur des sciences humaines et sociales ? Gageons que ce ne sera toutefois pas faire injure à son effort que de le soumettre à un examen visant à dégager les traits et éprouver la consistance du personnage politico-conceptuel qu’elle découvre et forge dans un même geste, par touches successives, tout au long de son essai : le barbare.
L’être barbare
« Rester barbare », c’est à Kateb Yacine que Yousfi emprunte la formule, traduisant un impératif, qui donne son titre au livre. L’ « espèce de barbarie » dont il est question est d’abord cette part de soi qui demande à être conservée, protégée. De quoi ? De la tentation et du mirage de l’intégration qui, dans la « langue de l’Empire », est synonyme de « domestication des barbares » (p. 16).
De ce point de vue, la barbarie ne désigne nullement un « manque d’humanité, de culture ou de sens moral », manque de civilisation (occidentale s’entend), mais ce quelque chose, « notre épaisseur historique, notre vie profonde » qui précisément lui résiste ; c’est « l’inassimilable en nous », et pourrait-on dire l’incolonisable, « ce qui n’a pas été touché – contaminé – par l’intégration dans l’Empire », ce qui peut être éradiqué mais jamais perverti et retourné contre soi : « C’est la friche en nous. Notre terre vierge. » (p. 21-22, 25).
Disant cela, Yousfi opère une singulière subversion du discours de la première colonisation, la colonisation de l’Amérique, et de son argument central, l’argument de la terra nullius, au nom duquel avait été justifiées l’expropriation et, incidemment, la décimation des « sauvages » indiens du Nouveau Monde ; comme si cette terre vierge, non moins porteuse d’histoire, avait trouvé refuge dans les tréfonds des sociétés colonisées soucieuses non seulement d’en cultiver la mémoire, mais d’en préserver les puissances fécondantes.
On ne s’étonnera guère que Yousfi trouve dans ces conditions à rejouer le topos de l’opposition entre le sauvage et le barbare qui, depuis le cours de 1976 de Michel Foucault au Collège de France, « Il faut défendre la société »[2], a connu des déclinaisons plus ou moins heureuses. Là où le sauvage est conçu comme un « humain attardé », à l’image d’un enfant, être docile, inoffensif, « à développer », que les maîtres civilisateurs auraient le devoir d’éduquer pour le « hisser à hauteur d’hommes », le barbare quant à lui, d’autant plus rétif à une telle captation qu’elle se pare des meilleures intentions, toujours à se « rebiffer », est un « être irrécupérable »(p. 15, 22).
Cette dichotomie quelque peu rigide se voit néanmoins complexifiée par la « dialectique de l’ensauvagement » (p. 66) thématisée par l’autrice au fil des pages et de manière particulièrement admirable dans son premier chapitre qui se concentre sur le roman de Chester Himes, La Fin d’un primitif (1956), plus exactement sur sa scène finale, celle de l’assassinat par le héros noir, Jesse Robinson, de son amante blanche, Kriss Cummings. Dans ce dénouement, on peut identifier l’œuvre de la prophétie auto-réalisatrice du racisme qui « bousille ses victimes pour qu’elles se comportent comme le prédisait le grand récit de l’Empire, comme une altérité brutale et vengeresse, comme des primitifs » (p. 30) ; un racisme qui « en abîmant l’âme de ses victimes, en faisant grossir en elles un monstre furieux, en les ensauvageant, fait advenir la menace qu’il prétend combattre et, par là même, assure sa perpétuation » (p. 31).
Mais qu’on ne se méprenne pas en confondant le message ici délivré par Himes avec celui que ressassent les « sociologues » disposés à acquiescer à de telles conclusions à condition de réduire cette tragédie à une « histoire de manques » et la condition raciale à une condition purement victimaire. Le barbare Jesse Robinson n’est pas un sauvage « qu’il aurait fallu moins fouetter, moins humilier, et davantage câliner » ; ce n’est pas un être qui, abandonné sur les bas-côtés de la civilisation, souffrirait essentiellement de ce que le monde blanc ne lui a pas donné (p. 32).
Lorsqu’il suggère qu’en tuant une Blanche, Robinson a cessé d’être un primitif pour devenir un « humain », autrement dit l’égal du Blanc, le civilisé, le même que lui, Himes révèle que ce meurtre ne signe rien d’autre que l’endossement pas son auteur du « grand crime civilisationniste de l’homme blanc » ; c’est l’inévitable produit dérivé de l’« ensauvagement de l’Europe » qu’Aimé Césaire avait diagnostiqué quelques années plus tôt dans son Discours sur le colonialisme (1950). D’où cette imparable conclusion : « Ce n’est […] pas d’un manque d’intégration que “l’ensauvagement” est le nom, mais du processus intégrationniste lui-même […] : nos monstres ne naissent pas à cause d’un manque de vous, ils naissent d’un trop de vous – trop de France, trop d’Empire. Ils naissent à votre contact et c’est à votre contact toujours qu’ils prennent forme et déterminent peu à peu leurs missions (auto)destructrices » (p. 38-39).
Le « tragique de la condition barbare », telle que l’incarne Jesse Robinson, est qu’elle semble condamner son sujet à ne pouvoir résister qu’en précipitant sa « ruine intérieure », à ne pouvoir défendre son honneur qu’en se faisant « monstre » (p. 34). C’est cette loi de l’ensauvagement, face cachée de l’intégration, qu’exprime également à sa manière le destin de Mehdi Meklat relaté dans le troisième chapitre du livre : histoire vraie d’un jeune de banlieue, un kid, « sage comme une image », adoubé par le gratin médiatico-littéraire blanc, qui, pour pouvoir supporter les « conflits de loyauté » que cette situation avait fait naître en lui, s’était inventé un « double maléfique », un monstre du nom de Marcelin Deschamps qui déversait sa haine antisémite, homophobe et sexiste sur Twitter, « cracha[nt] au visage » de ceux-là mêmes auxquels, parallèlement, son alter ego « rendait grâce » en public (p. 62).
Que faire dès lors de ces monstres ? Les réduire au silence signifierait se conformer à un rôle de victime, mieux de « larve » ; les faire grossir jusqu’à leur « céder[r] toute la place », à l’instar des terroristes passés à l’acte, c’est accepter et « acheve[r] le destin que l’Empire » a tracé par avance pour finalement s’accoupler incestueusement avec lui (p. 47-48). La réponse se trouve en réalité dans la formule de Baldwin « la prochaine fois, le feu », en tant qu’elle est le nom moins d’une menace, un ultime avertissement, que d’un défi : « risquer l’incendie tout en le dominant », œuvrer à ce que ce feu soit « tenu en respect sans jamais pourtant s’éteindre » ; autrement dit, sauvegarder et entretenir soigneusement une « barbarie intime, qui donne le courage de lutter, parfois contre ce feu même » (p. 54).
Mais ici une ambiguïté se fait jour. La barbarie apparaît simultanément dans le texte de Yousfi comme l’autre ou le dehors inassimilable de la civilisation, ce « “nous intact” que nous protégeons contre les assauts de l’intégrationnisme » (p. 47-48) et comme un rejeton immaîtrisable, rebelle et vengeur, de cette même civilisation, un effet pervers de l’intégration, l’envers de la barbarie de l’Empire lui-même (p. 53). Elle le dit on ne peut plus explicitement :
« [L]e barbare […] n’existe pas en antériorité à la civilisation, ni n’est une simple “absence de civilisation”. Il est le produit de cette civilisation, tout en ne s’y résumant pas. Il témoigne d’une mutation non programmée, non encodée du processus civilisateur. » (p. 23).
N’avons-nous pas affaire ici à une contradiction flagrante qui viendrait compromettre la cohérence théorique, et partant la consistance politique de la figure du barbare, qui s’avèrerait ainsi intrinsèquement brouillée ? Non, car c’est précisément dans ce nouage délicat et risqué des opposés que réside la plus grande originalité de la proposition de l’autrice, qui ne peut être pleinement saisie qu’à condition d’identifier l’enchevêtrement des temporalités qui s’y déploie. L’enjeu, soutient-elle dès son introduction est « moins de retrouver ce que nous étions que de résister à ce que nous devenons » (p. 21). En ce sens, cultiver la part barbare, indomptée, de soi, c’est aussi incessamment la recréer, la réinventer à partir de cela même que le grand œuvre de domestication de la civilisation a fait et fait aux sujets non-blancs, à partir donc des conditions engendrées par l’ensauvagement, contre et avec elles.
Dès lors, le barbare doit être conçu comme une « figure du futur, condamnée à venir » (p. 23). Plus précisément, le présent de la condition barbare se définit comme le lieu même d’une tension dialectique entre passé et avenir. Nul passage du livre de Yousfi ne le montre mieux que le chapitre qu’elle consacre au rap de Booba dont l’art pourrait se résumer à une leitmotiv : devenir « ce qu’il aurait dû être », sans « la catastrophe originelle », sans « le fracas de l’Occident sur les terres indiennes » ; redonner vie, sous le mode conditionnel, à des futurs passés, non advenus, au sein même du monde qui s’est construit sur leur forclusion brutale.
Si l’enjeu est de retisser « le fil d’[une] histoire » violemment interrompue par le « déracinement », c’est-à-dire l’intégration, avec la honte de soi qui en est le corollaire, cela ne peut se faire aux yeux de Booba, dans sa bouche, qu’en incarnant « le cauchemar de l’Occident : à la fois la réalisation de ses fantasmes racistes et leur conjuration » (p. 75) ; qu’en assumant, à l’instar des indiens Jivaros revendiquant leur renommée cannibale à la face des anthropologues, un « ensauvagement stratégique » (p. 77). Ce qu’il s’agit alors et de préserver et de constituer, c’est un « maquis intérieur » (p. 82), zone retranchée d’où la lutte pourra être menée ; ce qu’il s’agit de construire, dit encore Yousfi en puisant à présent dans les paroles de PNL, c’est un « empire intérieur, […] déclinaison nouvelle de cette “espèce de barbarie” katebienne » (p. 104) : un empire dans l’empire qu’il s’agit de subvertir pour pouvoir espérer le détruire. En un mot : rester barbare, c’est le devenir.
Le dire barbare
On manquerait cependant l’essentiel si on ignorait, comme le souligne Yousfi dès les premières pages à propos de Kateb Yacine, que la barbarie n’est une condition qui peut et doit être dite, énoncée, que dans la mesure où c’est aussi, et peut-être d’abord, un « lieu d’énonciation » (p. 13) : faire du barbare un objet de discours sans le rétablir dans sa dignité de sujet parlant ne serait, quels que soient les jugements proférés, qu’une nouvelle manière de le domestiquer. Il faut donner droit de cité au point de vue barbare. C’est ce que fait l’autrice dans les deux derniers chapitre du livre, sur le rap, en tant que s’y édifierait une « nouvelle mythologie de la condition barbare » (p. 25), laquelle, chez Booba, et pour introduire une autre figure liminale de la civilisation, s’incarne dans la réactivation d’une « légende pirate » (p. 89).
Dans des passages saisissants, Yousfi déclare que la manière qu’a le rap de glaner et mélanger avec « désinvolture » les références culturelles les plus diverses, parfois les plus contradictoires, souvent les plus vulgaires, en s’interdisant de les hiérarchiser, ne peut être définie que paresseusement comme la preuve de sa « soumission à la logique commerciale » ; car c’est avant tout le fruit d’une volonté d’ « assume[r] complètement » la « trivialité du monde » en refusant de « s’en laver ». Ce faisant, le corpus des œuvres du rap endosse la structure du mythe : « kaléidoscope qui puise ses sources de lumière dans tous les univers culturels et hétérogènes d’une société, les rendant – c’est là sa magie – compatibles et équivalents dans un ensemble étonnamment cohérent » (p. 79). Ce faisant encore, les personnages du rap, pénétrant à grand bruit dans « l’Histoire du monde », empruntent les traits des « barbares au sens homérique », venus des confins de la civilisation pour y exercer leur puissance de fascination plus encore que de destruction (p. 80).
Le mythe, comme vecteur d’auto-agrandissement, est en définitive une manière privilégiée de « se raconter dans un monde qui nous ratatine » (p. 80). Il est ce qui « fait émerger du néant tout un monde intérieur venu des marges de l’Empire ( p. 78) ; il pose les bases d’un « grand récit des marges de l’Empire » (p. 93) qui seul peut contrecarrer le grand récit de la modernité occidentale, forgé au centre de l’Empire, et dont la disparition annoncée ne s’est guère produite que dans les cénacles universitaires (et encore…). Or, ce contre-récit barbare ne rechigne pas, l’exemple de PNL en témoigne, à s’emparer du « champ lexical de la sauvagerie » (p. 93). « Multipliant les métaphores sur le règne animal », se jouant de son ensauvagement, le duo aspire, dans ses termes même, à « redevenir la bête » (p. 94).
Cependant, si le dire barbare dispose dans son arsenal de l’arme du retournement du stigmate, il ne s’y limite pas, ainsi que le prouve, dans le cas de PNL encore, la mise en place d’une « stratégie narrative inverse » démontrant, au prix d’une tension extrême et sans jamais céder aux « bons sentiments de la civilisation », qu’ « être barbare » et « être sensible », « [s]e raconter en barbare » et « se raconter en humain », ne sont nullement incompatibles (p. 95-96) ; stratégie qui, en d’autres termes, démontre que le barbare a une « âme » non pas en dépit de sa barbarie, mais en vertu d’elle : une âme de barbare, c’est-à-dire une « âme bousillée » (p. 96) se donnant pour mission d’exprimer « la dignité des parasites de ce monde » (p. 103). Ce que révèle à nouveau la « dialectique des destins mêlés » faisant du petit frère cette « figure de l’innocence qui persiste sous des couches de misère morale », cela même qui « n’a pas encore été touché par la salete du monde » (p. 97), c’est que la barbarie qu’il faut prémunir de la contamination et celle qui en est l’effet ne sont au fond qu’une seule et même chose.
Dès lors, Yousfi peut réinvestir, pour le repeindre autrement, le portrait classique du barbare comme l’homme, ou plutôt le non-homme qui parle une autre langue (que le Grec, le civilisé). Si, comme le savait déjà Kateb Yacine, la langue française avait été un des instruments les plus puissants de la domestication des barbares, lui-même était parvenu à se l’approprier comme – la formule est devenue célèbre – un « butin de guerre », afin de la retourner contre les fins civilisatrices-colonisatrices qu’elle servait (p. 13, 15).
Or, ce qui a lieu dans le rap, ce en quoi il fait ou mieux est « événement », ce en quoi il demeure insaisissable pour les analystes qui y cherchent désespérément un style littéraire (nouveau mais néanmoins inscriptible dans une noble tradition) et/ou un message politique (original mais néanmoins traductible dans la langue militante), ce n’est rien de moins qu’une « aliénation » de la langue allant jusqu’à sa« destruction» (p. 85-86). Mais ce qui se joue dans le même temps, c’est l’invention d’une autre langue, « avec ses propres codes », « conçue sur mesure », pour que s’y « archive comme une conscience barbare » (p. 83, 92). Dès lors, le rappeur fait figure de « barbare littéral » (p. 88) : il est conforme à la lettre de sa définition parce que les lettres sont ses armes. Là encore, l’altérité barbare est ce qui ne peut être gardée, rester, qu’à condition d’être continuellement récréée en partant à l’assaut de la citadelle civilisationnelle.
Il convient toutefois de ne pas se masquer les conséquences des thèses qui précèdent pour les « esprits chagrins » de la critique. Yousfi le répète : le rap ne « cherche rien à leur dire » car cela le condamnerait à « revenir dans le giron de la langue-empire » (p. 87) ; consacrant « l’appartenance au groupe, l’appartenance au sang » (p. 92), seul moyen de défendre la « famille barbare » de la « guerre sourde » que lui livrent « les lois du dehors » (p. 50), le rap « ne fait aucun pas vers l’autre » (p. 92) ; il se veut d’emblée « rupture fondamentale avec l’ennemi » (p. 93).
Or, ne devrait-il pas naturellement en aller de même du livre de Yousfi ? Cette question n’est pas rhétorique dans la mesure où, les citations que nous avons faites en attestent, l’autrice fait un usage immodéré du « nous » – au point où elle peut quasiment se passer des termes consacrés pour désigner son référent à la troisième personne : indigènes, immigrés, non-Blancs. Quant aux autres, Blancs, ils sont (plus rarement) apostrophés via un « vous » incriminateur ; ainsi pour rendre la posture de PNL : « Ne cherchez pas plus loin. Cet univers n’est pas fait pour vous et personne ne pourra vous l’expliquer […] » (p. 92).
La question qui se pose, et qu’on ne saurait éluder, est par conséquent celle de l’adresse du livre, cette même question que soulevait déjà Jean-Paul Sartre en 1961 à propos des Damnés de la terre de Frantz Fanon : « Européens, ouvrez ce livre, entrez-y. Après quelques pas dans la nuit, vous verrez des étrangers réunis autour d’un feu, approchez, écoutez : ils discutent du sort qu’ils réservent à vos comptoirs, aux mercenaires qui les défendent. Ils vous verront peut-être, mais ils continueront de parler entre eux, sans même baisser la voix. »
Si les Européens, les Blancs, pouvaient néanmoins gagner quelque chose de la lecture du livre de Fanon, qui n’est « pas écrit pour nous », c’est, disait Sartre employant stratégiquement à son tour la deuxième personne du pluriel, la possibilité « de vous découvrir à vous-mêmes dans votre vérité d’objet » [3]. Nous pourrions tirer plus ou moins les mêmes conclusions du livre de Yousfi, plus encore sans doute que de toute autre texte produit à ce jour, en milieu francophone, par ces « barbares revendiqués » que sont les « décoloniaux » (p. 21).
Il nous semble pourtant qu’il y a à la fois moins et plus que cela dans Rester barbare, ainsi que le suggère la confession de l’autrice dans sa conclusion : « J’ai écrit ce livre parce que j’ai échoué. Je ne suis pas restée barbare. Je suis une bonne élève de la République, une bonne indigène aux cheveux lissés et à la langue domestiquée » (p. 110). Ces mots sont le point d’orgue d’une réflexion sur les dilemmes que suscitent le fait d’ « écrire en tant que femme issue de l’immigration » (p. 105), plus spécifiquement sur les difficultés rencontrées pour s’affranchir d’un « désir d’universel » qui certes les habilite à parler des leurs, mais cela à la condition expresse de parler « pour tout le monde » : « L’universel se gave et nous recrache aussitôt » (p. 108-109).
C’est dans le but de « décliner la stratégie du rester-barbare au féminin », du moins d’initier cette tâche, que Yousfi s’est tournée vers les rappeurs, c’est-à-dire vers des hommes, réputés pour ne pas être toujours très courtois envers les femmes. Paradoxe ? Non, car, comme elle l’affirme, ils ont parlé « [n]on pas de moi, mais pour moi » (p. 110). Mais il est alors loisible de retourner la question à Yousfi elle-même : pour qui parle-t-elle des rappeurs et autres barbares ? La réponse paraît évidente : elles parlent d’abord et avant tout pour celles et ceux qui, comme elle, sont coincé.es, tiraillé.es, moins entre deux mondes, « deux cultures », deux rives », comme on le dit flatteusement pour mieux pouvoir les plaindre de ce statut de « trait d’union » (p. 23), qu’entre la barbarie et l’intégration, ni plus ni moins « civilisées » l’une que l’autre mais entre lesquelles n’existe nulle passerelle.
Cependant, par là-même, et comme par effet collatéral, Yousfi médie aussi auprès du lectorat blanc la parole des barbares médisants ; elle lui explique ce que ces derniers lui ont enseigné. Si elle ne lui parle pas, elle donne à se faire entendre par lui, sous la guise d’une interpellation lui parvenant en écho. Cette interpellation, c’est la tâche de la gauche blanche que de l’écouter et d’y répondre sans se renfrogner en y percevant une insulte, sans se sentir blessé dans son amour-propre parce qu’elle se sent (à raison) visée, mais sans se faire d’illusion non plus sur l’éventualité d’une réconciliation prochaine.
La tâche est urgente, plusieurs occasions ont déjà été manquées et elles pourraient se faire de plus en plus rares, car un programme plus radical encore se dessine déjà : « traduire la légende pirate dans notre réalité politique » (p. 72), « imaginer comme un destin littéraire du rap » qui trouverait à s’inspirer de l’exemple de ces figures « de l’islam médiéval qu’on appelait les malâmatîs, les “gens du blâme” » (p. 111) ; et qui sait, se permettra-t-on d’ajouter pour conclure, déjouer la langue du savoir universitaire, l’aliéner et la détruire de l’intérieur : barbariser la théorie… après quoi, le type d’exercice auquel je me suis sagement livré ici deviendra impossible.
Notes
[1] Sadri Khiari, Pour une politique de la racaille. Immigré-e-s, indigènes et jeunes de banlieue, Paris, Textuel, 2006 ; Sadri Khiari, La contre-révolution en France. De de Gaulle à Sarkozy, Paris, La fabrique, 2009 ; Houria Bouteldja, Les Blancs, les Juifs et nous, Paris, La fabrique, 2016 ; Norman Ajari, La dignité ou la mort. Éthique et politique de la race, Paris, La Découverte, 2019.
[2] « Il n’y a pas de barbare sans une civilisation qu’il cherche à détruire et à s’approprier. […] Le barbare, à la différence du sauvage, ne repose pas sur un fond de nature auquel il appartient. Il ne surgit que sur un fond de civilisation contre lequel il vient se heurter. » (Michel Foucault, Il faut défendre la société, Cours au Collège de France, 1976, Paris, Gallimard, Seuil, 1997, p. 174).
[3] Jean-Paul Sartre, « Préface » à Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, Paris, Gallimard, 1991 (1961), p. 43 ; sur cette question, voir aussi Judith Butler, « Violence, non-violence : Sartre à propos de Fanon », trad. I. Ascher, Actuel Marx, 2014/1, n° 55, p. 12-35.