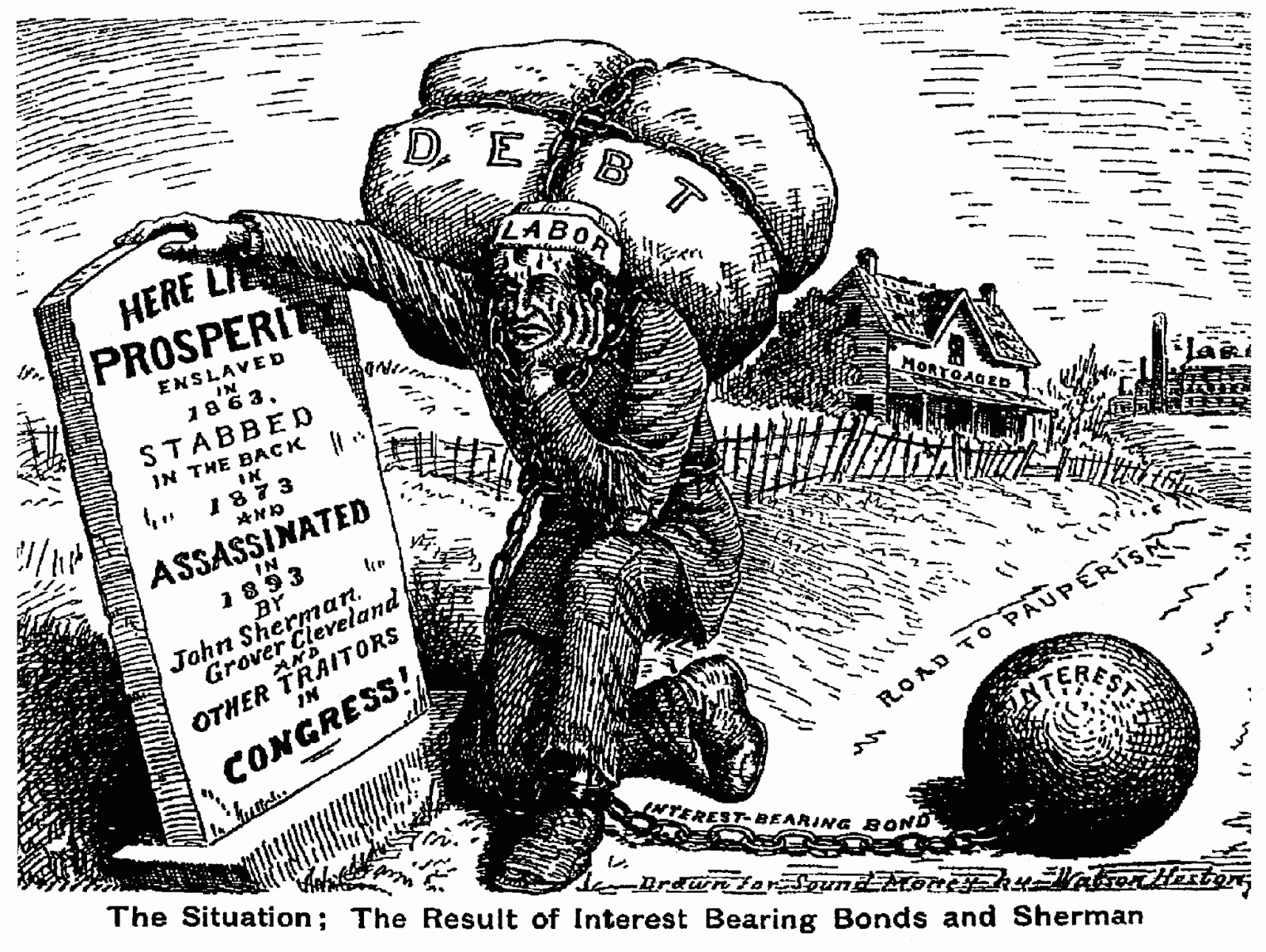
D’où vient le populisme ? Extrait du livre de F. Tarragoni
Federico Tarragoni, L’esprit démocratique du populisme, Paris, La Découverte, 2019.

Populisme. Depuis plusieurs années le mot parcourt les discours politiques, les interventions médiatiques et les analyses pseudo-savantes. Il sert à désigner divers phénomènes, politiques ou non, et le plus souvent à discréditer ceux qu’on désigne par ce terme.
Dans son ouvrage L’esprit démocratique du populisme, Federico Tarragoni déconstruit les usages dominants de « populisme » et en propose une interprétation étroitement liée à la question démocratique. Et s’il s’aventure dans les débats politiques et scientifiques contemporains, il prend soin de retracer les expériences historiques qui se sont revendiquées du populisme.
C’est en particulier l’objet du chapitre 3, « Les populismes à leur source » où l’auteur retrace les expériences fondatrices du populisme au 19ème siècle, aux États-Unis et en Russie, puis il revient sur ce qu’il désigne comme un simulacre de populisme travers dans le cas français du Boulangisme
***
Chapitre 3 – Les populismes à leur source
« La conceptualisation des phénomènes historiques […] n’enchâsse pas […] la réalité dans des catégories abstraites, mais s’efforce de l’articuler dans des relations génétiques concrètes qui revêtent inévitablement un caractère individuel propre » (Max Weber, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Plon, 1964, p. 44).
Lorsqu’on cherche à reconstruire un concept à partir de ce qu’il décrit historiquement, deux problèmes apparaissent d’emblée. Le premier est que souvent le concept est un agrégat portant la trace de sa naissance et de ses élaborations successives, tel des strates de significations qui se sédimentent dans le temps[1]. C’est le piège de l’anachronisme : faire dire au passé ce que le concept, produit de ses évolutions et de ses usages, dit au présent[2]. Le deuxième problème est celui de la comparaison. Comme toute idéologie politique – le libéralisme, le socialisme, l’anarchisme ou le communisme –, le populisme apparaît à différents moments de l’histoire contemporaine et à différents endroits du globe. L’histoire commence tout juste à s’intéresser à ces échos et ces circulations qui expliquent qu’une même manière de faire de la politique se retrouve d’un côté et de l’autre de la planète. Comment comparer dès lors des populismes apparaissant, à des moments et dans des contextes radicalement différents, aux quatre coins du globe ?
Il n’est pas possible de débuter l’enquête historique sans résoudre ces deux problèmes épineux. Il faut donc faire, comme y invitait Michel Foucault, une brève archéologie de ce concept voyageur qu’est le populisme. C’est en sachant ce qu’il veut dire de par son histoire, qu’on pourra le reforger pour décrire, analyser et comparer à nouveau des expériences du passé.
Archéologie d’un concept multi-strate
Comme le fut au xixe siècle l’individualisme, le populisme est aujourd’hui, pour paraphraser Tocqueville, « une expression récente qu’une idée nouvelle a fait naître[3] ». Le mot apparaît pour la toute première fois, vers 1870, en russe pour décrire un courant socialiste tourné vers la paysannerie (narodnitchestvo, de narod « peuple »). Vingt ans après, en 1891, il fait son entrée dans la langue anglaise (« populism »). Les journaux états-uniens de la fin-de-siècle inventent ce néologisme pour décrire un nouveau parti composé de fermiers ruinés, non loin de l’exemple russe : le People’s Party[4]. Enfin, il apparaît en français, dans le Larousse de 1907, comme traduction du russe. Il désigne ici « tout membre d’un parti prônant des thèses de type socialiste en Russie[5] ». Cependant – c’est toute la spécificité de sa réinvention française –, le mot sort rapidement du champ politique pour entrer dans la sphère esthétique. Il est repris, en 1929, par Léon Lemonnier pour désigner l’avant-garde littéraire dont il écrit le manifeste : le « roman populiste »[6]. Inspirée de Balzac et Zola, cette avant-garde vise à élargir l’espace de la représentation romanesque, dominé par la psychologie bourgeoise, à la morale et à la pensée des « gens du peuple »[7]. Elle se dote aussitôt d’un prix qui sera décerné, entre autres, à Jean-Paul Sartre et à Louis Guilloux. À cause de l’évolution péjorative du terme populisme, le prix est renommé en 2012, du nom de son premier lauréat, le « Prix Eugène Dabit ».
Un lien existe entre ces deux moments de l’histoire universelle du mot, le moment politique et le moment esthétique. Tout d’abord, les populistes russes, comme leurs homologues états-uniens, sont des intellectuels qui cherchent à nouer une révolution culturelle et une révolution politique. Il suffit de penser à ces deux figures tutélaires que furent le russe Alexandre Herzen et l’américain Ignatius Donnelly, tout à la fois écrivains romantiques et socialistes utopiques. Il n’est donc pas anodin que Léon Lemonnier ait repris ce terme à son compte. Ensuite, tant du côté politique que du côté esthétique, le terme est pensé à partir de la question du peuple démocratique. Les populistes russes et états-uniens cherchaient à développer une conscience sociale dans la paysannerie opprimée, afin de l’inciter à se soulever et à lutter pour la démocratie. Les romanciers populistes chercheront, de leur côté, à démocratiser la littérature en l’ouvrant à toutes les formes sociales de vie, et notamment à la vie du peuple[8].
Lorsque le mot fait son entrée dans les sciences sociales comme concept, cette jonction avec le peuple démocratique est maintenue, mais pour un très court laps de temps. L’un des premiers ouvrages cherchant à définir scientifiquement le populisme à partir de son histoire est consacré, une fois de plus, au cas russe. C’est le livre de l’historien italien Franco Venturi, publié en 1952 sous le titre Il populismo russo et traduit en français, vingt ans plus tard, sous celui trompeur de Les Intellectuels, le peuple et la révolution[9].
À l’instar du Larousse de 1907, Franco Venturi construit le concept de populisme à partir d’une expérience historique qui s’est nommée comme telle en son temps, et qui en est donc réellement constitutive : le narodnitchestvo. Le mot décrit des intellectuels (la fameuse « intelligentsia »), des petits notables (avocats, médecins) et des étudiants qui, enthousiasmés par le Printemps des peuples européens de 1848, souhaitent « aller » vers leur propre peuple, la paysannerie russe, pour la mobiliser contre le tsar. Ils se définissent comme des « démocrates révolutionnaires ». Herzen, Bakounine, Tchernychevski, Lavrov, Tkachëv : dominé par ces grandes figures intellectuelles, le populisme russe s’apparente, selon Venturi, à une glorieuse « page d’histoire du mouvement socialiste européen[10] ».
Ce lien au contexte russe est toutefois rapidement oublié. Quatre ans seulement après la publication de Il populismo russo, en 1956, le sociologue américain Edward Shils bâtit de toutes pièces une nouvelle définition du populisme[11]. Contrairement à Venturi, qui avait patiemment accumulé un immense matériau historique exposé sur près de mille pages, Shils est pressé. Il ne s’encombre ni de la rigueur empirique, ni de l’administration de la preuve. Il impose, à proprement parler, une définition anhistorique du populisme, commandée uniquement par son jugement subjectif sur l’actualité immédiate. Ce geste préfigure celui qu’accomplira, quarante ans plus tard, la populologie : le populisme va désormais pointer un danger imminent, celui-ci servant à définir, en retour, le phénomène lui-même.
Ici, le danger s’appelle Joseph McCarthy. Effrayé, à juste titre, par sa chasse aux sorcières et son anti-intellectualisme, Shils les impute tous deux à une « idéologie du ressentiment populaire » : « il y a populisme, écrit-il, à chaque fois qu’il existe une idéologie du ressentiment populaire, orientée vers un “ordre” imposé par une classe dirigeante établie et plurielle, que l’on croit pouvoir disposer du monopole absolu du pouvoir, de la propriété, de la reproduction sociale et de la culture[12] ». Cependant, l’explication sociologique du « ressentiment populaire » qui légitimerait cette idéologie reste, quant à elle, très vague, surtout pour un sociologue wébérien comme Shils. Considéré le moteur éternel du populisme, le ressentiment populaire se nourrirait, selon Shils, de tout type de frustration, qu’elle soit due à l’inassouvissement d’un désir d’ascension sociale, d’enrichissement, de reconnaissance symbolique, d’élévation culturelle ou spirituelle, ou encore d’épanouissement sexuel. Le psychologisme devient ainsi la caution d’un usage purement normatif de la catégorie. Parler de « populisme » permet d’alerter l’opinion publique sur les dangers du maccarthysme, chose très louable, mais aussi d’en attribuer la responsabilité aux classes populaires jugées frustrées, chose très contestable.
Cette réinvention normative du populisme fait rapidement des émules. La nouvelle sociologie fonctionnaliste s’en saisit très vite. Elle fait de ce populisme réinventé une véritable anomalie du processus de modernisation. Dans les sociétés de masse comme les États-Unis des années 1950, le maccarthysme apparaît comme la manifestation dysfonctionnelle et illibérale de ce même conformisme social qui faisait fonctionner, via la consommation, la société industrielle[13]. En Amérique latine, un sociologue formé aux théories fonctionnalistes, Gino Germani, regarde du même mauvais œil l’arrivée au pouvoir de Juan Domingo Perón en 1946. Il nomme ce régime « populiste » en expliquant, comme les fonctionnalistes, son émergence par deux processus concomitants : une modernisation anormale, car trop violente, inachevée et asynchrone (l’économie s’étant développée plus vite que le système politique, et en laissant « à la traîne » les masses populaires) ; la captation, comme dans le maccarthysme, des « attitudes autoritaires des classes populaires »[14].
Entre le début et la fin des années 1950, le populisme change ainsi totalement de signification. À son sens originaire, indexé à l’expérience révolutionnaire et démocratique russe, se superpose une nouvelle strate de sens, arrimée au chapitre maccarthyste. La phase suivante sera la relecture intégrale du passé à l’aune de cette nouvelle signification. En témoigne l’analyse du People’s Party (1877-1896) qui s’élabore dans ces mêmes années. Alors que ce mouvement progressiste de fermiers états-uniens avait peu intéressé les sciences sociales jusque-là (à l’exception de l’histoire sociale), car éphémère et sans effets immédiats sur la politique américaine, il est désormais sous tous les projecteurs. Seymour Martin Lipset, fondateur de la science politique états-unienne, enjambe alors le pas à Shils : comme le peuple du sénateur McCarthy, écrit-il, celui du People’s Party était aussi extrémiste, bigot, raciste et passéiste[15]. Les deux peuples partageraient la même histoire : celle du long « radicalisme de droite » (right-wing extremism or radicalism) qui traverse la modernité américaine et qui devient synonyme de populisme[16]. Étrange mésaventure pour un concept qui était né pour décrire un radicalisme plébéien de sens strictement opposé, celui des narodniki russes. Des intellectuels libéraux comme Richard Hofstadter et Daniel Bell valideront cette interprétation rétrospective, en affirmant que l’adhésion populaire à des messages politiquement radicaux s’explique essentiellement par l’usage d’une rhétorique persuasive, fondée sur le conspirationnisme et les théories du complot[17].
Enfin, un dernier jalon dans l’histoire du concept de populisme constitue une révolution paradigmatique majeure. Entre la fin des années 1960 et le début des années 1980, une nouvelle école voit le jour entre la Grande-Bretagne et l’Amérique latine, autour des travaux comparatistes de Ghita Ionescu, Ernest Gellner, Isaiah Berlin, Margaret Canovan, Torcuato S. di Tella et Hélio Jaguaribe. Nous l’avons déjà évoquée dans le chapitre précédent comme un courant fondateur dans les études sur le populisme. Et il le fut en effet, car il inaugura une véritable réflexion collective sur la nature du phénomène, visant à en produire une théorie générale. Nous l’appelons ici l’« école comparatiste ».
Pour la plupart d’entre eux issus de la science politique, ces nouveaux théoriciens se posent la question qu’aucun sociologue fonctionnaliste ne s’était posée auparavant. Que désigne exactement le concept de populisme ? Renvoie-t-il à une spécificité de la politique continentale américaine, tant au Nord qu’au Sud, ou un « spectre populiste » hante-t-il toutes les sociétés contemporaines du monde[18] ? En mobilisant une vaste palette de spécialistes d’aires culturelles différentes, en confrontant des expériences passées et présentes, d’ici et d’ailleurs, cette école ajoute une troisième et dernière signification au concept de populisme : sa « criticité démocratique ». Autrement dit, le fait qu’il apparaît toujours dans un contexte de crise de l’ordre politique institué, en concomitance avec des mouvements populaires qui le critiquent en vertu de sa faible « démocraticité ». Plus précisément, le populisme se saisit d’un conflit dans lequel une définition utopique ou « rédemptrice » (redemptive) de la démocratie est opposée, terme à terme, à une définition procédurale ou « pragmatique » (pragmatic) du gouvernement (y compris, et surtout, lorsque celui-ci est démocratique)[19]. La première définition fédère des mouvements sociaux très hétérogènes en leur sein ; la deuxième structure la résistance des classes dirigeantes, qu’elles soient économiques, politiques ou culturelles[20]. Les différents types de mouvements sociaux donneront lieu, par contre, à une longue liste de variantes du populisme dans le monde (populisme « agrairien », populisme « politique », populisme « réactionnaire », populisme « politicien », etc.[21]). C’est le principal écueil de l’école comparatiste, et la raison de son déclin.
Un programme wébérien : l’éthique démocratique et l’esprit du populisme
Trois strates de significations apparaissent donc clairement dans le concept de populisme. La signification originaire, construite par les historiens dix-neuviémistes, est indexée sur l’expérience russe et met en avant la dimension révolutionnaire, plébéienne et radicalement démocratique du phénomène. Une autre signification, construite par la sociologie fonctionnaliste dans les années 1950 et 1960, est indexée sur le maccarthysme et met en avant sa dimension autoritaire. Une dernière signification enfin, construite par la science politique dans les années 1960 et 1970, est indexée sur une comparaison globale et transhistorique, et met en avant sa dimension critique (au double sens de crise politique et de critique envers l’ordre établi).
Reprenons maintenant la question qu’on posait au début de ce chapitre. Pouvons-nous nous emparer d’un concept aussi « stratifié » pour décrire, sous un jour nouveau, des expériences du passé ? Peut-on le reprendre, alors qu’il n’a pas cessé d’être redéfini au gré d’une actualité toujours changeante ? Comment éviter l’anachronisme ?
La réponse nous vient de Max Weber. En effet, la position du « populisme » aujourd’hui ressemble de très près à celle du concept de « capitalisme » à son époque. Lorsque Weber s’apprête à écrire L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme au début du xxe siècle, le mot « capitalisme » n’existe que depuis une cinquantaine d’années : il a été introduit vers 1850 en France par Louis Blanc, dans son Organisation du travail[22]. Il est toutefois déjà pratiquement inutilisable, du fait de sa naissance comme concept péjoratif, et de la prolifération, tout au long de la deuxième moitié du xixe, d’usages idéologiques, polémiques et contradictoires. Comme le populisme, justement ! Weber trouve une solution originale à ce problème : l’évolution pluriséculaire que le capitalisme peut décrire d’un point de vue sociologique (son « esprit culturel »), écrit-il, va bien au-delà de ses quelques décennies de vie en tant que concept polémique. Il faut alors se plonger dans le passé, et tenter de reconstruire une trame de processus sociaux que ce mot pourrait qualifier en tant que concept sociologique. Une telle trame décrirait, justement, la genèse sociale du capitalisme et donc, sinon sa « véritable » nature, du moins son image idéal-typique[23].
Il faut faire aujourd’hui exactement la même chose avec le populisme. Si ce terme décrit quelque chose de notre modernité politique, c’est qu’il permet d’analyser, en son sein, l’évolution de notre condition démocratique. C’est la grande découverte de l’école comparatiste : l’opposition, typique du populisme, entre « esprit rédempteur » et « esprit pragmatique » de la démocratie représentative[24]. Faire l’histoire du populisme c’est donc retracer dans le passé des phénomènes où cette opposition soit parfaitement visible, et par leur entremise analyser l’évolution de nos démocraties représentatives. Voilà ouverte l’enquête historique ; mais il faut en contrôler d’emblée l’étendue, au risque de comparer trop de choses, et de tomber dans les mêmes travers de l’école comparatiste[25]. La solution est, dans les termes wébériens, le « comparatisme restreint[26] ». Il s’agit d’identifier un noyau central, une expérience historique faisant office de véritable matrice du populisme, pour dégager ensuite, de comparaison en comparaison, un idéal-type du phénomène. Il nous faut donc trouver une expérience ayant, pour le populisme, le même statut méthodologique que le protestantisme du xviie siècle pour le capitalisme tel qu’analysé par Weber. Quelle autre expérience choisir sinon le narodnitchestvo ? Il s’agit du premier moment dans l’histoire où des acteurs se sont définis et pensés, et ont agi comme populistes ; le premier moment qui a été analysé a posteriori comme populisme par l’historiographie ; la première expérience sur laquelle toutes les théories du populisme convergent. Le choix s’impose par la force de l’évidence.
Mais quelles expériences comparer au narodnitchestvo ? Et comment comparer, du coup, des phénomènes qui ont eu lieu dans des espaces-temps différents ? Se pose le problème de la validité proprement historique de la comparaison. Ici aussi, le programme de Max Weber nous vient en aide. Lorsqu’il chercha à comparer, à travers un « comparatisme élargi », les dispositions économiques façonnées par les différentes religions du globe, il savait pertinemment que ces dispositions avaient surgi dans des contextes très éloignés, qu’elles revêtaient des fonctions distinctes et qu’elles n’étaient pas forcément entrées en contact entre elles. Les croyants qui accumulaient, travaillaient, calculaient ou dépensaient aux quatre coins du globe vivaient à plusieurs siècles, voire millénaires de distance[27]. La comparaison était toutefois pleinement justifiée par l’existence d’un même « esprit » entre toutes ces pratiques : justement, leur rationalité instrumentale, plus ou moins développée selon les contextes culturels. Ces différents groupes sociaux de croyants étaient, pour Weber, les « Träger » (« couches porteuses ») des idées religieuses et de leur traduction économique. C’est par leur intermédiaire que les croyances ont eu une influence déterminée dans le développement de l’économie aux quatre coins du globe. Comme l’écrit Stephen Kalberg, « [chez Weber] les idées ne constituent des forces causales puissantes dans le processus de changement social que dans la mesure où elles sont « portées » par des groupements, des strates sociales ou des organisations particuliers et influents[28] ».
Cette démarche est très heuristique pour le populisme. Nous ne disposons, au départ, que de l’expérience russe : la seule qui puisse être analysée comme un véritable populisme. C’est notre matrice : une grande mobilisation sociale qui visa, dans un contexte de crise politique, à faire émerger un peuple démocratique des groupes subalternes, mais qui fit très vite l’expérience douloureuse du décalage entre le peuple rêvé et les aspirations réelles de la paysannerie. Avec cette image analytique à l’esprit, il faut ensuite observer d’autres expériences historiques dans lesquelles d’autres groupes sociaux, ayant d’autres coordonnées culturelles, ont agi avec le même type de rationalité politique : constituer un peuple démocratique à partir des groupes subalternes, et opposer une démocratie rêvée, que le peuple doit reconstruire, à la démocratie réelle, qu’on juge gangrénée par les élites. Pour être comparables au narodnitchestvo, il faut que ces expériences apparaissent dans un contexte similaire de crise de l’ordre politique institutionnel et d’intense mobilisation sociale. Sans être les seuls cas à respecter ces critères, le People’s Party états-unien (1877-1896) et les populismes latino-américains (1930-1960) semblent les plus significatifs. C’est à travers cette comparaison triangulaire qu’on pourra dégager un idéaltype du populisme. Au sens wébérien, ce sera un « tableau de pensée homogène[29] » du phénomène qui en soit également une explication sociologique.
Nous arrivons à la première grande hypothèse qui guide notre enquête comparative. En paraphrasant Weber, on pourrait l’énoncer comme suit : tout comme l’esprit du capitalisme, c’est-à-dire sa genèse socio-historique, vient de l’éthique protestante (les valeurs créées par cette doctrine religieuse), l’esprit du populisme puise à l’éthique démocratique, autrement dit aux valeurs issues de l’institutionnalisation des démocraties représentatives modernes. En d’autres termes, tout comme les bâtisseurs du capitalisme furent des groupes sociaux se saisissant des valeurs ambivalentes du protestantisme, les fondateurs du populisme furent des groupes sociaux s’emparant de l’ambiguïté des valeurs démocratiques. Mais on nous rétorquera aussitôt : le populisme n’eut pas le monopole des valeurs démocratiques. Cette relation n’est-elle pas observable pour d’autres idéologies politiques, comme le libéralisme, l’anarchisme, le communisme ou le socialisme, qui ont puisé, chacune à sa manière, à l’éthique démocratique ? Certainement. Mais la grande différence avec le populisme, c’est que ce dernier n’a jamais été systématisé dans une philosophie organique, dans un programme politique, dans un manifeste stratégique. Et pour cause : car il ne s’est pas réalisé historiquement comme une suite de mouvements politiques structurés, avec un programme et des objectifs, comme le furent les mouvements libéraux, anarchistes, communistes ou socialistes. Son histoire est plutôt celle d’un ensemble de moments critiques de la démocratie représentative, que celle-ci reste à fonder, comme chez les narodniki, ou soit jugée tragiquement incomplète, comme dans le People’s Party et le populisme latino-américain. Ce statut du populisme comme moment critique est la deuxième grande hypothèse qui guide notre enquête comparative. C’est le dernier point qu’il nous reste à élucider avant de la débuter à proprement parler.
Des moments, non des mouvements
Nous disions plus haut que l’école comparatiste s’englua dans une taxinomie sans fin des variantes du populisme dans le monde. Cet écueil était lié à la modalité spécifique de la comparaison. Là où ce livre propose de suivre la voie du comparatisme sociologique de Max Weber, cette école crut pouvoir mener une comparaison globale, sans toutefois jamais se détacher de la spécificité irréductible des contextes nationaux[30].
Mais il y a une autre raison à cet écueil. Les tenants de l’école comparatiste, et notamment Margaret Canovan, défendirent en effet deux propositions méthodologiquement contradictoires : le populisme leur apparut comme un phénomène de crise des démocraties représentatives ; il semblait désigner, par là même, les différents mouvements politiques se saisissant de cette crise. Si la première affirmation est vraie historiquement et ouvre à la comparaison, la deuxième est invérifiable et la voue à l’échec. Car les réponses données aux crises démocratiques par des mouvements socialistes, anarchistes, communistes ou fascistes, ouvriers ou agrairiens, nationalistes ou internationalistes, dans des espaces-temps différents, sont proprement incomparables. Ces mouvements socio-politiques ne sont pas assimilables du simple fait qu’ils apparaissent dans des contextes de crise qui, eux, le sont. C’est l’un des principaux écueils de toutes les théories du populisme, et ce jusqu’à nos jours. On assume que le populisme est à la fois un phénomène de crise et l’ensemble des réponses radicales ou extrêmes à cette crise, de gauche et de droite, même si une telle hypothèse astreint à des comparaisons historiques totalement acrobatiques. Cela rend inévitable le tropisme de la « taxinomie infinie ». Car en comparant trop de choses, et des choses foncièrement incomparables, on finit toujours par lister un nombre infini de singularités irréductibles, et perdre de vue ce qui fait l’« unité du phénomène », sa cohérence profonde[31].
Et si la seule proposition correcte pour mener une comparaison rigoureuse était la première, et non la seconde ? Et si le populisme ne définissait aucune classe de mouvements politiques, mais bien plutôt un type de moment critique de la démocratie ? Cela nous demande un petit effort d’imagination conceptuelle. Il s’agit d’abandonner la facilité de raisonnement consistant à voir de la politique uniquement là où il y a des organisations politiques (des administrations, des partis, des associations, des syndicats, des ONG, etc.) ou de l’action collective organisée (des mouvements sociaux, des grèves, des sit-in, etc.)[32]. Suivant ce tropisme, si l’on assume que le populisme est un phénomène de crise, il ne peut que désigner le type de mouvement social et politique que la crise génère. Or, nous savons qu’il existe souvent une distance considérable entre les aspirations politiques qui voient le jour pendant un moment de contestation, les différents mouvements sociaux qui s’en emparent, et leur canalisation dans la politique institutionnelle. Mai 68 est un exemple en la matière[33].
Dire que le populisme est un type de crise et un type de mouvement politique nous conduit ainsi à confondre trois classes d’objets. La première est la classe des crises ; la deuxième, la classe des mouvements sociaux et des répertoires contestataires ; la troisième, celle des organisations politiques. Les effets politiques produits par ces trois classes de phénomènes, même s’ils peuvent parfois converger, sont différents et fondamentalement incomparables. Les premiers agrègent les aspirations utopiques et les critiques de la domination qui voient le jour dans un moment de crise de l’ordre politique institutionnel, dont il s’agit d’étudier les causes, les modes de gestation et la résilience dans l’espace social[34]. Les deuxièmes relèvent de l’organisation, de la fédération et de la publicisation de ces aspirations et critiques[35]. Les troisièmes, enfin, de leur transformation dans le cadre des luttes de pouvoir traversant les gouvernements représentatifs[36].
Confondre ces trois classes de phénomènes et d’effets derrière une même définition du politique conduit à se méprendre particulièrement sur les premiers. Car cela amène à penser les causes, la genèse et les effets d’une crise politique, ainsi que sa temporalité propre, en relation aux transformations postérieures qu’elle est censée avoir induites dans le système politique (suivant le principe « post hoc, ergo propter hoc »)[37]. Or, une crise politique peut donner lieu à toutes sortes de mouvements sociaux et, surtout, à toutes sortes d’effets institutionnels, à court, moyen et long terme, dont certains complètement imprévisibles, voire même antinomiques à ceux que les acteurs contestataires avaient escomptés ou souhaités (suivant le principe wébérien du « paradoxe des conséquences »[38]). Entre la fin du xixe siècle et les années 1930, de nombreuses crises démocratiques ébranlent l’Europe, la Russie et les Amériques : dans certains pays, elles renforcent les partis de gauche, dans d’autres les partis de droite ; dans certains elles produisent le fascisme, dans d’autres le totalitarisme, dans d’autres enfin des démocraties plus riches en droits sociaux.
Venons-en alors au populisme. S’il est certain qu’il se produit historiquement en temps de crise démocratique, le plus plausible c’est qu’il définisse un certain type de crise politique. Autrement dit, qu’il appartienne à la même classe sociologique des révolutions et, plus généralement, des moments contestataires de la vie collective. Qu’il soit donc un moment critique de la démocratie représentative et rien d’autre ; un moment tout à fait spécifique, mais dont (comme pour toute crise politique) les effets systémiques à moyen et long terme sont indéterminés. Or ce qui fait la spécificité d’une crise, c’est son contexte de naissance, son mode idéologique de production et les effets transformateurs de ladite idéologie, prônant la rupture et la refondation, sur le système politique dans son ensemble.
La comparaison que nous proposons ne portera donc pas sur les mouvements ou les organisations politiques apparaissant à la suite de la crise populiste, mais bien sur son contexte de genèse, sur l’idéologie qu’elle installe dans le système politique, et sur les transformations profondes que cette idéologie produit dans les sociétés démocratiques. La question « tel mouvement politique fut-il populiste ? », qui hante souvent les Congrès de science politique, est donc superfétatoire : elle est vouée à ne pas trouver de réponse. Le populisme ne désigne pas des mouvements politiques sui generis, mais des configurations de crise[39], au cours desquelles l’ordre institutionnel est critiqué au nom d’une radicalité démocratique, et les champs politiques se recomposent, souvent pour une durée limitée.
On peut désormais débuter notre enquête sur des bases sûres. Nous ne nous déplaçons plus sur des sables mouvants. Nous pouvons utiliser le concept de populisme pour décrire des expériences passées, car nous avons une matrice historique à partir de laquelle construire une enquête sociologique comparative : le narodnitchestvo. À partir de cette matrice, nous disposons désormais d’une problématique claire, qui légitime la comparaison et justifie chaque cas analysé : quel type de critique démocratique le populisme développe-t-il dans les contextes de crise dans lesquels il apparaît ? Nous savons, enfin, que la comparaison ne porte pas sur des organisations ou des mouvements politiques, mais sur des moments populistes, des configurations critiques au cours desquelles les acteurs contestataires cherchent à fonder une démocratie pleine et entière, ou pointent son incomplétude dans le gouvernement représentatif.
Acte 1 : les narodniki russes
Le populisme russe se développe entre 1848 et le milieu des années 1890. Il constitue « la réponse russe aux problèmes du socialisme romantique [européen][40] » : une réponse élaborée en prenant en compte trois éléments qui différencient profondément la Russie de l’Europe. Le retard économique, tout d’abord : la Russie est un pays essentiellement féodal, tournant autour de l’institution du servage, tant paysan qu’ouvrier. Le retard politique, ensuite : contrairement à tous les pays européens, y compris les plus conservateurs, la Russie est une autocratie traditionnelle incapable de se réformer de l’intérieur, c’est-à-dire de se doter d’un habeas corpus et d’un minimum de libertés sauvegardées par une Constitution. Le retard social enfin : tandis qu’en Europe naît le mouvement ouvrier, la Russie reste plongée, malgré l’exploitation considérable de la paysannerie et du prolétariat urbain, dans une inertie totale. Dépendante du tsar, des seigneurs et de la tradition, la paysannerie, largement majoritaire parmi les classes opprimées, ne semble disposer ni de la volonté, ni de la stratégie, ni de l’organisation pour se révolter. Le populisme russe vient répondre à ce problème. Il cherche à adapter le socialisme européen à un contexte tout à fait idiosyncrasique ; contexte qui lui permet, en retour, de produire une philosophie socialiste originale[41]. Celle-ci anticipe certains débats que la pensée marxiste, devenue hégémonique entre la IIe et la IIIe Internationale ouvrière, ne se pose que dans les années 1970, par l’intermédiaire de l’œuvre redécouverte d’Antonio Gramsci.
C’est cette originalité qui est à l’origine du terme même de « populisme ». Il est inventé par les marxistes, vers 1870, pour discréditer ces révolutionnaires russes – les narodniki, littéralement « démocrates » – qui n’adhèrent pas à leur stratégie. Ils ont, à vrai dire, tout pour ne pas leur plaire, quand bien même Marx leur réserve un traitement autrement favorable. Ils croient « naïvement » que la Russie pourrait, en raison de ses spécificités structurelles, passer directement du féodalisme au socialisme sans transition capitaliste ; ils affirment que la paysannerie (et non le prolétariat) serait, en vertu de sa culture, de ses valeurs et de ses formes d’organisation, le groupe social le plus à même d’accomplir cette transformation ; ils pensent, enfin, que la révolution devrait émaner de l’auto-organisation du peuple, et non pas d’une avant-garde de professionnels de la politique, et que pour cela même elle ne peut pas liquider certains éléments de la tradition, comme les coutumes ou la religion. Étiquetés comme « populistes », ils ne tardent pas à reprendre à leur compte le stigmate, en l’inversant. Ils décrivent alors leur tâche comme celle de guider le peuple « non pas au nom d’idées importées, abstraites et livresques », mais de la nécessité de « les adapter au peuple tel qu’il [est], afin de le pousser à la résistance en fonction de ses besoins réels et quotidiens »[42].
Leur histoire court sur trois générations, qui se donnent le relais tout au long du xixe siècle et sont étroitement en contact les unes avec les autres. Chacune est marquée, suivant la définition sociologique de « génération »[43], par un ou plusieurs événements politiques socialisateurs.
Trois générations « allant au peuple »
La première génération, née dans les années 1810, est celle des inspirateurs (Alexandre Herzen, Mikhaïl Bakounine, Nikolaï Ogarev, Vissarion Belinski) ; on l’appelle également la « génération des années 1840 ». Pour la plupart issus de la noblesse et de la bourgeoisie intellectuelle, élevés en français plus qu’en russe, ils sont tous marqués par la répression de l’insurrection du 14 décembre 1825, menée par de jeunes officiers opposés au despotisme du tsar. Leur monde intellectuel, dont ils font pleinement partie par leurs collaborations et échanges épistolaires[44], est le socialisme romantique européen, essentiellement français (Saint-Simon, Fourier, Leroux, Sand, Cabet, Proudhon, Blanqui) et, dans une moindre mesure, allemand (le romantisme de Iéna). À l’instar de ses principales figures, ils considèrent le peuple comme une utopie réelle. Tout en désignant concrètement les masses populaires opprimées par le despotisme, la propriété et la culture bourgeoise, le peuple constitue un idéal presque sacré : il est le sujet transformateur de l’Histoire, l’acteur d’une grande révolution à venir.
Comme les socialistes romantiques, les narodniki le dépeignent avant tout dans la littérature. Ils sont persuadés en effet qu’en le bâtissant comme idéal fictionnel, ils le feront advenir comme sujet moral (par une sorte d’indignation partagée parmi les opprimés) et, donc, comme acteur de l’Histoire[45]. D’où leur problème nodal : la question de la relation entre les intellectuels (intelligentsia), avant-garde savante, et le « peuple réel », c’est-à-dire la paysannerie : 48 millions de serfs illettrés (sur une population de 60 millions) qui appartenaient à titre privé à des seigneurs ruraux ou à l’État[46].
Si la paysannerie leur apparaît dépourvue de véritables ambitions révolutionnaires, elle semble posséder toutefois les catégories, les valeurs et les formes d’organisation qui lui permettraient de les développer. Pour la raison suivante : contrairement au prolétariat urbain exalté à la même époque par les socialistes européens, elle est restée, selon les narodniki, à l’écart des valeurs matérialistes et utilitaristes, car elle n’a pas été contaminée par le capitalisme. Sa tradition culturelle lui permet ainsi d’être spontanément socialiste, sans besoin de stratégie, d’acculturation, d’organisation politique de l’extérieur. Avec son sens fraternel de la coopération et du commun, le paysan (le « moujik ») leur apparaît comme la quintessence de cette tradition précapitaliste que les socialistes romantiques avaient regardée de manière nostalgique et rêveuse, en pensant la révolution, de manière cyclique et non linéaire, comme le retour d’un âge d’or perdu[47].
De ce constat s’ensuit la tâche révolutionnaire qu’ils se donnent. Il s’agit de rapprocher des intellectuels maîtrisant la « pensée occidentale », mais peu familiers avec la praxis politique, et un peuple vivant en dehors de la culture lettrée, mais dont la pratique permet de penser la révolution à venir. Comme l’écrit Herzen en 1862, « la puissante pensée de l’Occident, dernier terme de son long développement historique, pourra seule féconder les germes qui sommeillent au sein de l’ordre patriarcal des peuples slaves. L’artel [l’association ouvrière] et la communauté rurale, le partage des produits et des champs, l’assemblée communale et la réunion des villages en arrondissements qui s’administrent eux-mêmes, tout cela servira d’assises à notre futur régime de liberté nationale. Mais ces assises ne sont encore que des pierres éparses et, sans la pensée occidentale, l’édifice de notre avenir n’aura jamais que ces fondements[48]. »
La génération suivante, née entre le milieu des années 1820 et le milieu des années 1830, est celle des militants (Nikolaï Tchernychevski, Piotr Lavrov, Nikolaï Dobrolioubov) : on l’appelle également la « génération des années 1860 ». Appartenant à la classe des « raznotchintsy » (« sans rang »), ni seigneurs, ni paysans, ni marchands, ces nouveaux révolutionnaires sont issus de la classe moyenne, et pour l’essentiel professeurs ou éditeurs. Deux évènements les marquent en profondeur, en les amenant à concrétiser les idées des inspirateurs. Le premier est le Printemps des peuples de 1848, dont ils espèrent en vain qu’il allume un foyer insurrectionnel en Russie. Le deuxième est l’émancipation des serfs par le tsar Alexandre II en 1861 : une réforme démocratique « par le haut », largement inachevée et insatisfaisante, menée sciemment pour éviter un soulèvement de la paysannerie. Les narodniki espèrent que cette étincelle réformiste pousse les paysans à une grande révolution sociale. Celle-ci devrait instituer les libertés démocratiques tant attendues – l’habeas corpus, la séparation des pouvoirs, les libertés d’opinion et de la presse –, tout en instaurant le socialisme. Tant désirée, la révolution ne viendra pas : on parlera alors de « révolution manquée »[49].
C’est ce mélange d’incompréhension, de déception et de volontarisme qui les pousse enfin à l’action, galvanisés par l’exemple de la révolution polonaise de 1863. Pendant l’« été fou » de 1874, ils réalisent le grand rêve d’Herzen et Ogarev : ils vont au « peuple », afin de mieux connaître les campagnes russes et d’y prêcher leur évangile révolutionnaire. Ils sont accompagnés de deux à trois mille étudiants, issus des mobilisations universitaires et impressionnés par l’activisme des jeunes « tchaïkovtsy » saint-pétersbourgeois[50]. Dans ce cortège, la présence des femmes est considérable. Elles participent à la « croisade vers le peuple » pour revendiquer leur propre droit aux études, dont elles sont massivement exclues, garantissant leur émancipation[51].
Le pari des narodniki est stratégique. Certes, se disent-ils, la révolution n’a pas eu lieu. Mais l’occasion historique n’est pas perdue, bien au contraire. Car en émancipant les serfs, le tsar pensait étouffer la révolution paysanne. Mais en réalité, comme l’Ancien Régime a pavé la voie à la Révolution française par sa réforme de l’État[52], le décret de 1861 a profondément changé l’ordre féodal des campagnes. Celui-ci était structuré, du temps du servage, par les règlements et les institutions aux mains de la seigneurie. Les serfs pouvant désormais acheter leurs lopins de terre, il est à jamais révolu. Celui qui naît à sa place, concomitamment avec les nouveaux désordres qui agitent les campagnes, est fondé sur une ancienne institution de la coutume traditionnelle : l’obscinia (la « commune rurale »), devenue désormais l’association des paysans propriétaires. Elle est la clé de voûte du nouveau découpage administratif des campagnes. Elle inclut même un parlement local, le « mir » (l’« assemblée rurale »), dont chaque paysan est membre à part entière en vertu de son appartenance à l’obscinia. Sa fonction est de régler les différends locaux, d’harmoniser la propriété individuelle et la propriété communale, et de créer de l’entraide entre les associés.
Ce nouvel ordre administratif accorde ainsi une place centrale aux savoirs, aux valeurs et aux institutions traditionnels de la paysannerie russe. Là où l’ancien promouvait la hiérarchie et le respect de l’ordre féodal, celui-ci consacre, pour parler comme Edward P. Thompson, les « droits de la coutume » : l’autonomie locale, la solidarité, l’entraide et la coopération, la résistance à toute imposition normative « du haut » qui ne prenne pas en compte les spécificités sociales du « bas »[53]. Pour cela même, il pousse les paysans à s’organiser et à résister à l’autorité du tsar, lointaine et illégitime. Le pari des narodniki est que de cette résistance naisse la révolution tant attendue contre le despotisme : une révolution indissociablement libérale, libertaire (car antiétatique) et socialiste[54].
Mais ils déchantent rapidement. Leur « pèlerinage »[55] ne donne pas les résultats escomptés. En dépit de leur fréquentation assidue, entre 1874 et 1876, des communautés rurales, qu’ils apprennent à mieux connaître au-delà des idéalismes, les paysans leur parlent peu et se méfient d’eux. Nonobstant leurs prédications révolutionnaires, tout à fait pacifiques au demeurant, ils rechignent à les suivre et montrent une loyauté indéfectible au tsar. Assumant les conséquences de ce premier échec, le mouvement se transforme en société secrète (Zemlia i Volia, « Terre et liberté »). Il est décimé par la répression tsariste entre 1877 et 1878, avec la complicité de la paysannerie.
L’échec de la « Croisade au peuple », ensemble avec la répression tsariste, constitue l’événement politique marquant de la troisième génération des narodniki, celle des activistes (Nikolaï Mikhaïlovski, Nikolaï Ichoutine, Dmitri Karakozov, Sergueï Netchaïev, Pyotr Tkachev, Vera Figner). Née vers la moitié des années 1840, elle est composée essentiellement d’étudiants prolétarisés et désaffiliés, ayant abandonné leurs familles et l’université, et ne comptant plus que sur eux-mêmes pour vivre. Leurs motifs de révolte ont changé par rapport aux générations précédentes. Révulsés par la misère morale et matérielle du peuple russe, les anciens faisaient de l’agitation politique par le biais de la littérature, du journalisme ou du prosélytisme dans les campagnes. Désormais méfiants envers les paysans, haïssant la société tout entière et le tsar au plus haut point, les nouveaux sont de plus en plus tentés par le terrorisme[56].
Le contexte social a entretemps changé. Les paysans, devenus des petits propriétaires, se sont progressivement endettés auprès de l’État : l’ancien servage, légitimé par la tradition, a été peu à peu remplacé par une nouvelle et redoutable dépendance, résultant de la marchandisation de la terre. En même temps, la poussée industrielle sous le règne d’Alexandre II a créé un nouveau prolétariat urbain, issu en partie de la paysannerie endettée et vivant dans la misère la plus totale[57]. Enfin, une nouvelle classe d’hommes d’affaires, très liés au capital étranger, a peu à peu remplacé l’ancienne seigneurie féodale. Les nouveaux révolutionnaires partent du présupposé que le capitalisme est bel et bien réel en Russie, et que l’ancienne hypothèse d’un passage direct au socialisme n’est plus d’actualité[58]. Faute d’un nouveau cadre théorique, et ne cherchant plus vraiment à en recréer un, ils concentrent toutes leurs énergies sur la lutte contre le régime, en espérant que la mort du tsar fasse péricliter le capitalisme en Russie. À l’image du personnage tchékhovien de Trofimov dans La Cerisaie, qui en est le type social, le dilemme de cette nouvelle génération est désormais le choix entre la violence terroriste et la propagande légale dans l’espace public.
Ce choix donne lieu en 1879 à une scission de Zemlia i Volia en deux groupes. Le premier (Narodnaïa Volia, « Volonté du peuple ») regroupe les terroristes et parvient à assassiner Alexandre II en 1881. Il est liquidé par le nouveau tsar avant 1890. Son legs politique est recueilli par le Parti socialiste révolutionnaire quinze ans plus tard, en 1902. Le second groupe (Chernyi Peredel, « Partage de la Terre »), qui privilégie l’agitation politique légale et suit l’héritage d’Herzen et Tchernychevski, s’éteint progressivement pour converger, en 1894, dans le Parti ouvrier social-démocrate. Les deux voies, la terroriste et la légale, fécondent le bolchevisme naissant dans la personne de Lénine, dont le frère aîné Alexandre Ilitch Oulianov, membre de Narodnaïa Volia, est condamné à mort en 1887 suite à une tentative avortée d’assassinat d’Alexandre III. Très affecté par cet échec, Lénine se réclame de l’héritage révolutionnaire du populisme tout en marquant les différences indépassables avec le marxisme qu’il « traduit » en même temps en Russie[59]. Son traité Que faire ? (1902) emprunte ainsi, à dessein, son titre au roman du populiste Tchernychevski (1863), qui avait été le livre de chevet des croisés de 1874. Il en reprend l’ambition révolutionnaire, mais en critique fermement la croyance dans la spontanéité des masses. Selon Lénine, il incombe dorénavant à un parti de professionnels de la révolution, le parti bolchévique, d’organiser « par le haut » le changement social ; parallèlement, les espoirs révolutionnaires se déportent vers le prolétariat urbain, considéré la principale victime de l’exploitation tant économique (capitaliste) que politique (tsariste)[60]. La mémoire historique du populisme sera définitivement liquidée par Staline, pour ne réapparaître timidement qu’après 1956[61]. Par contre, en Europe, elle ne cessera d’irriguer la tradition anarchiste à travers les émigrés politiques russes, comme ce Nicolas Lazarévitch, fils de populistes, ayant profondément influencé Albert Camus[62].
Comment émanciper le peuple ?
Que peut-on tirer de cette histoire pour la compréhension sociologique du populisme ? La populologie a insisté sur trois points : la mythification/mystification du peuple comme élément central du populisme ; l’opposition idéologique au libéralisme et à la démocratie représentative, considérés comme des importations politiques européennes ; une certaine tendance anti-politique bien représentée par le tournant terroriste[63]. En plus de tordre à l’extrême l’idéologie du narodnitchestvo, plurielle et évolutive[64], ces analyses ne prennent pas en compte une autre dimension, qui saute pourtant aux yeux : la volonté de bâtir une démocratie pleine et entière sur la base d’une auto-émancipation du peuple. La révolution doit, selon les narodniki, avoir pour unique but
« “d’éveiller, de faire la cohésion des forces populaires spontanées et de les organiser”. Toute tentative pour se substituer à elles, pour agir en leur nom, pour les duper, [est] dommageable et vaine […] Aussi fallait-il placer au centre de toute action “l’auto-détermination du peuple sur la base d’une égalité absolue, de la liberté humaine complète et multiforme” ». Voilà pourquoi « en allant au peuple, […] la Russie se fraya un chemin vers une pensée et une action démocratiques, tout en renforçant cet idéal socialiste qui se trouvait à la base de tout mouvement populiste ». Le narodnitchestvo montre clairement qu’« un socialisme qui n’est pas démocratique n’est pas un socialisme »[65].
Le populisme russe est indissociablement lié à l’idée démocratique, abordée comme la triple nécessité de créer des institutions libérales dans un pays tyrannique, de réaliser l’égalité sociale et, surtout, de partir de l’hypothèse radicale de l’autonomie du peuple. Le peuple ne doit pas être instruit par des professionnels de la politique, qui lui apporteraient de l’extérieur une science de l’émancipation. Bien au contraire, c’est lui qui doit les instruire, et c’est à partir de ses propres catégories, de sa morale sociale, de ses institutions, qu’il faut penser la démocratie révolutionnaire.
« Les ouvriers, écrit Herzen, qui pensent avec leur propre tête, ne recherchent pas de liens avec les révolutionnaires professionnels ni avec les rédacteurs de journaux, mais avec les paysans[66]. »
La visée du populisme est donc de persuader le peuple de sa capacité politique fondamentale, de lui donner la conscience profonde de son autonomie, et ainsi de créer les conditions d’une véritable alliance populaire entre tous les opprimés (les paysans, les prolétaires et les femmes) et tous les peuples-nations d’Europe et de Russie. À lui seul, ce bloc populaire international pourrait abattre les despotismes impériaux.
Ce dernier point est fondamental. En exaltant la nation russe, les narodniki ne cherchent pas à la purifier de ses ennemis internes, ni de ses hybridations corruptrices. La nation fait partie de la culture qu’ils cherchent à bâtir pour le peuple et avec lui, via l’observation en prise directe, ethnographique, lors de la grande Croisade de 1874-1876. Elle sert avant tout à lui donner une conscience de ce qu’il est socialement et de ce qu’il peut être politiquement, afin qu’il s’arme contre le despotisme. Les narodniki font un usage civique, utopique et ouvert de la nation, imaginée à partir de son fond plébéien, comme l’avait été naguère la « classe » pour les ouvriers et les artisans du premier socialisme anglais[67]. Dans les deux cas on a affaire, selon l’expression d’Étienne Balibar, à des « universels conflictuels »[68].
Bakounine, inspirateur du narodnitchestvo, puis fondateur de l’anarchisme, transforme cette position en programme politique. Son raisonnement est le suivant : les Empires (l’Empire russe, l’Empire allemand, l’Empire austro-hongrois) sont multinationaux et multiculturels. De ce fait, les peuples vivant sous leur férule peuvent se fédérer plus facilement. Le Printemps des peuples de 1848, puis la Révolution polonaise de 1863, ne l’enthousiasment pas en tant que révolutions nationales, mais comme les étincelles d’une possible association des peuples slaves, en Europe et en Russie, en vue d’une « République démocratique fédérale ». « Le mouvement révolutionnaire, écrit-il, ne s’arrêtera que lorsque l’Europe, toute l’Europe, y compris la Russie, se transformera en une république démocratique fédérale… Je suis russe, et mon âme appartient à la Russie… Cette révolution, destinée à sauver tous les peuples, sauvera aussi la Russie[69]. »
Aussi, en exaltant la nation russe ou la culture slave, les narodniki ne font pas valoir des particularismes ethniques. Ils accomplissent quelque chose de similaire à ce que fait Marx avec l’idée du prolétariat, « part active » du peuple et agent universel de l’émancipation humaine. La nation russe, parmi toutes les nations, devient l’agent de l’émancipation universelle : car, pour ses valeurs et son organisation, elle est radicalement démocratique. Son combat devient celui de tous les peuples-nations opposés aux despotismes.
Tant l’insistance sur l’autonomie populaire que cet usage universalisant de la nation sont contenus, en germe, dans le socialisme romantique du premier xixe siècle, dont le dernier grand représentant est Pierre Leroux. D’où une autre affinité, qui constitue un trait du populisme en général : son caractère antimoderne. En faisant de l’autonomie du peuple la seule directive possible de l’action révolutionnaire, les populistes se vouent à observer, avant tout, les formes effectives de la politique populaire. Cette politique est faite de solidarité, de partage, de coopération mais, aussi et surtout, de résistance à la modernité. Le peuple russe n’a pas cessé de s’insurger, depuis le xviiie siècle, contre une modernisation économique dont les critères n’étaient pas en phase avec la réalité nationale, mais étaient définis à l’extérieur : toutes ces transformations « venues de l’Occident », qui « descendirent d’en haut et furent imposées par l’appareil de l’État et les exigences du marché mondial »[70]. Des refus de corvée à la défense des coutumes ancestrales, comme l’obscinia et le mir, ces résistances populaires sont, après la poussée industrielle d’Alexandre II, en passe d’être balayées par la modernité. Le populisme russe cherche à les rendre visibles et à enrayer la marche du progrès, afin que le peuple comprenne que l’histoire peut être aussi de son côté, et non pas uniquement du côté des dominants qui en imposent le cours à marche forcée[71].
Cette démarche est radicalement démocratique. Autrement dit, elle est démocratique à sa racine même. Une vraie démocratie ne peut pas se réduire, selon Herzen, au quota de libertés négatives que des États accordent à la société ; elle doit faire une place au peuple, c’est-à-dire aux forces vives de la société qui s’opposent à toute oppression, quelle qu’elle soit, et donc à l’État lui-même[72]. Une vraie démocratie, nous disent les populistes, doit rendre son autonomie à la politique telle que pensée par le peuple, et ne pas faire du peuple un être informe, inorganisé, incompétent, devant être civilisé par les professionnels de la politique ou par la loi du progrès. C’est en ce sens qu’il faut comprendre l’insistance des populistes sur la littérature. Leur projet d’une littérature nationale-populaire sert au peuple à voir, comme dans un miroir, l’image de l’idéal qu’il doit se faire de lui-même, afin de sortir de l’invisibilité[73]. En donnant une noblesse littéraire à la culture populaire, les narodniki ne font pas autre chose qu’analyser la société russe du point de vue du peuple, c’est-à-dire du point de vue des opprimés d’un État despotique, bureaucratique et seigneurial[74].
Et toutefois, lorsqu’ils mettent en pratique leurs idées en 1874, ils se confrontent à toutes les contradictions de leur programme. Ces contradictions sont celles du populisme en général. Car une action révolutionnaire qui prend l’autonomie des opprimés comme hypothèse fondamentale n’est-elle pas vouée à se supprimer d’elle-même ? À se voir invalidée d’emblée ? Comment des savants, ou plus généralement des porte-paroles, pourraient-ils rendre le peuple conscient de son autonomie, sinon en le persuadant du fait qu’il n’a guère besoin d’eux pour le lui révéler ? Le populisme suppose toujours un (ou des) porte-parole(s) qui dise(nt) : « Le peuple est là : il pense, vit et agit politiquement, même si vous, classes dominantes, ne vous en apercevez pas. » Mais lorsque le peuple commence effectivement à penser et à agir, le rôle du porte-parole n’a plus de sens. Par simple énonciation, le porte-parole fait exister un « absent »[75], le peuple. Mais lorsqu’un peuple démocratique se constitue via la mobilisation des opprimés, il n’a plus besoin de ce même porte-parole qui, en l’appelant, l’a poussé à exister. Car il sera, justement, enfin autonome ! Aussi le populisme joue-t-il sans cesse, et indissociablement, sur l’absence et la présence ; sur l’absence d’un peuple démocratique qui reste à faire, et sur la présence irréductible de son autonomie politique dans la société.
La question de l’autonomie populaire pose aussi des problèmes. Car en tant que directive révolutionnaire, c’est un postulat tout à fait louable. Mais en tant que principe analytique, il peut être irréaliste. D’où la deuxième contradiction de tout populisme : la survalorisation de l’autonomie populaire ou l’écart entre le peuple idéalisé et le peuple réel. Comme les narodniki l’éprouvent tragiquement, il ne suffit pas de constater que la culture populaire est autonome, pour qu’une revendication effective d’autonomie politique voie le jour de la part des opprimés[76]. À l’inverse, le populisme nous prémunit face au postulat opposé, tout aussi réducteur : le fait de croire que le peuple ne peut pas s’émanciper tout seul. C’est cette croyance que le populiste Mikhaïlovski décèle en 1868 dans la philosophie de Marx, en l’appelant « postulat fataliste »[77].
Une dernière contradiction a trait à la question de l’alliance populaire. Cette idée aussi est typique du populisme en général, qui ambitionne toujours de construire un bloc des « subalternes »[78], toutes positions de classe confondues, contre le bloc des élites, toutes fractions internes confondues. Mais il ne suffit pas de l’énoncer, de manière volontariste, pour qu’il se réalise. Comme le diront Rosa Luxemburg et Antonio Gramsci quelques décennies plus tard, une telle coalition populaire se produit dans peu d’occasions historiques car elle suppose un contexte révolutionnaire de départ et un cadrage des luttes de la part d’une organisation (l’intellectuel organique gramscien). Nous touchons ici aux limites du populisme comme mode d’action politique : en étant radicalement spontanéiste et autonomiste, il ne bâtit pas vraiment les conditions de sa réussite.
Malgré la déconsidération qu’il a suscitée chez les marxistes, le populisme a été, par contre, parfaitement compris par Marx. En feignant de s’étonner que les narodniki aient été les premiers à traduire le Capital[79], le philosophe allemand saisit très bien les raisons de l’intérêt qu’ils portent à son œuvre. Ils y trouvent une théorie de l’opposition de la société à l’État[80], du peuple des non-propriétaires aux élites propriétaires, mais doutent fondamentalement que la théorie marxienne, à visée universelle, puisse s’appliquer en dehors de l’Occident. Et Marx de conclure, à l’encontre de tout ce que le marxisme orthodoxe affirmera par la suite, que l’hypothèse populiste d’un saut du féodalisme au socialisme est tout à fait plausible.
« Si la Russie, dit-il, continue à marcher dans le sentier suivi depuis 1861 [la modernisation économique], elle perdra la plus belle chance que l’histoire ait jamais offerte à un peuple pour subir toutes les péripéties fatales du régime capitaliste[81]. »
Cette chance historique tient, écrit-il en 1881, à la spécificité de l’organisation populaire en Russie : autrement dit, à la présence de la commune rurale « point d’appui de la régénération sociale », à laquelle il faut assurer toutes les conditions « d’un développement spontané »[82]. Après la Commune parisienne, Marx est de plus en plus attiré par les formes autonomes et spontanées de l’organisation populaire. Il y voit, comme il l’écrit dans son Adresse sur la Commune de 1871, « une révolution contre l’État comme tel » et « la résurrection de l’authentique vie sociale du peuple, réalisée par le peuple »[83]. Fasciné par l’obscinia russe et la Commune parisienne, il est de plus en plus persuadé de la nécessité de penser la révolution socialiste à partir de la question de l’autonomie du peuple[84].
Acte 2 : le People’s Party états-unien
À l’inverse de l’Europe, où le populisme n’a jamais pris pied, le continent américain a connu une véritable prolifération d’expériences de ce type. Cela est dû, essentiellement, à la difficulté des mouvements socialistes à infléchir les politiques gouvernementales dans le sens de la création des modernes États-Providence. Dans les Amériques, les premiers systèmes de sécurité et de protection sociale ne sont créés qu’après la Grande Dépression de 1929, au cours des années 1930 et 1940. Soit un retard de trois décennies environ par rapport aux principaux pays industrialisés d’Europe du Nord : l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France[85]. Ce retard s’explique, dans les pays d’Amérique latine, essentiellement par leur industrialisation tardive[86]. Aux États-Unis, il doit beaucoup à l’hégémonie presque incontestée, après la Guerre de sécession, du libéralisme économique et au rôle substitutif qu’exerça la philanthropie par rapport à un véritable État-providence[87]. Tant au sud qu’au nord du continent, ce retard a produit, dans un contexte de modernisation économique accélérée, une forte sensibilité à l’idéologie populiste.
En Amérique latine, cette idéologie est devenue, nous le verrons plus tard, une tradition politique structurée. En Amérique du Nord, elle a pris la forme d’un « radicalisme plébéien à base communautaire » (« radical grassroots populism[88] »), canalisé dans quelques expériences fondatrices comme celle du People’s Party états-unien à la fin du xixe siècle, ou du Social Credit dans la province canadienne de l’Alberta dans les années 1930[89]. Plus près de nous, le mouvement Occupy Wall Street en 2011, et l’engouement consécutif pour la candidature de Bernie Sanders aux primaires démocrates américaines, ont été considérés comme des revivals de ce « populisme radical-plébéien » aux États-Unis[90].
De ces expériences, celle du People’s Party (1877-1896) est sans doute la plus emblématique. Comme le populisme russe, il naît dans un contexte de crise économique et sociale. Elle est due ici à la transformation financière et oligopolistique du capitalisme américain et à la mise en concurrence croissante d’une agriculture traditionnelle et d’une agriculture industrielle. Son terreau est l’augmentation considérable des inégalités socio-économiques, entre la côte Est et son hinterland rural, entre le Nord et le Sud, entre les villes et les campagnes.
Comme le narodnitchestvo, le People’s Party voit poindre un mouvement populaire très hétérogène en son sein. Mais, contrairement au cas russe, l’hétérogénéité n’est pas ici sociographique (les fractions des classes moyennes et inférieures qui constituent le mouvement), mais plutôt socioculturelle. Le mouvement est, pour l’essentiel, constitué de fermiers ruinés de l’ouest et du sud des États-Unis. Mais il attire dans sa galaxie politique
« des paysans tant blancs que noirs, des travailleurs journaliers issus de l’immigration, des militant·e·s pour les droits des femmes, des prohibitionnistes, des militant·e·s pour le papier monnaie (greenbackers), des militant·e·s de l’impôt unique sur la valeur rentière (single-tax), des utopistes “de salon”, des socialistes marxistes ou chrétiens, des chômeurs, des vagabonds, bref toutes sortes de personnages aux marges[91] ».
Entre ces différents acteurs contestataires il existe des hiérarchies symboliques, bien sûr. Dans les meetings du People’s Party, la prise de parole suit le tracé des inégalités de sexe, d’origine nationale et de race, quand bien même les fermiers en lutte défendent, au sein de leur mouvement, les droits des femmes, des immigrés et des Noirs. N’empêche que le People’s Party devient très vite un catalyseur de demandes démocratiques plurielles. Leur agrégation éphémère tout au long des années 1880 est rendue possible par une certaine vision du peuple que les fermiers défendent, ainsi que par la définition des élites qui en découle.
Le peuple des populistes russes, on s’en souvient, est le moujik : paysan coopératif et solidaire à l’origine de la commune rurale, il incarne l’autonomie de la société tout entière face à un État tyrannique. Le peuple du People’s Party est le fermier en tant que producteur, et le producteur en tant que citoyen. Cela est dû à la place hautement symbolique qu’occupe l’imaginaire du « petit propriétaire agricole » dans le récit national états-unien. Depuis Jefferson et son idéal de la « république agraire », il est au cœur de la démocratie américaine, et la maison, ainsi que la terre, sont considérées – que l’on pense à la crise des subprimes – comme des quasi-droits constitutionnels[92]. Cet imaginaire permet, dans les années 1880, à un mouvement de fermiers de fédérer des demandes démocratiques allant bien au-delà des intérêts de la petite paysannerie. Le noyau de ces demandes est la question de la citoyenneté économique et sociale. Contre les monopoles industriels et financiers, le mouvement rêve d’adapter l’économie américaine au principe constitutionnel de la souveraineté populaire, et de jeter les bases d’une « économie coopérative » ou, dirait-on aujourd’hui, d’une « économie sociale et solidaire » fondée sur la propriété populaire de la richesse[93].
Contre Wall Street, les droits économiques, sociaux et culturels
Dans les années 1870, les États-Unis cherchent à refermer la plaie de la guerre de Sécession (1861-1865). Celle-ci avait opposé le nord urbain et industriel, concentrant les principaux leviers du pouvoir économique et politique, et le sud rural et esclavagiste, loin des centres de décision. Si la guerre avait permis d’abolir l’esclavage dans tout le pays, la frontière entre le Nord et le Sud, et entre la côte Est et l’hinterland, n’était pas devenue plus poreuse, bien au contraire. Du point de vue économique, les paysans du sud et de l’ouest des États-Unis souffraient d’une politique fédérale qui était bien plus en phase avec les intérêts des grands trusts industriels et des centres financiers, comme Wall Street, qu’avec ceux de la production agricole. Le secteur primaire constituait pourtant, avec l’image des États-Unis comme nouveau « grenier du monde », la base de leur économie.
Avant la guerre de Sécession, les différents États américains avaient gardé leurs propres monnaies fiduciaires régionales (greenbacks), dont ils pouvaient contrôler, dans une certaine marge, l’émission en fonction de leurs besoins économiques. Pendant la guerre, cette politique monétaire est suivie tant par les États confédérés, qui ont leur propre dollar (greyback), que par les États de l’Union, qui maintiennent le dollar traditionnel. Après la guerre, un consensus se dégage entre le Parti Républicain et une partie des Démocrates sur la nécessité de réguler le marché bancaire national en fixant la valeur du dollar à l’égard de l’or (gold standard), pour accompagner le développement international de l’industrie et de la finance. À l’issue de cet accord, en 1873, les États-Unis adhèrent au gold standard. Dès l’année suivante, un nouveau parti voit le jour, le Greenback Party, qui s’oppose farouchement à cette politique économique, au motif qu’elle risque d’entraîner une déflation globale, et donc une chute de l’activité productive – tant agricole qu’industrielle – préjudiciable à la paysannerie et au prolétariat urbain. L’entrée dans le gold standard est ainsi requalifiée en véritable « crime » (« the crime of 1873 »). En 1878, le parti se renomme Greenback Labor Party, et ajoute à son plaidoyer pour un dollar délesté du gold standard des revendications visant directement la classe ouvrière : la journée de travail de 8 heures et le droit syndical à la grève[94].
Les sombres pronostics du Greenback Party se réalisent hélas très vite. Les prix du maïs, du blé et du coton, chutent drastiquement à partir de l’entrée américaine dans le gold standard, qui coïncide avec le début de la Grande Dépression mondiale du dernier quart du siècle (1873-1896). Les fermiers américains se voient obligés de produire de plus en plus pour engranger les mêmes revenus, et s’endettent auprès des banques, en hypothéquant souvent leurs fermes[95]. En même temps, l’augmentation exponentielle des grandes surfaces cultivées de manière intensive, aux mains des trusts de l’agriculture industrielle, alimente ce processus pervers : le pays s’engouffre très vite dans une crise structurelle de surproduction[96]. La crise agricole se répercute rapidement sur le secteur industriel. Les entreprises profitent de la baisse des prix pour comprimer les salaires ouvriers dans une période de contraction globale de l’activité productive. Seuls les rentiers de Wall Street en sortent gagnants, profitant du « dollar fort » à l’international pour accumuler des revenus spéculatifs.
La crise économique crée une énorme tension entre les élites politiques, industrielles et financières d’un côté, et les forces productives du pays, paysans et travailleurs industriels confondus de l’autre. Les premiers à s’organiser sont les fermiers du Sud. Ils cherchent à bâtir, au Texas, en Caroline du Nord, Louisiane, Alabama et Géorgie, un circuit économique local de prêt, production et échange, à l’écart du système qui les étrangle. En 1877 voit le jour l’Association paysanne du Texas (Texas Farmers’ Alliance Exchange). Elle fait rapidement des émules, comme la Colored Farmers’ Alliance, fondée par des paysans noirs[97]. Ces associations, sortes de plateformes coopératives et mutualistes[98], incluent également des dispositifs d’éducation, des cabinets de lecture, des bibliothèques populaires, des espaces d’échange dédiés aux travailleurs immigrés, des lieux préposés aux débats féministes – d’où la participation active de la National American Woman Suffrage Association au mouvement[99] -, et des églises afro-américaines engagées dans les combats pour les droits civiques.
Ces différents espaces de coopération, de débat et de démocratie directe font éclore, peu à peu, une critique globale de la démocratie représentative américaine, jugée asservie aux intérêts des grands trusts. C’est une militante féministe, Mary Elizabeth Lease, très impliquée dans le mouvement, qui l’énonce de façon lapidaire :
« Les gens de Wall Street ont pris les terres. Nous n’avons plus affaire depuis longtemps à un gouvernement du peuple, à une politique qui serait faite par le peuple et pour le peuple, mais aux gens de Wall Street. Le grand peuple de ce pays est réduit en esclavage, et le monopole est son maître[100] ».
Un programme politique voit le jour. Les fermiers se rendent compte qu’ils ne peuvent assurer une pérennité à leurs associations locales, sans envisager en même temps une réforme structurelle du système économique et politique national[101]. Ainsi, né à l’écart de la politique institutionnelle, le mouvement change, peu à peu, d’échelle et de projet : il s’ouvre de plus en plus aux luttes ouvrières, afin de créer un front populaire commun. Tout au long des années 1880, les associations paysannes se rapprochent du grand syndicat ouvrier The Knights of Labor, et participent activement aux grèves ouvrières de la fin du siècle, comme la grève des cheminots de 1886[102].
Une telle convergence des luttes était facilitée par l’idée que les fermiers se faisaient du « peuple ». Celui-ci allait bien au-delà de la condition paysanne, avec son attachement à la terre, à la tradition et à la religion. Il fédérait les campagnes et les villes, le paysan et l’ouvrier : c’était le producteur. Ce producteur que la modernité capitaliste, industrielle et financière mettait objectivement dans l’impossibilité de produire, en plaçant la nation tout entière dans l’impossibilité de survivre tant matériellement que symboliquement[103]. Les fermiers cherchaient à unifier ce qu’on désignait alors comme les « ordres productifs » au fondement de la république américaine, contre l’« ordre économique monopoliste » qui la corrompait de l’intérieur[104]. Cette insistance sur le « producteur » ne confine pas les revendications du mouvement, loin s’en faut, dans la seule sphère économique : ils demandent pêle-mêle le droit de vote des femmes, la reconnaissance des droits syndicaux pour les ouvriers et le droit à la culture en milieu rural. La fraction afro-américaine du mouvement, le « black populism », demande, quant à elle, la fin de la ségrégation raciale dans les États du Sud.
Cette variété de revendications s’explique par deux facteurs. Le premier est l’image du peuple-producteur comme fondement d’une république véritablement démocratique. Affranchir la production de la tutelle des monopoles industriels et de la finance devait servir expressément à radicaliser la démocratie, à réaliser les promesses non tenues de la République jeffersonienne[105].
Sous cet aspect, le projet politique des populistes diffère de celui qu’élaborent, à cette même époque, les socialistes états-uniens. Les fermiers n’ambitionnent guère d’abattre le système capitaliste : ils cherchent plutôt à le réformer de l’intérieur, pour le rendre compatible avec l’idéal démocratique. Ils souhaitent égaliser l’accès de tous les citoyens américains à l’activité économique, contre les privilèges dont jouissent les trusts et les rentiers, qui accaparent tous les bénéfices du marché. Ce projet démocratique est parfaitement compatible avec le capitalisme, qu’il ne s’agit pas de critiquer comme mode d’organisation de la société. Les socialistes concentrent tous leurs efforts, au contraire, sur la lutte anticapitaliste, dont ils ne cherchent pas à penser l’horizon démocratique, car pour eux la « république » est une chimère des classes possédantes. Contrairement aux populistes, ils analysent la réalité sociale comme une lutte des classes, ce qui les empêche de croire que des groupes différemment placés dans la division capitaliste du travail, comme les paysans blancs et noirs, puissent se coaliser durablement autour de la représentation consensuelle d’un « peuple producteur ». La cible des socialistes n’est pas le monopole ou l’élite qui « fausse » la démocratie économique et sociale, mais le système capitaliste dans son ensemble, qui maintient en esclavage, sous la forme de l’« indigne salariat », tous les hommes. Cette différence de projet politique, que l’on retrouvera dans tous nos cas d’étude, explique la défiance croissante que les socialistes états-uniens nourriront à l’égard du People’s Party.
Le deuxième facteur permettant la convergence éphémère des luttes sociales sous la bannière des fermiers, est leur conception de la modernité. Tout en étant antimodernes comme les narodniki, les populistes états-uniens sont porteurs d’une vision très originale de la modernité. Ils croient au pouvoir transformateur de la science et de la technologie, mais souhaitent se les approprier localement, en fonction des valeurs de la démocratie, de la communauté et de la solidarité. Ils adhèrent au modèle d’économie d’échelle, mais cherchent à l’adapter à un mode de production mixte, où coexisteraient la propriété privée, la propriété publique et la propriété associative. Ils opposent, surtout, leur propre vision d’une modernité réconciliée avec les forces productives du pays à celle, libérale, des élites qui est fondée sur l’idée de progrès[106].
Une institutionnalisation impossible ?
Le mouvement présente donc, tout au long des années 1880, un énorme potentiel politique. Il est autonome et enraciné dans l’espace local, mais possède, par ses liens avec les mouvements ouvriers et féministes, un fort rayonnement national. C’est ce rayonnement qui le porte à constituer un parti politique. En 1890, les différentes associations paysannes se réunissent, sous le patronage du représentant de la Southern Farmers’ Alliance Charles Macune, dans une nouvelle Association nationale (National Farmers’ Alliance). Elle est forte de près de 40 000 relais locaux dans quarante-trois États. Le People’s Party naît en 1892, lors de la Convention d’Omaha, comme sa « plateforme » politique. Son candidat aux élections présidentielles, James B. Weaver, recueille plus d’un million de voix et remporte 22 grands électeurs, démontrant ainsi le poids du mouvement à l’échelle nationale.
Le programme du parti est bâti à partir d’un discours d’Ignatius Donnelly, représentant de l’Association paysanne du Texas, donné à la Conférence industrielle de St. Louis de la même année. Donnelly s’en prend à la corruption matérielle et morale de la nation, due selon lui à l’accroissement des inégalités entre une classe oisive et une classe productive. Brillant orateur, aux envolées lyriques, il met en garde son auditoire contre le despotisme des banquiers et des financiers, auquel contribuent selon lui les deux partis de l’establishment politique, les Républicains et les Démocrates. Ceux-ci auraient abandonné depuis longtemps leur mission de « protecteurs du peuple » pour devenir les gardiens d’intérêts privés. Le People’s Party doit alors « restituer la république au peuple, c’est-à-dire aux groupes qui créent la richesse[107] », et favoriser les conditions sociales et culturelles (via l’accès au savoir) d’une citoyenneté intégrale.
Son indignation est construite, comme les narodniki, sur des catégories essentiellement morales. Les élites sont d’autant plus critiquables qu’elles sont dépourvues des vertus attachées au labeur et à l’effort et qu’elles profitent, pour s’enrichir, du travail honnête du peuple, qu’elles déshumanisent[108]. D’où la nécessité pour le peuple de se mobiliser et de refonder la république sur la base d’une « égalité absolue de droits pour tous les hommes et les femmes »[109].
Les revendications affichées dès 1892 sont à la mesure de la variété des demandes démocratiques du mouvement. Les fermiers réclament la mise en place d’une monnaie nationale contrôlée par l’État, détachée des intérêts privés des banques et soumise à l’intérêt des producteurs. Ils revendiquent la création d’une banque nationale pour les agriculteurs, collectant leurs épargnes et générant du crédit, sans but spéculatif. Ces deux réformes sont les piliers de leur programme de « socialisation de la monnaie[110] ». En matière de politique fiscale, ils demandent un impôt progressif sur le revenu – celui-ci n’est mis en place, finalement, qu’en 1913 (le 16e amendement sur la Constitution). Sur les transports, enjeu stratégique pour l’acheminement de la production agricole, ils réclament la nationalisation des chemins de fer et de la poste (deux anciennes revendications paysannes, apparues pour la première fois dans le mouvement des Grangers[111]), ainsi que des communications télégraphiques et des compagnies téléphoniques. Ils souhaitent, enfin, que les terres soient protégées des velléités spéculatives des trusts de l’agriculture industrielle et de Wall Street, et qu’une partie soit rachetée par l’État fédéral et redistribuée aux producteurs. Last but not least on trouve les revendications concernant les droits civiques et politiques : le vote à bulletin secret (secret ballot), le droit d’initiative référendaire, l’élection directe du Sénat et les limitations des mandats de la Présidence et de la vice-Présidence.
Les espoirs de changement sont vastes. Mais le nouveau parti débute dans des eaux troubles. Lorsque le mouvement, qui avait jusque-là gardé son indépendance de la politique institutionnelle, entre dans l’arène électorale, son ADN change. Avant, il n’avait pas de leader, ni de porte-paroles désignés : dans les meetings des associations paysannes, n’importe qui pouvait prendre la parole et aspirer à représenter le mouvement dans son ensemble. Il y avait, bien entendu, des personnalités plus en vue que d’autres, auxquelles on confiait des responsabilités politiques : Ignatius Donnelly, Charles Macune, Tom Watson, James B. Weaver en étaient quelques-unes[112]. Mais le mouvement était resté acéphale, pour garder sa pluralité interne et accroître ses chances d’être fédérateur. Il en allait de la possibilité même du front populaire entre les ordres productifs. Lorsqu’il entre dans l’arène électorale, il rencontre de grandes difficultés pour présenter un candidat national en vue des élections présidentielles de 1896.
Le choix se porte finalement sur William Jennings Bryan, candidat du Parti démocrate et partisan du silver standard, à savoir le raccrochage du dollar à l’argent et la création d’un système monétaire international bimétallique. Brillant orateur, Bryan séduit les militants du People’s Party avec son célèbre « discours de la Croix d’or », prononcé lors de la convention démocrate de Chicago de 1896. Le jeune avocat du Nebraska s’en prend aux détenteurs inactifs de capital dans les grandes villes américaines, accusés d’étrangler les masses laborieuses et d’assécher les « vastes et fertiles prairies » du pays. « Vous ne mettrez pas », lance-t-il aux partisans de l’étalon-or, « sur le front du travailleur cette couronne d’épines, vous ne crucifierez pas l’humanité sur une croix d’or ». L’alliance est aussitôt scellée. Mais en contrôlant de plus en plus le mouvement, le Parti démocrate l’asservit à ses dynamiques internes. À cette époque, les Démocrates sont enracinés dans le Sud et prônent la ségrégation raciale : les répercussions sur le People’s Party sont immédiates, notamment sur la participation des fermiers noirs[113]. Lorsque William Jennings Bryan est enfin battu aux élections de 1896, sa déroute emporte le People’s party. Le mouvement des fermiers disparaît avec lui[114].
Derrière cette entrée dans la course électorale se joue quelque chose de plus qu’une simple compromission avec la « saleté » de la politique institutionnelle, que le mouvement redoutait depuis le début. On passe, au fond, d’un mouvement social sans leaders à un mouvement politique organisé, avec des stratégies, des hiérarchies et des chefs. Aussi, en canalisant les revendications paysannes dans la politique institutionnelle, le Parti Démocrate et le Free Silver Movement les ont partiellement dénaturées : ils leur ont ôté la dynamique radicalement démocratique qui avait présidé à leur gestation, pour les assujettir à une stratégie politicienne. C’est pourquoi l’échec du People’s Party était, d’une certaine manière, programmé d’avance : en se transformant en parti politique, le mouvement ne pouvait que devenir, pour utiliser la métaphore de Lawrence Goodwyn, « l’ombre » de lui-même (un « shadow movement »)[115].
Par contre, ses effets sur la politique états-unienne ne se limitent pas, loin de là, à cet échec. La crise populiste a affecté durablement la législation américaine postérieure. Elle a progressivement sensibilisé les élus des États ruraux, du Sud, de l’Ouest et du Midwest, à la question sociale. On doit à leurs pressions sur le Congrès, au début du xxe siècle, la mise en place des premières agences fédérales de réglementation financière et de contrôle des trusts, ainsi que les premières mesures en faveur des travailleurs[116]. Quarante ans après l’échec de 1896, ce sont d’ailleurs des élus Démocrates des circonscriptions du Sud où le People’s Party était implanté, qui apportent un soutien décisif au New Deal, en faisant approuver les premières lois de soutien à l’agriculture (Agricultural Adjustement Act de 1933) et la Security Exchange Act, décret de réglementation de Wall Street. Plus généralement, la candidature de William Jennings Bryan, par-delà son échec, marque historiquement la réorientation sociale du Parti démocrate à l’échelle nationale, ainsi que la légitimation croissante de l’intervention de l’État dans les affaires socio-économiques du pays[117].
C’est ici que les choses se compliquent. Car dans les années 1930, le nom du People’s Party réapparaît concomitamment à un autre phénomène politique plus inquiétant. À cette réorientation sociale du Parti démocrate participent en effet des élus fascisants, tous solidement implantés dans les États du Sud. Ces élus démocrates attribuent les causes de la Grande Dépression à la finance juive, à l’absence d’hommes forts dans la République américaine, et à la dégénérescence, tant morale que raciale, de la nation[118]. L’un d’eux est Huey P. Long, jeune gouverneur démocrate de la Louisiane, surnommé « The Kingfish ». Entre 1928 et 1935, ce fanatique de la Bible, admirateur du fascisme italien, met en place dans son État un gouvernement semi-dictatorial. Il brise tout dissensus en instaurant la loi martiale, en se servant de la mafia à des fins d’intimidation, et en plaçant ses hommes dans les postes clés de l’administration publique. Considéré par Roosevelt comme un fasciste dangereux, Long cherche à s’imposer face à lui au sein du Parti démocrate, car il le juge trop complaisant envers les grandes banques et Wall Street. L’un de ses principaux soutiens est un prêcheur antisémite de Detroit, le Père Charles E. Coughlin. Depuis son émission de radio (L’heure du pouvoir), puis son journal pro-nazi (Social Justice), cet évangéliste annonce la fin du monde et une guerre raciale imminente. Dans les années 1930 ce duo très populaire – le démagogue véreux et le prophète antisémite -, cherche de facto à infléchir la politique du Parti démocrate vers une forme « sociale » bien distincte de celle que lui prêtera, finalement, Roosevelt.
Le duo a fait couler beaucoup d’encre parmi les spécialistes du populisme. Nombre d’entre eux le considèrent comme un moment de transformation du legs politique du People’s Party, et de transition du populisme de la gauche à l’extrême droite. Le résultat de cette mutation génétique aurait été, dans les années 1960, une autre figure haute en couleur du « populisme américain » : George Wallace. Gouverneur démocrate de l’Alabama entre 1963 et 1967, fervent défenseur de la ségrégation raciale, ce futur candidat à la Présidentielle restera célèbre pour avoir tenté d’empêcher les deux premiers étudiants noirs d’accéder à l’Université.
Du People’s Party au New Deal, du People’s Party à l’extrême droite ; deux postérités bien différentes et à maints égards antinomiques. Là où la première est documentée historiquement, avec des statistiques administratives et des études prosopographiques, la deuxième est purement spéculative. Elle repose sur la prétendue « rhétorique du ressentiment » qui aurait été commune au People’s Party et au trio Long-Coughlin-Wallace[119]. Or le peuple des fermiers états-uniens de la fin du XIXe siècle était, avant tout, un peuple économique et social réclamant davantage de démocratie ; il n’avait pas grand-chose à voir avec le peuple « pur », conservateur et raciste, exalté par Long, Coughlin et Wallace.
Surtout, les études qui insistent sur le « populisme » des uns et des autres, y compris dans un souci scientifiquement légitime de repérer des variantes politiques du phénomène[120], ne prennent pas en compte deux éléments fondamentaux. Primo : dans les années 1930, le choc social, économique, politique et culturel de la Grande Dépression donne lieu, avec la montée parallèle des totalitarismes en Europe, à une nouvelle ligne politique aux États-Unis, qui oppose la nation à des « traîtres » définis par leurs caractères raciaux (Noirs ou Juifs). Une telle ligne n’existait pas dans le People’s Party. Il est donc abusif de construire, à partir d’elle, une supposée « continuité » dans le populisme américain ; c’est plutôt le concept de populisme qui, appliqué à des réalités politiques totalement différentes, invite à l’établir de manière illusoire. Secundo : si une telle ligne rouge devait être tracée, elle ne devrait pas l’être au niveau du « style paranoïaque »[121] des uns et des autres, mais plutôt, dans un souci d’objectivité historique, au niveau de la politique du Parti démocrate dans les États du Sud. C’est le Parti démocrate qui était raciste et ségrégationniste, non le People’s Party. Le trio Long-Coughlin-Wallace n’appartient ni à l’histoire des fermiers en lutte de la fin de siècle, ni, par conséquent, à celle du populisme états-unien, mais à celle du Parti démocrate, notamment dans le Sud du pays[122].
Un simulacre de populisme : le boulangisme
Le boulangisme français (1888-1891) est souvent considéré comme une autre manifestation historique du populisme, à l’instar du narodnitchestvo et du People’s Party[123]. En réalité, il n’en est rien. Il n’est qu’un simulacre de populisme, car il en a l’apparence trompeuse, mais son idéologie est tout autre. En réalité, le boulangisme a été un mouvement proto-fasciste.
Certes, les similitudes avec le narodnitchestvo et le People’s Party sont frappantes. Comme le narodnitchestvo, le boulangisme est, pour reprendre l’expression de l’historien Arnaud-Dominique Houte, « né à gauche ». Il rassemble, sous la forme d’un grand mouvement populaire dans lequel convergent des ouvriers, des soldats, des travailleurs agricoles et des artisans ruinés, « les « petits » qui subissent les effets conjugués de la crise [économique] et de la modernisation ». Il s’inscrit, par ailleurs, « dans la tradition révolutionnaire romantique du xixe siècle, dont il constitue peut-être le dernier feu »[124]. Comme le People’s Party dont il est contemporain, il surgit d’une crise sociale et économique profonde d’un gouvernement républicain, la IIIe République (1870-1940). Il se propose, lui aussi, de fonder une nouvelle république non aliénée aux élites, à l’aide d’une Assemblée constituante qui consacrerait, enfin, le pouvoir populaire.
Mais, lorsqu’on l’observe plus attentivement, ce programme apparaît illusoire. Contrairement au narodnitchestvo et au People’s Party, il ne se décline jamais sous forme de revendications concrètes, mais reste à un niveau très abstrait. Cela permet, dans un premier temps, au boulangisme de fédérer tous les déçus, tant à gauche qu’à droite, de la IIIe République : il est, suivant l’heureuse expression de l’historien Michel Winock, le « syndic des mécontents »[125]. Mais très vite, cette vacuité idéologique éclate au grand-jour, et le mouvement implose sous l’effet de ses contradictions internes. Il apparaît alors pour ce qu’il a été depuis le début : la somme de deux poussées politiques synchrones, qui trouvèrent pour un temps très court, le temps de la séduction du général, un terrain d’entente. La première est la poussée du nationalisme. Elle se nourrit du revanchisme anti-allemand postérieur à la guerre de 1870, de la xénophobie d’une partie du mouvement ouvrier, dont sont victimes des travailleurs belges et italiens, et de la banalisation de l’antisémitisme. La deuxième poussée est celle du mouvement ouvrier. Il devient, en cette fin de siècle, un acteur incontournable de la scène politique française[126].
Le boulangisme en offre une synthèse éphémère, et très instable. Il exprime un nouveau nationalisme des classes populaires qui, ayant rompu avec le patriotisme universalisant de la Révolution française, cherche désormais des boucs émissaires ethniques aux injustices sociales : les Allemands, les Italiens, les Juifs[127]. Les élites économiques, politiques et financières auxquelles le boulangisme oppose le peuple sont pensées comme des ennemis de la nation et de la race. Cette opposition vague du peuple aux « gros »[128] a été la principale raison de son succès à gauche. En pleine structuration politique, le mouvement ouvrier était encore très divisé en son sein, notamment sur la stratégie à mettre en place, après le désastre de la Commune, pour vaincre le capitalisme et l’État. Une partie cède alors au chant des sirènes de Boulanger. Partisans de l’insurrection populaire spontantée, les blanquistes (du nom de leur inspirateur, Auguste Blanqui) voient dans la confusion créée par le général l’occasion de mener leur révolution sociale. « La révolution est commencée » disent à l’unisson, en 1887, Paul Lafargue et le « général Eudes », héros de la Commune. Si la révolte prolétarienne ne verra pas le jour, le boulangisme reste un bouleversement politique sans précédents depuis la Révolution française. Il s’apparente à une véritable crise proto-fasciste, comme celle qui agitera l’Italie trente-cinq ans plus tard.
La IIIe République en crise
À la fin du xixe siècle, l’économie française est en récession. En 1882, l’éclatement de la bulle spéculative sur l’immobilier et les chemins de fer a engendré la faillite de la banque d’affaires de l’Union générale. En 1886, on dénombre près de 9 000 faillites d’entreprises. Le taux de chômage dans le secteur le plus touché par la crise, l’industrie parisienne du bâtiment, atteint presque 50 %. À cela s’ajoute une profonde récession agricole, due à la baisse des prix du gros et du détail, qui pousse les paysans, après des décennies d’isolement, à s’organiser et à réclamer une prise en charge publique[129].
La classe dirigeante de la IIIe République semble peu apte à répondre à cette crise multiforme. Non seulement la jeune République parlementaire est encore politiquement instable, en raison des alliances nécessaires, et nécessairement éphémères, que les républicains doivent contracter avec les ennemis jurés de la république – les bonapartistes et les orléanistes. Mais encore, davantage que vers la résolution de la crise, elle semble tournée vers la défense des grands lobbies économiques, comme la Compagnie du canal de Panama de Ferdinand de Lesseps, balayée, quelques années plus tard, par un scandale retentissant de corruption. La figure tragicomique de Daniel Wilson, sous-secrétaire aux finances et gendre du président Jules Grévy, semble résumer ce moment de crise. On découvre en 1887, à l’apogée de la récession, qu’il s’est livré avec le sous-chef d’état-major de l’armée, le général Caffarel, à un trafic de légions d’honneur. Son beau-père démissionne le 2 décembre : fâcheux anniversaire, celui du coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. La République semble aux abois.
La défiance populaire envers la classe politique ne peut qu’augmenter. Car la crise a aussi rouvert dans la mémoire collective des blessures qui ne sont pas encore guéries. L’une est la défaite avec l’Allemagne de 1871, vécue comme une véritable humiliation nationale. Les réparations de guerre, ainsi que la perte de l’Alsace et de la Lorraine, grèvent l’économie française dans un moment de hausse des dépenses militaires en raison de l’expansion coloniale en Tunisie et au Tonkin. L’autre blessure est la question sociale. Au revanchisme national face à l’Allemagne, partagé par tous les groupes sociaux sans exception, se mêle un revanchisme social ressenti plus particulièrement par les classes populaires : les vétérans sans solde, les ouvriers au chômage, les artisans sans commandes et les travailleurs agricoles paupérisés. En cette fin de siècle, les classes populaires ne disposent toujours pas d’une législation sociale et d’un droit du travail à la hauteur de la modernisation capitaliste dont elles font, pourtant, les frais.
Tout en se voulant ouverte à la question sociale, avec les premières lois relatives à la création des syndicats professionnels (1884), la IIIe République avance très lentement en matière de droit du travail. Depuis la loi contre le travail des mineurs de 1874, aucune avancée concrète n’a été obtenue par les travailleurs, en dépit des pressions constantes des socialistes. La classe dirigeante de la IIIe République, et notamment son noyau dur constitué des libéraux modérés dits « opportunistes », avec Jules Ferry comme chef de file, semble insensible à ces revendications. Tout en ayant la « démophilie inconditionnelle », comme l’écrit l’historien Maurice Agulhon[130], ces républicains libéraux tendent l’oreille davantage aux desseins des élites économiques, auxquels ils prêtent leur concours légal ou illicite, qu’aux besoins des travailleurs. L’alliance avec les élites industrielles et financières, renforcée par la référence commune au libéralisme, est un gage de stabilité pour des partis qui doivent, pour l’essentiel, recourir à des fonds privés pour le financement de leurs campagnes électorales[131]. Mais la contradiction de cette République, sociale sur le papier, bourgeoise dans les faits, devient criante en temps de crise.
Dans ce contexte explosif, ponctué de nombreuses grèves ouvrières (les mineurs de Decazeville en 1886 et les ouvriers du bâtiment parisien en 1888), un personnage charismatique et haut en couleur rassemble bientôt tous les mécontents : le général Boulanger. Né en 1837, il s’était illustré dans des faits d’armes en Italie, en Cochinchine et dans la guerre franco-prussienne, ce qui lui avait valu d’être promu très rapidement et de devenir, en 1884, le plus jeune général de l’armée française. En tant que ministre de la guerre (1886-1887), il avait fait preuve de courage et de sensibilité sociale : il avait radié les officiers monarchistes de l’armée, amélioré les conditions de vie des soldats et refusé d’intervenir militairement contre les grévistes de Decazeville. « Peut-être, avait-il dit publiquement en 1886, à l’heure où je vous parle, chaque soldat partage avec un mineur sa soupe et sa ration de pain[132]. » Ses prises de position progressistes lui valent, le 31 mai 1887, de ne pas être reconduit à son ministère par le nouveau cabinet mené par Maurice Rouvier, après les démissions de Grévy. Mais elles lui assurent le soutien indéfectible des soldats. Elles suscitent, aussi, l’admiration des ouvriers des régions industrielles et des artisans des grandes villes, ayant souvent fait front commun dans les révolutions sociales du xixe siècle[133]. Elles rayonnent, enfin, dans les campagnes françaises, en touchant la fibre socialiste, romantique et chrétienne, des paysans politisés dans l’après-coup de 1848[134]. Tous ces groupes sociaux partagent, dans ces années de crise, la même vision négative de la « République opportuniste » des libéraux.
La popularité du général ne tarde pas à se manifester. En août 1888, il est élu simultanément dans trois circonscriptions, en Charente inférieure, dans la Somme et dans le Nord. En même temps des grèves massives agitent Paris, peu avant que Boulanger décide de s’y porter candidat. La répression policière et les maladresses gouvernementales renforcent sa popularité, en produisant un véritable raz-de-marée aux élections parisiennes du 27 janvier 1889 : le général recueille 57 % des suffrages exprimés. Toutes les forces contestataires de la IIIe République, allant de la gauche radicale à la droite monarchiste, cherchent à capitaliser sur cette victoire. La gauche se rallie au mouvement, à l’exception d’une partie des guesdistes, qui redoutent le césarisme du général. La droite l’instrumentalise en finançant secrètement ses campagnes électorales, en échange de la promesse d’une restauration de la monarchie.
Après l’apothéose parisienne, Boulanger est candidat aux élections générales de 1889. Mais la réaction des libéraux « opportunistes », après la déconvenue initiale, ne tarde à venir. Un procès pour complot, monté sans aucune preuve, vise Paul Déroulède, un des députés boulangistes les plus en vue, et sa Ligue des patriotes, soutien stratégique du mouvement. Face à la possibilité d’une levée de sa propre immunité parlementaire, Boulanger s’enfuit précipitamment en Belgique. La campagne de 1889 s’ouvre ainsi sans son champion. Le général est bientôt accusé, à son tour, de complot. Sa fuite le désigne alors publiquement comme coupable : condamné par contumace, il devient inéligible. Son parti, le Comité républicain national, affronte les élections générales dans un état de totale improvisation et, surtout, laisse les commandes aux monarchistes, qui menacent de couper les vivres si le programme vire trop à gauche. La désaffection croissante de la gauche radicale sonne le glas du boulangisme : malgré une dernière tentative de remobilisation de la base populaire parisienne en 1890, le mouvement se désagrège progressivement. Lâché par ses proches, le général s’écrie à quelques jours de son suicide : « Je me suis aperçu que j’étais plus socialiste que ceux qui étaient autour de moi et qui prétendaient l’être[135]. »
Plusieurs boulangismes coexistent ainsi dans le mouvement : un boulangisme insurrectionnel, notamment blanquiste, qui mise sur le républicanisme social du général et sa capacité de mobilisation révolutionnaire[136] ; un boulangisme ultra-nationaliste, qui lui fait confiance pour humilier l’Allemagne et libérer la France des Juifs ; un boulangisme anti-républicain, celui de la droite monarchiste qui voit dans le général le champion d’une possible restauration. Ce dernier est le premier à être déçu. Contrairement à une idée reçue encore largement répandue aujourd’hui, Boulanger n’a jamais eu pour projet de mener un coup d’État, car il avait renoncé à la possibilité d’en faire lorsqu’il l’aurait pu, le 27 janvier 1889[137]. Les deux premiers coexistent, quant à eux, chez certaines figures marquantes du mouvement, comme Henri Rochefort ou Maurice Barrès[138]. Ce dernier en constitue la meilleure synthèse idéologique : le futur fondateur de l’Action française puise dans le boulangisme son projet d’un socialisme nationaliste (ou, suivant les lectures historiographiques, d’un national-socialisme « à la française »)[139].
Il y a un dernier boulangisme qui est rarement pris en compte, alors qu’il constitue la colonne vertébrale du mouvement. C’est le « boulangisme populaire »[140] : la mobilisation des classes populaires, notamment parisiennes, qui a permis au mouvement d’exister politiquement. Il n’y aurait pas eu de boulangisme sans ce « boulangisme populaire », et le déclin de l’un est essentiellement le résultat de la démobilisation de l’autre. Le mouvement ne s’essouffle pas uniquement à cause de la fuite de son héros ; son glas est sonné par sa base populaire organisée qui, politisée majoritairement à gauche, s’y reconnaît de moins en moins. Ce « boulangisme populaire » ne se réduit pas, comme on le croit souvent, au vote massif des classes populaires pour le général. C’est un mouvement social à proprement parler, à base interclassiste, composé pour l’essentiel d’ouvriers, d’artisans et de soldats, et enraciné dans les grandes villes industrielles (Paris et sa banlieue, Nancy, Lille, Roubaix, Valenciennes)[141]. Il précède historiquement l’ascension fulgurante de Boulanger, car il s’alimente des grandes grèves ouvrières de 1885 à 1887, et naît sur les espoirs créés par la percée de la gauche radicale aux élections générales de 1885.
Comment expliquer alors que ce « boulangisme populaire » ne se soit dépris que trop tard de son « jeanfoutre », pour utiliser le mot sévère d’Engels[142] ? Deux séries de raisons peuvent être données. En premier lieu, le boulangisme a été sans doute le dernier moment où les ouvriers et les artisans des grandes villes ont convergé vers un même programme politique insurrectionnel. À la fin du xixe siècle, les uns se tourneront de plus en plus vers la gauche socialiste et les autres vers la droite nationaliste[143]. C’est pourquoi, soixante ans plus tard, ce revival du boulangisme que fut l’UDCA de Pierre Poujade (1953-1962), se plaçant dans la filiation de l’Action française, ne séduira que des boutiquiers et des artisans[144]. En deuxième lieu, en cette fin du XIXe siècle, la gauche radicale est encore divisée en une multitude de courants étanches, fonctionnant, à l’instar des blanquistes, comme de véritables sectes. Leur division a rendu possible la captation des mobilisations populaires par le boulangisme, fût-ce pour un temps très court.
Un proto-fascisme ?
Les conditions structurelles dans lesquelles surgit le boulangisme auraient pu en faire un mouvement radicalement démocratique, comme ce fut le cas du narodnitchestvo ou du People’s Party. Au contraire, le Comité républicain national n’a jamais pris la démocratie comme horizon concret de son action politique, mais la nation, jugée corrompue, blessée ou humiliée. Il a fait miroiter aux classes populaires mobilisées la promesse d’une nouvelle « République sociale », mais sans lien nécessaire et consubstantiel à la démocratie. Aucune délimitation procédurale n’est donnée, en effet, par Boulanger à son projet de refondation républicaine : on ne saura jamais à quel type de régime politique il aspirait. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il s’est présenté en leader inconditionnel, en chef incontesté du nouveau régime. C’est pourquoi le projet de république sociale des boulangistes n’est pas seulement compatible avec celui d’un État autoritaire, mais soluble en lui. Sur les ruines de la IIIe République, les boulangistes auraient probablement bâti un État nationaliste autoritaire, incarné par un chef charismatique et doté d’un système de protection sociale pour les travailleurs nationaux.
C’est, en tout et pour tout, le projet de république sociale qu’avait l’ex-socialiste Benito Mussolini (1883-1945) lorsque, à la tête de la Lista Nazionale, il gagne les élections de 1924, puis, en promettant une transformation ultranationaliste de l’État, gagne les faveurs des classes supérieures (comme les monarchistes acquis à Boulanger), et détruit la démocratie parlementaire de l’intérieur, sans nul besoin d’un coup d’État militaire[145]. Engels avait donc bien compris le danger de Boulanger. À une époque où La France juive d’Édouard Drumont se vendait par milliers d’exemplaires, dans un moment de recrudescence des tensions sociales, tout laissait penser que le boulangisme pût promouvoir une transformation ultranationaliste et autoritaire de la IIIe République. Une transformation légitimée, bien sûr, par la partie la plus xénophobe et la plus antisémite des classes populaires. Les archives politiques de la décennie 1890 nous apportent la preuve de cette possibilité historique. Après les avoir dépouillées, Bertrand Joly conclut que « dès 1891-1892, les rangs boulangistes furent massivement gagnés à l’antisémitisme, malgré quelques résistances vite marginales » et que « dans la période immédiatement antérieure à l’affaire Dreyfus [le thème de l’antisémitisme] entra visiblement et presque officiellement dans la rhétorique hostile à la république parlementaire[146] ».
Le boulangisme montre ainsi qu’il ne suffit pas de qualifier le populisme comme un moment critique de la démocratie ; encore faut-il savoir quelle critique du statu quo et quelle utopie démocratique habitent la crise. C’est ce confusionnisme qui a conduit la populologie à juger, à tort, le boulangisme comme un populisme[147]. En tant que crise démocratique cristallisée par l’opposition du peuple aux élites, le moment Boulanger rappelle le narodnitchestvo et le People’s Party. Mais sur quelles bases comparer la vision plébéienne et démocratique de la nation des narodniki et des fermiers états-uniens, et celle nationaliste, xénophobe et antisémite des boulangistes ? Comment comparer les cas russe et américain, où la démocratie est une utopie et une pratique militante, avec la démagogie d’un général qui, sous la férule des monarchistes, ne pouvait faire de la « république » qu’un miroir aux alouettes pour le peuple ?
En réalité, le boulangisme fut la concrétisation française, sous une forme encore embryonnaire, d’un phénomène politique différent du populisme, le fascisme :
un « phénomène politique moderne, nationaliste et révolutionnaire, […], avec une conception totalitaire de la politique et de l’État, […], avec des fondements mythiques, virilistes, […], qui affirme le primat absolu de la nation, entendue comme une communauté organique ethniquement homogène, hiérarchiquement organisée en un État corporatiste, avec une vocation belliqueuse à la politique de grandeur, de puissance et de conquête[148]. »
Cette définition, issue du fascisme italien (1922-43), se prête mieux à décrire les aspirations politiques réelles des boulangistes, de l’ultranationalisme du général à son revanchisme militaire vis-à-vis de l’Allemagne, de l’antisémitisme des figures clé du mouvement (Barrès, Déroulède et Rochefort) à sa vision de la république réduite au culte du chef.
En se penchant sur l’idéologie de Charles Maurras, qui reprend les idéaux boulangistes une décennie plus tard, l’historien Zeev Sternhell va même plus loin. Il fait de la crise boulangiste le premier moment où le fascisme, en tant que projet politique cohérent, apparaît en Europe[149]. Le boulangisme serait ainsi au fascisme ce que le narodnitchestvo est au populisme. En faisant du cas Boulanger, puis du poujadisme, des cas prototypiques du populisme, la populologie a occulté ce lien structurant avec le fascisme. Cet évitement doit beaucoup à l’emprise, en France, de la thèse de l’« exception fasciste », suivant laquelle le fascisme ne se serait pas implanté dans l’Hexagone, en raison de ses « antidotes républicains »[150].
Dans l’histoire des démocraties occidentales, la crise des gouvernements représentatifs libéraux a emprunté ainsi trois voies différentes : celle du populisme, celle du fascisme et celle du totalitarisme. Parfois ces chemins historiques semblent converger dans une même exaltation de la nation ; mais, à un examen plus attentif, la signification du mot « nation » diffère tellement entre eux que nous sommes en présence de phénomènes politiques incomparables. La voie populiste, qui maintient la démocratie et garde la définition la plus large et la plus inclusive du peuple et de la nation, naît en Russie, se développe aux États-Unis et prospère, on le verra, en Amérique latine. La voie fasciste, qui naît en France et se développe dans l’Italie mussolinienne, incarne le peuple dans une nation représentée par un chef, purifiée de ses ennemis internes et en guerre avec l’extérieur. Elle est aujourd’hui de retour en Europe, dans une extrême droite renouvelée qui affiche une posture xénophobe totalement décomplexée. La voie totalitaire, enfin, correspond à un développement extrême du projet fasciste : née dans l’Allemagne nazie et dans l’URSS stalinienne, elle place la purification de la nation au-dessus de tout, y compris de la destruction de la nation elle-même.
Anatomie d’une idéologie minimaliste
Une fois mis de côté le false friend du boulangisme, il nous reste désormais à accomplir la partie la plus difficile du travail. Il nous faut comprendre ce qui est structurellement commun à ces deux cas prototypiques du populisme, le narodnitchestvo et le People’s Party, auxquels il faudra bientôt ajouter la tradition latino-américaine. Quel est leur « noyau » idéologique commun ?
Une première tentative de définition, à laquelle aboutit l’école comparatiste dès les années 1960, met en avant le caractère agrairien de cette idéologie. Le populisme a été vu comme une exaltation des vertus naturelles du paysan, moujik ou granger, considéré représentatif du « peuple authentique », contre la modernité industrielle et urbaine[151]. Cette définition pose toutefois un problème méthodologique majeur. Elle cherche en effet à singulariser le populisme en tant qu’idéologie à partir de la supposée spécificité sociale de son acteur, la paysannerie. Mais une telle démarche ne vaudrait au fond… que pour le populisme ! Prenons d’autres idéologies politiques. Le libéralisme, par exemple : il ne saurait être défini comme un « bourgeoisisme », pour la simple raison que ses valeurs constitutives peuvent être revendiquées par une multitude d’acteurs dans des contextes sociaux et historiques différents. Pour la même raison, le socialisme ne saurait être défini comme un « prolétarisme ». Une telle analyse conduit à penser qu’une idéologie politique serait spécifique à un certain groupe social, au lieu de disposer d’une cohérence symbolique interne qui la rend appropriable par une multitude de groupes sociaux en fonction des contextes et des enjeux conflictuels[152]. C’est justement cette « appropriabilité » qui a fait qu’en Amérique latine le populisme soit devenu, au siècle suivant, une idéologie politique ouvrière, paysanne ou indigène selon les contextes, en quittant le côté spécifiquement « agrairien » du narodnitchestvo et du People’s Party.
Ce qui ressort des deux cas historiques analysés n’est pas l’hypothétique dimension agrairienne. La première caractéristique structurale du populisme est la radicalité démocratique. Dans les deux cas, on a affaire à des configurations historiques où une crise économique, sociale et politique se transforme en crise démocratique : autrement dit, en une crise où il y va de l’institution ou de la refondation de la démocratie. Dans le cas russe, cette démocratie reste à fonder : les narodniki cherchent donc à soulever le peuple contre le tsar. Dans le cas états-unien, cette démocratie existe déjà : c’est la république fille de la révolution de 1776. Mais elle est incomplète : elle se réduit à un gouvernement représentatif plaçant la majorité sociale dans l’incapacité, dans l’invisibilité, dans la passivité. Le premier point commun entre le narodnitchestvo, qui apparaît dans le contexte d’une société autocratique, et le People’s Party, qui surgit dans celui d’une république oligarchique, est l’utopie d’une démocratie radicale à réaliser ici et maintenant. Dans les deux cas, il s’agit de créer un ordre démocratique nouveau à partir d’un peuple, la paysannerie, auquel on impute les revendications de droits, liberté et justice de la majorité sociale opprimée. La crise qui engendre le populisme est donc lue et interprétée, tant dans ses causes que dans les solutions qui sont préconisées, par rapport à une démocratie à radicaliser. Dit autrement, la démocratie est la radix, la « racine » du populisme : c’est, pour les populistes, le problème à la racine même de la société.
D’où la deuxième caractéristique structurale, le minimalisme idéologique. La démocratie populiste, en effet, s’apparente à une utopie. Celle-ci, par définition, est tellement « maximaliste » qu’elle ne peut traduire un programme précis sans se renier. D’où un minimalisme idéologique parfaitement assumé : le socle de l’idéologie populiste tient en une simple opposition, le peuple contre l’élite. Les élites, entendues comme les forces corruptrices de la démocratie, sont opposées au peuple, qui en est sa sève, l’ensemble de ses forces vitales, légitimes, justes. Le peuple et les élites ne sont jamais socialement caractérisés. Leurs contours restent vagues, car ils sont entendus dans un sens métaphorique, comme des forces en lutte dans une démocratie à faire ou à refaire, et non pas comme des blocs sociaux distincts.
Ce minimalisme idéologique nous dit, de surcroît, quelque chose du contexte de production du populisme. Comme le montrent les cas russe et américain, le populisme surgit lorsque les attentes d’un changement démocratique, perçues différemment en fonction des groupes mobilisés, ne sont pas préalablement structurées par l’un d’entre eux dans une vision claire de ce qui peut et doit être fait, de la manière dont le changement doit se réaliser étape par étape, des buts à atteindre par la lutte. Bref : d’une stratégie. La principale raison du minimalisme de l’idéologie populiste n’est pas son indétermination structurelle, sa capacité à muer de manière caméléonesque de la gauche à la droite. C’est l’hétérogénéité des demandes démocratiques qu’elle véhicule. Ainsi en est-il, pour le narodnitchestvo, des demandes de « démocratisation de l’éducation et de la culture » formulées par l’intelligentsia russe, des revendications féministes des jeunes « croisées » de 1874 et des luttes ouvrières des tchaïkovtsy saint-pétersbourgeois. Il en va de même pour le People’s Party, avec ses demandes démocratiques émanant des fermiers ruinés, des ouvriers des Knights of Labor, des travailleurs issus de l’immigration, des femmes et des Noirs en quête des droits civiques. De cette hétérogénéité constitutive découle la vision forcément antistratégique du populisme, qui rend difficile son institutionnalisation, comme le montre l’échec programmé du People’s Party en 1896. De là vient également la méfiance qu’il a inspiré et continue d’inspirer à la gauche socialiste radicale : depuis les rejets de Lénine des « amis du peuple » jusqu’à la récente critique du philosophe marxiste-léniniste Slavoj Žižek de la théorie du populisme de gauche d’Ernesto Laclau[153].
Cette dimension antistratégique voue, bien souvent, le populisme à une apparition éphémère et inconséquente. Mais l’inconséquence n’est que provisoire car, en tant que moment démocratique radical, le populisme fige à jamais la trajectoire de la société dans laquelle il se produit. Plus rien ne pourra être comme avant. Il marque « au fer rouge » l’ordre politique en place, en faisant éclater au grand jour son caractère scandaleux, injuste, incomplet du point de vue du peuple. Ce « marquage » ne se traduit jamais, à l’exception du cas latino-américain où le populisme est parvenu au pouvoir, par un ensemble concret de réformes, car c’est la nécessité radicale et abstraite de démocratie qui fait tenir la mobilisation populaire dans toute sa pluralité et son hétérogénéité. Le populisme prépare, toujours, des changements profonds à venir, qui peuvent aller, suivant l’ouverture ou la fermeture croissante de la politique institutionnelle aux revendications populaires, dans un sens progressiste ou régressif.
Tous ces éléments apparaissent, réunis pour la première fois dans un ensemble idéologiquement cohérent, dans le socialisme romantique du premier xixe siècle[154]. C’est de là que vient le populisme. Comme le socialisme romantique, le populisme s’oppose, avec sa volonté d’élargir et les libertés et l’égalité sociale, tant aux tyrans qu’aux libéraux insensibles à la question sociale. Comme lui, il critique la vision que les libéraux ont de la « modernité démocratique », c’est-à-dire de la « bonne » démocratie qui, pour être moderne, devrait éradiquer toute aspiration populaire à une démocratie plus directe et plus juste, et suivre aveuglément la loi du progrès économique. Sa vision de la « modernité démocratique » est le produit d’une posture radicalement antimoderne : nous y reviendrons. Comme le socialisme romantique, enfin, le populisme s’oppose à toute conceptualisation rationnelle et stratégique du changement démocratique souhaité, tout en croyant fermement à la nécessité et à la possibilité d’un tel changement.
Cependant le populisme apparaît à une époque, la seconde moitié du xixe siècle, où le socialisme romantique s’épuise progressivement. Il est contemporain, par contre, de trois autres idéologies qui, comme lui, apparaîtront par la suite dans les moments critiques des démocraties représentatives et libérales : le nationalisme, le fascisme et le socialisme marxiste.
Les différences avec le nationalisme ont été étayées : là où le nationalisme, à partir de la fin du xixe siècle, réduit la nation à un ethnos et le pense en opposition à des boucs émissaires, à un « Autre menaçant[155] », le populisme relie la nation à une plèbe démocratique. La différence avec le fascisme tient à la pleine inscription du populisme dans la modernité démocratique, là où le fascisme y oppose « une modernité antagoniste », « fondée sur la militarisation et la sacralisation de la politique, mais aussi sur la totale subordination de l’individu à l’État »[156]. Le populisme livre toujours une critique interne de la modernité démocratique, là où le fascisme, par volonté anti-moderne ou hyper-moderne[157], prétend toujours dépasser la démocratie comme mode de gouvernement. La différence avec le socialisme marxiste est double : la construction morale, spontanéiste et antistratégique du conflit populaire du côté populiste, et sa construction politique, avant-gardiste et stratégique du côté socialiste ; l’opposition « peuple-élite » du côté populiste et celle « travail-capital » du côté socialiste. Le populisme est travaillé par la question démocratique : il vise à égaliser l’accès à la culture, à la politique, à l’activité économique, mais ignore le problème structurel de l’organisation capitaliste des sociétés modernes. Le socialisme marxiste, tout au contraire, est travaillé par la question du capitalisme : il vise à l’abattre comme mode d’organisation de la société en classes, mais ignore le problème structurel de l’organisation démocratique des sociétés modernes. Voici la grande différence idéologique entre ces deux enfants du socialisme romantique, le populisme et le socialisme marxiste. Elle explique, une fois ceux-ci convertis en projets de gouvernement, les déboires de l’un, qu’on examinera en détail dans le prochain chapitre, et ceux de l’autre, qu’on a découverts il y a longtemps déjà dans les pays du « socialisme réel ».
Notes
[1] Ce que Michel Foucault appelle, en utilisant la métaphore géologique des « strates », « l’ordre stratifié du discours », et Reinhart Koselleck la « sémantique historique » des concepts. Michel Foucault, L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971 ; Reinhart Koselleck, Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, Paris, Éditions de l’EHESS, 1990.
[2] Nicole Loraux, « Éloge de l’anachronisme en histoire », Le Genre humain, n° 27, 1993, p. 23-39.
[3] Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, tome II, Paris, Gallimard, 1961, p. 143.
[4] Tim Houwen, Reclaiming Power for the People : Populism in Democracy, Nijmegen, Radboud University, 2013, p. 39.
[5] Larousse mensuel illustré (éd. C. Augé), Tome I, 1907-1910, p. 62.
[6] En réalité, dès 1897, un militant de l’éducation populaire, Paul Crouzet, l’avait employé dans une acception similaire, en invoquant une littérature nouvelle placée sous l’égide du « Génie du populisme ». Paul Crouzet, Littérature et conférences populaires, Paris, Armand Colin, 1897, p. 88. Cit. in Pierre Rosanvallon, Le siècle du populisme, op. cit., p. 267.
[7] Léon Lemonnier, « Un manifeste littéraire : le roman populiste », L’Œuvre, 27 août 1929 (republié in Léon Lemonnier, Manifeste du Roman populiste et autres textes [éd. F. Ouellet], Le Raincy, La Thébaïde, 2017) ; Léon Lemonnier, Populisme, Paris, La Renaissance du livre, 1931.
[8] Federico Tarragoni, « Le peuple spectateur et l’émancipation démocratique. Sur la sensibilité populiste en littérature », Raison publique, n° 19, 2014, p. 199-222.
[9] Franco Venturi, Les intellectuels, le peuple et la révolution. Histoire du populisme russe au XIXe siècle (1952), 2 Tomes, Paris, Gallimard, 1972.
[10] L’expression revient souvent dans le livre. Ibid. (t. 1), p. 11, 21, 29.
[11] John B. Allcock, « “Populism” : A Brief Biography », Sociology, n° 5, 1971, p. 371-387.
[12] Edward Shils, The Torment of Secrecy : The Background and Consequencies of American Security Policies, Glencoe, IL Free Press, 1956, p. 100-101.
[13] William Kornhauser, The Politics of Mass Society, London, Routledge & Kegan Paul, 1959.
[14] Gino Germani, « L’autoritarisme et les classes populaires » (1957), Politique, société et modernisation, Gembloux, Duculot, 1972. Il remettra en cause, par la suite, la pertinence du deuxième processus pour l’explication du populisme.
[15] Seymour M. Lipset, « Democracy and Working Class Authoritarianism », American Sociological Review, n° 24, 1959, p. 482-501.
[16] Seymour M. Lipset et Earl Raab, The Politics of Unreason : Right-Wing Extremism in America, 1790-1970, London, Heinemann, 1971.
[17] Richard Hofstadter, « The Paranoid Style in American Politics » (1964), The Paranoid Style in American Politics and Other Essays, New York, Vintage Books, 2008 ; Daniel Bell (dir.), The Radical Right, Freeport/New York, Books for Libraries Press, 1971 [1963]. Pour une critique de cette interprétation rétrospective, voir Michael Kazin, The Populist Persuasion : An American History, New York, Cornell University Press, 2017, p. 192.
[18] Ainsi que le suggèrent Ghita Ionescu et Ernest Gellner, en paraphrasant l’incipit du Manifeste du Parti communiste dans leur Introduction générale : « A Spectre is haunting the world : Populism ». Ghita Ionescu et Ernest Gellner, op. cit., p. 1.
[19] Margaret Canovan, « Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy », Political Studies, n° 67, 1999, p. 2-16.
[20] Michael Oakeshott, The Politics of Faith and the Politics of Scepticism, New Haven/London, Yale University Press, 1996.
[21] Margaret Canovan, Populism, op. cit.
[22] Edmond Silberner et Lucien Febvre, « Mots et choses : le mot capitalisme », Annales d’histoire sociale, n° 2, 1940, p. 133-134.
[23] Max Weber, « L’ »esprit » du capitalisme », L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Plon, 1964.
[24] Ces deux esprits définissent stricto sensu la démocratie dont il est question dans le populisme. Faute de précisions supplémentaires, c’est cette définition de « démocratie » que nous adopterons par la suite. Voir aussi Giovanni Sartori, Democrazia e definizioni, Bologna, Il Mulino, 1957.
[25] Travers parfaitement assumés, au risque du contresens méthodologique, par M. Canovan. Dans sa typologie comparative, la politiste reconnaît que les variantes du populisme sont différents « types d’objets, non comparables directement entre eux ». Margaret Canovan, Populism, op. cit., p. 298.
[26] Jean-Claude Passeron, « L’espace wébérien du raisonnement naturel », Enquête, n° 7, 1992, p. 4. URL : https://journals.openedition.org/enquete/125 ; Jean-Pierre Olivier de Sardan, « L’espace wébérien des sciences sociales », Genèses, n° 10, 1993, p. 146-160 (notamment le chapitre « Type, comparatisme »).
[27] Max Weber, « Introduction à L’Éthique économique des religions universelles » (trad. et éd. J-P. Grossein), Archives de sciences sociales des religions, n° 77, 1992, p. 139-167.
[28] Stephen Kalberg, Les valeurs, les idées et les intérêts, Paris, La Découverte, 2010, p. 260.
[29] Max Weber, Essais sur la théorie de la science (tr. et éd. J. Freund), Paris, Pocket, 1992, p. 181.
[30] Paul Taggart, op. cit., p. 22. Le même problème se retrouve dans de nombreuses synthèses contemporaines. À titre d’exemple, on verra Sergiu Gherghina, Sergiu Miscoiu et Sorina Soare (eds.), Contemporary populism. A controversial concept and its diverse forms, Newcastle, Cambridge Scholar Publishing, 2013 ; Carlos de la Torre (ed.), The Promise and Perils of Populism. Global Perspectives, Lexington, The University Press of Kentucky, 2015 ; Benjamin Moffitt, The Global Rise of Populism. Performance, Political Style, and Representation, Stanford, Stanford University Press, 2016.
[31] Margaret Canovan, Populism, op. cit., p. 133.
[32] Pour une critique de ce tropisme, voir Jacques Lagroye (dir.), La politisation, Paris, Belin, 2003 ; Federico Tarragoni, « Introduction. Ce que politique veut dire », Raison publique, n° 21, 2017, p. 11-17. En ajoutant à cette définition restrictive de la politique les procédures électives, leurs pratiques et leurs représentations, Yves Déloye a proposé une ambitieuse « sociologie historique du politique » cohérente avec ce cadrage. Celle que nous proposons, d’inspiration wébérienne, est alternative : elle s’appuie sur une définition compréhensive du politique comme « mode d’action conflictuel en commun », en deçà ou au-delà de toute institutionnalisation. Cf. Yves Déloye, Sociologie historique du politique, Paris, La Découverte, 2007.
[33] Boris Gobille, « Conclusion. L’inouï de Mai », Mai 68, Paris, La Découverte, 2018 ; Ludivine Bantigny, 1968, de grands soirs en petits matins, Paris, Seuil, 2018.
[34] Federico Tarragoni, L’Énigme révolutionnaire, Paris, Les Prairies ordinaires, 2015.
[35] Daniel Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, Paris, La Découverte, 2007.
[36] Lilian Mathieu, L’espace des mouvements sociaux, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant, 2012.
[37] Ce que Michel Dobry appelle l’« illusion étiologique ». Michel Dobry, « Trois illusions de la sociologie des crises politiques », Sociologie des crises politiques, Paris, Presses de Sciences po, 2009 ; Federico Tarragoni, « Les cendres et le brasier : ce que l’historien apprend au sociologue des révolutions », Écrire l’histoire, n° 18, 2018, p. 69-79.
[38] Federico Tarragoni, « La révolution contre la « fin de l’histoire ». Réflexions sur une sociologie possibiliste à partir de Max Weber », Écrire l’histoire, n° 15, 2015, p. 45-52.
[39] Nous reprenons le concept de « configuration » dans l’acception de la sociologie historique de Norbert Elias. Ce concept a l’avantage d’articuler une approche macro des processus sociaux qui scandent l’histoire (dans notre cas, l’évolution des démocraties représentatives) et une approche micro des interactions qui nourrissent ces processus et les transforment (dans notre cas, l’effet sur les individus et les groupes de la crise populiste). Norbert Elias, Qu’est-ce que la sociologie ?, Paris, Pocket, 1981.
[40] Franco Venturi, op. cit., p. 12.
[41] Andrzej Walicki, The Controversy Over Capitalism. Studies in the Social Philosophy of the Russian Populists, Oxford, Clarendon Press, 1969.
[42] Richard Pipes, « Narodnitchestvo : A semantic inquiry », Slavic Review, n° 23, 1964, p. 445.
[43] Karl Mannheim, Le problème des générations, Paris, Armand Colin, 2011.
[44] Michel Cadot, « La Russie, l’Europe et la révolution », La Russie dans la vie intellectuelle française. 1839-1856, Paris, Fayard, 1967.
[45] Victor Hugo constitue une référence en la matière. Voir Alain Pessin, Le mythe du peuple et la société française du XIXe siècle, Paris, PUF, 1992. À la même époque, cette idée est partagée par les fondateurs des English studies au Royaume-Uni, en particulier Matthew Arnold (1822-88). Très proche des socialistes romantiques français, il en partageait « l’idéalisation du peuple au cœur de leur vision de la démocratie ». Comme eux, il considérait que le principal apport des intellectuels à la démocratie tenait à la création de nouvelles valeurs culturelles et esthétiques accompagnant la montée de l’égalité sociale. C’est pourquoi la représentation du peuple en littérature était pour lui un enjeu absolument central. Stefan Collini, Arnold, Oxford/NY, Oxford University Press, 1988, p. 69-70.
[46] Alain Pessin, Le populisme russe (1821-1881) ou la rencontre avec un peuple imaginaire : populisme, mythe et anarchie, Lyon, Atelier de création libertaire, 1997.
[47] Michael Löwy et Robert Sayre, Révolte et mélancolie. Le romantisme à contre-courant de la modernité, Paris, Payot, 1992.
[48] Cit. in Franco Venturi, op. cit., p. 63.
[49] Ibid., p. 78.
[50] Jeunes activistes qui cherchent, entre 1869 et 1872, à soulever les ouvriers de Saint-Pétersbourg. Voir Les tchaïkovtsy. Esquisse d’une histoire (par l’un d’entre eux), 1869-1872, Rennes, Éditions Pontcerq, 2013 (sans auteur) ; Reginald E. Zelnik, « Populists and Workers. The First Encounter between Populist Students and Industrial Workers in St. Petersburg, 1871-74 », Soviet Studies, n° 24, 1972, p. 251-269.
[51] Richard Stites, The Women’s Liberation Movement in Russia. Feminism, Nihilism and Bolshevism, 1860-1930, Princeton, Princeton University Press, 1990.
[52] Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution (livre 2, ch. 5), Paris, Gallimard, 1985.
[53] Edward P. Thompson, Les Usages de la coutume. Traditions et résistances populaires en Angleterre. XVIIe-XIXe siècle, Paris, Gallimard, 2015.
[54] Theodore H. Von Laue, « The Fate of Capitalism in Russia : The Narodnik Version », The American Slavic and East European Review, n° 13, 1954, p. 11-28.
[55] L’expression, soulignant l’imbrication de thèmes religieux et politiques, est utilisée par Adam B. Ulam, Prophets and Conspirators in Prerevolutionary Russia, New Brunswick, NJ Transaction, 1998.
[56] L’engagement des femmes dans la cause terroriste est symptomatique de cette évolution. L’ancienne revendication du droit d’accès aux études et à la culture cède le pas à la lutte violente contre le patriarcat, qu’il s’agit d’abattre dans toute la société russe, y compris, et surtout, dans la culture paysanne traditionnelle. Vera Zassoulitch, Olga Loubatovitch, Élisabeth Kovalskaïa et Vera Figner, Quatre femmes terroristes contre le tsar (tr. H. Châtelain, éd. C. Fauré), Paris, Maspero, 1978.
[57] Viktor K. Jacunskij, « La révolution industrielle en Russie », Cahiers du monde russe et soviétique, n° 2, 1961, p. 307-308.
[58] Ce constat signe, pour Lénine, l’échec définitif de la stratégie populiste. « La réalité montre de la façon la plus évidente, écrit-il en 1895, que la « voie » est déjà choisie, que la domination du capital est un fait ». Vladimir I. Lénine, « Le contenu économique du populisme » (1895), Œuvres, t. 1, Paris, Éditions Sociales, 1976, p. 410.
[59] Vladimir I. Lénine, « Ce que sont les “Amis du peuple” et comment ils luttent contre les social-démocrates » (1894), Œuvres, op. cit. ; Simon Clarke, « Was Lenin a Marxist ? The Populist Roots of Marxism-Leninism », Historical Materialism, n° 3, 1998, p. 3-28 ; Mathieu Renault, « Traduire le marxisme dans le monde non-occidental. Lénine contre les populistes », Revue Période, 13 avril 2017. URL : http://revueperiode.net/traduire-le-marxisme-dans-le-monde-non-occidental-lenine-contre-les-populistes/.
[60] Toute autre fut la réception du narodnitchestvo dans le maoïsme, qui salua, précisément, sa stratégie pionnière de mobilisation de la paysannerie. Maurice Meisner, Marxism, Maoism and Utopianism. Eight Essays, London, The University of Wisconsin Press, 1982, p. 76-117.
[61] John E. Bachman, « Recent Soviet Historiography of Russian Revolutionary Populism », Slavic Review, n° 29, 1970, p. 599-612 ; Bruce F. Adams, « Recent Historiography of Russian Populism », Russian History, n° 16, 1989, p. 449-454.
[62] Christine Fauré, « Albert Camus, Nicolas Lazarévitch et le populisme russe », Communisme, n° 61, 2000, p. 111-118. Certains, comme l’historien R. Krakovsky, considèrent les partis agrariens de l’Europe de l’Est comme une autre postérité du narodnitchestvo. Issus de la décomposition des Empires austro-hongrois et ottoman, ces partis allient au début du XXe siècle le projet d’une réforme agraire à l’exaltation nationaliste de la paysannerie. Leur conception ethnique et antisémite de la nation, absente chez les narodniki, rend toutefois la filiation douteuse. Roman Krakovsky, Le populisme en Europe centrale et orientale. Un avertissement pour le monde ?, Paris, Fayard, 2019.
[63] Paul Taggart, op. cit., p. 49-50 ; Guy Hermet, Les populismes dans le monde, op. cit., p. 171.
[64] Sans compter la mutilation de la pensée d’Herzen et Tchernychevski : Venturi souligne qu’elle ne fut guère anti-libérale. Franco Venturi, op. cit., p. 76-77.
[65] Ibid., p. 87-88, 96-97. Les citations internes sont de Bakounine.
[66] Ibid., p. 150.
[67] Edward P. Thompson, La formation de la classe ouvrière anglaise, op. cit. ; Craig Calhoun, The Question of Class Struggle : Social Foundations of Popular Radicalism during the Industrial Revolution, Oxford, Blackwell, 1982 ; Gareth Stedman Jones, Languages of Classes: Studies in English Working Class History, 1832-1982, Cambridge, Cambridge University Press, 1983. Tous ces auteurs insistent sur l’influence du populisme dans le premier socialisme anglais. Renaud Morieux, « Un populist turn dans l’historiographie du XVIIIe siècle anglais ? », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 51, 2004, p. 153-174. Pour un parallèle avec le cas français, voir Roger Dupuy, La politique du peuple. Racines, permanences et ambiguïtés du populisme, Paris, Albin Michel, 2002.
[68] Étienne Balibar, Des universels. Essais et conférences, Paris, Galilée, 2016.
[69] Franco Venturi, op. cit., p. 184.
[70] Ibid., p. 52.
[71] Une telle position apparaît aussi dans le premier socialisme anglais, tel que décrit par E. P. Thompson. Federico Tarragoni, « La méthode d’Edward P. Thompson », Politix, n° 118, 2017, p. 183-205.
[72] Alain Pessin, La Rêverie anarchiste 1848-1914, Lyon, Atelier de création libertaire, 1999.
[73] Une telle position réapparaît, bien plus tard, chez Antonio Gramsci, « Problèmes de civilisation et de culture », Gramsci dans le texte, op. cit. Cette idéalisation petite-bourgeoise du peuple en littérature n’est pas sans poser problème. Voir Alberto Asor Rosa, Scrittori e popolo. Il populismo nella letteratura italiana contemporanea, Torino, Einaudi, 1988.
[74] Cette même question du « point de vue populaire » travaille Le Peuple de Jules Michelet (1846), bien avant que l’historien se familiarise avec la pensée d’Herzen. Federico Tarragoni, « Le peuple et son oracle. Une analyse du populisme savant à partir de Michelet », Romantisme, n° 170, 2015, p. 113-126.
[75] Pierre Bourdieu, « Vous avez dit « populaire » ? », Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil, 2001.
[76] Bourdieu appelle ce problème la « mystique populiste ». Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 2003, p. 333. Claude Grignon et Jean-Claude Passeron parlent, quant à eux, de « populisme épistémologique ». Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, Le savant et le populaire. Populisme et misérabilisme en sociologie et en littérature, Paris, Éditions de l’EHESS, 1989.
[77] Cit. in Karl Marx, Sociologie critique (tr. et éd. M. Rubel), Paris, Payot & Rivages, 2008, p. 114, note 1. Dans son avant-propos au Fromage et les vers, l’historien Carlo Ginzburg reconnaît avoir appliqué une même « sensibilité populiste » au cas de Menocchio, incarnation d’une culture populaire créative et subversive dans l’Italie du XVIe siècle. Il rapporte ce populisme au narodnitchestvo dont son père, Leone Ginzburg, né dans l’Empire tsariste avant d’émigrer en Italie, était, aux dires de son compagnon antifasciste Franco Venturi, une « incarnation neuve et originale ». Carlo Ginzburg, Le fromage et les vers. L’univers d’un meunier au XVIe siècle, Paris, Aubier, 1993, p. XXXIII et 239. Cf. Dominique Kalifa, « Les historiens français et « le populaire » », Hermès, n° 42, 2005, p. 54-59 ; Laurent Jeanpierre, « Les populismes du savoir », Critique, n° 776-77, 2012, p. 150-164.
[78] Le « subalterne » désigne un individu opprimé qui construit son identité collective par rapport à une domination vécue, quelle qu’elle soit, en cherchant à en inverser les catégories. Guido Liguori, « Le concept de subalterne chez Gramsci », Mélanges de l’École française de Rome, n° 128, 2016. URL : https://journals.openedition.org/mefrim/3002.
[79] Lettre à Kugelmann, 12 octobre 1868. In Karl Marx, op. cit., p. 113.
[80] Miguel Abensour, La démocratie contre l’État. Marx et le moment machiavélien, Paris, Collège international de philosophie, 1997.
[81] Karl Marx, op. cit., p. 114.
[82] Lettre à Vera Zassoulitch, 8 mars 1881 (ibid., p. 118). Cf. Teodor Shanin, Late Marx and the Russian Road : Marx and the « Peripheries of Capitalism », London, Routledge & Kegan Paul, 1983.
[83] Cit. in Maximilien Rubel, Marx théoricien de l’anarchisme, Genève, Éditions Entremonde, 2011, p. 29.
[84] Maximilien Rubel, « Karl Marx et le socialisme populiste russe », La Revue socialiste, n° 11, mai 1947. URL : https://www.marxists.org/francais/rubel/works/1947/rubel_19470500.htm.
[85] Gøsta Esping-Andersen, Les trois mondes de l’État-Providence. Essai sur le capitalisme moderne, Paris, PUF, 2015.
[86] Albert O. Hirschman, « The political economy of import-substituting industrialization in Latin America », A Bias for Hope : Essays on Development and Latin America, New Haven, Yale University Press, 1971.
[87] Robert H. Bremner, American Philanthropy, Chicago, University of Chicago Press, 1988. Theda Skocpol relativise cette institution tardive de l’État-providence, en insistant sur les programmes sociaux destinés aux vétérans de la Guerre de Sécession. Theda Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers. The Political of Social Policy in the United States, Cambridge, Harvard University Press, 1993.
[88] Laura Grattan, Populism’s Power. Radical Grassroots Democracy in America, New York, Oxford University Press, 2016.
[89] Pour le Social Credit, on verra Alvin Finkel, « Populism and the Proletariat : Social Credit and the Alberta Working Class », Studies in Political Economy, n° 13, 1984, p. 109-135.
[90] Charles Postel, « Occupy: A Populist Response to the Crisis of Inequality », Mittelweg, n° 36 (5), 2012. D’autres situent ce revival dans les années 1980, en traçant une ligne de continuité entre le People’s Party et les mouvements citoyens réclamant la « démocratie participative » (le début du « community organizing ») et l’empowerment des minorités. Voir la publication synchrone de Harry C. Boyte et Frank Riessman (eds.), The New Populism : The Politics of Empowerment, Philadelphia, Temple University Press, 1986 ; Harry C. Boyte, Heather Booth et Steve Max, Citizen Action and the New American Populism, Philadelphia, Temple University Press, 1986 ; Joseph F. Zimmerman, Participatory Democracy, Populism Revived, Westport (CT), Greenwood Press, 1986.
[91] Laura Grattan, op. cit., p. 49 ; 68-69.
[92] Catherine Maumi, Thomas Jefferson et le projet du Nouveau Monde, Paris, Éditions de la Villette, 2007.
[93] Robert C. McMath Jr., American Populism : A Social History, 1877-1898, New York, Hill and Wang, 1993.
[94] Irwin Unger, The Greenback Era. A Social and Political History of American Finance, 1865-1879, Princeton, Princeton University Press, 1964.
[95] John D. Hicks, The Populist Revolt : A History of the Farmers’ Alliance and the People’s Party, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1931.
[96] Émile de Kératry, « La crise agricole aux États-Unis », Revue des deux mondes, tome 100, juillet 1890, p. 58-107.
[97] Sur l’autonomie d’un « black populism » au sein du mouvement, voir Omar H. Ali, In the Lion’s Mouth: Black Populism in the New South, 1886-1900, Jackson, University Press of Mississippi, 2010 ; Omar H. Ali et Gerald H. Gaither, Blacks and the Populist Movement. Ballots and Bigotry in the New South, Tuscaloosa, University of Alabama Press, 2005 ; Lawrence Goodwyn, « Populist Dreams and Negro Rights : East Texas as a Case Study », American Historical Review, n° 76, 1971, p. 1435-1456.
[98] John Curl, For All the People. Uncovering the Hidden History of Cooperation, Cooperative Movements and Communalism in America, Oakland, PM Press, 2012.
[99] Marion K. Barthelmé (ed.), Women in the Texas Populist Movement. Letters to the Southern Mercury, College Station, Texas A&M University Press, 1997 ; Julie R. Jeffrey, « Women in the Southern Farmers’ Alliance : A Reconsideration of the Role and Status of Women in the Late Nineteenth Century South », Feminist Studies, n° 3, 1975, p. 72-91 ; Donald P. Marti, Women of the Grange. Mutuality and Sisterhood in Rural America, 1866-1920, Westport, Greenwood, 1991.
[100] Cit. in Margaret Canovan, op. cit., p. 33.
[101] Lawrence Goodwyn, Democratic Promise. The Populist Moment in America, New York, Oxford University Press, 1976 ; Thomas Goebel, A Government by The People. Direct Democracy in America, 1890-1940, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2002.
[102] Matthew Hild, Greenbackers, Knights of Labor and Populists. Farmer-Labor Insurgency in the Late-Nineteenth-Century South, Athens, University of Georgia Press, 2007.
[103] Norman Pollack, The Populist Response to Industrial America. Midwestern Populist Thought, Cambridge, Harvard University Press, 1962.
[104] Charles Postel, The Populist Vision, New York, Oxford University Press, 2007, p. 19.
[105] Laura Grattan, op. cit., p. 60-61 ; Lawrence Goodwyn, « Rethinking “Populism”: Paradoxes of Historiography and Democracy », Telos, n° 88, 1991, p. 37-56.
[106] Christopher Lasch, Le seul et vrai paradis. Une histoire de l’idéologie du progrès et de ses critiques, Paris, Flammarion, 2006. En ôtant à cette posture toute son autonomie, Richard Hofstadter en fait une réponse purement négative et réactionnaire à la révolution industrielle. Richard Hofstadter, The Age of Reform. From Bryan to FDR, New York, Alfred A. Knopf, 1955.
[107] « National People’s Party Platform » (juillet 1892), in Norman Pollack (ed.), The Populist Mind, Indianapolis, Macmillan, 1967, p. 61.
[108] Bruce Palmer, « Man over Money » : The Southern Populist Critique of American Populism, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1980 ; Gene O. Clanton, Populism, the Human Preference in America, 1890-1900, Boston, Twayne Publishers, 1991.
[109] Norman Pollack, The Populist Mind, op. cit., p. 66.
[110] Edward Castleton, « Une “armée d’hérétiques” dans une “croix d’or” : le premier populisme américain et l’hétérodoxie monétaire », Critique, n° 776-777, 2012, p. 24-35.
[111] Mouvement de paysans du Midwest fondé en 1867 par Oliver Hudson Kelley, et militant pour la baisse des tarifs facturés par les chemins de fer et la gratuité du service postal dans les campagnes.
[112] John D. Hicks, « The Political Career of Ignatius Donnelly », Mississippi Valley Historical Review, n° 8, 1921, p. 80-132 ; C. Vann Woodward, Tom Watson, Agrarian Rebel, New York, Macmillan Company, 1938.
[113] James M. Beeby (ed.), Populism in the South Revisited. New Interpretations and New Departures, Jackson, University Press of Mississippi, 2012.
[114] Robert F. Durden, The Climax of Populism. The Election of 1896, Lexington, The University Press of Kentucky, 1965.
[115] Lawrence Goodwyn, The Populist Moment. A Short History of the Agrarian Revolt in America, New York, Oxford University Press, 1978.
[116] Elizabeth Sanders, Farmers, workers and the American State, 1877-1917, Chicago, University of Chicago Press, 1999.
[117] Michael Kazin, A Godly Hero : The life of William Jennings Bryan, New York, Anchor Books, 2006.
[118] Alan Brinkley, Voices of Protest: Huey Long, Father Coughlin and the Great Depression, New York, Knopf, 1982.
[119] Comme le signale Michael Kazin, « Le fait de voir [les militants du People’s Party] comme des provinciaux grincheux au lieu d’une coalition de producteurs, [a conduit à affirmer] que les délires des populistes se réverbéraient dans l’idéologie de Coughlin et Huey Long, et sur les fulminations de McCarthy et de ses admirateurs ». Michael Kazin, The Populist Persuasion, op. cit., p. 192 (Nous soulignons). L’hypothèse, avancée par Kazin, d’une « captation conservatrice » (conservative capture) du discours du People’s Party est certainement plus judicieuse. Mais elle pose le même problème fondamental, occulté par l’analyse du discours politique, de l’existence d’un invariant anthropologique dans la modernité politique américaine (au risque de l’essentialiser) : la « culture populiste ». Michael Kazin, op. cit., p. 2-5 ; ch. 5 et 9 ; p. 291-292.
[120] C’est le problème de la typologie de M. Canovan, qui identifie le « populisme réactionnaire » de G. Wallace et E. Powell (au Royaume-Uni) comme un type de « populisme politique », lors même que celui-ci est défini comme un mode de mobilisation lié à l’idéal démocratique de la « souveraineté du peuple ». Si tant est qu’on puisse repérer un tel idéal dans la pratique raciste de Wallace et Powell, il serait tellement aux antipodes de l’« utopie démocratique » des narodniki et du People’s Party, que son sens politique deviendrait littéralement indéfinissable, à l’effet de faire de la « démocratie » aussi un mot vide de sens. M. Canovan, op. cit., p. 225 sq.
[121] Richard Hofstadter, « The Paranoid Style », op. cit.
[122] Charles Postel, « Populism as a Concept and the Challenge of U.S. History », Ideas. Idées d’Amérique, n° 14, 2019. URL : https://journals.openedition.org/ideas/6472.
[123] Michel Winock, « Le boulangisme, un populisme protestataire », Après-demain. Journal trimestriel de documentation politique, n° 43, 2017, p. 34-36 ; Pierre Birnbaum, Genèse du populisme, Paris, Hachette « Pluriel », 2012.
[124] Arnaud-Dominique Houte, Le triomphe de la République (1871-1914), Paris, Seuil, 2014, p. 179-180.
[125] Michel Winock, La fièvre hexagonale. Les grandes crises politiques 1871-1968, Paris, Seuil, 2009.
[126] Laurent Mucchielli, La découverte du social. Naissance de la sociologie en France (1870-1914), Paris, La Découverte, 1998, p. 101-106.
[127] Robert Tombs (ed.), Nationhood and Nationalism in France, from Boulangism to the Great War, 1889-1918, Londres/New York, Harper-Collins, 1991.
[128] La postérité la plus connue de ce mythe des « gros » au XXe siècle est le thème des « deux-cents familles » censées régir les destinées de la France, repris tant par la droite nationaliste (l’Action française) que par la gauche radicale (Daladier), socialiste (Blum et Faure) ou communiste (Thorez). Pierre Birnbaum, Le peuple et les gros. Histoire d’un mythe, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle, 1979.
[129] Jacques Néré, La crise économique de 1882 et le boulangisme, Thèse de doctorat ès lettres, Université de Paris, 1959 ; Jean Lhomme, « La crise agricole à la fin du XIXe siècle, en France. Essai d’interprétation économique et sociale », Revue économique, n° 21, 1970, p. 521-553.
[130] Maurice Agulhon et al., « Le populisme ? Neuf réponses », Vingtième siècle, n° 56, 1997, p. 226.
[131] Yves Billard, « Les campagnes électorales », Le métier de la politique sous la IIIe République, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 2003.
[132] Cit. in Jean Garrigues, Le boulangisme, Paris, PUF, 1992, p. 14.
[133] William H. Sewell Jr., Gens de métier et révolutions. Le langage du travail de l’Ancien Régime à 1848, Paris, Aubier, 1983.
[134] Edward Berenson, Populist Religion and Left-wing Politics in France, 1830-1852, Princeton, Princeton University Press, 1984.
[135] Cit. in Jean Garrigues, op. cit., p. 100.
[136] Patrick H. Hutton, « The role of the Blanquist party in left-wing politics in France, 1879-1890 », Journal of Modern History, n° 46, juin 1974, p. 285-296.
[137] Jean Garrigues, « Le Général Boulanger et le fantasme du coup d’État », Parlement(s) : revue d’histoire politique, no 12, 2009, p. 43-48.
[138] Le cas de Paul Déroulède est plus complexe. Comme le montre l’historien Bertrand Joly, le fondateur nationaliste de la Ligue des patriotes est resté fidèle, jusqu’au bout, à l’idéal d’une république démocratique et s’est montré rétif voire hostile à l’antisémitisme. Bertrand Joly, Paul Déroulède. L’inventeur du nationalisme, Paris, Perrin, 1998.
[139] Zeev Sternhell, La droite révolutionnaire 1885-1914. Les origines françaises du fascisme, Paris, Arthème Fayard, 2000 ; Zeev Sternhell, Maurice Barrès et le nationalisme français, Paris, Arthème Fayard, 2000.
[140] Patrick H. Hutton, « Popular Boulangism and the advent of mass politics in France, 1886-1890 », Journal of Contemporary History, n° 11, 1976, p. 85-106.
[141] Jean Garrigues, « Le boulangisme comme mouvement social, ou les ambiguïtés d’un social-populisme », in Michel Pigenet et Danielle Tartakowsky (dir.), Histoire des mouvements sociaux en France. De 1814 à nos jours, Paris, La Découverte, 2014.
[142] Friedrich Engels et Paul Lafargue, « Lettre du 6 avril 1890 », Correspondance, t. II, Paris, Éditions sociales, 1956, p. 355.
[143] Philip G. Nord, The Politics of Resentment. Shopkeeper Protest in Nineteenth-Century Paris, Princeton, Princeton University Press, 1986.
[144] Romain Souillac, Le mouvement Poujade. De la défense professionnelle au populisme nationaliste (1953-1962), Paris, Presses de Sciences po, 2007.
[145] Antonio Gramsci, « Dalle tesi di Lione (août 1925) », Nel mondo grande e terribile. Antologia degli scritti 1914-1935 (éd. G. Vacca), Turin, Einaudi, 2007, p. 108-114.
[146] Bertrand Joly, « Le nationalisme », in Vincent Duclert et al., L’affaire Dreyfus, Paris, Armand Colin, 2009, p. 53. Voir, du même auteur, « Les Antidreyfusards avant Dreyfus », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 39, 1992, p. 198-221.
[147] À titre d’exemple, on verra Guy Hermet, Les populismes dans le monde, op. cit., p.
[148] Emilio Gentile, op. cit., p. 16-17. Cf. Enzo Traverso, Le totalitarisme. Le XXe siècle en débat, Paris, Seuil, 2001, p. 21.
[149] Zeev Sternhell, Ni droite ni gauche. L’idéologie fasciste en France, Paris, Gallimard, 2013.
[150] Michel Dobry (dir.), Le mythe de l’allergie française au fascisme, Paris, Albin Michel, 2003.
[151] Donald MacRae, « Populism as an Ideology », in Ghita Ionescu et Ernest Gellner (eds.), op. cit.
[152] Pierre Ansart, Idéologies, conflits et pouvoir, Paris, PUF, 1977.
[153] Slavoj Zizek, « Against the Populist Temptation », Critical Inquiry, n° 32, 2006, p. 551-574 ; Ernesto Laclau, « Why Constructing A People Is the Main Task of Radical Politics », Critical Inquiry, n° 32, 2006, p. 646-680. Pour une critique analogue à partir de la perspective d’un socialisme anticapitaliste et fédéraliste, on verra Thomas Piketty, op. cit., p. 1108, n. 1.
[154] Les influences du socialisme romantique sur le narodnitchestvo ont été détaillées. Pour le cas états-unien, où le socialisme romantique a transité via l’owenisme, on verra William Epstein, The Masses are the Ruling Classes. Policy Romanticism, Democratic Populism and Social Welfare in America, New York, Oxford University Press, 2016.
[155] Alain Dieckhoff et Christophe Jaffrelot (dir.), Repenser le nationalisme. Théories et pratiques, Paris, Presses de Sciences po, 2006, p. 20, 29-103.
[156] Emilio Gentile, op. cit., p. 16.
[157] Pour la lecture « anti-moderne » de la tradition fasciste, on verra Zeev Sternhell, Les anti-Lumières. Une tradition du XVIIIe siècle à la guerre froide, Paris, Gallimard, 2010 ; Zeev Sternhell, Mario Sznajder et Maia Ashéri, Naissance de l’idéologie fasciste, Paris, Gallimard, 2010. Pour la lecture « hyper-moderne », on verra Emilio Gentile, Modernità totalitaria. Il fascismo italiano, Roma-Bari, Laterza, 2008.

![Chili 73 : un coup d’État qui permit la contre-révolution néolibérale [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/golpe-chile-1973-150x150.jpg)







