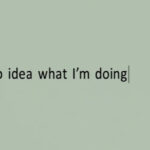Le rôle des mathématiques en économie
Parmi les sciences sociales, l’économie est celle qui, de loin, utilise le plus les mathématiques. Ce qui s’explique aisément : l’économiste s’intéresse à la production et à la répartition des ressources dont dispose la société. D’où de multiples opérations chiffrées, avec des quantités de biens, des prix et des valeurs. L’activité de l’économiste va de calculs relativement simples comme ceux faits en comptabilité et en calcul actuariel à ceux, plus compliqués, qui ont trait à la recherche d’une affectation efficace des ressources. Les mathématiques fournissent alors des outils qui peuvent aider à parvenir à un objectif défini – le profit de certains ou le bien être de la collectivité, par exemple – ou à extraire de l’information à partir des données disponibles, en mobilisant des techniques comme l’analyse factorielle ou l’analyse discriminante.
Le débat à propos du rôle des mathématiques en économie ne porte pas, en fait, sur leur utilisation en tant que moyen de gestion efficace des ressources ou de traitement des données, mais sur les théories qui font appel à elles pour expliquer divers aspects de la vie économique et, si possible, faire des prédictions. Les théories donnent lieu alors à des modèles qui prennent la forme d’un ensemble d’hypothèses – ou d’ « axiomes » – dont sont déduits des théorèmes ou des résultats mathématiques, que l’économiste transcrit dans son langage et interprète. Le choix des axiomes joue donc un rôle décisif dans la formulation des modèles, puisqu’il détermine le type et la signification des résultats qui peuvent être obtenus. Ce choix dépend fondamentalement de la « vision du monde » du théoricien – c’est-à-dire, de la façon dont il conçoit la société et les relations entre ses membres. Il n’est d’ailleurs pas sans conséquence sur le type de mathématiques utilisées dans la modélisation.

Visions du monde et modèles
Toute société est, par définition, formée par un ensemble d’individus. Mais tout ensemble d’individus ne forme pas une société. Celle-ci est généralement stratifiée et régie par des règles, des coutumes ou des conventions. Deux attitudes sont donc possibles lorsqu’on veut étudier des phénomènes sociaux : soit prendre pour point de départ l’individu et ses choix, dans un contexte ad hoc, le plus simple possible, soit préciser d’abord ce contexte, dans le temps et l’espace, puis étudier comment les choix individuels s’y insèrent. La première attitude est celle qu’adopte la théorie économique dominante, dite « néoclassique », dans le cadre de ce qu’on a coutume d’appeler la « microéconomie ». La deuxième attitude est celle de Smith, Ricardo et Marx, entre autres, mais aussi de Keynes et de ce qu’on appelle la « macroéconomie ».
On va s’intéresser ici tout particulièrement à la première d’entre elles, la vision du monde néoclassique, qui prétend fonder sa légitimité par une utilisation intensive des mathématiques. Les individus, souvent appelés « agents », lui servent donc de point de départ. Elle commence en réalité par les diviser en deux grandes catégories : les consommateurs (ou « ménages ») et les producteurs (ou « entreprises »)1. Elle les caractérise ensuite par un certain nombre de traits – psychologiques pour les premiers, techniques de production disponibles pour les seconds – qui peuvent avoir une traduction mathématique. Celle-ci demande beaucoup d’efforts pour le non initié, qui doit ingurgiter un langage, des concepts et des symboles nouveaux pour lui (relation de préférence, courbe d’indifférence, taux de substitution, ensemble de production, convexité, etc.). L’image de Robinson Crusoe est alors souvent mobilisée à ce stade, notamment dans les présentations pédagogiques de la théorie néoclassique, car elle permet de s’en tenir aux seules caractéristiques des individus, en dehors de toute contrainte sociale.
L’étape suivante consiste à introduire l’échange, qui est l’objet d’étude propre à l’économie. Elle consiste, si on s’en tient aux préceptes de l’individualisme méthodologique, à envisager une situation où plusieurs Robinsons se retrouvent ensemble et cherchent à faire des échanges, en vue d’augmenter leur satisfaction. Ils vont donc, dans cette perspective, marchander entre eux. Cependant, le résultat du processus mis ainsi en marche est indéterminé, puisqu’il dépend du pouvoir de marchandage de chacun et de l’ordre de rencontre des uns et des autres. Conscients que cela ne les menait nulle part, les théoriciens néoclassiques n’ont pas poursuivi dans cette direction. Ils ont opté pour la solution consistant à intégrer dans le modèle des règles et des formes d’organisation des échanges qui évitent d’avoir à faire face à des situations de marchandage. C’est alors qu’est introduite l’idée de marché.
De l’individu au marché
Pour sortir de l’impasse consistant à envisager la société comme un ensemble d’individus livrés à un marchandage généralisé, les néoclassiques vont donc introduire « le marché ». Pas celui auquel on songe spontanément, où chacun achète ou vend ce qu’il veut, en fonctions des prix – qu’il propose, accepte ou négocie, selon le cas. Parce que le faire impliquerait de retomber dans l’indétermination propre à tout marchandage. Le marché est donc présenté comme une sorte de personnage, qui impose ses prix à tous et les modifie selon la « loi de l’offre et de la demande ». Si on veut utiliser les mathématiques, il faut préciser tout cela. C’est ce que fait le modèle fétiche des néoclassiques – le modèle dit « de concurrence parfaite » qui postule que les prix des biens sont donnés et que les agents établissent leurs offres et leurs demandes en croyant qu’ils peuvent vendre ou acheter tout ce qu’il veulent à ces prix. Ce qu’on résume souvent en disant que les entreprises et les ménages sont « preneurs de prix ».
Cette hypothèse étant faite, le mathématicien peut entrer en action : il se donne un ensemble quelconque de prix, noté P, et s’intéresse, pour chaque consommateur, au panier de biens qui maximise sa satisfaction (sa « fonction d’utilité ») et pour chaque entreprise, au panier d’entrants (inputs) qui maximise son profit. Le terrain lui est familier : c’est celui de la recherche du maximum d’une fonction, dont les variables peuvent être soumises à des contraintes. Ce maximum ne peut en réalité être calculé, puisque les fonctions à maximiser, comme la fonction d’utilité, ne sont pas connues – et ne peuvent l’être, la satisfaction n’étant pas une quantité mesurable. Tout l’art du mathématicien va alors consister à déduire de certaines propriétés de ces fonctions (goûts des consommateurs, par exemple) des propriétés de leur maximum. Parmi ces propriétés, la plus recherchée est la continuité des fonctions d’offre et de demande : lorsque les prix P varient « en douceur », les quantités offertes et demandées de biens doivent en faire de même – elles ne doivent pas « faire de sauts ». Si tel est le cas, certains théorèmes de topologie mathématique permettent de montrer que parmi tous les prix possibles, il en existe certains pour lesquels les offres et les demandes globales, sont, pour chaque bien, égales. Ces prix sont dits « d’équilibre ».
L’existence de prix d’équilibre dans le modèle de concurrence parfaite est considérée comme le résultat le plus important de l’économie mathématique. Sa démonstration par Kenneth Arrow et Gérard Debreu est, d’une certaine façon, une prouesse. L’équilibre de concurrence parfaite a, en outre, une propriété très prisée par les économistes : l’affectation des ressources obtenue après que chacun ait reçu ce qu’il demande aux prix d’équilibre (et donné en contrepartie ce qu’il offre), est efficace (« optimale selon le critère de Pareto »)2. Non seulement l’équilibre existe, mais il est une bonne chose pour la collectivité – si on abstrait les problèmes de répartition. La supériorité de l’économie de marché par rapport à tout autre système serait ainsi prouvée, mathématiquement, du moins dans le cas idéal, où il y aurait « concurrence parfaite ». C’est par exemple à ce théorème que se référait le projet de constitution européenne lorsqu’il parlait de la « concurrence libre et non faussée » qui permettrait de parvenir à une « allocation optimale des ressources ».
Tout cela est bien beau. Mais comment croire à cette histoire, alors que chacun peut constater les innombrables gaspillages, en temps et en ressources, qui ont lieu dans les économies de marché, avec ou sans concurrence ? Il suffit de revenir sur les hypothèses du modèle de concurrence parfaite pour se rendre compte qu’il décrit en fait une situation qui n’a strictement rien à voir avec l’idée que l’on se fait habituellement des marchés.
Un drôle de marché…
L’hypothèse de départ du modèle est que les prix – le vecteur P du mathématicien – sont « donnés ». On peut estimer que c’est le cas pour le consommateur qui fait son choix à partir de prix affichés et non négociables – les étiquettes dans les magasins, par exemple. Mais il y a forcément quelqu’un qui propose ces prix – le gérant du magasin qui rédige les étiquettes, par exemple – alors que dans le modèle de concurrence parfaite tout le monde est supposé être preneur de prix. En fait, il suffit de fouiller dans les équations de la démonstration de Arrow et Debreu pour y trouver des allusions à un mystérieux « joueur fictif » dont la tâche consiste à afficher les prix dont les autres participants sont « preneurs » (Arrow et Debreu, 1954). Ce qui est pour le moins bizarre … Les choses ne s’arrêtent d’ailleurs pas là, puisqu’on a vu que les prix d’équilibre sont tels qu’ils égalisent les offres et les demandes globales – c’est-à-dire la somme des offres et des demandes individuelles. Pour savoir s’il y a équilibre, il faut donc quelqu’un qui, outre qu’il propose des prix, recueille les offres et les demandes de chacun, puis les confronte après les avoir additionnées. Les opérations élémentaires pour le mathématicien consistant à se donner un vecteur (P) quelconque et à additionner (symbole ?) d’autres vecteurs (les quantités offertes ou demandées) ont pour l’économiste des conséquences décisives sur l’interprétation économique du modèle. Celui-ci ne peut que représenter un système très centralisé, dans lequel personne n’a le droit de proposer des prix ni de faire des échanges directs avec qui que ce soit d’autre que le centre. Système qui ne ressemble en rien aux économies de marché telles que nous les connaissons. Pourtant, les théoriciens néoclassiques le présentent comme le cas du marché idéal. Seules des raisons idéologiques peuvent expliquer un comportement aussi aberrant.
Mathématiques et idéologie
Par idéologie, on entend généralement un système de croyances a priori, ayant pour origine l’expérience et le vécu de chacun – à commencer par son éducation et le milieu dont il est issu. En économie, le choix d’une vision du monde plutôt qu’une autre a quasiment toujours une base idéologique. Ceux qui accordent, par exemple, une place privilégiée aux comportements individuels sont persuadés que les prix du marché coordonnent (à peu près) correctement les décisions prises sur la base de ces comportements. La vision du monde globale, ou macroéconomique, est en revanche plutôt le fait de ceux qui ne partagent pas cette croyance et qui s’intéressent donc surtout à la façon dont le système « boucle » (se maintient à peu près à l’identique dans le temps), sans supposer que les ressources sont forcément complètement utilisées – ou efficacement.
Si l’idéologie est incontournable dans les disciplines comme l’économie, c’est entre autres parce qu’il n’est pas possible d’y faire des expériences contrôlées – qui permettraient de trancher entre croyances a priori (Guerrien, 2007). Elle est en cela acceptable. Elle ne l’est pas, en revanche, quand elle conduit à énoncer des contre-vérités, comme dans le cas de la concurrence parfaite – présentée comme décrivant un système décentralisé alors que c’est le contraire qui est vrai. La seule explication à un tel dérapage ne peut s’expliquer que par la croyance a priori que marché et efficacité sont étroitement associés, du moins dans le cas parfait. Or il suffit de réfléchir un peu pour comprendre que les seuls états efficaces possibles sont ceux où un « centre » coordonne bénévolement les décisions prises par les ménages et les entreprises – qui ne gaspillent par ainsi leur temps et des ressources à chercher des partenaires et à marchander avec eux. Ce que ne peut admettre celui qui est profondément convaincu de l’efficacité des « marchés concurrentiels ». D’où l’imbroglio sur la nature du modèle de concurrence parfaite.
Le plus étonnant est que des esprits avisés – qui ne sont pas forcément des chantres du libéralisme – n’y échappent pas. C’est ainsi que Yves Balasko, un mathématicien venu à l’économie, écrit dans la présentation de l’un de ses cours que « le modèle d’Arrow-Debreu est la représentation mathématique du marché concurrentiel »3. Joseph Stiglitz, auteur réputé et « Prix Nobel » d’économie, explique pour sa part dans ses Principes d’économie que « le modèle de concurrence parfaite ne décrit pas parfaitement la réalité » (les italiques sont de Stiglitz), mais que c’est un « cadre de référence utile [qui] donne des résultats satisfaisants – les prévisions obtenues, sans être parfaites, correspondent bien à ce que l’on observe effectivement » (page 27). On trouve des observations similaires dans le traité de microéconomie de Paul Krugman, autre « Prix Nobel », connu par ailleurs par ses critiques virulentes des partisans du tout-marché.
Seule l’idéologie peut expliquer que des esprits brillants comme Balasko, Stiglitz et Krugman – qui connaissent l’existence de l’agent fictif de Arrow et Debreu – s’accrochent à l’idée que le modèle de concurrence parfaite puisse représenter une quelconque économie de marché. A cela s’ajoute probablement la peur du vide : sans le modèle de concurrence parfaite, et ses équilibres, il n’y a plus de repère, de norme à laquelle se référer. Une bonne partie de l’enseignement en économie – et de la recherche théorique – serait ainsi mise au rancart.
En ce qui concerne les manuels, la solution généralement adoptée pour faire passer la pilule consiste à noyer le poisson, en énonçant des soi-disant « conditions » qui caractériseraient la concurrence parfaite. Il y aurait ainsi l’« atomicité », l’« homogénéité », la « transparence », l’ « information parfaite », la « libre entrée ». Autant d’expressions vagues qui n’ont aucune contrepartie dans la formulation mathématique du modèle – contrairement à l’hypothèse, essentielle, selon laquelle les agents sont preneurs de prix. Les mathématiques ne sont évidemment pour rien dans la confusion ainsi entretenue – délibérément ou pas, peu importe. On ne peut, en revanche que s’étonner du silence des mathématiciens, qui laissent dire, quand ils ne participent pas à la confusion. Idéologie ou peur du vide ? Réticence à scier la branche sur laquelle ils sont assis ? On ne sait trop.
Sortir de la concurrence parfaite ?
Le théorème d’Arrow et Debreu est le seul résultat mathématique d’ordre général auquel parvient, et peut parvenir, la théorie néoclassique4. Il suffit de relâcher légèrement l’une quelconque des hypothèses de la concurrence parfaite, même en gardant le caractère centralisé de l’économie, pour que l’existence de l’équilibre ne soit plus assurée. C’est ce qui arrive, par exemple, si on suppose que certains agents abandonnent la croyance naïve qu’ils peuvent vendre ou acheter tout ce qu’ils veulent aux prix affichés par l’agent fictif. Des entreprises vont alors chercher à estimer la fonction de demande du bien qu’elles produisent – la quantité du bien qu’elles pensent pouvoir vendre aux divers prix possibles. Prendre en compte ce nouveau paramètre – ce qui semble plutôt raisonnable – met à mal toute la construction. Car soit on considère que les fonctions de demande sont « subjectives » – elles dépendent de l’opinion que s’en fait l’entreprise – et alors les résultats obtenus le sont aussi. Soit on suppose que l’entreprise connaît les fonctions de demande « objectives » – mais alors ces fonctions dépendent de ce que fait l’entreprise (ses achats de matières premières, les revenus qu’elle distribue), ce qui met à mal, notamment, leur continuité, rendant problématique l’existence d’un équilibre. Les économistes qui se sont penchés sur ce genre de modèle, dans les années 1970, s’en sont vite aperçus et ont renoncé à poursuivre5. Surtout qu’il n’y a rien à tirer de cette approche d’un point de vue normatif : avant même tout calcul, on peut dire que, même si un équilibre existe, il ne représente pas une affectation efficace des ressources – il y a toujours au moins un équilibre de concurrence parfaite qui « fait mieux » que lui.
Deux options étaient alors possibles pour les théoriciens néoclassiques : soit adopter une approche dite « d’équilibre partiel », consistant à ne considérer qu’un seul bien, dont la courbe de demande, ou d’offre, est supposée « donnée », soit mettre sous forme mathématique des « petites histoires » dont le propos est d’attirer l’attention sur certaines des particularités des interactions des décisions individuelles. Les théoriciens néoclassiques sont plutôt réservés en ce qui concerne l’approche d’équilibre partiel, qui ne respecte pas les préceptes de l’individualisme méthodologique – les courbe de demande ou d’offre ne sont pas déduites des choix individuels et les interactions entre les divers secteurs de biens sont ignorées. L’enseignement de base lui accorde, il est vrai, une place importante car elle lui permet de faire passer à moindres frais le message que seule la concurrence, du moins si elle est « parfaite », conduit à une affectation optimale des ressources. Mais outre son caractère peu « rigoureux » (des courbes non déduites d’une maximisation) selon les critères mêmes des néoclassiques, l’approche d’équilibre partiel fait appel à des mathématiques rudimentaires, peu compatibles avec la « recherche de haut niveau ». Le filon est limité, notamment pour ceux qui veulent publier dans les revues académiques. Celui des petites histoires est, en revanche, inépuisable, les interactions des décisions individuelles pouvant prendre une infinité de formes et faire intervenir des mathématiques compliquées à souhait.
Petites histoires et mathématiques
On entend ici par « petites histoires » des modèles qui s’intéressent aux conséquences des choix d’un nombre très restreint d’individus rationnels (qui cherchent à rendre maximum une fonction objectif), dans un cadre défini à l’avance, hors du temps et de l’espace. Les économistes n’hésitent pas d’ailleurs à qualifier ces histoires de « fables » ou de « paraboles ». La plus ancienne et la plus connue d’entre elles est celle de Robinson Crusoé, qui cherche à utiliser au mieux les (maigres) ressources dont il dispose sur son île. Cette histoire a été remise au goût du jour dans les années 1980 par les ultralibéraux, dans le cadre de ce qu’on appelle la « nouvelle macroéconomie ». Selon eux, l’économie dans son ensemble se comporte comme un individu – parfois appelé « agent représentatif » – qui maximise une fonction d’utilité (comme celle d’un ménage) en décidant de sa consommation ainsi que de la part de son temps consacré à la production, pour toute sa durée de vie – supposée en fait infinie (ce qui, en soi, n’est pas très gênant). Le problème relève de ce que les mathématiciens appellent le « contrôle optimal ». Les inconnues sont des suites (ou des « trajectoires ») de productions et de consommations6. Bien que l’histoire à la base du modèle soit simple – pour ne pas dire grotesque … – la recherche de la solution optimale pour Robinson ne l’est pas. D’où l’occasion pour certains de montrer leur savoir-faire en mathématiques tout en épatant le chaland. Pas moins de trois « Prix Nobel » d’économie ont été attribués à ceux qui ont proposé des solutions à ce modèle sans aucun intérêt7. Seule l’idéologie – le marché est par nature efficace, le chômage volontaire et la surproduction inexistants – peut expliquer que cette robinsonnade élaborée ait connu un grand succès chez les universitaires à partir des années 1980, au point que ceux qui osaient émettre quelques réserves à son propos étaient l’objet de sarcasmes et mis au ban de la communauté8. La crise commencée en 2008 a cependant modifié la donne. Les tenants de la nouvelle macroéconomie ont reconnu du bout des lèvres qu’ils ont été « surpris » par ce qui s’était passé et font depuis le gros dos, en attendant des jours meilleurs. Leur séjour au purgatoire risque toutefois d’être long, vu la tournure des évènements …
Une autre histoire qui a connu, ces dernières décennies, un grand succès est celle dite des « générations imbriquées » : à tout moment, un « jeune » coexiste avec un « vieux », en lui donnant une partie de ce qu’il produit et en recevant en contrepartie un « bon » (un morceau de papier sur lequel est écrit un chiffre), qu’il utilisera lorsqu’il deviendra vieux pour obtenir du jeune qui lui a succédé une partie de sa production, et ainsi de suite. Le « bon » est censé représenter la masse monétaire d’un pays, la condition pour qu’il soit toujours accepté par les générations successives de jeunes est que le processus ne s’arrête jamais (ou que chaque jeune le croie au moment où il accepte le bon). Le fait de faire intervenir l’infini modifie profondément la donne. C’est ainsi que les équilibres de concurrence parfaite de ce modèle – le vecteur-prix affiché par l’agent fictif devenant alors une suite, au sens mathématique – perdent leur propriété d’efficacité, sauf pour certaines valeurs particulières écrites sur le « bon » initial. Cette histoire a été conçue au départ dans le cadre de la bataille entre « monétaristes » et « keynésiens » à propos de la politique monétaire que doit mener l’Etat – ou les Banques Centrales. Elle a donné lieu à une multitude de variantes, avec des développements mathématiques plus ou moins compliqués – qui assurent l’accès aux revues académiques les plus prestigieuses. Chacune de ces variantes a sa morale, qui dépend par exemple des hypothèses sur le nombre de générations, sur les « chocs externes » qu’elles peuvent subir, sur l’information dont disposent les uns et les autres, etc. Le choix de ces hypothèses dépend la plupart du temps des penchants du modélisateur – concernant notamment le degré d’intervention de l’Etat – et donc de la leçon qu’il veut voir se dégager du modèle.
La même constatation peut être faite à propos de la théorie des jeux, grande pourvoyeuse d’histoires de tous genres, avec une certaine prédilection pour les « dilemmes » et les « paradoxes » qui peuvent résulter de la vie en société. Le plus connu des « types (ou concepts) de solution » qu’elle propose pour ses modèles – appelés « jeux » – est l’équilibre de Nash, où chaque participant prévoit correctement le choix des autres. Ce qui est intéressant pour le mathématicien parce que cela revient pour lui à chercher les points fixes d’une fonction construite pour la circonstance, mais pas pour l’économiste, l’hypothèse selon laquelle chacun prévoit correctement les choix des autres n’étant pratiquement jamais vérifiée (Guerrien, 2010).
La théorie des jeux – qui est souvent présentée comme une « branche des mathématiques » – impose en fait aux joueurs des règles très strictes, nécessaires à la transcription sous forme mathématique de ses modèles. Parmi ces règles, il y a celle qui stipule que les joueurs annoncent simultanément et une fois pour toutes leur décision – la « stratégie » qu’ils ont choisie9. Il est en fait impossible de trouver un seul exemple de situation de la vie réelle où les choses se passent ainsi. Parler, comme c’est courant, des « applications » de la théorie des jeux, de ses « outils » ou des « solutions » qu’elle propose, est faux et trompeur. En réalité, comme dans le cas des robinsonnades de la nouvelle macroéconomie ou dans celui des modèles à générations imbriquées, le succès de la théorie des jeux dans les milieux académiques tient essentiellement au fait qu’elle est un bon filon pour ceux qui sont à la recherche de thèmes et de lieux pour publier livres et articles10.
Mathématiques et finances
La finance est probablement le secteur qui recrute le plus de mathématiciens. Surtout depuis l’essor des marchés dérivés, destinés au départ à aider à la couverture de certains risques (prix des matières premières, fluctuations des taux de change, par exemple) mais qui sont devenus par la suite un endroit où dominent largement les transactions sur les titres représentant cette couverture. Les « innovations financières » – censées permettre aux détenteurs de ces titres de les (re)vendre plus facilement et donc de diminuer les réticences à les acheter – se sont traduites par l’apparition d’une multitude de titres d’un nouveau genre, formés par des « paniers » des titres existants, qui peuvent être eux-mêmes des paniers de titres, et ainsi de suite. Le mathématicien est sollicité pour donner un prix à ces « produits complexes » et leur apporter ainsi une caution de sérieux, qui facilite leur vente à ceux qui disposent de fonds à placer. Il fabrique le prix de ces « produits » à partir de ceux des titres qui les composent, qu’il considère comme des variables aléatoires dont les paramètres sont estimés à partir des données disponibles – essentiellement, l’évolution passée du prix des titres formant le produit. Ces variables sont supposées, en fait, suivre la loi de Gauss – dite « loi normale » –, qui a le grand avantage d’être caractérisée par seulement deux paramètres, tout en étant typique des situations … normales, c’est-à-dire les plus courantes. Il est pourtant notoire que tel n’est pas le cas des cours boursiers, qui sont soumis épisodiquement à des changements brusques et importants. Les organismes financiers qui élaborent les produits élaborés par leurs mathématiciens ne peuvent complètement ignorer les risques qu’ils font courir à ceux qui les leur achètent, mais ils cherchent néanmoins à en fabriquer et à en vendre le plus possible, sous des formes diverses, leur rémunération en dépendant. Ils espèrent seulement que la situation « normale » prévaudra le plus longtemps possible11.
Il est également notoire que, avec ou sans mathématiques, les professionnels de la finance ne font pas mieux que « le marché » – c’est-à-dire que celui qui se contente de détenir un portefeuille de titres suffisamment diversifié. D’innombrables études l’ont prouvé mais un peu de bon sens suffit pour le comprendre : en Bourse, quand quelqu’un gagne (l’acheteur, disons), un autre perd (le vendeur). Il revient au hasard de trancher12. Les modèles mathématiques qui attribuent des prix aux produits financiers font d’ailleurs systématiquement appel à l’hypothèse dite d’ « absence d’occasion d’arbitrage », qui exclut la possibilité de faire un gain certain en spéculant (achat et (re)vente de titres). Ceux qui fabriquent ces produits ne croient donc pas qu’ils permettent de « battre le marché ». Ils se contentent de toucher leur commission …
Les mathématiques participent ici de la mystification en entretenant le sentiment fort répandu qu’il y a des « trucs » qui permettent de gagner en bourse. Chacun aurait le sien, qui s’appuierait sur un modèle très compliqué, mais soigneusement caché – puisque ce sont les « résultats » fourni par ce modèle qui sont vendus, parfois fort cher. Quand ça marche – période de hausse boursière, par exemple, bien que les gains ne soient que virtuels – les commissions et les bonus sont généreux. Ils le sont moins quand ça ne va plus – chute de la Bourse, par exemple – mais il suffit alors de faire le gros dos, en attendant que le vent tourne, les gens oubliant vite.
Faut-il rejeter les mathématiques en sciences sociales ?
La réponse à cette question ne peut être que nuancée. Oui, l’utilisation des mathématiques s’avère être nuisible en économie quand contrairement à leur vocation première, elles jouent le rôle d’un écran de fumée entre le commun des mortels et les « experts », qui seraient les seuls à savoir, grâce à leurs modèles, ce qu’il en est et ce qu’il faut faire. Cet écran de fumée est notamment utilisé pour travestir les hypothèses des modèles et la signification de leurs résultats. Très souvent, les tenants (néoclassiques) de l’économie mathématique qualifient d’ « idéologique » toute démarche autre que la leur, la seule « rigoureuse » selon eux puisque faisant abondamment appel aux mathématiques, alors que seule l’idéologie explique qu’ils puissent prendre au sérieux leurs modèles-phare – ceux de la concurrence parfaite et de l’ « agent représentatif » – en les présentant pour ce qu’ils ne sont pas (des représentations des économies de matrché). Empiler des équations à partir d’hypothèses non pertinentes ou farfelues ne peut que détourner l’attention de l’étude des problèmes qui se posent effectivement en économie – et même dégoûter de celle-ci.
Les mathématiques ont toutefois leur intérêt dans une perspective autre que celle qui cherche vainement à faire grâce à elles l’apologie des marchés. Elles fournissent ainsi de puissants moyens pour extraire de l’information à partir des nombreuses données dont on dispose sur tous les aspects de la vie économique et sociale. Leur utilisation est indispensable dans tout ce qui touche à la gestion la meilleure possible des ressources disponibles, que ce soit au niveau des entreprises (celles qui travaillent en réseau par exemple) ou celui de la société toute entière. La planification de l’économie, ou de certains de ses secteurs, ne peut – ni pourra – se faire sans mathématiques, ni mathématiciens. Il ne faut jamais perdre cela de vue, notamment lorsqu’on songe à la formation des futurs économistes.
Bibliographie
Arrow K. et G. Debreu (1954), “Existence of an equilibrium for a competitive economy”, Econometrica, 22:265-290.
Bénicourt E. et B. Guerrien (2008), La théorie économique néoclassique, Paris, La Découverte.
Guerrien B. (2007), L’illusion économique, Paris, Omnisciences.
Guerrien B. (2010), La théorie des jeux 4ème édition, Paris, Economica.
à voir aussi
références
| ⇧1 | Le choix des mots traduit toute la difficulté de la démarche consistant à partir des « individus », les ménages et les entreprises – unités de base de fait de la microéconomie – étant des entités collectives, des rassemblement d’individus non réductibles, en règle générale, à l’un d’entre eux. |
|---|---|
| ⇧2 | Situation où il n’est pas possible d’augmenter la satisfaction de quelqu’un sans détériorer celle d’au moins quelqu’un d’autre. |
| ⇧3 | Voir http://www.enpc.fr/ceras/labo/pontslecture2003.pdf |
| ⇧4 | Dans les années 1970 il a été prouvé (par le théorème dit de Sonnenschein) que l’application de la « loi de l’offre et de la demande » – même dans le cadre centralisé, qui lui est le plus favorable – ne conduit pas, en règle générale, vers l’équilibre (le système est instable) et que « tout peut arriver » en ce qui concerne les déplacements des équilibres quand on modifie les paramètres du modèle (Bénicourt et Guerrien, 2008). |
| ⇧5 | Le théorème de Sonnenschein (note 2) a ici aussi tué tout espoir d’aller plus loin. |
| ⇧6 | Voir, pour plus de détails, http://www.autisme-economie.org/article22.html. |
| ⇧7 | Cf. http://www.autisme-economie.org/article17.html |
| ⇧8 | L’histoire est tellement grotesque que certains néoclassiques – y compris des « Prix Nobels » – ont manifesté des réserves. Mais mollement, du moins avant la crise commencée en 2008. |
| ⇧9 | Cf. http://www.autisme-economie.org/article16.html. |
| ⇧10 | Un autre filon est celui des « expériences » destinées à vérifier les (rares) prédictions de la théorie. Filon qui risque toutefois de s’épuiser rapidement, les gens ne réagissant pas comme prévu. |
| ⇧11 | Voir http://www.autisme-economie.org/sites/autisme-economie.org/IMG/pdf/les_copules_du_Dr_Li.pdf. |
| ⇧12 | Voir http://bernardguerrien.com/Gainstraders.pdf. |