
Contester la subordination des salarié·es à l’heure de la start-up nation
À propos de Danièle Linhart, L’insoutenable subordination des salariés, Erès, 2021.
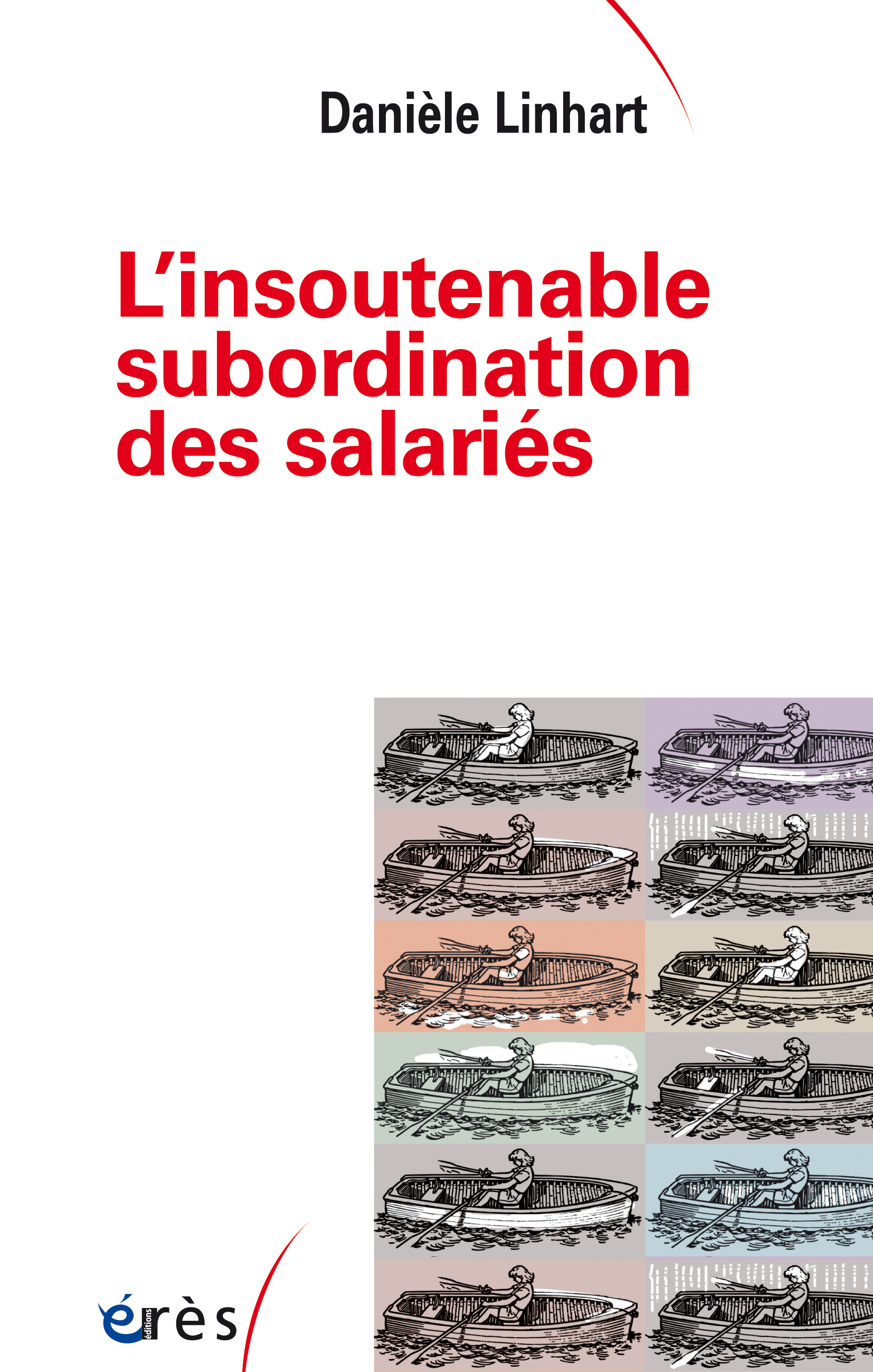
Le dernier livre de la sociologue Danièle Linhart développe une critique radicale du lien de subordination consubstantiel au salariat. Dans La comédie humaine du travail déjà, elle montre que le management contemporain tente de faire passer le salariat pour une relation gagnant-gagnant entre deux « collaborateurs » et désamorce toute possibilité de critique, de la part des salariés comme des sociologues, par des changements d’organisation permanents. Dans son dernier livre, elle insiste sur les rapports de force intrinsèques au travail salarié. Le salariat se définit en effet comme un contrat entre un employeur, qui possède les moyens de production, et un travailleur, qui vend sa force de travail et l’exerce selon des modalités déterminées par l’employeur, comme les conditions et l’organisation du travail. Comme ce contrat implique l’assujettissement du travailleur, l’employeur a pu « s’emparer du travail » en le soumettant entièrement à sa volonté : il l’a déterminé unilatéralement selon des normes de production qui ne servent que le capitalisme. Les travailleurs sont sous pression constante pour augmenter leur productivité. Les consommateurs se voient imposer des produits à durée de vie limitée pour faire augmenter leur consommation. L’environnement est toujours plus dégradé par la surproduction et la surconsommation. Pour Linhart, c’est la subordination au cœur du salariat qui rend possible cet accaparement du travail par l’employeur.
Linhart propose une histoire des techniques d’organisation du travail par lesquelles le patronat et le management ont fait accepter aux travailleurs ce lien de subordination, incarné juridiquement par le contrat de travail, qui leur demande de s’assujettir à leur volonté. La diversité de ces moyens tente de masquer leur but de domination : le management se donne des airs bienveillants et humanistes pour augmenter l’adhésion subjective des travailleurs. De cette recherche descriptive, Linhart tire une conclusion prescriptive. Elle dénonce la relation de subordination au cœur du salariat, pour envisager un autre rapport de travail, libéré de cette subordination. Le concept de subordination n’est cependant pas analysé en propre. Elle cite en introduction, en note, la Cour de cassation qui définit, le 13 novembre 1996, le lien de subordination au travail comme « caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné », sans la commenter ou se positionner à son égard. Dans ses analyses, le concept prend un sens à la fois juridique et philosophique. Dans le premier cas, on peut le penser comme la relation résultant du contrat de travail salarié, dans le second, comme une relation de dépendance d’un terme inférieur à un terme supérieur dans un système hiérarchique, mais Linhart n’explicite jamais son choix. Or, préciser l’extension du concept de subordination est nécessaire pour comprendre son projet d’un salariat non subordonné. Nous commenterons l’analyse de Linhart, puis nous étudierons la possibilité d’un salariat non subordonné à travers le projet de l’autogestion productive, que Linhart n’évoque pas, alors qu’il paraît répondre aux critiques qu’elle adresse au salariat subordonné.
L’histoire des techniques d’organisation du salariat : métamorphoses de la subordination au travail
Linhart commence son histoire des techniques d’organisation du travail par la genèse du taylorisme. Dans le contexte d’un rapport de force favorable aux ouvriers de métier de l’industrie, qui se mettent en grève pour revendiquer l’amélioration de leur salaire et de leurs conditions de travail, Taylor constate la dépendance du capitaliste à l’égard de ses travailleurs, qu’il juge contre-productive : ils définissent les règles de travail, contrôlent l’embauche et organisent le travail au sein de l’unité de production. Taylor déplore leur « flânerie systématique » parce qu’ils peuvent travailler à un rythme modéré, pour respecter les règles de métier comme pour ajuster leurs efforts au tarif auquel ils sont payés. Dès lors, l’organisation du travail qu’il invente vise à déposséder les travailleurs de leur pouvoir sur la production pour les soumettre entièrement aux ordres du capitaliste, qui organise unilatéralement la production avec le concours d’ingénieurs. Taylor exacerbe la subordination juridique du salariat en construisant une organisation du travail où le travailleur doit respecter complètement les ordres de celui qui l’emploie. Il réifie cette autorité hiérarchique dans un système technique qui semble incontestable : elle s’abstrait d’un corps individuel, celui du contremaître ou du patron, pour devenir celle de la machine elle-même, alors que les cadences, le rythme et la distribution du travail restent déterminés par la direction. Cette double technique taylorienne – amplifier la subordination et la masquer – inspire ensuite toute l’histoire des techniques d’organisation. Le but de Taylor n’est pas seulement technique et économique mais aussi politique et social : mater les ouvriers et les déposséder de leurs pouvoirs.
Linhart n’évoque pas les résistances ouvrières au taylorisme, alors que des syndicats ouvriers américains l’ont vivement dénoncé, notamment les syndicats de métier1. Ils ont même poussé Taylor à se justifier face à une commission d’enquête de la Chambre des Représentants en 19122, mais les gains de productivité utiles à l’industrie de guerre ont fait taire les premières critiques. Pour Linhart, cette perte de pouvoir ouvrier est acceptée parce qu’elle est compensée par les prétendus progrès du taylorisme. Il s’agirait autant de progrès économique, comme les gains de productivité, qui font, en plus, baisser les prix des produits pour les consommateurs, que de progrès démocratique parce qu’il rend le travail accessible à tous, sans formation préalable et sans cooptation avec les syndicats qui géraient jusqu’alors l’embauche. C’est surtout un progrès politique pour les capitalistes, qui détruisent le pouvoir des salariés sur la production et leurs capacités de contestation. Mais pas entièrement, note Linhart, parce que même le travail le plus rigoureusement organisé a besoin d’une implication subjective des salariés, qui s’engagent pour bien réaliser leur travail. Elle reprend la distinction entre travail réel et travail prescrit issue de l’ergonomie. Le travail prescrit correspond à ce qui est exigé par les employeurs, ingénieurs et managers, selon la formalisation des tâches et les résultats attendus, tandis que le travail réel désigne tous les ajustements, non prévus par l’organisation formelle du travail, que le travailleur doit opérer pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Sans cette implication subjective dans le travail réel, la production achoppe sur mille détails non pris en compte par les ingénieurs, ce que manifestent les grèves de zèle en temps de protestation. Dans le contexte tayloriste, Linhart interprète cette implication subjective d’application comme une protestation contre les ordres qui paraissent absurdes et comme une réappropriation personnelle du travail. En faisant bien leur travail alors qu’ils transgressent les prescriptions, les travailleurs montrent qu’ils connaissent mieux leur travail que la hiérarchie, ce dont ils tirent une fierté. Cela engendre un phénomène paradoxal qu’elle appelle la « malédiction » des travailleurs : ils ressentent la subordination dans leur travail mais, pour la compenser affectivement et pour satisfaire leurs besoins de reconnaissance et d’épanouissement à l’égard du travail, ils s’y investissent malgré tout corps et âme, ce qui rend possible la production et renforce leur domination sans toucher au statu quo.
Les principes tayloriens sont peu critiqués au début du XXème siècle en raison d’une acceptation du productivisme, comme l’a déjà montré Bruno Trentin en 2012 dans La cité du travail3, que Linhart ne cite pas. Même dans la gauche révolutionnaire, les syndicats et partis prennent les forces productives en l’état, puisque leur développement intensif est perçu comme une étape nécessaire pour faire advenir la révolution prolétarienne. Comme l’analyse en détail son frère Robert Linhart dans Lénine, les paysans, Taylor4, l’organisation taylorienne du travail est promue par Lénine pour faire augmenter la productivité et libérer du temps hors du travail, destiné à la politique. Certes, cette position productiviste, discutable dans le détail, ne fait pas l’unanimité dans le parti bolchevik, mais elle façonne durablement les pratiques. Quand le taylorisme se répand dans l’entre-deux-guerres, les syndicats et partis politiques de gauche dominants des démocraties occidentales dénoncent l’appropriation capitaliste des gains de productivité et revendiquent leur partage entre capital et travail, mais critiquent peu l’organisation du travail en elle-même. Alors que pour Robert Linhart et Bruno Trentin, cette absence de critique est due à une acceptation tacite de l’organisation hiérarchique du travail, en raison des gains de productivité qu’elle engendre, Danièle Linhart émet une hypothèse supplémentaire. L’organisation taylorienne du travail n’aurait pas été critiquée parce qu’il n’y avait pas de modèle alternatif consensuel pour tous les ouvriers. Linhart néglige à ce sujet les critiques virulentes de l’organisation capitaliste du travail des années 1960, qu’on trouve notamment dans l’opéraïsme italien du Quaderni Rossi comme dans la deuxième gauche de la CFDT et du PSU, qu’incarne par exemple en partie André Gorz dans Critique de la division du travail. Ces courants critiques n’ont cependant pas réussi à transformer durablement l’organisation du travail. Pour Linhart, transformer le contenu et l’organisation du travail dans les Trente Glorieuses aurait impliqué de diviser autrement le travail et donc de transformer les positions professionnelles des militants. Or, elles fondent leur identité professionnelle. Cela aurait risqué d’opposer certaines catégories de travailleurs entre elles, ce que voulaient éviter les militants syndicaux, pour ne pas diviser le corps professionnel militant : la boîte de Pandore de la discussion sur l’organisation du travail ne s’est donc pas ouverte, renforçant sa forme hiérarchique tayloriste.
Dans les termes du compromis fordiste de l’après-guerre, l’aliénation au travail semble compensée par une hausse du pouvoir d’achat, la découverte du plaisir de la consommation et l’accès aux congés payés. Par la consommation, le travailleur a l’impression de quitter la misère et l’insécurité économique tandis que le capitalisme étend sa domination à la sphère de la consommation et donne l’impression d’une liberté de choix alors qu’elle est largement influencée par le marketing et la publicité. Mais Linhart n’explique pas le passage de cette situation de domination par la consommation à l’explosion de mai 68 où éclate le « ras-le-bol ouvrier » qui refuse le monde du travail taylorien et ses minimes compensations. Pourquoi, à ce moment-là, les travailleurs revendiquent-ils une autre organisation du travail ? Pour André Gorz par exemple, qui commente les mutations du prolétariat de 1960 à 2000, cette prise de conscience est le fruit d’une expérience de liberté hors du travail, permise par les congés payés et la réduction du temps de travail, qui a rendu les travailleurs plus exigeants vis-à-vis de leurs conditions de travail5. Pour lui, le temps libre n’est pas seulement du temps dominé par la consommation capitaliste, mais aussi l’occasion de vivre autrement que comme un travailleur. L’expérience hors de la discipline du travail a fait naître leurs revendications d’autonomie au travail, d’autant plus fortes chez les générations de travailleurs plus éduqués, au cœur de mai 68 français et de l’opéraïsme italien.
De quelque manière qu’on les explique, des revendications d’autonomie au travail naissent dans les années 1960. Il faut alors une réponse du patronat. Linhart montre son tour de force : il semble prendre acte de ces exigences d’autonomie, mais il amplifie en fait la subordination des travailleurs, par l’individualisation du travail, qu’il déploie dès les années 1980. Le travail n’est plus organisé et perçu comme une activité collective où se nouent des solidarités mais comme une activité individuelle, qui s’inscrit dans une carrière singulière, où les efforts variables doivent être récompensés par une rémunération individualisée. La direction propose une réponse aux revendications d’autonomie des travailleurs qui sert ses propres intérêts, parce qu’elle organise une compétition permanente entre les salariés. Cela renforce le lien de subordination tout en désamorçant toute possibilité de contestation parce que les travailleurs perdent leur conscience collective de classe, leur solidarité et leur envie de lutter ensemble. Conscient qu’il faut le consentement et l’adhésion des travailleurs pour le succès de l’entreprise, le management se targue de principes humanistes et inclusifs alors qu’ils ne servent qu’à faire adhérer le travailleur au projet de l’entreprise, pour qu’il augmente son dévouement à l’entreprise et sa productivité. Le lien de subordination est personnalisé et invisibilisé, ce qui engage subjectivement le travailleur au point de se sentir mis en cause dans sa personne même, et non plus dans son identité professionnelle. Tous les problèmes de management, les risques psycho-sociaux ou les forts turn-over sont attribués à des problèmes de « comportement » plutôt qu’à une organisation globale du travail. Les changements systématiques d’organisation déterminés par la direction visent à rendre l’expérience professionnelle obsolète, pour saper la confiance des salariés dans leur travail et leurs compétences et étouffer ainsi toute possible revendication. Linhart remarque, sans le justifier plus avant, que cette stratégie triomphe aussi parce que les syndicats n’arrivent plus à proposer de stratégie collective face à cette individualisation du travail, pour répondre à la fois aux aspirations des travailleurs tout en évitant leur mise en concurrence. Divisés, ils ne parviennent pas à s’opposer massivement à l’offensive patronale.
Cette mise en concurrence ne touche pas que les travailleurs en bas de la hiérarchie. Même les cadres dirigeants, catégorie socio-professionnelle d’élite, voient leur travail encadré par des méthodes d’autant plus humiliantes qu’ils se croient au-dessus de tout ça : un travail normé, encastré, contrôlé par des contraintes procédurales et des évaluations infinies, soumis à une pression des résultats, tout comme une réorganisation spatiale des espaces de travail pour discipliner les corps dans les open-space. Alors qu’ils croient leur carrière acquise, ils découvrent l’insécurité en se faisant licencier, à 55 ans, au nom d’une envie de sang neuf dans l’organisation. Ils vivent la contradiction analysée par Alain Supiot, citée par Linhart, entre la subordination d’une part, en tant que salariés, et la responsabilisation par des objectifs à atteindre en tant que cadres, alors que les méthodes et procédures leur sont imposées. Sur le plan méthodologique, on peut s’étonner que le patronat, la direction et le management soient souvent associés sans distinction par Linhart et considérés comme un même milieu de prise de décision, présupposant une homogénéité dans leurs intérêts et leurs pratiques, alors même que les statuts et les fonctions des uns et des autres sont en fait différents, surtout dans le capitalisme actionnarial où même l’équipe de direction est soumise à des impératifs de rentabilité dictés par des actionnaires auxquels elle rend des comptes. Il aurait été pertinent d’utiliser les recherches sur le vécu de la subordination au sein même des classes dirigeantes. On peut ici citer les récents ouvrages de Gaëtan Floccon, Des dominants très dominés. Pourquoi les cadres acceptent leur servitude, sur les structures objectives de domination des cadres d’entreprise et leur consentement à cette domination, celui de Sébastien Stenger, Au cœur des cabinets d’audit et de conseil. De la distinction à la soumission qui décrit les mécanismes utilisés dans ces milieux professionnels d’élite économique pour soumettre leurs salariés à des impératifs de productivité, ou encore celui de Vincent Petitet, Enchantement et domination : le management de la docilité dans les organisations, analyse d’un cabinet de conseil de qui montre la façon dont la gestion symbolique à des fins de communication sert de contrôle disciplinaire au cœur de l’organisation.
Ce que dénonce Linhart, c’est la soumission psychologique du travailleur à son organisation qui résulte de la subordination juridique du contrat de travail : le travailleur adhère subjectivement aux objectifs de son organisation et se met tout entier à son service, au détriment parfois de sa santé mentale et physique. Elle réfute toutes les conceptions dites humanistes ou positives d’un management qui tiendrait compte des singularités de chaque travailleur pour œuvrer à son épanouissement au travail. Le travailleur n’est qu’un moyen au service des fins de l’organisation et toute inadéquation à cette fin peut compromettre leur relation. Pour Linhart, le seul but du management est
« toujours d’obtenir [des travailleurs] qu’ils renoncent à leurs propres valeurs morales, citoyennes et professionnelles pour ne travailler qu’en fonction des critères d’efficacité décidés en dehors d’eux par leurs employeurs. Qu’ils acceptent de consacrer leur temps, leur énergie, leurs efforts pour aligner leur travail sur les seules finalités de ceux qui les paient, quand bien même ces finalités leur imposent une mobilisation d’eux-mêmes démesurément exigeante, quand bien même elles conduisent à flouer les consommateurs, usagers ou clients, quand bien même elles contribuent à compromettre à terme l’avenir de l’humanité » (p. 21-36).
Le management prétend s’adapter aux revendications des salariés et aux impératifs économiques de la concurrence. Mais s’il change sans cesse de méthode, c’est en fait pour désamorcer toute critique des précédentes, les nouvelles promettant toujours monts et merveilles. Pour Linhart, ces métamorphoses des pratiques du patronat et du management témoignent surtout d’une quête obsessionnelle de légitimité face à la montée de la contestation de leurs méthodes. Toutes ces techniques de management ne servent qu’à renforcer la soumission subjective des travailleurs de plus en plus isolés en diminuant leur capacité de contestation. Même l’idéal de bonheur au travail est utilisé pour faire adhérer le salarié aux impératifs de productivité de l’organisation : les chief happiness officers servent à développer la capacité de résilience des salariés pour qu’ils puissent résister aux difficultés, tout en s’adaptant sans cesse aux exigences et défis pour mieux s’aligner sur les valeurs de l’entreprise.
Linhart analyse ensuite en détail les pratiques qui se présentent comme novatrices pour montrer qu’elles ne changent rien aux rapports de force consubstantiels au salariat : l’ « intrapreneuriat », économique ou social, et l’ « entreprise libérée ». Le premier, néologisme issu du management, désigne, dans sa version économique, une démarche interne où des salariés s’associent pour créer, au sein de leur entreprise, une structure organisationnelle capable de développer un procès précis, pour le réaliser de façon plus souple : elle diffuse une culture de la prise de risque individuelle et des résultats pour évaluer le succès du projet. Pour Linhart, elle ne sert qu’à instiller une relation contractuelle de droit commercial au sein de la condition salariale, sans remettre en cause le fondement du contrat de travail qu’est le lien de subordination. La version sociale consiste dans la réponse de l’entreprise à une demande de sens des salariés par des congés solidaires et humanitaires financés par l’entreprise – qui en déduit 60 % de ses impôts en tant que don caritatif. Ce faisant, elle reconnaît que ses salariés ne peuvent satisfaire leurs attentes de sens et leurs valeurs dans leur travail. Elle leur fait croire que ce sont quelques stages ponctuels qui les soulageront, sans remettre en cause son propre fonctionnement.
Le cas des entreprises libérées est plus longuement étudié, à travers des analyses de cas et des discours de ses dirigeants. Cette forme d’organisation prétend émanciper les salariés des contraintes hiérarchiques et bureaucratiques, en leur faisant confiance pour qu’ils puissent révéler leurs capacités, mais toujours au service de l’organisation. Cela se traduit notamment par une suppression des cadres intermédiaires, sans que les salariés ne voient leur fonction et rémunération revalorisées. Linhart constate que la cause de l’entreprise reste déterminée unilatéralement par un leader qui essaie ensuite de persuader ses salariés. La structure du pouvoir et le partage du capital ne sont pas questionnés : les salariés ne peuvent pas mettre en question les choix de la direction qui modèlent la finalité du travail ou ses critères d’évaluation. Les salariés sont seulement plus libres de co-déterminer les moyens d’atteindre les objectifs de productivité fixés par l’entreprise et le marché : « La mise des salariés en prise directe avec les clients est un des moyens d’exercer une pression en dehors de la ligne hiérarchique. Le marché ou le client sont ceux qui dictent directement le niveau de productivité nécessaire » (p. 183-220). Ce qui compte, comme l’admettent les têtes pensantes de cette forme d’organisation, à l’instar de Michel Hervé, c’est le sentiment de liberté chez les salariés, et non leur liberté réelle, parce que ce sentiment suffit à renforcer leur bien-être et à les inciter à davantage s’engager subjectivement dans l’entreprise et à son service.
L’enjeu normatif : supprimer la subordination au cœur du salariat
Après cette analyse descriptive, qui rassemble des recherches contemporaines et ses recherches des années 1970 commentées à travers cet angle, Linhart présente en conclusion sa visée prescriptive. Pour elle, toutes ces nouvelles formes d’organisation évitent de questionner le vrai problème : le lien de subordination au cœur du salariat. C’est lui qu’il faudrait supprimer, parce qu’il est le fondement juridique qui permet à l’employeur de s’emparer unilatéralement du travail. Elle raconte les hostilités qu’elle rencontre quand elle le suggère dans des discussions avec des syndicalistes, des inspecteurs du travail ou des avocats de droit social : peut-on remettre en question la subordination au cœur du salariat alors même que la protection sociale s’est construite sur le salariat ? On lui répond que les salariés ont des droits parce que l’employeur est responsable et garant de leur santé physique et mentale, en raison du lien de subordination qui les unit. Pour elle, ce n’est pas un problème fondamental : les droits et mécanismes de protection liés au travail ne sont pas une contrepartie dédommageant une subordination salariale consentie qu’il faudrait conserver comme telle, mais une contrepartie reconnaissant l’engagement existentiel des travailleurs dans leur travail, qui leur octroie alors des droits sociaux. Les droits sociaux ne sont pas les dommages et intérêts de la subordination à l’employeur, mais des droits des travailleurs qui resteraient légitimes même si la subordination au cœur du salariat était supprimée. Dès lors, la protection sociale serait compatible avec un travail salarié non subordonné parce qu’elle se fonde sur des droits sociaux.
La subordination au cœur du salariat est d’autant plus problématique à ses yeux qu’elle implique une obéissance incompatible avec un idéal de démocratie fondée sur le pouvoir de citoyens libres et réfléchis :
« Est-il légitime de demander aux citoyens d’entrer dans une relation d’obéissance dès lors qu’ils s’engagent à travailler pour parvenir à satisfaire leurs besoins et contribuer à satisfaire ceux d’autrui ? Ne sommes-nous pas dans des démocraties politiques où nul n’est censé appartenir à quiconque ? Est-il réellement utile d’asservir les compétences, les connaissances et l’expérience des travailleurs à l’autorité d’une direction qui n’a le plus souvent pas l’expertise nécessaire ? De les soumettre à des directives et à des procédures concoctées à distance des réalités du travail concret ? De les assujettir à des finalités inscrites dans une rationalité ultralibérale, qui les pressurisent comme elles instrumentalisent les consommateurs et mettent en danger la survie de notre espèce sur cette planète ? » (p. 269-273)
C’est le lien de subordination lui-même qui empêche toute lutte autour des finalités et des modalités du travail. Le dépasser permettrait de se réapproprier la discussion sur la finalité du travail et sur son organisation : si le travail n’est plus déterminé unilatéralement par la direction, alors les salariés peuvent participer à l’élaboration du contenu de la production et de ses conditions de réalisation. Le contenu du travail serait moins soumis aux impératifs capitalistes de productivité et de hausse du taux de profit et pourrait être orienté en fonction de la valeur d’usage et des besoins réels auxquels la production sociale doit répondre. Néanmoins, elle n’envisage pas les modalités possibles d’une telle réappropriation démocratique du travail, alors même que c’est un sujet de plus en plus débattu en sociologie et philosophie du travail, comme en témoignent par exemple les récents ouvrages d’Alexis Cukier, Le Travail démocratique et de Julie Battilana, d’Isabelle Ferreras et de Dominique Méda, Le Manifeste travail : démocratiser, démarchandiser, dépolluer. Nous voulons étudier à présent une piste pour un tel projet, l’autogestion productive.
L’horizon d’un salariat non subordonné : l’autogestion ?
Linhart nous lègue une question radicale, qu’elle a le mérite de poser : peut-on envisager un salariat sans subordination ? Autorisons-nous à prolonger sa réflexion en étudiant le cas de l’autogestion, qui semble à cet égard crucial et qu’on s’étonne de ne pas retrouver dans l’ouvrage. L’autogestion se présente en effet comme une tentative de dépasser la subordination au cœur du salariat, en soumettant les salariés à leur volonté générale plutôt qu’à des ordres déterminés extérieurement par une direction. Cette absence est d’autant plus étonnante que le nombre de SCOP explose depuis quelques décennies en France, passant de 650 en 1979, 1300 en 1985 à 3439 en 2019, qui font travailler plus de 63 000 salariés. Se développent aussi, très récemment, les recherches historiques et sociologiques à leur sujet, sur l’histoire de l’idée d’autogestion et sur diverses pratiques d’autogestion dans les milieux professionnels, de consommation et d’habitat6. Cela donne de la matière pour discuter précisément des pratiques salariales et des métamorphoses du lien de subordination dans ce contexte spécifique. L’autogestion correspondrait-elle à cette forme plus démocratique de salariat exempt de la subordination que Linhart recherche ? Même si c’est un thème à la mode, on peut en fait en douter, ce qui expliquerait le silence de Linhart à son égard.
Arrêtons-nous un instant sur le concept d’autogestion, pour voir s’il correspondrait à un travail non subordonné. L’historien Frank Georgi en fait l’archéologie. Dès le XIXème siècle, le désir de contrôler la production fait partie de l’utopie émancipatrice du travail, au cœur de la lutte quotidienne pour l’autonomie des groupes ouvriers dans l’unité de production. Proudhon mobilise le concept d’autogouvernement (self-government) incarné dans les premières coopératives de 1830. Il est repris ensuite par la commune de Paris et les fondateurs des Bourses du travail. Malgré l’usage de concepts différents, l’idée des conseils ouvriers se diffuse dans certains courants marxistes minoritaires au début du XXème siècle. C’est le cas en Allemagne, par le biais de Rosa Luxembourg, mais aussi en Hongrie, en Italie et en Ukraine. Ces marxistes y voient une institution de démocratie ouvrière directe. Celle-ci s’incarnera dans les soviets de 1917, l’Espagne anarchiste pendant la guerre civile, puis l’Algérie de Ben Bella, le Chili d’Allende et l’Argentine après la crise de 2001. Le concept spécifique d’autogestion apparaît sporadiquement dans la première moitié du XXème siècle, avant d’être massivement brandi par les communistes yougoslaves, pour désigner la gestion ouvrière des entreprises dans la Yougoslavie titiste : ils traduisent en russe la notion de self-government, qu’utilisait Bakounine. En France, l’idée est reliée à trois concepts : le contrôle par les travailleurs de la production, la pratique démocratique autonome et l’autogestion des conditions de vie sociales par les citoyens.
L’histoire des débats français sur l’autogestion au sein des partis et des syndicats est tumultueuse et porte sur des domaines variés. Nous nous concentrons ici sur son idéal et ses pratiques au niveau de la production, puisque c’est là que l’autogestion répond aux critiques que Linhart adresse à la subordination salariale. Nous nous intéressons à la forme la plus radicale de l’autogestion, à savoir la possession du capital par les travailleurs. Nous excluons les formes d’autonomie opérationnelle et de gestion que souhaitent les modernistes du PS dans les années 1970 parce qu’ils ne transforment pas le rapport entre capital et travail.
L’autogestion entend satisfaire les aspirations des travailleurs à plus d’autonomie et de démocratie au travail : ceux qui agissent prennent les décisions concernant le travail, sans intermédiaires. Le projet productif autogestionnaire soulève moultes questions : comment organiser la production et le travail, faut-il traduire les différences de qualification et de compétences en différences de rémunérations, comment prémunir l’émergence de nouvelles dominations, comment décider des orientations stratégiques en tenant compte de la diversité des attentes des travailleurs ? Les pratiques autogestionnaires visent à montrer qu’une autre organisation du travail est possible. Dans les cas de luttes, comme celle de Lip à Besançon ou celle de Pil à Cerizay, c’est une activité qui accroît la capacité de résistance des grévistes parce qu’elle leur assure un revenu. L’autogestion peut s’incarner dans la forme juridique d’une SCOP, où le capital est détenu par les travailleurs, qui prennent collectivement les décisions quant au contenu et aux conditions de la production : il n’y a donc plus de distinction entre un patronat et une direction qui déterminent les conditions de travail et des salariés qui y obéissent, donc plus de subordination juridique à un tiers. L’autogestion incarnée dans la SCOP supprime donc la subordination salariale mais parvient-elle pour autant à supprimer tout rapport de force entre les salariés ?
La SCOP reste dépendante du marché capitaliste : il faut produire et vendre à profit. Si ces coopératives sous contrôle des travailleurs peuvent constituer un modèle alternatif à l’organisation du travail capitaliste, elles ne permettent pas de dépasser le capitalisme lui-même parce qu’elles doivent toujours survivre dans un marché concurrentiel par la vente de marchandises rentables. Face à ces impératifs de productivité et de rentabilité, l’autogestion ne parvient pas toujours à changer les pratiques capitalistes de production et les souffrances au travail qu’elles engendrent. Dans son étude sur les usines récupérées de l’Argentine après la crise de 20017, le sociologue Maxime Quijoux montre que les ouvrières de l’usine autogérée Brukman reproduisent en fait des règles de contrôle du travail, de pression managériale et de hiérarchie similaires aux pratiques capitalistes, dont elles ont hérité et qui leur semblent légitimes pour faire face aux difficultés économiques qu’elles rencontrent. Quijoux montre aussi, dans son étude d’une imprimerie francilienne autogérée8, que des rapports de force entre les travailleurs se recréent, en fonction de la hiérarchie des compétences et de l’expérience antérieure de gestion des ouvriers syndiqués. L’interprétation du projet coopératif et l’adhésion subjective qui en découlent dépendent des différences de position des travailleurs, partisanes comme professionnelles.
L’autogestion dépasse donc la subordination juridique du contrat de travail salarié capitaliste, qui repose sur la distinction stricte entre employeur et salariés, mais ne suffit pas pour supprimer les impératifs économiques liés à l’organisation marchande de la production capitaliste, ni certains rapports de force présents au travail. Elle peut même servir de pilule pour faire avaler une situation économique. L’historien Guillaume Gourgues9 montre ainsi que la solution de reprise de la production a été proposée par l’Etat aux salariés de Lip pour nier sa responsabilité dans la politique économique qui a permis l’appropriation des capitaux par des investisseurs étrangers puis les licenciements. Les salariés de Lip demandent la poursuite de leur activité sans licenciement. Quand ils refusent, à plusieurs reprises, la reprise sous forme de coopérative, l’Etat déclare alors « avoir tout fait pour eux ». Pour Gourgues, si l’autogestion est parfois suggérée par le patronat et les responsables politiques comme la solution de reprise de l’unité de production, c’est pour éviter de questionner les politiques économiques globales qui mènent aux difficultés économiques et aux licenciements qui en résultent. Face aux licenciements, on ne permet aux travailleurs que de sauver partiellement leur emploi dans un format entrepreneurial qui ne change pas le fonctionnement de l’économie de marché. Gourgues invite alors à se méfier du danger de privilégier l’expérience autogestionnaire en elle-même, sans considérer les rapports de force au sein de l’économie capitaliste, qui conditionnent les possibilités de luttes pour les salariés. Se concentrer sur l’organisation interne du travail, comme le font les partisans de l’autogestion et Linhart, risque de faire oublier les rapports de force entre travail et capital liés à la situation macro-économique et les luttes qui se jouent au niveau politique, par-delà l’unité de production et son organisation. C’est une limite commune au projet autogestionnaire et à l’ouvrage de Linhart que nous voulons souligner ici : c’est l’organisation capitaliste du travail, de la production et de son marché, qu’il faut dépasser si on veut espérer réduire la subordination des travailleurs, si ce n’est la supprimer tout à fait.
Conclusion
Linhart présente une critique stimulante du lien de subordination au cœur du salariat et des formes d’organisation du travail qui tentent de le masquer pour le faire insidieusement accepter. Elle diffuse un esprit de soupçon envers toutes ces pratiques qui prétendent transformer le travail pour mieux soumettre le travailleur aux impératifs de l’organisation, esprit de soupçon bienvenu au milieu du matraquage idéologique à la gloire du travail propre à la start-up nation. L’ouvrage permet de soulever des questions cruciales sur l’ampleur de la subordination au travail et sur les possibilités de son dépassement, même s’il n’offre pas toutes les solutions pour y répondre.
*
Photo : « After Work I. », via europeana.
à voir aussi
références
| ⇧1 | Rolande Pinard, « De la démocratie syndicale en Amérique », in La révolution du travail : De l’artisan au manager. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2000. |
|---|---|
| ⇧2 | Frederick Winslow Taylor, Ce que Taylor dit de sa méthode, Clermont-Ferrand, Michelin, 1927. |
| ⇧3 | Bruno Trentin, La cité du travail, Paris, Fayard, 2012. |
| ⇧4 | Robert Linhart, Lénine, les paysans, Taylor, Paris, Seuil, 2010 [1976]. |
| ⇧5 | André Gorz, Adieux au prolétariat, Paris, Galilée, 1980. |
| ⇧6 | Isabelle Chambost, Olivier Cléach, Simon Le Roulley, Frédéric Moatty, Guillaume Tiffon (dir.), L’Autogestion à l’épreuve du travail, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2020 ; Frank Georgi, L’autogestion en chantier, Nancy, Arbre bleu, 2018 ; Frank Georgi (dir.) L’autogestion : la dernière utopie ? Paris, Publications de la Sorbonne, 2003. |
| ⇧7 | Maxime Quijoux, Néolibéralisme et autogestion. L’expérience argentine. Paris, IHEAL, 2011. |
| ⇧8 | Maxime Quijoux, Adieux au patronat, Vulaines sur Seine, Editions du Croquant, 2018. |
| ⇧9 | Guillaume Gourgues, « De l’autogestion au rapport salarial. Comprendre l’affaire Lip au-delà de ses mythes », in L’Autogestion à l’épreuve du travail, op. cit. |









