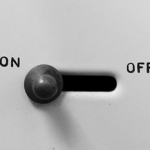L’Université marchandisée. Entretien avec Hugo Harari-Kermadec
Hugo Harari-Kermadec est économiste, enseignant à l’École normale supérieure de Paris-Saclay et chercheur à l’IDHES (CNRS). Il vient de publier Le classement de Shanghai. L’université ubérisée (aux éditions Le Bord de l’eau), dont nous avons publié un extrait.

Contretemps : Pourquoi avoir écrit le livre Le classement de Shanghai. L’Université marchandisée ?
Hugo Harari-Kermadec : C’est mon manuscrit d’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR). En économie, la plupart des collègues ne font qu’un recueil de leurs articles depuis la thèse, surtout les économistes du courant néoclassique, dominant. À l’inverse, avec l’Association Française d’Économie Politique, on défend l’idée d’écrire pour l’HDR, comme pour la thèse, un vrai manuscrit, avec un début et une fin, qui permette de développer une pensée un peu élaborée. Dans mon cas en plus, j’ai fait une thèse de maths, donc je n’avais jamais écrit un texte un peu long, c’était un peu un rite de passage vers les sciences sociales.
Pourquoi avoir choisi cette citation[1] du chapitre 3 du Capital en exergue d’un livre sur l’Université ?
Dans le livre, j’essaie de faire dialoguer le marxisme (ou en tout cas un certain marxisme) avec la sociologie de la quantification, qui utilise la mise en nombre du social comme révélateur de l’exercice du pouvoir. Cette citation du Capital me semble un bon point de départ : Marx nous dit que ce n’est pas la monnaie qui rend les marchandises « commensurables », c’est-à-dire mesurables dans la même unité, comparables quantitativement. On a à la fois cette question de la mise en nombre, à un niveau très profond (pourquoi peut-on mesurer ensemble les marchandises ?) et de la monnaie, l’économie, dont Marx nous dit qu’elle n’est pas première. C’est exactement ce qui me semble intéressant, et inquiétant, dans les transformations actuelles de l’Université : on n’a ni une privatisation des universités, ni une vente marchande des cours et des diplômes, pas encore ; mais on la prépare, en produisant les dispositifs nécessaires à cette commensuration qui permettra ensuite de faire du savoir une marchandise. Et Marx nous dit où chercher, c’est la suite de la citation : dans le travail. Il faut que le travail à l’Université soit du travail de même nature que celui du secteur marchand, un travail abstrait, c’est-à-dire économiquement identique à celui d’une boulangère, d’un livreur ou d’un responsable d’agence bancaire. Il gardera un aspect concret (de production et d’enseignement des savoirs) comme tout travail, mais il faut subordonner cet aspect concret à l’aspect abstrait, économique, celui qui permet de dégager des profits. Je défends que l’évaluation quantitative joue un rôle important dans cette subordination du travail concret à un travail abstrait qui colonise progressivement le monde universitaire.
En quoi le célèbre classement de Shanghai redéfinit-il l’activité au sein des établissements ?
En 2019, l’Université Paris-Sud (qui va devenir l’an prochain le cœur de l’Université Paris-Saclay) est devenue la première Université française au classement de Shanghai, devançant enfin Sorbonne Université (récente fusion de Paris IV et de Paris VI) qui occupait la première place nationale depuis des années. Pourquoi ? Grâce au recrutement d’un prix Nobel durant l’année 2018. Le classement de Shanghai est une évaluation quantitative tellement grossière que le recrutement d’un seul chercheur peut modifier significativement la position d’une Université comptant des milliers de salarié·e·s et des dizaines de milliers d’étudiant·e·s. évidemment, c’est avant tout pour monter dans le classement de Shanghai que la présidence de l’Université a fait ce recrutement et non pas pour renforcer un laboratoire sur un sujet déjà existant. On voit bien là que le travail concret de recherche devient secondaire par rapport à la logique quantitative, mais qu’on n’en est pas encore à une logique directement marchande : le chercheur en question ne permettra pas de vendre plus ou plus cher de l’enseignement ou de la recherche. Là où la marchandisation est plus poussée, comme en Angleterre ou aux États-Unis, le fait de monter dans le classement grâce au recrutement d’un prix Nobel permettrait d’augmenter les frais d’inscription et donc de rentabiliser commercialement ce recrutement. La direction d’un établissement peut alors estimer la rentabilité d’un tel recrutement, et la comparer avec celle d’une campagne de publicité ou de la rénovation d’un équipement sportif. C’est ce que j’appelle l’abstraction du travail académique, le fait de le rendre comparable et échangeable avec tout autre travail.
L’émergence du travail abstrait, qui relègue au second plan les aspects concrets du travail d’enseignement, de recherche, de gestion pédagogique ou de tous les métiers techniques et administratifs, est une redéfinition du sens l’activité. On fait toujours la même chose, mais plus pour la même raison : si on recrute un·e chercheu·se, il ou elle fera bien sûr de la recherche, mais la raison première de son recrutement, ce qui va devenir prioritaire au moment de faire un choix, c’est d’estimer combien ce recrutement rapportera. Là où la marchandisation est avancée, cette rentabilité passe par un vrai marché de l’enseignement supérieur où les classements jouent un rôle déterminant. En France, le classement de Shanghai est encore plus important puisque c’est le gouvernement qui attribue les fonds en mimant le marché avec des appels à projets concurrentiels (les fameuses politiques d’excellence) avec ce classement comme principal argument de légitimation. Pour obtenir les plus gros financements (les Idex de plusieurs centaines de millions d’euros), il faut faire la preuve qu’on sera très bien classé par le classement de Shanghai.
Tu consacres un chapitre entier à la nouvelle gestion publique dans l’enseignement supérieur : en quel sens l’autonomie des Universités (notamment à travers la fameuse loi LRU) est-elle liée à une concurrence évaluative ?
C’est un des principaux ressorts de ces appels à projets concurrentiels, qui simulent le fonctionnement marchand et le préparent. Si les Universités n’étaient pas autonomes, c’est le ministère qui serait responsable de bien les financer. Avec l’autonomie, on peut faire comme si chaque Université était responsable de sa situation : pas assez de financement pour assurer les enseignements dans de bonnes conditions, pour faire de la bonne recherche ? C’est parce que vous avez mal géré ou parce que vous n’êtes pas assez concurrentiel, vous avez échoué à obtenir des financements lors des appels à projets. Évidemment tout cela est biaisé parce qu’il n’y a pas assez de fonds pour tout le monde de toute façon et parce que les appels à projets tendent à concentrer les moyens : ce sont toujours les mêmes qui les remportent.
Dans d’autres travaux, plus statistiques, je m’intéresse à ce phénomène de polarisation du supérieur en France, qui a toujours existé, mais qui s’accentue depuis les années 2000. Les Universités les plus anciennes, dans les centres des grandes métropoles, fusionnent avec les grandes écoles et captent l’essentiel des financements concurrentiels. Par ailleurs, elles ont une population étudiante d’origine bien plus aisée que les autres Universités de banlieue ou de villes moyennes et prennent bien moins en charge la massification du supérieur. Les étudiant·e·s qui ont le plus de besoins d’accompagnement arrivent dans des Universités sous-financées, alors que celles et ceux qui sortent des meilleurs lycées, avec en plus un important capital culturel familial, bénéficient d’un enseignement dans des établissements bien mieux financés.
La polarisation se propage vers les échelles plus petites du labo ou de l’UFR, voire à l’échelle individuelle. Dans une Université « d’excellence » comme Paris-Saclay où je travaille par exemple, l’enseignement est plus facile puisque nos étudiant·e·s sont mieux préparés quand ils et elles arrivent, on a peu de tâches administratives et plus de financements pour la recherche. Du coup, évidemment, on fait plus de recherche, on remporte plus facilement des appels à projets, et donc on est mieux évalué. Cependant, c’est encore hétérogène : au sein même de Paris-Saclay, c’est plus facile dans les grandes écoles et au niveau master qu’en licence, et ça dépend aussi des disciplines. Mais même cette hétérogénéité-là est en train d’être institutionnalisée, l’Université Paris-Saclay crée une « école universitaire de premier cycle » pour y mettre les licences non sélectives, c’est-à-dire les étudiant·e·s d’origine populaire, dont le diplôme ne portera pas le label Paris-Saclay !
La dernière chose qui limite la polarisation complète du supérieur français, c’est le statut des enseignants-chercheurs : il faut de toute façon avoir fait une très bonne thèse pour être recruté et avoir une importante activité de recherche. Et vu le peu de postes qu’il y a, même dans la plus petite fac de province on recrute de très bons enseignants-chercheurs. On commence donc sa carrière à peu près au même niveau. C’est ce verrou du statut que la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, en préparation pour février 2020, va faire sauter. Il n’y aura presque plus de postes statutaires d’enseignant-chercheur, les salaires, les conditions de travail et même les règles seront différentes selon l’Université qui recrute. C’est ce que demandait explicitement le 20 novembre 2019 le PDG du CNRS, Antoine Petit, juste avant l’annonce de la loi par Macron : « Une loi ambitieuse, inégalitaire — oui, inégalitaire, une loi vertueuse et darwinienne, qui encourage les scientifiques, équipes, laboratoires, établissements les plus performants à l’échelle internationale »… et qui décourage les autres.
Il y a, actuellement, un mouvement étudiant assez important contre la précarité étudiante. Dans ce même chapitre sur la nouvelle gestion publique dans l’enseignement supérieur, tu reviens sur la théorie du capital humain comme évaluation de l’employabilité future des étudiants. Pourrais-tu revenir sur le rapport qu’entretient la théorie du capital humain avec la hausse des frais d’inscription dans l’Université ?
La théorie du capital humain date des années 1960 et elle permet aux économistes dominants de parler de l’éducation comme étant l’un des ingrédients de la croissance économique. Évidemment, l’éducation, en particulier du supérieur, a un rôle dans l’économie, au niveau agrégé de la société comme au niveau individuel. Chaque étudiant·e réfléchit à sa future situation professionnelle lors de ses choix d’études. Le problème, c’est de ne voir l’éducation que d’un point de vue instrumental, économiciste, uniquement comme un moyen pour accélérer la croissance économique. Dans ce cas, si la situation climatique nous impose d’arrêter la croissance économique, alors il faudrait aussi arrêter l’éducation ? Non, bien sûr, il y a beaucoup plus que des enjeux économiques, l’éducation vaut pour les individus, pour leur émancipation, indépendamment de leur productivité économique ; le savoir vaut pour lui-même, même lorsqu’il n’a pas application immédiate évidente.
Surtout, la théorie du capital humain a été reprise à partir des années 1980 par la banque mondiale et le FMI pour appréhender les dépenses d’éducation des pays endettés. Les politiques d’ajustement structurel avaient leur volet de réforme de l’éducation et la théorie du capital humain permet de justifier, du point de vue économique, que certaines dépenses d’éducation sont utiles, et d’autres non. Pour les pays plus riches, c’est l’OCDE qui fait des recommandations, moins contraignantes, à partir des années 1990 et surtout 2000, avec l’idée de l’économie de la connaissance. La recherche et l’enseignement supérieur sont censés être désormais les principaux moteurs de la croissance, à travers l’innovation. Donc il faut augmenter les dépenses d’éducation. Mais les dépenses publiques ou privées ? Si on pense en termes de droit à l’éducation, il faut bien sûr un financement public pour permettre l’accès à tous. Mais pour l’OCDE, c’est la théorie du capital humain qu’il faut suivre. Et elle prévoit que pour le supérieur (plus que pour le primaire et le secondaire) les gains de l’éducation soient surtout individuels : si je fais une année d’étude supplémentaire, j’aurai un meilleur salaire. Donc c’est à moi de payer le coût de cette année d’étude, puisque c’est moi qui y gagne. Tout cela est bien plus idéologique qu’empiriquement prouvé, mais l’intérêt principal c’est que ça permet de justifier la hausse des frais d’inscription.
Dans la logique du capital humain, on ne doit faire des études que si c’est individuellement rentable. Cela produit naturellement de la financiarisation, avec l’endettement étudiant pour payer les frais d’inscription, parce que c’est finalement la logique du banquier : pour décider de faire un prêt étudiant, ce n’est pas le contenu critique des cours qui compte, l’émancipation ou l’intérêt intellectuel ; c’est seulement la rentabilité future de cet investissement, c’est-à-dire la capacité à rembourser le prêt étudiant. Comme les hommes peuvent espérer de meilleurs salaires, c’est plus rationnel économiquement qu’ils fassent plus d’études et donc qu’on leur fasse un meilleur prêt étudiant. Les enfants des classes populaires et/ou de l’immigration, toutes les victimes de discriminations salariales devraient intégrer cette situation et l’anticiper en adaptant leurs études à cet horizon bouché. Et si elles ne le font pas, leur banquier le fera pour elles en refusant le prêt, et donc l’accès aux études supérieures là où les frais d’inscription sont assez élevés.
En quel sens la question des frais d’inscription à l’Université t’apparaît-elle avant tout comme idéologique ?
Pas de malentendu, la hausse des frais pose des problèmes matériels très graves à des millions de personnes dans les pays où ils sont élevés. L’endettement étudiant est absolument colossal aux États-Unis, mais aussi au Chili, et il plonge et maintient les anciens étudiants dans la grande pauvreté. Comme c’est le premier prêt, c’est par les études supérieures qu’on rentre dans le système financier et on commence sa vie active avec le fardeau de l’endettement. Cela contraint à incorporer la logique du capital humain : puisqu’on est endetté, il faut bien les rentabiliser, ces études. Et donc finalement, se comporter en homo-economicus, toujours faire ses choix suivant l’intérêt économique.
Dans les pays comme l’Australie ou l’Angleterre qui l’a copiée, et en France si on augmente les frais, l’endettement étudiant est géré par l’État, par le même service que les impôts. C’est ce qu’on appelle les prêts à remboursement conditionnel au revenu : je m’inscris à l’Université, l’État paie à ma place et inscrit une dette à mon débit, et je rembourserai quand j’en aurai les moyens, en même temps que l’impôt sur le revenu. Si je reste non imposable toute ma vie, je ne rembourserai jamais. Par contre, si jamais je sors un instant de la précarité, en fait c’est surtout l’État-prêteur qui y gagne en se remboursant directement sur mon revenu.
Donc en fait ça ressemble beaucoup à la situation française actuelle : c’est l’État qui paie, et ce sont les impôts qui financent ces dépenses publiques pour l’enseignement supérieur. Sauf qu’idéologiquement, ça rentre dans la logique du capitalisme financiarisé : c’est un prêt dans une logique de rentabilité, et non le financement public d’un droit à l’éducation. En prime, enfin pour les néolibéraux, d’un point de vue comptable, ça permet à l’État de ne pas compter le budget de l’enseignement supérieur comme une dépense publique, mais comme un investissement, donc ça ne compte pas dans les 3 % de déficit autorisé dans la zone euro. Mais surtout, contrairement à ce que dit la théorie du capital humain et les économistes mainstream, ça coûte moins cher aux riches : dans le cas d’un prêt étudiant, ils paient, très chers, leur éducation… mais seulement la leur. Dans le financement public tel qu’il existe actuellement en France, les riches financent par les impôts leurs études, mais aussi celles des classes populaires (même si elles n’ont pas suffisamment accès au supérieur).
Dans un texte publié dans la revue Période, le théoricien marxiste grec Panagiotis Sotiris écrit que : « La libéralisation de l’enseignement supérieur n’implique pas seulement une transformation de la gouvernance universitaire grâce à des méthodes et des structures managériales, mais implique également une nouvelle culture de la connaissance, de leur acquisition et de leur utilisation. Celle-ci permet d’éviter que la généralisation de l’enseignement supérieur n’altère la balance des forces sur le marché du travail et de garantir l’hégémonie capitaliste dans la production[2] », un aspect que tu évoques également dans ton livre. Pourrais-tu revenir sur le rapport entre la libéralisation de l’Université et cette « nouvelle culture de la connaissance » ?
Je pense que j’ai déjà répondu au-dessus, mais la référence à Sotiris est en effet très pertinente, la lecture de son texte sur Période en 2014 a participé à me décider à approfondir une approche marxiste de mon sujet de recherche, l’enseignement supérieur. Disons simplement que ce que je tente d’apporter, c’est comment les dispositifs techniques de mise en nombre donnent corps à cette « nouvelle culture de la connaissance ».
Pourrais-tu expliciter ce que tu entends par « subsomption du travail académique sous le capital » ?
L’idée c’est que l’Université s’est souvent pensée comme un extérieur à l’économie, mais aussi à l’État. Elle apparaît avant le capitalisme, et c’est une autonomie vis-à-vis du pouvoir d’État qui l’institue, au prix d’une allégeance à la papauté. Ensuite, avec les Lumières on a une nouvelle autonomisation, vis-à-vis de l’Église cette fois-ci. Cecilia Rikap a écrit un article sur Contretemps.eu sur cette histoire de l’Université.
Cette autonomie est une tendance fondatrice, mais elle est contrebalancée, suivant les périodes, par les impératifs politiques et économiques. Les liens avec le marché ne sont donc pas nouveaux et en France la recherche a pu être très directement liée à l’économie dans les instituts de recherche (INRA, INRIA, INSERM, CEA et, sans doute dans une moindre mesure, CNRS). L’intégration plus grande de ces instituts de recherche dans les Universités en ce moment n’est sans doute pas un hasard : dans la période actuelle, en plus d’une instrumentalisation plus complète du savoir au service de l’économie, on assiste à une tentative de confier directement au marché l’enseignement supérieur et la recherche.
La subsomption complète, c’est-à-dire l’intégration, de l’Université sous le capital, ce serait la privatisation pure et simple des facs. Ça existe, par exemple en Russie ou aux États-Unis, mais aussi en France, avec un espace d’enseignement supérieur à but lucratif, petit mais en croissance. Mais l’étape actuelle c’est plutôt celle de l’assimilation des mécanismes de marché, dans un fonctionnement financier où l’essentiel des fonds pour l’enseignement comme pour la recherche passe toujours par l’État.
Comme je l’expliquais au début, l’élément décisif c’est la forme que prend le travail. Je défends que l’évaluation quantitative du travail académique le transforme (change sa forme) en un travail producteur de plus-value. Et ça peut arriver indépendamment de la privatisation, soit parce que l’Université se comporte en entreprise publique (c’est ce qu’autorisent les dernières lois françaises, le PIA3), soit parce que ce sont des partenaires privés qui récupèrent cette plus-value. C’est particulièrement vrai pour la recherche, comme nous le développons avec Cecilia Rikap dans un article un peu postérieur à la rédaction du livre.
Quel lien fais-tu entre la précarité grandissante des personnes fréquentant l’Université (étudiant.e.s, enseignant.e.s non titulaires, bibliothécaires, etc.) et l’évolution de la marchandisation de l’Université ?
La précarité est un phénomène qui traverse le néolibéralisme et donc qui touche l’Université comme les autres secteurs. Les étudiant·es sont particulièrement touché·es parce que leur jeunesse est utilisée comme un prétexte à les surexploiter. Et dans le cas des personnels de l’Université, cette jeunesse se prolonge très longtemps, puisque les études sont très longues et l’entrée dans l’emploi stable toujours plus rare et plus tardive. Les financements sur projet de la recherche, donc à durée limitée, servent aussi de prétexte pour multiplier les contrats précaires. Mais même sans prétexte, on emploie des vacataires payé·es à l’heure (et avec un an de retard) pour faire des cours parfaitement pérennes. L’austérité budgétaire est l’explication principale de cette précarité à l’Université. L’État et les établissements publics ne sont pas soumis au même droit du travail que dans le privé et donc les conditions sont parfois pires.
Réciproquement, à force de subir une précarité durable, les travailleurs de l’Université peuvent voir comme une amélioration relative de prendre le statut d’auto-entrepreneur ou de passer par une entreprise pour effectuer en sous-traitance des tâches qui devraient être assurées directement par les Universités avec des personnels fonctionnaires. Et les rares titulaires, qui se retrouvent de plus en plus à assumer des tâches d’employeur et de manager, trouvent finalement pratique et cohérent de reproduire les fonctionnements du marché, puisque c’est sur ce modèle qu’ils obtiennent des financements, bien qu’ils soient publics.
Pour la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui devrait arriver en février 2020, le gouvernement fait directement le lien entre précarisation et financement public : d’après les rapports préparatoires, l’État serait prêt à augmenter d’un milliard le financement en échange « d’efforts » sur les statuts des personnels, en particulier avec la création d’un « CDI de chantier », c’est-à-dire un contrat précaire sans les primes de précarité ni les rares garde-fous encore existants et l’ajout d’une nouvelle étape avant le recrutement statutaire : après le master, après le doctorat, après le(s) post-doctorat(s), un tenure-track de 5 ou 6 ans avant la titularisation. Avec ça, on sera jeune jusqu’à 40 ans !
Notes
[1] « Ce n’est pas la monnaie qui rend les marchandises commensurables : au contraire. C’est parce que les marchandises en tant que valeurs sont du travail matérialisé, et par suite commensurables entre elles, qu’elles peuvent mesurer toutes ensemble leurs valeurs dans une marchandise spéciale, et transformer cette dernière en monnaie, c’est-à-dire en faire leur commune mesure. Mais la mesure des valeurs par la monnaie est la forme que doit nécessairement revêtir leur mesure immanente, la durée du travail. » (Le Capital, 1867, chapitre 3 : « La monnaie ou la circulation des marchandises).
[2] http://revueperiode.net/enseignement-superieur-et-classes-sociales-production-et-reproduction/